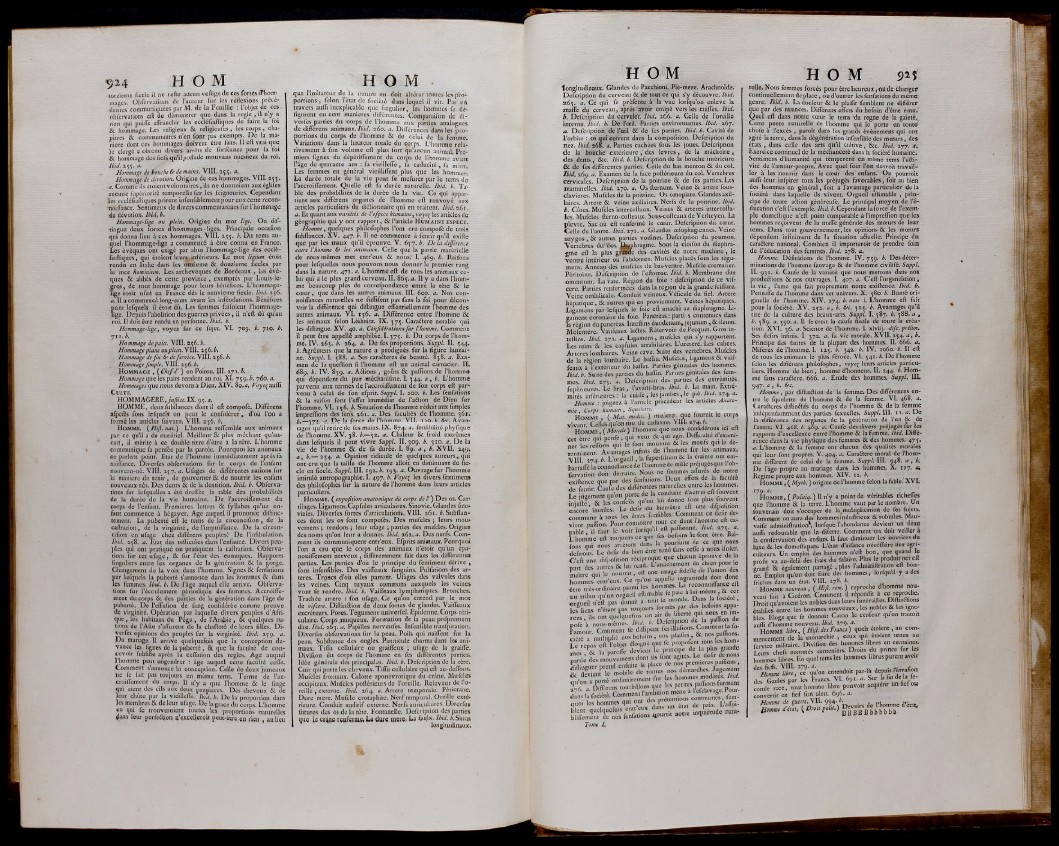
9*4 h O M
torzicme fieclc il ne rcfte aucun vertige de ces fortes tFhom'
mages, übfcrvations de l’auteur fur les réflexions précédentes
communiquées par M. de la Feuillie : l’objet de ces.
obfervations cft de démontrer que dans la regle , il n.y a
rien qui puifle affranchir les cccléfiaftiques de faire la foi
& hommage. Les religieux & religieuics, les corps., chapitres
& communautés n’en font pas exempts. D e la maniéré
dont ces hommages doivent être faits. Il cft vrai que
l e clergé a obtenu divers arrêts de furféance pour -la foi
8 c hommage des fiefs qu’ il poffede mouvans nuement du roi.
■Ibid. 253. a. .
Hommage de bouche & de mains. V I I I . aqq. a.
Hommage de dévotion. Origine de ces hommages. VIII. 233.
a. Comme ils étoientvolontaires, ils ne donnoient auxéglifes
aucune fupériorité temporelle fur les feigneuries. Cependant
Jcs cccléfiaftiques prirent infenfiblement pour eux cette recon-
moiffance. Sentimens de divers commentateurs fur l’hommage
t le dévotion. Ibid, b.
Hommage-lige ou plein. Origine du mot lige. On dif-
tàngué deux fortes' d’hommages - liges. Principale occafion
■qui donna lieu à ces hommages. V I I I . 233. b. D u tems auÏuel
l’hommage-lige a commencé à être connu en France.
>es évêques ont exigé par abus fhommagc-lige des ecclé-
ftaftiques, qui étoient leur^nféricurs. L e mot l'rnum étoit
rendu en Italie dans les onzième & douzième fiecles par
le mot hominium. Les archevêques de B ord eau x, les évêques
& abbés de cette p ro v in ce , exemptés par Louis-le-
g ro s , de tout hommage pour leurs bénéfices. L’hommage-
i ig e étoit ufité en France dés le neuvième fieclc. Ibid. 236.
a. Il a commencé long-tems avant les inféodations. Bénéfices
fiour lefquels il étoit du. Les femmes faifoient l’hommage-
ige. Depuis l’abolition des guerres pr iv ée s , il n’eft dû qu au
roi. Il doit être rendu en perfonne. Ibid. b.
Hommage-lige f v o y e z fur ce fujet. V I . 709. b. 710. b,
7 x 1 . b.
Hommage depa i« . VIII. a c6 .b .
Hommage plane ou plein. V III. 2 36. b.
Hommage de f o i 6* defervice. V III. a 36. b.
Hommage JImpie. VIII. a 56. b.
H o m m a g e , f C h e f d‘ ) en Poitou. III. 271. b.
Hommage que les pairs rendent au roi. X L 759. b. 7 6 0 . a.
Hommages q u e nous devons à Dieu. X IV . 80. a, V o y e[ aufti
C u l t e .
H OM M AG ER E , ju ß iee. IX. 9 3. a.
H OM M E , deuxfubrtances dont il efteompofé. Différons
ofpeéls fous lefquels on peut le confidérer, d’où l’on a
formé les articles fuivans. VIII. 236. b.
H om m e . ( H iß . nat. 1 L’homme reffcmblc aux animaux
par ce qu’il a de matériel. Meilleur & plus méchant qu’au-
curi, il mérite à ce double titre d’être à la tête. L ’homme
communique fa penfée par la parole. Pourquoi les animaux
ne parlent point. Etat de l’homme immédiatement après fa
naiüance. Diverfes obfervations fur le corps de l’enfant
nouveau-né. V I I I . 257. a. Ufages de différentes nations fur
la manière de ten ir , de gouverner 8c de nourrir les enfans
nouveaux-nés. D e s dents tic de la dentition. Ibid. b. Obfervations
fur lefquelles a été dreffée la table des probabilités
de la durée de la v ie humaine. D e l’accroiflement du
corps de l’enfant. Premières lettres 8c fyllabes qu’un enfant
commence h bégayer. A g e auquel il prononce dirtinc-
tement. La puberté eft le tems de la circoncifion, de la
caftration, de la v irginité, de l’impuiffance. D e la circoncifion
en ufage chez différens peuples; D e . l’infibulation.
Ibid. 258. a. Etat des terticules dans l'enfance. D iv er s peuples
qui ont pratiqué ou pratiquent la caftration. Obfervations
fur cet u fa g e , 8c fur l’état des eunuques. Rapports
finguliers entre les organes de la génération 8c la gorge.
Changement de la vo ix dans l’homme. Signes & fenfations
par lefquels la puberté s’annonce dans les hommes 8c dans
les femmes. Ibid. b. D e d’âge auquel elle arrive. Obfervations
fur l’écoulement périodique des femmes. Accrôiffe-
ment du corps 8c des parties de la génération dans l’âge de
puberté. D e l’effufion de fang confidérée comme preuve
de virginité. Opération par laquelle divers peuples d’A frique
, les habitans du Pégu , de l’Arabie, & quelques nations
de l’A fie s’affurent de la chafteté de leurs filles. D iverfes
opinions des peuples fur la virginité. Ibid. 259. a.
D u mariage. Il arrive quelquefois que la conception devance
les fignes de la puberté , & que la faculté de concevoir
fubfute après la ceffation des réglés. A g e auquel
l’homme peut engendrer : âge auquel cette faculté celle.
Comment s’annonce la conception. Celle de deux jumeaux
ne fe fait pas toujours en même tems. Terme de l’accroiffement
du corps. 11 n’y a que l’homme 8c le finge
qui aient des cils aux deux paupières. D e s cheveux 8c de
leur chute par la vieillefle. Ibid. b. D e la proportion dans
les membres 8c de leur ufage. D e la grâce du corps. L ’homme
en qui fe trouveroient toutes les proportions naturelles
ijïins leur pcrfcfljon u’cxccfteroit peut-être en rien , au lieu
H O M
que l’imitatéur de la nature en dort altérer'tôdtcs les pVofc
portions, félon l’état de fociété dans lequel il vit. Par un
travers aufti inexplicable que fingulier, les hommes fe •dé’-
figurent en cent maniérés différentes. Comparaifon de diverfes
parties du ‘corps de l’homme aux parties analogues
de différens animaux. Ibid. 260. a. Différences dans les proportions
du corps de l’homme & de celui de la femme.
Variations dans la hauteur totale du corps. L’homme relativement
à ion volume cft plus fort qu’auctm animal. Premiers
fignes du dépériffement du corps de l’homme avant
l’âge de quarante ans : fa vieillefle, la caducité, fa mort.
Les femmes en général vieilliffent plus que les hommes-.
La durée totale de la vie peut fe'mefurer par le tems de
l’accroiffement. Quelle eft fa durée naturelle. Ibid. b. Ta-
ble des probabilités de la durée de la vie. Ce qui appartient
aux différens organes de l'homme eft renvoyé auct
articles particuliers du diétionnaire qui en traitent. //>;</. 26 t.
a . Et quant aux variétés de Tefpcce humaine, voye{ les articles de
géographie qui y ont rapport, 8c l’article H um ain e espece.
Homme, quelques philofophes l’ont cru compofé de trois
fubrtances. X V . 447. b. Il ne commence à fentir qu’il exifte
que par les maux qu’il éprouve. V . 657. b. D e là différend
entre l'homme 6* les animaux. C e lle que la partie matérielle
de nous-mêmes met entr’eux & nous; I. 469. b. Raifons
pour lefqüelles nous pouvons nous donner le premier rang
dans la nature. 47 1. a. L ’homme eft de tous les animaux ce*
lui qui a le plus grand cerveau. II. 863. a. Il y a dans l’homme
beaucoup plus de correfpondance entre la tête 8c le
coe u r , que dans les autres animaux. III. 600. a. Nos con-
noiffances naturelles ne fufiifent pas fans la foi pour décou*
v rir la différence qui diftingue effentiellement 1 homme des
autres animaux. V I . 156. a. Différence entre l’homme &
les animaux félon Léibnitz. IX. 377 . Caraétere notable qui
les diftingue. X V . 40. à. Càhfidératïons fu r l'homme. Comment
il peut être appellé amphibie. I. 375. b. D u corps de l’hom*-
me. IV . 263. b. 264. a. D e fes proportions. Suppl. II. 544.
b. Agrémens que la nature a prodigués fur la figure humaine.
Suppl. I. 588. a . Ses caraéteres de beauté. 038. a. Examen
de la queftion fi l’homme eft un animal carnacier. IL
689. b. IV . 839. a . A étions , goûts & partions de l’homme
qui dépendent du pur méchanifme. I. 344. a y b. L ’homme
parvenu aux termes de l’accroiffement de fon corps eft par*
venu à celui de fon efprit.S u p p l. I. 200. b. Les fenfations
8c la raifon font l’effet immédiat de l’aétion de D ieu fur
l’homme. V I . 136. b. Situation de l’homme réduit aux Amples
impreflions des fens. 261. a . D e s facultés de l’homme. 361*
b .— 3 7 1 . -a. D e la force de l’homme. V I I . 120. b. & c . A v an tages
qu’il retire de fes mains. IX . 874. a . fenfibilité phyfique
de l’homme. X V . 38. ¿.— 3a. a. Chaleur 8c froid extrêmes
dans lefquels il peut v iv r e Suppl. II. 309. b. 310. a. D e la
v ie de l’homme & de fa durée. I. 89. a , b. X V I I . 249.
a , b.'— 254. a. Opinion ridicule de quelques auteurs, qui
ont cru que la taille de l’homme alloit en diminuant de Ac-
cle en fieclc. Suppl. III. 192. b. 193. a. Ou vrage fur l’homme
intitulé antropographie. I. 497. b. Voy c{ les divers fentimens
des philofophes fur la nature de l’homme dans leurs articles
particuliers.
H om m e. ( expofition anatomique du corps dcT") D e s os. C a r4
tilages. Ligamens. Capfules articulaires. Sinovie. G landes fi no*
viales. D iv er fes fortes d’articulatioris. V I I I . 261. b. Subftan-
ces dont les os font compofés. D e s mufdes ; leurs mou*
vemens ; tendons ; leur ufage ; parties des mufcles. Origine
des noms qu’on leur a donnés. Ibid. 262. a . Des nerfs. Comment
ils communiquent entr’eux. Efprits animaux. Pourquoi
l’on a cru que le corps des animaux n’étoit qu’un épa-
nouiffement nerveux » différemment fait dans les différentes
parties. Les parties d’où le principe du fendaient dérive »
font infenfibles. Des vaiffeaux fanguins. Pulfations des ar*
teres. Trpncs d’où elles partent. Ufages des valvules dans
les veines. Cinq tuyaux communs auxquels les veines
vont fe rendre. Ibid. b. Vaiffeaux lymphatiques. Bronches.
Trachée artere : fon ufage. C e qu on entend par le mot
de vifeere. Diftinélion de deux fortes de glandes. Vaiffeaux
excréteurs. Pores. Tégument univerfel. Epiderme. Corps réti-
culaire. Corps .muqueux. Formation de la peau proprement
dite. Ibid. 203. a. Papilles nerveufes. Infenfible tranlpiration.
Diverfes obfervations fur la peau. Poils qui naiffent fur la
peau. Subftancc des ongles, rannicule charnu dans les animaux.
T iffu cellulaire ou graiffeux ; ufage de la graiffe.
Divifion du corps de l’homme en fes différentes parties.
Idée générale des principales. Ibid. b. Defcription de la tête.
Cuir qui porte les cheveux. Tiffu cellulaire qui eft au-deffous.
Mufcles frontaux. Calotte aponévrotique du crâne. Mufcles
occipitaux. Mufcles poftérieurs de l’oreille. Releveur dc l’oreille
, externe. Ibid. 264. a. Artere temporale. Péricrane.
Dure mere. Mufcle crotaphitc. N e r f temporal. Oreille extérieure.
Conduit auditif externe. Nerfs auriculaires. Diverfes
futures des os de la tête. Fontanelle. Defcription des parties
que le cràjje reuftjrmsiLa dure mere. La fsqlx. Ibid. ¿.Sinus
longitudinaux«
H O M
longitudinaux. Glandes de Pacchioni. Pie-mere. Arachnoïde;
Description du cerveau 8c de tout ce qui s’y découvre. Ibid.
a 65. a. C e qui fe préfente à la vue lorfqu’on enleve la
anaffe dû cerveau , après avoir coupé vers les cuiffes. Ibid.
b. Defcription du cervelet. Ibid. 266. a. Celle de l’oreille
interne. 'Ibid. b. D e l’oeil. Parties environnantes. Ibid. 267.
a. Defcription de l’oe il 8 t de fes parties. Ibid. b. Cavité de
l ’orbite : os qui entrent dans la compofition. Defcription du
nez. Ibid. 268. a. Parties cachées fous les joues. Defcription
d e la bouche e x té r ie u r e d e s le v r e s , de la mâchoire,
de s dents, & c . Ibid. b. Defcription de la bouche intérieure
& de fes différentes parties. Celle du bas menton 8c du col.
Ibid. 269. a. Examen de la face poftérieure du col. V ertebres
cervicales. Defcription de la poitrine 8c de fes parties. Les
mammelles. Ibid. 270. a. O s fternum. Veine 8c artere fous-
clavieres. Mufcles de la poitrine. O s omoplate. Glandes axil-
laircs. Artere 8c veine axillaircs. Nerfs de la poitrine. Ibid. \
b. Côtes. Mufcles intercoftaux. Veines & arteres intercofta-
les. Mufcles ftcrno-cofteaux. Sous-cofteaux de Verheyen. La
plevre. Sac où eft renfermé le coeur. Defcription du coeur.
C e lle de l’aorte. Ibid. 271. a. Glandes oefophagiennes. Veine
azygos , & autres parties voifines. Defcription du poumon.
Vertebres dU"dos. Ekiphragme. Sous la cloifon du diaphragme
eft la plus grWWo des cavités de notre machine, le
ventre intérieur ou l’abdomen. Mufcles placés fous les tégu-
mens. Anneau des mufcles du bas-ventre. Mufcle crematier.
Péritoine. Defcription de l’eftomac. Ibid. b. Membrane dite
omentum. La rate. Région du foie : defcription de ce v ifeere.
Parties renfermées dans la région de la grande feiffure.
V e in e ombilicale. Conduit veineux. V éficule du fiel. Artere
hépatique, & autres qui en proviennent. Veines hépatiques.
Ligamens par lefquels le foie eft attaché au diaphragme. Ligament
coronaire du foie. Pancréas : parti . s contenues dans
fa région du pancréas. Inteftins duodénum, jéjunum, 8c ileurn.
Mefentere. Vaiffeaux laélés. Rélervoir de Pecquet. Gros inteftins.
Ibid. 272. a. Ligamens, mufcles qui s’y rapportent.
L e s reins 8c les capfules atrabilaires. L’uretere. Les calices.
Arteres lombaires. Veine cave. Suite des vertebres. Mufcles
d e la région lombaire. Le baffin. Mufcles, ligamens 8c vaiffeaux
à l’extérieur du baflin. Parties génitales des hommes.
Ib id. b. Suite des parties du baflin. Parues génitales des femmes.
Ibid. 273. a. Defcription des parties des extrémités
fupérieures. Le b ras, l’avant-bras. Ibid. b. La main. Extré-
mités intérieures : la cuiil'e, les jambes, le pié. J M . 1 7 + <*•
Homme : joignez à l'article précèdent les articles A ,M o -
m ie , Corps humain y Squelette. - ■
Homme , ( Ma t. médic. ) matière^ que fournit le corps
vlv an t^Cc llcs qu’on tire du cadavre. VIII. a74-é*
Homme , ( Morale ) l’homme que nous conlidérons .ci eft
ce t être qui pen fe, qui veut & qui agit. Difficulté d examiner
les refforts qui le font mouvoir ta les motifs qui le déterminent.
Avantages infinis de l’homme fuf les animaux.
•VIII 274. b. L’o rgu e il, la fuperftition & la crainie ont em-
b a rra ffé la connoiflïnce de l’hommede mille pré|Ugésque 1 ob-
fervation doit- détruire. Nous ne femmes allurés de notre
exiftence que par des fenfations. Deux effets de la faculté
d e fentir: ¿au te des différences na.urelles entre les hommes
L e figement qu’on porte de la conduite d autru, eft fouvent
ini. f t f & les conieils qu’on lui donne font plus fouvent
encore inutiles. L e défit du bien-être eft une difpofition
commune à tous les êtres fcnfibles. Comment ce défit de-
vîent^paflton. Pour conuoitre tout ce dont 1 homme eft ca-
1, ,1,1e, il faut le voir lorfqu'il eft paffionné. /iid. 175- “ ■
L'homme eft toujours ce que fes befoins le font être. Rai-
f o n s T i nuus anétent dans la pourfu.te de ce que nous
defirons. Le defir du bien être-tend laits ceffe à nous ifoler.
C ’eft me difpofition réciproque que chacun ipronve de a
c lt , & 1,4 rend, L’attachement du chien pour le
'S^llens" n'étant* ims"toujours formés par des befoins appa-
M on. quelquefois^ un
l'am o u ^ Comment le diffipen. fes illufions. C o m m e n t ^ .
& devient le mobde 0 ^ .0 1^ . ^ hom,„ es m0[lir£ . , t iJ .
Ï ^ V & t E r e n s tourbillons que les petites paffions forment
? * I Vf C om m en t l’anu>itioh mene â 1 efdavage. Pour-
« r p T Â inq"iétude ,u iu -
Tome
H O M 9iS
relie. Nous fommes forcés pour être heureux, otl de changer
continuellement de place, ou d’outrer les fenfations du même
genre. Ibid. b. La douleur & le plaifir femblcnt ne différer
que par des nuances. Différens effets du befoin d’être ému«'
Q u e l eft dans notre coeur le tems ‘du regne de la gaieté..
Cette pente naturelle de l’homme qui le porte en toute
chofe à l’excès , paroît dans les grands événemens qui ont
agité la terre, dans la dégénération infenfible des moeurs, des
éta ts , dans celle des arts qu’il cultive, & c . Ibid. 277. a.
Exercice continuel de la méchanceté dans la fociété humaine.
Sentimens d’humanité qui temperent en m&me tems l’aéti-
v ité de l’amour-propre. A v e c quel foin l’on devroit travailler
à les nourrir dans le coeur des enfans. O n pourroit
aufti leur infpirer tous les préjugés favorables, foit au bien
des hommes en général, foit à l’avantage particulier de la
fociété dans laquelle ils -vivent.'O rgue il eitimable , principe
de toute action généreufe. Le principal moyen de l’éducation
c’eft l’exemple. Ibid. b. Cependant laforce de l’exemple
domeftique n’eit point comparable à l’impreflion que les
hommes reçoivent de la maffe générale des moeurs de leur
tems. Dans tout gouvernement,les opinions & les moeurs
dépendent infiniment de la fituation aéhielle. Principe du
caraétere national. Combien il importeroit de prendre foin
de l’éducation des femmes. Ibid. 278. a.
Homme. Définitions de l’homme. IV . 739. b. Des déterminations
de l’homme fauvage 8c de l’homme civilifé. Suppl.
II. 931. b. Caufe de la variété que nous mettons dans nos
produétions 8c nos ouvrages. I. 407. a. C ’eft l’organifation,
la v i e , l'ame qui fait proprement notre exiftence. Ibid.' b.
Petiteffe de l'homme dans' cet univers. X. 380. b. Bonté originelle
de l’homme. X IV . 274. b. note i. L’homme eft fait
pour la fociété. X V . 232. a , b. & c . 323. b. Avantages qu’il
tire de la culture des beaux-arts. Suppl. I, 387. b. 588. a ,
b. 389. a. 390. a. 11 fe croit la caufe nnàle de toute la création.
X V I . 36. a. Science de l’homme. I. xWiq. difc. prélim.
Ses defirs infinis. I. 372. a. fa vïe morale. X V II. 234. a't b.
Principe des fautes de la plupart des hommes. II. 666. a»
Miferes de l’homme. I. 123. b. 342.- b. IV . 1060. b. I l eft
de tous les animaux le plus féroce. V I . 341 . b. D e l’homme
félon les différens philofophes, voye{ leurs articles particuliers.
Homme de b ien, homme d’honneur. II. 244. b. Homme
fans caraétere. 666. a. Étude des hommes. Suppl. IIL
947. a y b. &c.
Homme y par diftinétion de la femme. Des différences entre
le fquelette de l’homme 8c de la femme. V I. 468. a .
Caraétercs diftinétifs du corps de l’homme & de la fémme
indépendamment des parties fexuelles. Suppl. 111. 1 1 . a. D e
la différence des organes de la génération de l’un & de
l ’autre; V I 468. b. 469. a. Caufe des divers préjugés fur les
rapports d’excellence entre l’Homme & la femme. Ibid. Différence
dans la vie phyfique'des femmes & des hommes. 47Ï*
a. L ’homme & la femme ont chacun des qualités morales
qui leur font propres. V . 404. a. Caraétere moral de l’homme
différent de celui de la femme. SuppL III. ^ 8 . a , b.
D e l’âge propre au mariage dans les nommes,. X . 1 17 . a*
Regime propre aux-hommes. X IV . 12. b. ' ,
H om m e , ( Myth. ) origine de l’homme félon la fable. X V I .
179. a. ' „
H om m e , ( Politiq. ) I 1 n’y a point de véritables riclteffes
que l’homme 8c la terre. L ’homme vaut par le nombre.-.Un
iouverain doit s’occuper de la multiplication de fes fujets.
Comment on aura des hommes induftricux & robuftes. Mau-
vaife adminiftration*, lorfqufe l’abondance devient un fléau
auffi redoutable que la dilette. Comment1 on doit veiller à
la confervation des enfans. Il faut diminuer les Ouvriers dU
luxe 8c les domeftiques» L ’état d’aifance -néceffaire dux-agriculteurs.
Un emploi des hommes n’eft bon , que quand le
profit va au-delà des frais du lalaire. Plus le produitneteft
grand & également partagé , plus l’admmiftration'eft bonne.
Emploi qu’on doit faire des hommes, lorfquil y a des
friches dans un état. VIII. 278. b. .
H om m e nouveau y ( H iß . rom. ) reproche d homme nou-
veau fait ê Cicéron. Comment il répondit à ce reproche.
Droit qu’avoient les nobles dans leurs tunêradlcs. Diftinflions
établies entre les hommes nouveaux, les nobles 8t les ignobles.
Eloge que fe donnoit Catoo le cenfeur quon traitoit
auffi d’homme nouveau. lHd- 479. e.
H om m e B r t , (H i ß . dis Francs) quels étoient, au commencement
de la monarchie , ceux qu. étoient tenus au
fervice militaire. Divifion des hommes libres en centaines.
Leurs chefs nommés M M Droits du prince fur les
hommes libres. En quel tems les hommes libres purent avoir
dC£ L w " ' , ’ c7=9 : i ’on entendoit par-là
des Gaules par les Francs. V I . 691. a. Sur fa fin^ de la le
conde race, tout homme libre pouvoir acquérir un fief ou
convertir en fief fon aleu. 696. a.
Homme de guerre.'VII. 9 9 4 ^ de rhomme
Homme d (tat, ( D m t p o k i . ) B ß B l i B b b b b b b