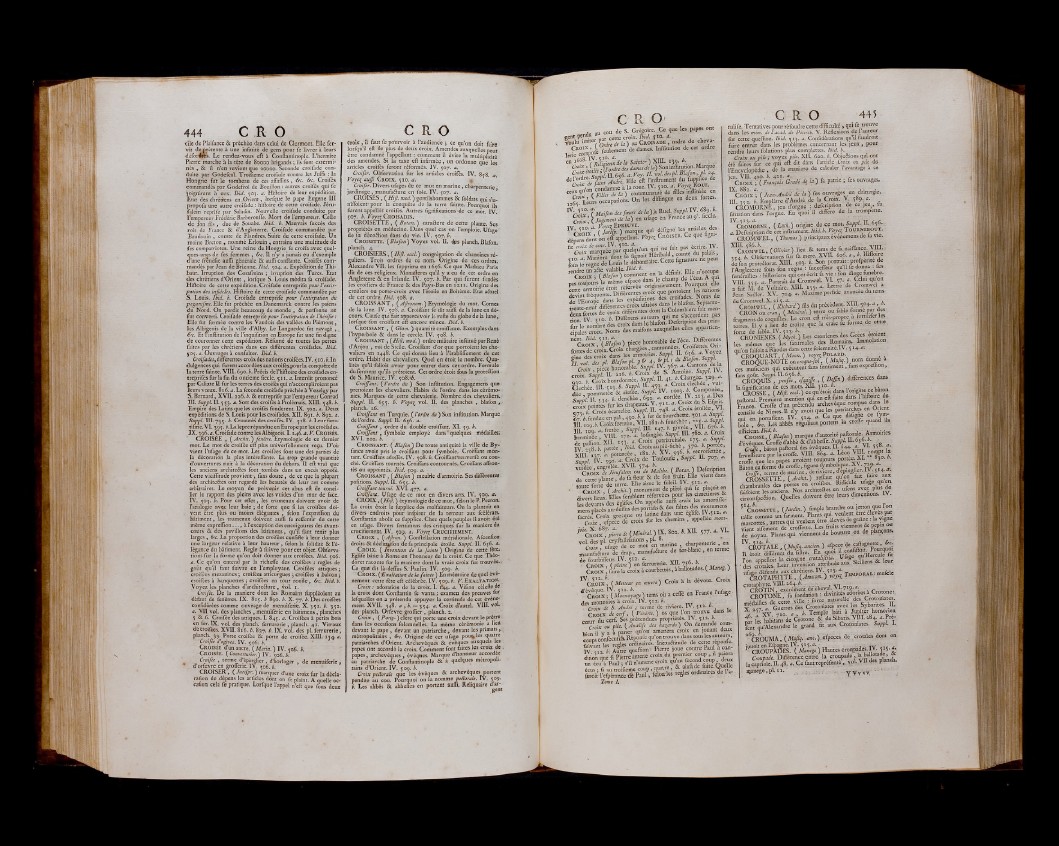
444 C R O
•cïlc de Plaifance & prêchée dans celui de Clermont. Elle fer-
vit dejrotexte à une infinité de gens pour fe livrer a leurs
riéforifllis- Le rendez-vous eft à Coimantinople. L’hermite
Pierre marche à la tête de 80000 brigands ; ils font exterminés
, & il n’en revient que 20000. seconde croifade conduite
par Godefcal. Troineme croifade contre les Juifs : la
Hongrie fut le tombeau de ces âffâflins, &c. &c. Croifés
commandés par Godefroi de Bouillon : autres croifés qui fe
joignirent à eux. Ibid. 503. a. Hiftoire de leur expédition.
Etat des chrétiens en .Orient , lorfque le pape Eugène III
propofa une autre croifiidc : hiftoire de cette croifade. Jéru-
falcm reprife par Saladin. Nouvelle croifade conduite par
l'empereur Frédéric Barberouffe. Mort de l’empereur. Celle
de ion fils, duc de Souabc. Ibid. b. Mauvais fuccès des
rois de France & d’Angleterre. Croifade commandée par
Baudouin , comte de Flandres. Suite de cette croifade. Un
moine Breton , nommé Erlouin , entraîna une multitude de
fes compatriotes. Une reine de Hongrie fe croifa avec quelques
unes de fes femmes , &c. Il n’y a jamais eu d’exemple
•d’une frenéfie aufti générale & aufii confiante. Croifés commandés
par Jean deBrienne. Ibid. 304. a. Expédition de Thibaut.
Irruption des Corafmins ; irruption des Turcs. Etat
des chrétiens d’Orient , lorfque S. Louis médita fa croifade.
Hiftoire de cette expédition. Croifade entreprife pour L’extirpation
des infidèles. Hiftoire de cette croifade commandée par
S. Louis. Ibid. b. Croifade entreprife pour l’extirpation du
paganifme. Elle fut prêchée en Danemarck contre les païens
du Nord. On perdit beaucoup de monde., & perfonne ne
fut converti. Croifade entreprife pour Vextirpation de l'hiréfie :
Elle fut formée contre les Vaudois des vallées du Piémont,
les Albigeois de la ville d’Alby. Le Languedoc fut ravagé , s
6'c. Et rinftitution de l’inquifition en Europe fut une fin digne
de couronner cette expédition. Réfumé de toutes les pertes
faites par les chrétiens dans ces différentes croifades. Ibid.
503. a. Ouvrages a confulter. Ibid. b.
CroiyW«, différentes croix des nations Croifées.IV. 510. é.In
dulgences qui furent accordées aux croiié&pourla conquête de
la terre fainte. VIII. 690. b. Précis dcl’hiftoire des croifades en-
treprifes fur la fin du onzième fiede. 511.0. Interdit prononcé
car Calixtc II fur les terres des croifés qui n’accompliroient pas
leurs voeux. 816. o. La fécondé croifade prêchée à Vezeljjy par
S. Bernard, XVII. 226. b. & entreprife par l’empereur Conrad
III. Suppl. II. 553. a. Sort des croiles à Ptolémaïs. XIII. 548. b.
Empire des Latins que les croifés fondèrent. IX. 302. a. Deux
expéditions de S. Louis pour les croifades. XII. 891. b. 892. a.
Suppl. III.795. W Cruautés des croifés. IV. 518. ¿..Leur fana-'
tifmc. VI. 395. b.La lepre répandue en Europepar les croifades.
JX. 396. a. Croifade contre les Albigeois. 1. 240. a. V. Croisés.
CROISÉE , ( Archit. ) fenêtre. Etymologie de ce dernier
mot. Le mot de croifée eft plus univerfellemcnt reçu. D’où
vient l’ufage de ce mot. Les croifées font une des parties de
la décoration la plus intérefiante. La trop grande quantité
d’ouvertures nuit à la décoration du dehors. Il eft Vrai que
les anciens architeâes font tombés dans un excès oppofé.
Cette viciffitude provient-, fans doute , de ce que la plupart
dès ardütcôcs. ont regardé les beautés de leur art comme
arbitraires. Le moyen de prévenir cet abus eft de concilier
le rapport des pleins avec les vuides d’un mur de face.
IV. 505. b. Pour cet effet, les trumeaux doivent avoir de
l’analogie avec leur baie ; de forte que fi les croifées doivent
être plus ou moins élégantes , félon l’exprefiion du
bâtiment, les trumeaux doivent aufti fe reffentir de cette
même exprefiion. . . , à l'exception des encoignures des avant-
cours & des pavillons des bâtimens, qu’il faut tenir plus
larges, &c. La proportion des croifées confifle à leur donner
une largeur relative à leur hauteur, félon la folidité & l’élégance
du bâtiment. Réglé- à fuivre pour cet objet. Obferva-
itions fur la forme qu’on doit donner aux croifées. Ibid. 506.
a. Ce qu’on entend par la richeffe des croifées : réglés .de
goût qu’il faut fuivre en l’employant. Croifées attiques j
croifées mezanines ; croifées atticurgues 3 croifées a balcon ;
croifées à banquettes ; croifées en tour ron'de, &c. Ibid. b.
Voyez les planches d’architeâure, Vol. 1.
Croifée. De la maniéré dont les Romains fuppléoient au
défaut de fenêtres. IX. 815. b 890. b. X. 77. b. Des croifées
confidérées comme ouvrage de menuiferie. X. 351. b. 352.
a. VII vol. des planches , menuiferie en bâtimens,'planches
5 & fi. Croifée des attiques. I. 843. a. Croifées à petits bois
en fer. IX. vol. des planch. ferrurcrie , planch. 41. Vitraux
‘dè étoilées. XVII. 816. b. 827» b. IX. vol.- des pl. ferrurerie ,
planch. 39. Porte croifée & porte de croifée. XIII. 134.0.
Croifée d’ogives. IV. 506; b.
CROISÉE d’un ancre. ( Marin. ) IV. 506. b.
CROISÉE. ( Couverturier. ) IV. 506. b.
Croifée , terme d|éping|ier , d’horloger , de menuiferie •
. d orfevre en groffene. IV. 506. b.
CROISER , ( Jurifpr. ) marquer d’une croix fur la déclaration
de dépens les articles dont on fe plaint. A quelle oc-
cafion cela fe pratique. Lorfque l’appel n’eft que fous deux
C R O
croix, il faut fe pourvoir à l’audience j ce qu’on doit faire
lorfqu’il eft de plus de deux croix. Amendes auxquelles peut
être condamné l’appellant : comment il évite la multiplicité
des amendes. Si la taxe eft infirmée, on ordonne que les
articles croifés feront réformés. IV. 507. o.
Croifer. Obfervation fur les articles croifés. IV. 858. a.
Voye^ aujfi C ro ix . 510. o.
Croifer. Divers ufages de ce mot en marine, charpenterie '
jardinage, manufacture en foie. IV. 507. a. *
CROISÉS , (Hift. mod.) gentilshommes & foldats qui s’u-
niffoient- pour la conquête de la terre fainte. Pourquoi ils
furent appelléS croifés. Autres fignifications de ce mot. IV.
5O7. b. FoyrrCROISADES.
CROISÉItE , ( Botan. ) cara&ere de cette plante. Ses
propriétés en médecine. Dans quel cas on l’emploie. Ufage"
de fa décoilion dans du vin. IV. 50J »
C ro is e tte . (Blafon) Voyez vol. II. des planch.Blafon.
planch. 4.
CROISIERS, ( Hiß. ceci1. ) congrégation de chanoines réguliers.
Trois ordres de ce nom. Origine de ces ordres.
Alexandre Vil. les fupprima en 1656. Ce que Mathieu Paris
dit de ces religieux. Monafteres qu il y a eu de cet ordre en
Angleterre 8c en Irlande. IV. 507. b. Par qui furent fondés
les croifiers de France 8c des Pays-Bas en 1211. Origine des
croificrs ou porte-croix avec l’étoile en Bohême. Etat aéluel
de cet ordre. Ibid. 508. a.
CROISSANT, ( Afironom. ) Etymologie du mot. Cornes
de la lune. IV. 508. a. Croiffant le dit aufti de la lune en décours.
Caufe qui fait appercevoir le refte du globe de la lune,.
lorfque fon croiffant en encore mince. Ibid. b.
C ro is san t , ( Gêom. ) quantité croiffante. Exemples dans
l’hyperbole 8c dans le cercle. IV. 508. b.
C ro is san t , (Hift. mod.') ordre militaire inftitué par René
d’Anjou , roi de Sicile. Croiffant d’or que portoient les chevaliers
en 1448. Ce qui donna lieu à l’établiftement de cet
ordre. Habit des chevaliers. Quel en étoit le nombre. Qualités
qu’il falloit .avoir pour entrer dans cet ordre. Formule
du ferment qu’ils prêtoient. Cet ordre étoit fous la proteétion
de S. Maurice. IV. 508.'•b.
Croiffant. ( l’ordre du ) Son inftituüon. Engagemens que
prenoient les chevaliers. Habits de l’ordre dans les cérémonies.
Marques de cette chevalerie. Nombre des chevaliers.
Suppl. II. 655. b. Voye{ vol. IÏ. des planches , blafon«
planch. 26.
Croiffant ert Turquie. ( l'ordre du ) Son inftitution. Marque .
de l’ordre. Suppl. II. 656. a.
Croiffant , ordre du double croiffant. XI. 59. b.
Croiffant . fymbole employé dans “quelques médailles«
XVI. 202. b. .
Crois san t, f Blafon ) De toute antiquité la ville de By-
fance avoit pris le croiftant pour fymbole. Croiffant montant.
Croiffans adoffés. IV. 508. b. Croiflant*reuveriè ou couché.
Croiffans tournés. Croiffans contournés. Croifians affrontés
ou appointés. Ibid. 509. a.
C ro is san t , ( Blafon ) meuble d'armoirie. Ses différentes
polirions. Suppl. II. 655. b,
CrpÎffant tourné. XVl. 477. à.
Croiffant. Ufage de ce mot en divers arts. IV. 509. a.
CROIX, (Hift.) étymologie de ce mot, félon le P. Pezron.
La croix étoit le fupplice des malfaiteurs. On la plantoit en
divers endroits pour infpirer de la terreur aux fcélérats.
Conftantin abolit ce fupplice. Chez quels peuples il avoit été
en ufage. Divers fenrimens des critiques fur la maniéré du
crucifiement. IV. 509. a. Voyej Crucifiement.
C r o ix , Aftron.) Conftellation méridionale. Afcenfion
droite 8c déclingjfon de fa principale étoile. Suppl. II. 656. a.
C ro ix . ( Invention de la fainte) Origine de cette fête.
Eglife bâtie à Rome en l’honneur de la croirf. Ce que Théo-
doret raconte fur la maniéré dont la vraie croix fut trouvée. >
Ce que dit là-deftùs S. Paulin. IV. J09. b.
Croix. (Exaltation delà fainte ) En mémoire de quel événement
cette fête eft célébrée. IV. 509. b. V. E x a l t a t i o n .
Croix : adoration de la croix. I. 1*44. a. Vifion céleftede
la croix dont Conftantin fe vanta.: examen des preuves fut
lefquelles on a prétendu appuyer la certitude de cet événement.
XVII. 348. a , ¿. — 354. a. Croix d’autel. VIII. voL
des planch. Orfevre groifier , planch. 2.
Croix, ( Portf- ) clerc qui porte une croix devant le prêtre
dans les occafions folcmnelles. La même cérémonie a lieu
devant le pape , devant un patriarche, devant les primats,
métropolitains , &c. Origine de cet ufage poulies quatre
patriarches d’Orient. Arclievêques 8c évêques auxquels les
papes ont accordé la croix. Comment font faites les croix de .
papes, archevêques, évêques. Marque d’honneur accordée
au patriarche de Conftantinople 8c à quelques métropolitains
d’Orient. IV. 509. b.
Croix peélorale que les évêques 8c archevêques portent
pendue au cou. Pourquoi on la nomme peélorale. IV. 509.
b. Les abbés 8c abbeffes en portent aufti Reliquaire d argent
C R O „Ju au cou de S. Grégoire, Ce que les pap« our
gent pendu au ^ croix. Ibid. J ro- ». •
voulu unucr P ^ , 0J1 C ro is ad e , ordre de cheva-
?°ompoÎi feulement de daines. Inflitution de cet ordre
m | { * £ $ £ * U XIII- m - Ë : . ...
C'°IX & dames de la) Son in&tunon. Marque
Croix etotl ,1 ,r voi ¿espl. Blafon., pl. 24.
filles inftitûèe en
. «cupatiote. On les dlftingue en deux fortes.
t Mai fat des Césars de la ).à Ruel. Suppl. IV. 689.».
en ufage eu Frkncé au 9«. fiede.
S P f S | i " q u l défigne- leu articles des
'dépmiatlont oit ¿ 4 .P *® « « ^
pas touiours l e o r i g i n a i r e m e n t . Pourquoi elle
cette armoine ' “ “ S ™ « , croix que portoient les nations
“ c k o t Î 'ImaCon) piece honorable dePécu. Différentes
11. val. des pl. Blafiapt. } 4 , P Cantons de la
020 b. ¿ o ix bourdonné«. Suppl. II. 4i.b . Chargée. 329. u.
S5 ■; jT 111 . l Suovl. IL 459- a. Croix clcchée , vuidéeC,
pommetee Sc'alel^e. Suppl-h. Compon^e
croix peintes fur les drapeaux, v. étoilée, VI.
f e t o o i Croixformée, V il. 18.. b. fourché. , aaji
III. to|. ». frétée M 'W 'to fL g è f S « iIT llî’{«o ». Croix
aÊÊéSSt i O E b 570.i. portée,
S a ÔâttW’ & I Croix au pié-fiché, 370. portée
S , f ! t „ | S 1 1 g &V. 936 t. recroifettée
^36. b. recroifettée,
îv . 39a. »• Croix de Touloufe , Sappi. II. 707,
VUCi \ " i : % a ^ 7d4eL l,h e . f * - 0 Defcripnon
d e cèuè piarne, de fa (leur & de fou fret. Elle vtent dans
' ' “ c k o « ' , mon’ l e m d Ä u i f e ' p V e n
dive« lieux. Elles feiblent rêferyées divers lieux. Elles ¿emnmnt ' ' - - “ g¡j.o“u .' les 1c«,» eatuneorrreifsfe^.
mens placés au-deffus d« portails & des faîtes des monumens
■fnrrés Croix grecque ou latine dans une églifc.lV.5 . .
Cmte , èfpcce de croix fur lte chemins , appeUée ntont-
’ " c î o S lp t r e d e {Miré,al.) IX. 8oa. b. XH. , 77- - VI
T°Cr»S Pl!u&ÿie®uS£fe1i marine , charpenterie , en
ntanSure le drap, manufeSure de fer-blanc | eu terme
C r o ix ’, faire la croix à courbettes, à ballotades. ( Maneg. )
lVC R O IX A Metteur en ouvre) Croix à la dévote. Croix
déS ; Cx i (Monnoyage) tems où a ceffé en France l’ufage
des monnoics à croix. IV. 512. b.
Croix de S. André ; terme de riviere. IV. 512. 0.
C r o ix de cerf, ( Vcnirie. ) os que l’on trouve dans le
du cerf. Ses .prétendues propriétés. IV. 512. b.
™Zixoupue. mm m « T.-.,. y a à parier qu’on amènera croix en jouant deux
c vLfécutifs. Réponfc qu’on trouve dans tous les auteurs,
coups com ordinaires. IriexaRitude de cette réponfc.
w T t a b a ! « queffion : Pierre joue contre Paul Con-
TV . 512. . ^ croix du premier coup , il paiera
dtuon que fi Ptetreamene v feohd coup, deux
. * X ? I trOlftcmC ,P 1 ^1, & nairndfiindaeir Mes'tüce- Ql’ai-cllc
C R O 445
nalife. Tentatives pour réfoudre cette difficulté > qui fe trouve
dans les mèm. del’acad. de Pétersb. V. Réflexions, de.l auteur
fur cette queftion. Ibid. 513. a. Confidêrations qu’il faudroit
faire entrer dans les problèmes concernant les jeux,.pour
rendre leurs folutions plus complettes. Ibid. b. .. -• .•/,/
Croix ou pile i voyez vile. XIL 620. b. Objeôions qui ont
été Faîtes fur ce qui eft dit dans l’article Croix ou pile de
l’Encyclopédie ,. de la manière de calculer 1 avantage à ce
Ck ô îx t’ cffmaflir' Oradi di la) fa patrie ; fes ouvrages.
IXCRÔfxî 1 Jean-André de la) t e ouvrag« en> chiq.rgie.
III. ira. b. Emplâtre 4’André de la Croix. V. 589. ».
CkOMÔRNE, jeu d’orgue : defcripnon de ce jeu,, fa
fitnanon dàns l'orgue. Eu quoi il différé de la trompette.
^Cromorne , ( Luth.) origine .de ce mot. Suppl. II. 636..
».Defcripnonde cetinftrument.Ibid.b. VayxjTournebout.
CROMWEL, ( Thomas) p rinc ip au xévénemensde la vie.
^CROélwEE, (Olivier) lieu.& tems de fanaiffance. VIU.
334. b. Obfervations fur fa mere. XVII. 606. », i. Hh?“ «
âe fou proteftorat. XIII. S b Son j i o j n g
l’Angleterre fous fon regne : fucceffeur qmlfe donna . fes
funérailles : hllloriens qui ont écrit fa vie : fon éloge funebre.
VIII. 353. »..Portrait de Cromwel. VI. 57- »■ Celui quen
a fait M. de Vbllalre. XIII. ,133. »•
JTean Sadleri XV. 704. ». M a x im e perfide avancée du tems
deGromwel.X.2i-5. a. vTTT »
C romw el , ( Richard) fils du précèdent. XIU.504g »/’•
CRON ou cran (.Minéral. ) terre ou fable ^m«par(les
fragmens de coquilles. Le cron M M H S
terres. II. y a lieu de croire .que la craie le forme, de cette
f° rCRONIENES/( Myth. ) Les cronienes.des Grecs é^oienc
lès mêmes que \cs ^âti/rnales des Romains. Immolation
qu’on foifoit a Rhodes dans cette folemnité.IV. 514- *■
CROQUART, ( Monn.) voye^POLARD. . y.
CROQUE-NOTE ou croque-fol, ( Mufiq.) nom
ces muficiens qui exécutent fans fenument, fans expreffion,
mëiwMM’, W. (üi d“s 1 t e s t (V” ST) f q u C i^ a n H ’origine ee bâton
pafioral Preiniere mention a g f g É l É g B l l I
^ | *S£Ï!Ï^Blafon) marque d’autorité paliorale. Armoiries
d’évêqu«. Croffed'abbé Scd’abbeffe.Sappl.U.6f 6.b. ,
CredTe, bâton paftoral des évêques. II. ■44 »- v l- l l°- •
In c lu r e par laPe,offe. VIU. 864. »• Uon VII . rompt la
croffe que les papes avoient toujours portée. XL 3 •
Bâton en forme de croffc, figure tymbohque, XV. 7*9-a- g
Croffe, terme de marine, dermere, dèpingl e . ; 5 4
CROSSETTE, (Archit.) reffaut quon fan faire aux
chambranles des portes ou eroiféés. Sidieule ufage quen
faifoient les anciens. Nos arclmca« en ufcnt avec plus de
circonfpeaion. Quelles doivent être leurs dimeofions. IV.
! 'c ros se tte , (Jardin. ) fimple branche ou ieuon que l’on
taille comme unfarment. Plants qui veulent être élevés par
S a r e o n t lu u « qui veulent être élevés de grarne : la vigne
VienTrifément de etoffene. Les ftnlts viennent.depepmog
de tioyau. PUnts qui viennent de bouture ou de plaoçons.
IVrknTAI.F. ( MuCtet ancien. ) efpece de caftagnctte, Crc.
1 g
^'c^cÎflN! excrément.de cheval. VI. 719.». _
CROTONE, a B W B S M i i P P p i B K
médulles d^cette^ ^ ¿ ;otonii tei ivec' lcs Sybarites. IL
à 5 VV vio » b. Temple bâti 1 Jupiter homoncn
4<S' les hlbiMs de Crotone £ de Sibatis. VÜt. a8+ ». Pré-
fem ¿ ’Alexandre le grand fit aiix Crptoniates. Sappi I.
f&tÔUMA. (.Mujiq. anc.icdpKtx de crotales dont on
’" c R O o t Î S k 1! Vfmtgc) Haut«
Croupade. Différence, entre la croupade, la fe fe bdu ^
1^ capriole. II. 48. a. Ce fautrepréfentê,. vol-v n des P