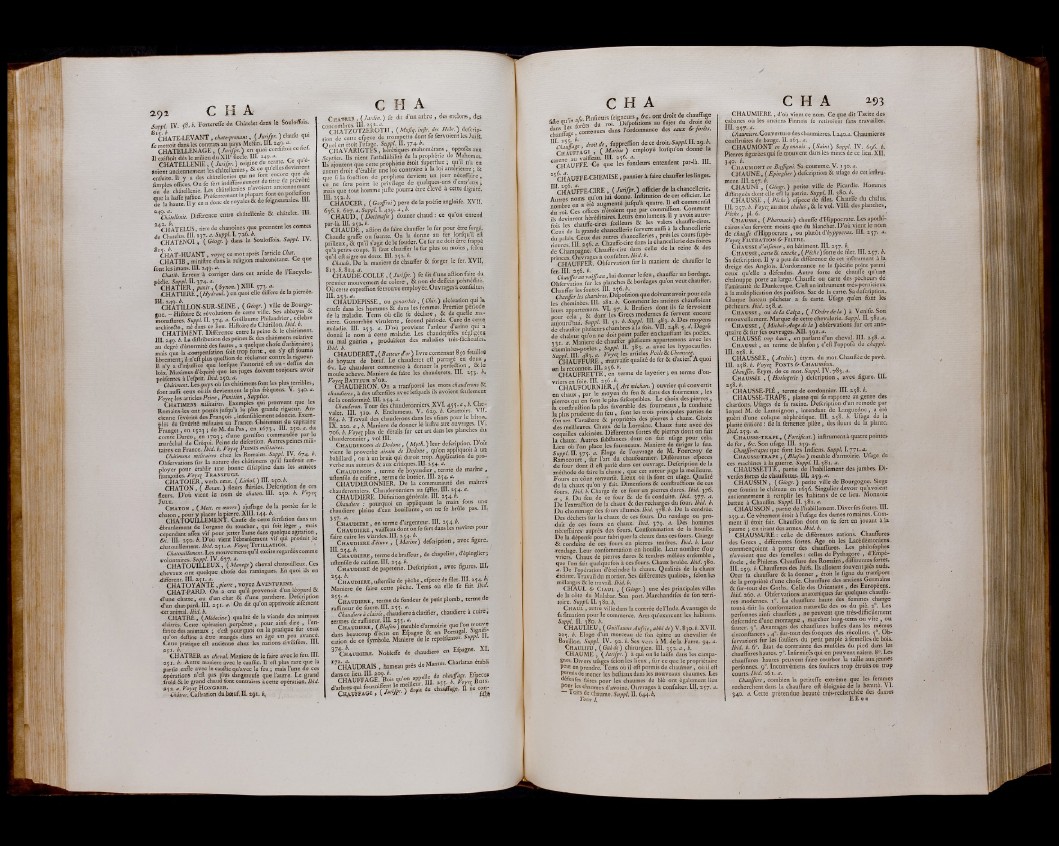
292 C H A
SuppL IV. ¿8. i. Foriercfle du Chàtelet dam le SeuloSois.
Ê1 ¿HATE-LEVANT , chatc-pnuunt, (Jurifpr. ) cÎanfc qui
fe mettoit dans les contrats au pays Meffin. III. » «•
CHATELLENAGE , (Jurifpr.) en quoi conWloit ce net.
Il exidoit dès le milieu du XII' fiecle. III. »49-a' c ,,
enfuite. 11 y a des diâtellen es qui
Amples offices. On
qiicln M t a Prlfeïtemënt [anlimart font en poffellion
de la haute. 11 y en a donc de royales tic de feigneunales. 111.
■4S £ / fe i" Différence entre châtellenie & chàtelet. III.
^CHATELUS, titre de chanoines que prennent les comtes
de Chatclus. III. 137- 4. Suppl. I. 716. b.
CHATENOI, ( Geogr. ) dans le Souloffois. Suppl. IV.
Sl^HAT-HUANT, voyez ce mot après l’article Chat.
CHATIBI miniftre dans la religion mahométane. Ce que
font les imans. 111.149. a. .
CAtfwt. Erreur à corriger dans cet arucle de 1 Encyclopédie.
SuppLU. 374. a. |
CHATIER, punir, (Symwi. ) XIII. <73. <*• .
CHATIERE, (Hydraul. ) en quoi elle différé de la pierrôe.
H CHATILLON-SUR-SEINE, ( Gcogr. ) ville deBourgo-
•ne - Hiftoirc & révolutions de cette ville. Ses abbayes oc
monafleres. Suppl. II. , 74- ^Guillaume Phihmdr.e r ,j;a e^e
architeâe, né dans ce lieu. Hiftoirc de Chatillon. Ibid-b.
CHATIMENT. Différence entre la peine oc le châtiment.
III. 140. b. La diftributîon des peines 8c des châtimens relative
au degré d’énormité des fautes, a quelque chofe d arbitraire -,
mais que la compenfation foit trop forte, on s y elt tournis
librement-, ilm’eft plus queftion de réclamer contre la ngueur.
Il n’y a d’injuftice que lorfque l’autorité eft au - deffus des
loix. Maximes d’équité que les juges doivent toujours avoir
préfentes à l’efprit. Ibid. 250. a. , , .
Châtiment.Les pays où les châtimens font les plus terribles,
font aufli ceux ouiU deviennent le plus fréquens. y. 340. *.
Voyer les articles Peine , Punition , Supplice.
CHATIMENS militaires. Exemples qui prouvent que les
Romains les ont portés jufqu’à la plus grande rigueur. Ancienne
févérité des François, infenfiblcment adoucie. Exemples
de févérité militaire en France. Châtimens du capitaine
Franeet, en 1513 ; de M. du Pas, en 1673, III. 250. g du
comte Darco, en 1703 ; d’une garmfon commandée parle
maréchal de Créqni. Peine de defertion. Autres peines mih-
taires en France. Ibid. b. ¡ ¡ ¡ ¡ | Peine s militaires.
Châtimens militaires chez les Romains. Suppl. IV. 674. b.
Obfervations fur la nature des châtimens qu’il faudrait employer
pôur établir une bonne difcipline dans les armées
françoiles. Voyez T ransfuge.
CHATOIER, verb. neut..( Luhol. ) III. 2 50. b.
CHATON, ( Botan. ) fleurs ftériles. Defcription de ces
fleurs. D’où vient le nom de chaton. III. 150. b. Voye$
C haton , ( Met t. en ceuvre ) ajuftage de la portée fur le
chaton , pour y placer la pierre. XIII. 144* % .
CHATOUILLEMENT. Caufe de cette fenfimon dans un
ébranlement de l’organe du toucher, qui foit léger , mais
cependant affez v if pour jetter l’ame dans quelque agitation,
bc. III. 150. b. D’ou vient l’ébranlement vif qui produit ;le
chatouillement. Ibid. 251. a. Vvyez T itillation.
Chatouillement. Les mouvemens qu il excite regardes comme
volontaires. Suppl. IV. 637. a.
CHATOUILLEUX, ( Manege) cheval chatoudleux. Ces
chevaux sont quelque chofe des ramingues. En quoi ils en
.différent. III. aç*- <*•
CHATOYANTE, pierre, voyez A venturine.
CHAT-PARD. On a cru qu’il provenoit d un léopard et
d’une chatte, ou d’un chat 8c d’une panthere. Defcription
d’un chat-pard. IIL 251.*. Ou dit qu’on appnvoife aifément
cet animal. Ibid. b.
CHÂTRÉ, (Médecine) qualité de la viande des animaux
châtrés. Cette ' opération perpétue^, pour ainfi dire , 1 enfance
des animaux ; c’cft pourquoi on la pratique fur ceux
qu’on deftinc à être mangés dans un âge un peu avancé.
Cette pratique eft ancienne chez les nations civilifees. III.
açï* b.
CHATRER un cheval. Maniéré de le faire avec le feu. III.
251. b. Autre maniéré avec le cauftic. Il eft plus rare que la
parue enfle avec le cauftic qu’avec le feu ; mais l’une tfe ces
opérations n’eft pas plus oangereufe que l’autre. Le grand
froid 8cle grand chaud font contraires à cette opération. Ibid.
a j i . a. Voyez Hongrer.
Châtrer. Caftration du boeuf. IL 291. b%
C H A
CHATRER , (jardin. ) fe dit d’un arbre , des melons, dç?
C°CHATZOTZe1iOTII , ( Mufiq. injlr. des Hcbr. ) deferip-
tion de cette efpece de trompette dont fe fervoient les Juifs.
Quel en étoit l’ufage. Suppl. II. 374- f-
CHAVARIGTES, hérétiques mahométans, oppolcs aux
Scythes. Us nient l’infaillibilité de la prophétie de Mahomet.
Us ajoutent que cette prophétie étoit fuperfluc ; qu il n a eu
aucun droit d’établir une loi contraire à la loi antérieure ; 8c
que fi la fonftion de prophète devient un jour néceffaire ,
ce ne fera point le privilège de quelques-uns d entr eux \
mais que tout homme jufte pourra être éleve a cette dignité.
CHAUCER, ( Geoffroi ) pero de la poéfie angloife. XVII.
636. b. 627. a. Suppl. I. 4*9- a>b. ,
CHAUD, ( Docimafie ) donner chaud : ce quon entend
par-là. 111. 2-52. b. ,
CHAUDE, aétion de faire chauffer le fer pour etre forge.
Chaude graffe ou fuante. On la donne au fer lorfqu ¡1 eft
pailleux, 8c qu’il s’agit de le fonder. Ce fer ne doit etre frappe
qu’à petits coups. 11 faut chauffer le fer plus ou moins, fclon
qu’il eft aigre ou doux. lll. 252. é.
Chaude. De la maniéré de chauffer 8c forger le fer. XVII,
1 CHAUdÊ-COLLE , ( Jurifpr.) fe dit d'une aflion faite du
premier mouvement de colere , & non de deffein prémédite.
Où cette expreffion fé trouve employée. Ouvrages'à confulter,
CHAUDEPISSE, 011 gonorrhee , ( Chir.) ulcération qui la
caufe dans les hommes & dans les femmes. Premier période
de la maladie. Tems où elle fe déclare , 8c de quelle maniéré.
Gonorrhée virulente , fécond période. Cure de cette
maladie. III. 253. a. D’où provient l’ardeur d’urine qui à
donné le nom à cette maladie. Les chaudepiffes négligée*
ou mal guéries , produifent des maladies très-fâcheufes.
Ibid. b. . . r ...
CH AU DERET, ( Batteur £ or) livre contenant 850 feuilles
de boyaux de boeuf. Le chauderet eft partagé en deux >
Oc. Le chauderet commence à donner la perfection, 8c le
moule achevé. Maniéré de faire les chauderets. III. 253. b,
Voyer B a t t e u r d’OR. , , , , 0
CHAUDERON. On a tranfporté les mots chauderons et
chaudières, à des uftcnfiles avec lefquels ils avoient feulement
de la conformité. III. 254. a.
Chauderon. Tour des chauderonniers.XVI. 45j.a ,b . Uie-
valet. III. 310. b. Enclumeau. V. 629. b. Grattoirs. VII.
864. b. Travail des chauderons dans les ufines pour le laiton.
IX. 220. a , b. Maniéré de donner le luftre aux ouvrages. IV.
706. b. Voyez plus de détails fur cet art dans les planches du
chauderonnier, vol III. . . . . -i, .
C hauderons de Dodone, (Myth. )leur defcription. D ou
vient le proverbe airain de Dodone, qu on appliquoit à un
babillard , ou à un bruit qui duroit trop. Application du proverbe
aux auteurs 8c aux critiques. 111.254. a.
C hauderon , terme de boyaudier, terme de marine ,
uftenfile de cuifine, terme de bottier. III. 254. a. K ;•
CHAUDERONNIER. De la communauté des maîtres
chauderonnicrs. Chauderonniers au fi/Het. III. 254. a.
CHAUDIERE. Définition générale. III. 2 5 4 - f-
Chaudière : pourquoi en appliquant la main fous une
chaudière pleine d’eau bouillante, on ne fe brûle pas. IL
^^Chaudière, en terme (Targenteur.III. 254.b. _
C haudière , vaiffeau dont onfe fert dans les navires pour
faire cuire les viandes. III. 254. b.
CH AUDIERE (Tétuvc , ( Marine) defcription, avec figure.
C haudière , terme de braffeur, de chapelier, d’épinglier;
uftenfiledecuifine.lll. 254. b.
C haudière de papeterie. Defcription, avec figures. 111«
2 ÎC h Âudiere, uftenfile de pêche, efpece de filer.
Maniéré de faire cette pêche. Tems ou elle fe fait. Ibid.
2<i C h a u d iè r e , terme de fondeur de petit plomb, terme de
raffineurdefucre.III. 25c. ii. „x
Chaudière à clairée, chaudière à clarifier, chaudière à cuire,
termesderaffineur.III.255.il. ft ♦y.rtiivte
CHAUDIERE, ( Blafon ) meuble d armoine que 1 on trouve
dans beaucoup d’écus en Efpagne & en Portugal g
cation de ce lymbole. Maniéré de le repréfenter. S pp •
374C h 4UDIER£. Noblcffe de chaudière en Efpagne. XI.
I7CHAUDRAIS , hameau prè» de Man.«. Charla.au érabli
f e dc £ha^ -
C H A
.. ,,r„ Pluficursfeigneurs, «•£. ont droit de chauffage
fdle qu '» du roi DUjiofiüoiB au fujet du droit de
chauffage, contenues dans l’ordonnance des taux &■ forcir.
, droit de, fuppreffion de ce droit. 5«ppi II. n9. i.
c S fM O E , ( Marine ) employé lorfqu on donne la
carene au vaiffeau. 111. 156. <r.
CHAUFFE. Ce que les fondeurs entendent par-là. III.
XHÀUFFE-CHEMISE, pannler à faire chauffer les linges.
11 CHAUFFE-CIRE , (Jurifpr.) officier de la chancellerie.
Autres noms qu’on lui donne, lnflitution de cet officier. Le
nonibrc en a é°é augmenté juftpt’à quatre. 11 eft commenfa
.lu roi Ces offices ifétoient que par commiffion. Comment
Us devinrent héréditaires. Leurs émolumens: 11 y avoir autrefois
1« chauffe-cires fcelleurs & les valets chauffe-cires
Ceux de la grande chanceUerie fervent auffi a la chancellerie
du palais. Ceux des autres chancelleries, près les cours fupé-
rieures III. a(6- 4. Chauffe-cire dans la chancellerie des foires
de Champagne. Chauffe-cire dans celle de la reine & des
Pr C H A U F F ^ SObfervation fur la maniéré de chauffer le
ZaifTeau, lui donner le feu, chauffer un hordage.
Obfervation fur Us planches & bordages qu’on veut chauffer.
Chaufferlesfoutes.nl. 256.^ |
Chaufferies chambres. Difpofition que doivent avoir pour cela
les cheminées. III. a8t.é. Comment les anciens chauffo.ent
leurs appartemens. VL 9® Braf.çrs don. ds fe fervoient
pour cela , & donf les Grecs modernes fe fervent encore
aujourd’hui. Suppl. II. 1 « J Ï I Z
de chauffer plufieurs chambres à la fois. VH. 148. 5. d. Degré
de chaleur qu’on ne doit point paffer en chauffant les poeles.
art 4 Maniéré de chauffer plufieurs appartemens avec les
cheminées-poèlcs , Suppl. IL 3» «. avec les hypocaufles.
Suppl.. III. 483. «. » 1« àmfJsi f 0“ “ .
CHAUFFURE , mauvaife qualité de fer 8c d acier. A quoi
on la reconnoît. III. 256. é. . . . „
CHAUFRETTE, en terme de layetier ; en terme d ouvriers
en foie. III. a5^- % ■ , , . .
CHAUFOURNIER, {Art mechan. ) ouvrier qui convertit
en chaux par le moyen du feu 8c dans des fourneaux, les
pierres qui en font le plus fufceptibles. Le choix des pierres,
la conftruftion la plus favorable des fourneaux, la conduite
la plus prudente du feu , font les trois principales parties de
fon art. CaraÛere 8c propriétés des pierres à chaux. Choix
des meilleures. Chaux de la Lorraine. Chaux faite avec des
coquilles calcinées. Différentes fortes de pierres dont on fait
la chaux. Autres fubftances dont on fait ufage pour cela.
Lieu où l’on place les fourneaux. Maniéré de diriger le feu.
Suppl. II. 375. i Éloge de l’ouvrage de M. Fourcroy de
Ramecourt, fur l’art du chaufournier. Différentes cfpeces
de four dont il eft parlé dans cet ouvrage. Defcription de la
méthode de faire la chaux, que cet auteur juge la meilleure.
Fours en cône renverfé. Lieux ou ils font en ulage. Qualité
de la chaux qu’on y fait. Dimenfions 8c conftruftions de ces
fours. Ibid. b. Charge de ce four en pierres dures. Ibid. 376.
a , b. Du feu. de ce four 8c de fa conduite. Ibid. 377. a.
De l’extra&ion de la chaux 8c des recharges du four. Ibid. b.
Du chommage des fours allumés. Ibid. 378. b. De la cendrée.
Des déchets fur la chaux de ces fours. Du rendage ou produit
de ces fours en chaux. Ibid. 379. a. Des hommes
néceflaires1 auprès des fours. Confommation de la houille.
De la dépenfe pour fabriquer la chaux dans ces fours. Charge
8c conduite de ces fours en pierres tendres. Ibid. b. Leur
•rendage. Leur confommation en houille. Leur nombre d ouvriers.
Chaux de pierres dures 8c tendres mêlées enfemble ,
que l’on fait quelquefois à ces fours. Chaux brûlée. Ibid. 380.
a. De l’opération d’éteindre la chaux. Qualités de la chaux
éteinte. Travail du mortier. Ses différentes qualités, félon les
mélanges 8c le travail. Ibid. b. ■
CHAUL O C iau l , ( Géogr. ) une des principales villes
de la côte du Malabar. Son port. Marchandifes de fon territoire.
Suppl. II. 380. b.
C h au l , autre ville dans la contrée de l’Inde. Avantages de
fa fituadon pour le commerce. Arts qu’exercent les habitans.
Suppl. II. 380. b.
CHAULIEU, ( Guillaume Aufrie, abbé de| V. 830. b. XVII.
225. b. Eloge d’un morceau de fon épître au chevalier de
Souillon. Suppl. IV. 92. b. Scs vers à M. de la Farre. 94. a.
CHAULIEU, (Gui de) chirurgien. III. 352. a , b.
CHAUME , ( Jurifpr. ) à qui on le laifle dans les campagnes.
Divers ufages félon les lieux, fur ce que le propriétaire
peut en prendre. Tems où il eft permis de chaulner, où il eft
5îrm,s mcner lés beftiaux dans les nouveaux chaumes. Les
défenfes faites pour les chaumes de blé ont également lieu
P0lÜI^ chaumes d’avoine. Ouvrages à confulter. III. 257. a.
Toits de chaume. Suppl. U. 644. b.
Tome /.
CHAUMIERE , d’où vient ce nom. Ce que dit Tacite des
cabanes où les anciens Finnois fe retiraient fans travailler.
III. 257. a.
Chaumière. Couverture des chaumières. I.240.1Z. Chaumières
conftmires de bauge. II. 163. a.
CHAUMONT en Lyonnais , ( Saint) Suppl. IV. 696. b.
Pierres figurées qui fe trouvent dans les mines de ce lieu. XII.
,340. b.
CHAUMONT en Bajftgni. Sa coutume. V . 130. a.
CH AUNE, ( Epinglier ) defcription 8c ufage de cet inftru-
ment. III. 257. b. .. „
CHAUNl , ( Géogr.. ) petite ville de Picardie. Hommes
diftineués dont elle eft la patrie. Suppl. II. 380. b.
CHAUSSE, ( Pêche ) efpece de filet. Chauffe du chalus.
III. 257. b. Voye{ au mot chalus, 8c le vol. VIII. des planches.
Pêche, pl. 6. T '
Ch ausse, ( Pharmacie) chauffe d’Hippocrate. Les apothicaires
s’en fervent moins que du blanchet. D ’où vient le nom
de chauffe d’Hippocrate , ou plutôt tYhyppocras. III. 257. a.
Voye[ Filtratio n O Filtre.
C hausse d’aifance, en bâtiment. III. 257. b.
CHAUSSE, carte 8c cauche, f Pêche) forte de filet. III. 257. b.
Sa defcription. Il y a peu.de différence de cet inftrumcnt à la
dreige des Anglois. L’ordonnance ne le fpécific point parmi
ceux qu’elle a défendus. Autre forte de chauffe qu’une
chalouppe porte au large/ Chauffé ou carte des pêcheurs de
l’amirauté de Dunkerque. C’eftuninftrument très-pernicieux
à la multiplication des poiffdns. Sac de la carte. Sa cfefcription.
Chaque bateau pêcheur a fa carte. Ufage qu’en font les
pécheurs. Ibid. 258._a.
C hausse , ou delà Cahyi, ( l'Ordre de la ) à Venifc. Son
renouvellement. Marque de cette chevalerie. Suppl. II. 3 81.a.
C hausse , ( Michel-Ange delà) obfervations fur cet antiquaire
& fur fes ouvrages. XII. 391. a.
CHAUSSÉ trop haut, en parlant d’un cheval. III. 258. a.
C haussé , en terme de blafon ; c’eft l’oppofé de chappê.
111.258.^. H R R
CHAUSSÉE, ( Archit.) étym. du mot. Chauffée de pavé.
III. 258. b. Voye% Ponts O C haussées.
Chauffée. Étym. de ce mot. Suppl. IV. 783. a.
C haussée , ( Horlogerie ) defcription , avec figure. III.
258. b.
CHAUSSE-P1É , terme de cordonnier. III. 258.b.
ÇHAUSSE-TRAPE, plante qui fe rapporte au genre des
chardons. Ufages de fa racine. Defcription d’un remede jiar
lequel M. de Lamoignon, intendant de Languedoc, a été
guéri d’une colique néphrétique. III. 258. b. Ufage de la
plante entiere : de la femence pilée, des fleurs de la plante.
Ibid. 259. a.
C hausse-t r a p e , ( Fortifient.) inftrumcnt à quatre pointes
de fer, Oc. Son ufage. III. 259. a.
Chauffe-trapes que font les Indiens. Suppl. 1.77}.a.
C hausse-tr ap e , ( Blafon ) meuble a armoirie. Ufage de
ces machines à la guerre. Suppl. II. 381. a. _ v. .
CHAUSSETTE, partie de l’habillement des jambes. Di-
verfes fortes de chauffett.es. ÜL 259. a.
CHAUSSIN , ( Géogr. ) petite ville de Bourgogne. Siege
que foutint le château en 1036. Singulier devoir qu’avoient
anciennement à remplir les habitans' de ce lieu. Monnoie
battue à Chauflin. Suppl. II. 381.41. | | |
CHAUSSON, partie de l’habillement. Diverfes fortes. III.
259. a. Ce vêtement étoit à l’ufage des dames romaines. Comment
il étoit fait. Chauffon dont on fe fert en jouant à la
paume ; en tirant des armes. Ibid. b. ,
CHAUSSURE : celle de différentes nations. Chauffures
des Grecs , différentes fortes. Age où les Lacédémoniens.
commençoient à porter des chauffures. Les philofophes
n’avoient que des femelles : celles de Pythagore , d’Empé-
docle , de rhiletas. Chauffure des Romains, différentes fortes.
III. 259. b. Chauffures des Juifs. Ils alloient fouventpiés nuds.
Oter fa chauffure & la donner, étoit le figne du tranfport
de la propriété d’une chofe. Chauffure des anciens Germains
8t fur-tout des Goths. Celle des Orientaux, des Européens.
Ibid. 260. a. Obfervations anatomiques fur quelques chauffures
modernes. i°. La chauffure haute des femmes change
tout-à-fait la. conformation naturelle des os du pié. 2 . Les
berfonnes ainfi chauffées , ne peuvent que tres-difficilement
defeendre d’une montagne , marcher long-tems ou vite, ou
fauter. 30. Avantages des chauffures baffes dans les mêmes
circonftances, 40. fur-tout des focques des récollets. 50. Obfervations
fur les fouliers du petit peuple à femelles de bois.
Ibid. b. 6°. Etat de contrainte des mulcles du pied dans les
chauffures hautes. 70. Infirmités qui en peuvent naître. 8°. Les
chauffures hautes peuvent faire courber ,1a taille aux jeunes
perfonnes. 90. Inconvéniens des fouliers trop étroits ou trop
courts. Ibid. 261. a. -
Chauffure, combien la petiteffe extrême que les femmes
recherchent dans la chauffure eft éloignée de la beauté. VI.
340. a. Cette prétendue beauté très-recherchée des dames
E E e e