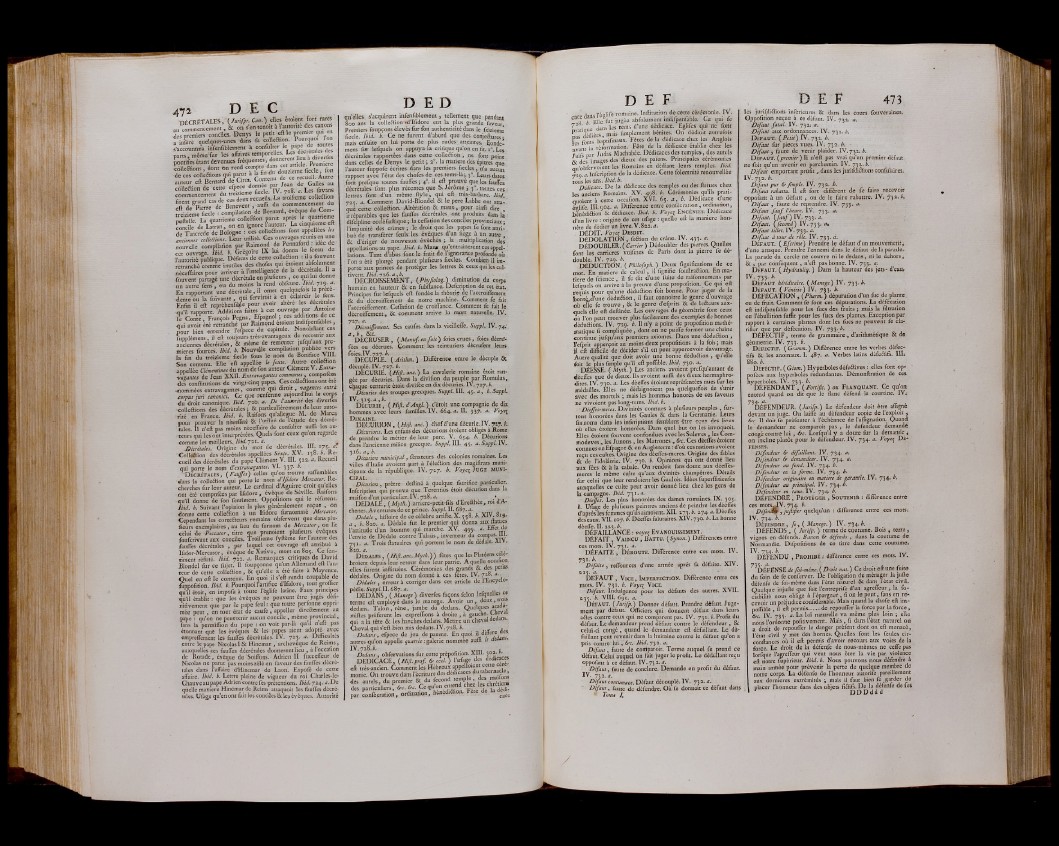
4 7 1 D E C
DÉCRÉTALES, ( Jurifpr. Csn. ) elles étoient fort rares
au commencement, & oh s’en tenoit à 1 autorité des canons
d e s premiers concHes. Denys le petit eft le premier .¡ut en
am L è quelques-unes dans fa colleaion Pourauoi On
s’accoutuma ; infenfiblement à c o n fite le S
mrts même'fur les affaires temporelles. Les décrétées «es
concilions , dont on rend compte dms ce o c l e j em,etc
de ces colleaions oui p atte . ^ / ^ e recueSl^nn"
auteur cft Bernard de Circa. '-on _ Galles au
côlleélion de cette T v . ^ 8 .1 i l s favans
commencement recueils, fat troifieme colleftion
eftde6p"eîre de Benevent, auff. du commencement du
treizième fiecle : compilation de Bernard, évêque de Com-
S e L a quatrième colleé te paru, après le quatrième
concile de Latran, on en ignore 1 auteur. La cinquième eft
de Tancrcde de Bologne : ces colleaions font appellies les
anciennes coUeSions. Leur utilité. C“ ?“vrages reums en une
nouvelle compilation par Raimond de Pennaford : idée de
cet ouvrage. L / . t. Grégoire IX lui donna le fccau de
l'autoritépublique. Défauts de cette coUeflion : d a fouvent
retranché comme inudles des chofes qu. étotent abfolu.nent
nécclfaires pour arriver à l'intelligence de la décrétale.
fouvent partagé une décrétale en plufieurs, ce qui lui donne
un autre fens, ou du moins la rend obfcure. Uid. 719. a.
En rapportant une décréule, il omet quelquefois la prfoé-
dente ou la fuivante , qui ferviroit à en éclaircir J e fenn
Enfin il eft repréhenfilile pour avoir altéré les décréulcs
qu’il rapporte. Additions faites a cet ouvrage par Antoine
?e Conte, François Pegna, Efpagool; ces addinons de ce
qui avoit été retranché par Raimçnd étoient mdifpenfables
pour bien entendre l’efpece du capitule. Nonobftant ces
fopplémens, il eft toujours très-avantageux de recourir aux
anciennes décrénles, & même de remonter jufquaux premières
fources. Ibid. b. Nouvelle compilation puHiée vers
la fin du treizième fiecle fous le nom de Bon,face Vffl.
Son contenu. Elle eft appellée U fisete. Autre colleaion
oppeUée CUmmtmes du nom de fon auteur Clément V. Exira-
■Jacames de Jean XXII. Extravagantes communes, compolies
des conftitutions de vingt-cinq papes. Ces coUcflions ont été
-nommées extravagantes, comme qui diroit, neagnntes exera
corpus juri cnonici. Ce que renferme aujourdhui le corps
du droit canonique. Ibid. 7xX>.a. De l awnrue &eso diverfes
colleaions des décrètales; & particulièrement de leur autorité
en France. Ibid. b. Raifons quaUegue M. de Marca
pour prouver la néceflité & l’utilité de l’étude des décrétales.
fi n’eft pas moins néccffaire de confulter suffi les auteurs
qui les ont interprétées. Quels font céux quon regarde
comme les m e i l l e u r s a. «
-Décritaies. Origine du mot de décrétai«. 111. 175* *•
'Collection des décrétâtes appellécs Scxfc. XV. 138. Recueil
des décrétales du pape Clément V. III. <¡22. a. Recueil
qui porte le nojn d’extravagantes. VI. 337. b.
DecrÉtÂles , ( Fauffes) celles qu’on trouve raffemblées
•dans la colleaion qui porte le nom d’Ifidore Mcrcator Rc-
• cherches fur leur auteur. Le cardinal d’Aguirre croit qu elles
ont été compofées par Ifidore, évêque de Séville. Raiions
qu’il donne de fon fenriment. Oppofuions qui le réfutent.
Ibid. b. Suivant l’opinion la plus généralement reçue , on
donne cette colleaion à un Ifidore furnommé . Mcrcator.
Cependant les corréâeurs romains obfervent que dans plu-
fieurs exemplaires, au lieu du furnom de Mcrcator, on lit
celui de Peccator, titre que prenoient plufieurs évêques
ibufcrivant aux conciles. Troiueme fyfteme fur 1 auteur des
fauffes décrétales , par lequel cet ouvrage eft attribué à
Ifidor-Mercator, évêque de Xativa, mort en 805. Ce fenriment
réfuté. Ibid. 722. a. Remarques critiques de David
Blondel fur ce fujet. Il foupçonne qu’un Allemand eft l auteur
de cette colleaion, 6c qu’elle a été faite à Mayence.
Quel en eft le contenu. En quoi il s’eft rendu coupable de
iuppofition. Ibid. b. Pourquoi l’artifice d’Hidore, tout groifier
qu’il étoir, en impofa à toute l’églife latine. Faux principes
qu’il établit : que les évêques ne peuvent être jugés définitivement
que par le pape feul : que toute perfonne opprimée
peut, en tout état de caufe, appeller directement au
pape : qu’on ne peuttenir aucun concile, même provincial,
fans la permiflion du pape : on voit par-là qu il n eft pas
étonnaqt que les évêques ■& les papes aient adopté avec
cmpreffcmcnt les fauffes décrétales. IV. 713. a. Difficultés
entre le pape Nicolas 18c Hincmar , archevêque de^ Reims,
auxquelles ,ces fauffes décrétales donnèrent lieu, à l’occafton
de Kotade, évêque de Soiffops. Adrien II fucceffeur de
Nicolas ne parut pas moins zélé en faveur des fauffes décrétales
dans l’affaire d’Hincmar de Laon. Expofé -de cette
affaire. Ibid. b. Lettre pleine de vigueur du roi Charlcs-le-
Chauve au pape Adrien contre fes prétentions. Ibid. 714. a.-De
quelle maniéré Hincmar de Reims attaquoit les fauffes décrétâtes.
Ufage qu’en ont fait les conciles 8c le* évêques. Autorité
D E D
qu’elles, s’acquirent infenfiblement, tellement que pendant
800 ans la colleftion>d’Ifidorc eut la plus grande faveur.
Premiers foupçons élevés fur fon authenticité dans le feiziemé
ftecle. Ibid. b. Ce ne furent d’abord que des conjetures ;
mais enfuite on lui porta de plus rudes atteintes. Çonde-
mens fur lefquels on appuya la critique qu’on en fit. i°. LeS
décrétales rapportées dans cette colleéliqh,, ne font point
dans celles de Denys le petit ; a°. la matière des épitres que
l’auteur fuppofe écrites dans les premiers ftedes, n’a aucun
rapport avec l’état des chofes de ces tems-là; 30. Leurs dates
font prefque toutes fauffes j 40. il eft prouvé que les fauffes
décrétales font plus récentes que S. Jérôme ; 50. toutes ces 1
lettres font d’un même ftyle-, qui eft très-barbare. Ibid.
72<. a . Comment David-Biondel 6c le pere Labbe ont attaque
cette colleôion. Altération 8c maux, pour ainft dire ,
irréparables que les fauffes décrétales, ont produits dans la
difcipline eccléfiaftique ; la cef&tion des conciles provinciaux;
l’impunité des crimes ;, le droit que les papes fe font attribué
de transférer feuls les évêques d’un fieee à un autre ,
8c d’ériger de nouveaux- évêchés ; h multiplication des
appellations au pape. Ibid. b. Mau* qif entraînèrent ces appellations.
Tant d’abus font le fruit de l’ignorance profonde où
l’on a été plongé pendant plufieurs fiecles. Combien il importe
aux princes de protéger les lettres 6c ceux qui les cultivent.
Ibid. 726. a,b.
DECROISSEMENT, {Phy/iolog.) diminution du cotps
humain en hauteur 8c en fubftance. Defeription de cet état.
Principes fur lefquels eft fondée la théorie de l’accroiffement
8c du décroiffement de notre machine. Comment fe fait
l’accroiffement. Ceffarion de croiffance. Comment fe fait le
décroiffement, 6c comment arrive la mojrt naturelle. IV.
7 Décroiffement. Ses califes dans la vieillcffe. Suppl. IV. 74;
a , b, 8cc.
DECRUSER, (Manuf.cn.foie) foies crues, foies déertf-
fées ou décrues. Comment les teinturiers décrufent leurs
foies. IV. 717. b. . . .
DECUPLE. ( Arithm. ) Différence entre le décuple &
décuplé. IV. 727. b.
DECURIE. (Hifi.anc.) La cavalerie romaine étoit rangée
par décuries. Dans la divifion du peuple par Romulus,
chaque centurie étoit divifée en dix décuries. IV. 727. b.
Dicuries des troupes grecques. Suppl. 1IL 43. a , b. Suppl.
D é c u r i e , ( Hift.d’Anel. ) c’étoit une compagnie de dix,
hommes avec leurs familles. IV. 664. a. II. 337. a . Voye^
D i x a in e . _ r m -
DECURION, (Hiff anc. ) chef d’une décurie. IV. 727. b.
Dicurions. Les enfans des décurions étoient obligés à Rome
de prendre le métier de leur pere. V. 634. b. Décurions
dans l’ancienne milice grecque. Suppl. III. 43. a . Suppl. IV.
316. a, b. , • • t
Decurión municipal, fénateurs des colonies romaines. Les
villes d’Italie avoient part à l’éleétion des magiftrats municipaux
de la république. IV. 727. b. Voye^ JUGE munic
i p a l . . '
Decurión , prêtre deftiné à quelque facrifice particulier.
Infcriptien qui prouve que Terentius étoit décurion dans la
maifond’unj>articulier.lV.728.<ï. •
DEDALE, (Myth.) arricre-petit-fils d’Ereéthée, roi dA-
thenes. Aventures de ce prince. Suppl. II. 687. a.
Dedale , liiftoire de ce célebre artifte.X. 338. b. XIV. 8iy.
a , b. 820. a. Dédale fut le premier qui donna aux ftatues
l’attitude d’un homme qui marche. XV. 499. a. Effet de
l’envie de Dédale contre Talaiis, inventeur du compas. PL
731. a. Trois ftatuaires qui portent le nom de dédale. XIV.
82°.a. w.«j -¿ ,
D é d a l e s , (H ift .a n c.M y th .)) fêtes que lesPlatécns ccic-
broient depuis leur retour dans leur patrie. A quelle occafion
elles furent inftituées. Cérémonies des grands 8t des petits
dédales. Origine du nom donné à ces fêtes. IV. 728. a.,
Dédales, erreur à corriger dans cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. II. 687. a. n
DEDANS, ( Manège ) diverfes façons félon lcfquelles ce
terme eft employé dans le manege. Avoir un, deux, trois
dedans. Talon, rêne, jambe du dedans. Quelques acaiae-
miftes préfèrent les expreflions à droite , à gauche. Cheval
qui a la tête 8c les hanches dedans. Mettre un cheval dedans.
, Cheval qui s’eft bien mis dedans. IV. 728. b. ,
Dedans, efpece de jeu de paume. En quoi il différé^ ,
autres qu’on appelle quarrés : galerie nommée aufli le dedan .
IV. 728.b. . .
Dedans, obfervations fur cette prépofition. XIII. 302. 0.
DEDICACE, ( Hift.prof. & eccl.) l’ufaee
cft très-ancien. Comment les Hébreux appeiloien ,
monic. On trouve dantl-éeri.ure des délaces
d» aureU, du premier & du fécond .emple, f e g j S S
des parrlculiers,'6-c- fSrcpar
confécration, ordination, bbtiMion. Fête de ^
D E F D E F 473
' , Calife romaine. Inftitutiôn de cêttc ¿éré'monie. IV.
Ca<if b Elle°fut jugée abfolument inclifpenfablc. Ce qui fe
7?®: ’ les tems d’une dédicace. Eglifes qui ne font
PraI'5édiées mais fimplement bénites. On dédioit autrefois
E ï fonts baptifmaux. Fêtes de la dédicace chez les Anglois
nt la rétormation. Fête de la dédicace établie chez les
Juifs par Judas Machabée. Dédicaces des temples, des autels
& des images des dieux des païens. Principales cérémonies
l’obfcrvoient jes Romains en dédiant leurs temples. Ibid.
729.4. lnfcription de la dédicace. Cette folemnité renouvellée
tous les ans. Ibid. bi .
Dédicace. De la dédicace des temples ou des ftatues chez
les anciens Romains. XV. 498. | Cérémonies qu’ils prati-
quoient à cette occafion. XVI. 63. 4, b. Dédicace d’une
éelife III. 904. a. Différence entré confécration, ordination,
bènédiftion & dédicace. Ibid. b. Voye^ E n c é n i e s . Dédicace
d’un livre : origine de cet ufage : quelle eft la maniéré honnête
de dédier un livre. V. 822» 4.
DÉDIT. Voye^ D e sd it .
DÉDOLATlON , feÔion du crâne. IV. 453 .a .
DÉDOUBLER.(Carrier) Dédoubler des pierres.Quelles
font les carrières voifines de Paris dont la pierre fe dédouble.
IV. 729. b. ; .
DÉDUCTION. ( Philofoph. ) Deux ftgntfications de ce
mot. En maticre de calcul, il ftgnifie fouftraftion. En matière
de fcience, il fe dit d’une fuite de raifonnemens par
lefquels dn arrive à la preuve d’une propofition. Ce qui eft
requis pour qu’une déduftion foit bonne. Pour juger de la
bonté/l’une déduftion, il faut connoître le genre d’ouvrage
où e lle fe trouve, & le genre d’efprits & de leâeurs auxquels
elle eft deftinée. Les ouvrages de géométrie font ceux
oii l’on peut trouver plus facilement des exemples de bonnes
dcduâions. IV. 729. b. Il n’y a point de propofition mathématique
fi compliquée , dont on ne puiffe former une chaîne
continue jufqu’aux premiers axiomes. Dans une déduélion *
l’efprit apperçoit au moins deux propofttions à la fois ; mais
il eft difficile de décider s’il en peut appercevoir davantage.
Autre qualité que doit avoir une bonne dédu&ion, qu’elle
foit le plus fimple qu’il eft poflible. Ibid. 730. a.
DÉESSE. ( Myth. ) Les anciens avoient prcfqu autant de
déeffes que de dieux. Ils avoient aufli des dieux hermaphrodites.
IV. 730. 4. Les déeffes étoient repréfentées nues fur les
médailles. Elles ne dédaignoient pas quelquefois de s’unir
avec des mortels ; mais les hommes honorés de ces faveurs
ne vivoient pas long-tcms. Ibid. b.
' Déeffes-mcrcs. Divinités connues à plufieurs peuples, fur-
tout honorées dans les Gaules & dans la Germanie. Leurs
furnoms dans les inscriptions femblent être ceux des lieux
où elles étoient honorées. Dans quel but on les invoquoit.
Elles étoient fouvent confondues avec les Sulevcs, lesCom-
modeves, les Junons, les Matrones, 6>c. Ces déeffes étoient
connues en Efpagne & en Angleterre : d’où ces nations avoient
reçu ces cultes. Origine des déeffes-meres. Origine des fables
& de l’idolâtrie. IV. 730. b. Opinions qui ont donné lieu
aux fées & à la cabale. On rendoit fans doute aux déeffes-
meres le même culte qu’aux divinités champêtres. Détails
fur celui que leur rendoient les Gaulois. Idées fuperftitieufes
auxquelles ce culte peut avoir donné lieu chez les gens de
la campagne. Ibid. 7} 1.4. ^ TV
Déeffes. Les plus honorées des dames romaines. IX. 303.
b. Ufage de plufieurs peintres anciens de peindre les déeffes
d’après les femmes qu’ils aimoient. XII. 273. b. 274. a. Déeffes
deseaux. VII. 107. b. Déeffes falutaires. XIV. 730. b. La bonne
déeffe. II. 223. b.
DÉFAILLANCE : voye^ Ev a n o u is sem e n t .
DÉFAIT, V a in c u , B a t t u . (Synon.) Différences entre
ces mots. IV. 731. a.
DÉFAITE, D é r o u te . Différence entre ces mots. IV.
731. b. ... }
Défaite, reffources d’une armée après fa défaite. XIV.
213. 4.
DEFAUT , V i c e , Im p e r f e c t io n . Différence entre ces
mots. IV. 731. b. Voye[ V ic e .
Défaut. Indulgence pour les défauts des autres. XVII.
233. b. VIII. 691. 4.
D é f a u t . (Jurifp.) Donner défaut. Prendre défaut. Jugement
par défaut. Officiers qui donnent défaut dans leurs
aétes contre ceux qui ne comparent pas. IV. 731. ¿. Profit du
■défaut. Le demandeur prend défaut contre le défendeur, &
celui-ci congé, quand le demandeur eft défaillant. Le défaillant
peut revenir dans la huitaine contre le défaut qu’on a
pris contre lui6*c. Ibid. 73a. 4.
Défaut, faute de coniparoir. Terme auquel fe prend ce
défaut. Celui auquel on fait juger le profit. Le défaillant reçu
oppofant à ce défaut. IV. 732. a.
Défaut, faute de conclure. Demande en profit du défaut.
IV. 712. af
Défaut contumace. Défaut découplé. IV. 7^2. a.
' Défaut, faute de défendre. Où fe donnoit ce défaut dans
* Tome I.
lés juriÇdittions inférieures 8c dans les cours fonvéraines;
Oppofition reçue à ce défaut. IV. 732. a.
Défaut fatal. IV. 732; a.
Défaut aux ordonnances. IV. 732. b.
D é f a u t . (Petit) IV. 732. b.
Défaut fur pièces vues. IV; 732. b. -
Défaut -, fauté de venir plaider. IV. 732. b.
D é f a u t , (premier) Il n’eft pas vrai qu’ün premier défaut
ne foit qu’un avenir en parchemin. IV. 732. L
Défaut emportant profit, dans les jurifcliaions confulaires;
IV. 732. b-.
Défaut pur % fimple. IV. 732. b.
Défaut rabattu. Il eft fort différent de fe faire recevoir
oppofant à un défaut , ou de le faire rabattre. IV. 73 2. b.
Défaut, faute de reprendre. IV. 733. a.
Défaut fauf Cheure. IV. 733. a.
Défaut, (fauf) IV. 733. a.
Défaut, (fécond) IV. 733. 4t
Défaut tiUet. IV. 723. 4;
Défaut à tour de rôle. IV. 733. à. .
D é f a u t . (Efcrime) Prendre le défaut d’un moiivenierit,
d’une attaque. Prendre l’ennemi dans le défaut de la parader
La parade du cercle ne couvre ni le dedans, ni le dehors,
8c, par conféquent, n’eft pas bonne. IV. 733. a.
D é f a u t . ( Hydrauliq. ) Dans la hauteur des jets - d’eau*
IV. 733. b.
D é f a u t héréditaire. (Manege) IV. 733.b.
D é f a u t . ( Vénéfte ) IV. 723. b.
DÉFÉCATION , (Pharm.) députation d’un fuc de plante
ou de fruité Comment fe font ces dépurations. La défécation
eft indifpenfable pour les fucs des fruits ; mais la .filtration
ou l’ébuïlition fuffit pour les fucs des plantes. Exception par
rapport à certaines plantes dont les fucs ne peuvent fe clarifier
que par défécation. IV. 733. A.
DÉFECTIF, terme de grammaire-, d’arithmétique 8c de
géométrie. IV. 733. b. . ,
D é f e c t i f . ( Gramm. ) Différence entre lés verbes défec-
tifs 6c les anomaux. I. 487. a. Verbes latins défe&ifs. I1L
880. b. « H
D é f e c t i f . ( Géom. ) Hyperboles dèfeâives : elles font op-
pofées aux hyperboles teaundantes. Démonftration de ces
hyperboles. IV. 733. b.
DÉFENDANT, (Fortifie.) ou F l a n q u a n t . Ce quon
entend quand on dit que le flanc défend la courtine. IV;
724. 4.
DÉFENDEUR. (Jurifo) Le défendeur doit être afligné
devant un juge. On laifle au défendeur copie de l’exploit *
&c. Il doit fe préfenter à l’échéance de l’affignation. Quand
le demandeur ne comparoît pas , le défendeur demandé
congé contre lu i, &c. Lorfqu’il y a doute fur la demande *
on incline plutôt pour le défendeur. IV. 734. a. Voye{ D e *
FENSES.
Défendeur 6* défaillant. IV. 734. a.
Défendeur & demandeur. IV. 734. a.
Défendeur au fond. IV. 734. b.
Défendeur en la forme. IV. 734. b.
Défendeur originaire en matière de garantie. IV. 734* h.
Défendeur aû principal. IV. 724. b.
Défendeur en taxe. IV. 734. b.
DEFENDRE, P r o t é g e r , S o u t e n i r : différence entre
ces mots—IV. 734. b.
Défendre , jujlifier quelqu’un : différence entre ces mots»
IV. 734. b.
D é f e n d r e , fe> ( Manege.) TV. 734.b.
DÉFENDS , ( Jurifp. ) terme de coutume. Bois , terre,
vignes en défends. Banon 6* défends , dans la coutume de
Normandie. Difpofitions de ce titre dans cette coutume.
IV. 734. b. . .
DÉFENDU , P r o h i b é ; différence entre ces mots. IV.
7 DÉFENSES foi-même. (Droit nat.) Ce droit eft une fuite
du foip de fe conferver. De l’obligation de ménager la jufte
défenfe de foi-même dans l’état naturel 6c dans l’état civil.
Quelque injufte que foit l’entrcprife d’un agreffeur > la fo-
ciabilité nous oblige à l’épargner, fi on le peut * fans en recevoir
un préjudice confidérable. Mais quand la chofe eft impoflible
, il eft permis de repouffer la force par la force,
ô-c. IV. 735- 4. La loi naturelle va même plus loin ; elle
nous l’ordonne positivement. Mais, fi dans l’état naturel on
a droit de repouffer le danger préfent dortt on eft menacé,
l’état civil y met dés bornes. Quelles font les feules cir-
conftanccs où il eft permis d’avoir recours aux voies de la
force. Le droit de la défenfe de nous-mêmes ne ceffe pas
lorfque l’agreffeur qui veut nous ôter la vie par violence
eft notre iupérieur. Ibid. b. Nous pouvons nous défendre à
main armée pour prévenir la perte de quelque membre de
I notre corps. La défenfe de l’honneur autoriic pareillement
I aux dernieres extrémités ; mais il faut bien fe garder de
l placer l’honneur dans des objets fittifs. De la défenfe de fes
» v D D D d d d