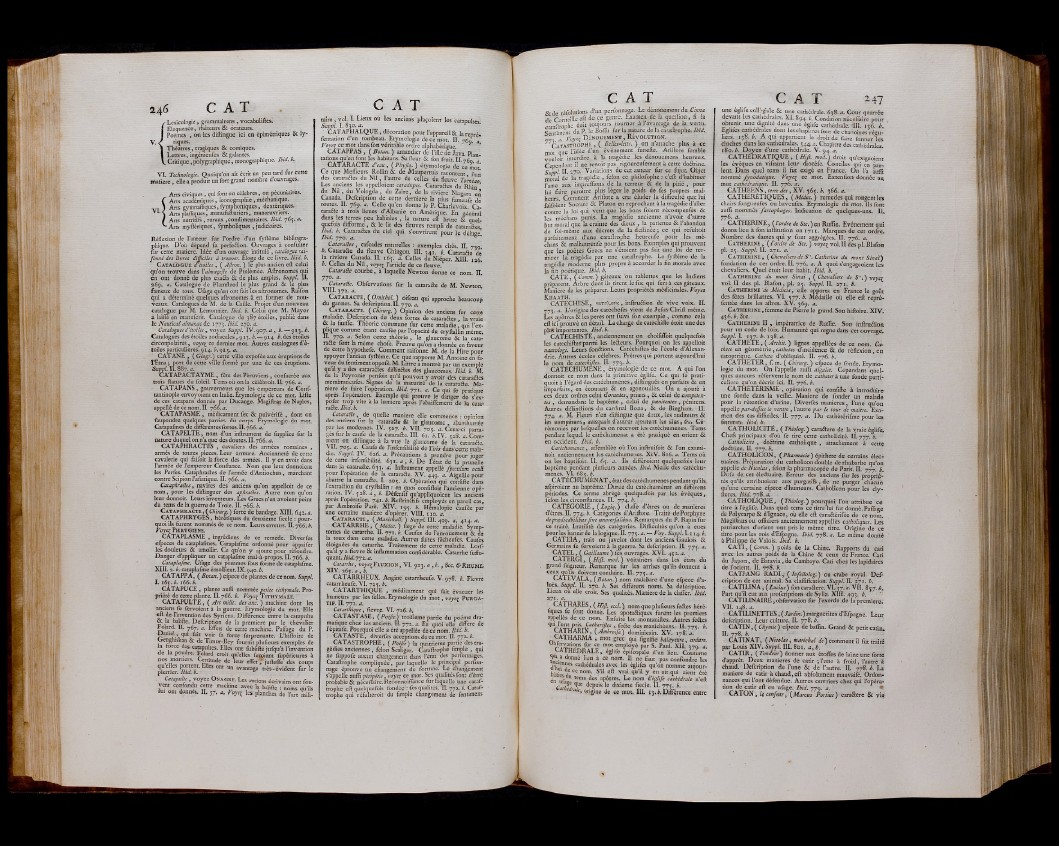
2 4 6 CAT
/■ Lexicologie, grammairens , vocabuliftes.
I Eloquence, rhéteurs & orateurs.
I Poëmes , on les diitingue ici en épimétriques & ly-
V. J riques.
j Théâtres, tragiques & comiques.
I Lettres, ingénieufes & galantes.
V Critique ,polygraphique, monograpliique. Ibid. b.
VI. Technologie. Quoiqu’on ait écrit un peu tard fur cette
matière, elle a produit un fort grand nombre d’ouvrages.
s civiques, qui font ou célébrés, ou pécuniaires,
s académiques, iconographie, méchanique.
Arts c
Ç Arts académiques JTi .
VT 1 Arts gymnaftiques, fymnhoniques, dextériques.
\ Artsplaftiques, manufacturiers, manoeuvriers.
/ Arts nutritifs, ruraux ,condimentaires. Ibid. 765.
Arts myftériques', fymboliques , judiciaires.
Réflexion de l’auteur fur l’ordre d’un fyilême bibliographique.
D’où dépend fa perfection. Ouvrages à confuïter
fur cette matière. Idée d’un ouvrage intitulé, catalogue rai-
fonné des livres difficiles à trouver. Eloge de ce livre. Ibid. b.
C a t a l o g u e d ¿toiles, ( Aftron. ) le plus ancien eft celui
qu’on trouve dans Yalmagefte de Ptolémée. Aflronomes qui
en ont donné de plus exafts & de plus amples. Suppl. II.
269. a. Catalogue de Flamileed le plus grand & le plus
fameux de tous. Ufage qu’en ont fait les aftronomes. Raifon
qui a déterminé quelques aflronomes à en former de nouveaux.
Catalogues de M. de la Caille. Projet d’un nouveau
catalogue par M. Lemonnier. Ibid. b. Celui que M. Mayer
â laiffe en manuferit. Catalogue de 387 étoiles, publié dans
le Nautical almanac de 1773. Ibid. 270. a.
Catalogues d'étoiles, voyez Suppl. IV. 907. a , b. — 913. b.
Catalogues des étoiles zodiacales, 913.b.— 914 b. des étoiles
circonpolaires, voye^ ce dernier mot. Autres catalogues d’étoiles
particulières. 914. b. 915. a.
CATANE , '( Géogr.') cette ville expofée aux éruptions de
l’Etna ; port de cette ville formé par une de ces éruptions.
Suppl. IL 887. a.
C AT APACTAYME, fête des Péruviens, confacrée aux
trois flatues du foleil. Temsoùonla cèlébroit. II: 766. a.
CATAPANS, gouverneurs que les empereurs de Conf-
tantinople envoyoient en Italie. Étymologie de ce mot. lifte
de ces catapans donnée par Ducange. Magiftrat de Naples
appelle de ce nom. II 766. a.
CATAPASME , médicament fec & pulvérifé , dont on
faupoudre quelques parties du corps. Étymologie du mot.
Catapafmes de différentes fortes. II. 766. a.
CATAPELTE, nom d’un infiniment de fupplice fur la
nature duquel on n’a que des doutes. II. 766. a.
CATAPHRACTES , cavaliers des armées romaines ,
armés de toutes pièces. Leur armure. Ancienneté de cette
cavalerie qui fàifoit la force des armées. Il y en avoit dans
l’armée de l’empereur Confiance. Nom que leur donnoient
les Perfes. Cataphraftes de l’armée d’Antiochus, marchant
contre Scipion l’aiiadque. II. 766. a.
Cataphraffes, navires des anciens qu’on appelloit de ce
nom, pour les diftinguer des aphraffes. Autre nom qu’on
leur donnoit. Leurs inventeurs. Les Grecs n’en avoient point
du tems de la guerre de Troie. II. 766. b.
C a taphracte j (Chirurg. ) forte de bandage. XIII. 642. a.
CATAPHRYGES, hérétiques du deuxième fiede : pourquoi
ils furent nommés de ce nom. Leurs erreurs. II. 766, b.
woyè| P h ry g ien s .
CATAPLASME , ingrédiens de ce remede. Divèrfes
efpeces de cataplafmes. Cataplafme ordonné pour appaifer
les douleurs & amollir. Ce qu’on y ajoute pour réfoudre.
Danger d’appliquer un cataplafme mal-à-propos. II. 766. b.
Cataplajme. Ufage des pommes fous forme de cataplafme.
XIIL 2. b. cataplafme émollient. IX. 940. b.
CATAPPA, ( Botan. ) efpece de plantes de ce nom. Suppl.
I. i6c. ¿. 166. ¿.
CÀTAPUCE, plante aufli nommée petite titkymale. Propriété
de cette plante. II. 766. b. Voye{ T ithymale.
CATAPULTE, ( Art milît. des anc. ) machine dont les
amâens fe fervoient à la guerre. Etymologie du mot. Elle
«ft de L’invention des Syriens. Différence entre la catapulte
& la balifte. Defcription de la première par le • chevalier
rolard. II. 767. a. Effets de cette machine. PafTage du P.
lianiel * qui fait voir fa force furprenante. L’hiftoire de
Axenghiskan & de Timur-Bey fournit plufieurs exemples de
la force ües catapultes. Elles ont fubhfté jufqu’à l’invention
e a pou re. Folard croit qu’elles feraient fupérieures à
f e ™ » * leur effetfjufteffe des coups
quelles portent. Elles onr u„ av»magc tiès-évident furie
pierrier. Ibid. b.. 0
■ ’ 7 ° yeZ ° NA<Ï I-vent confondu cette machine ü av eBc la| ba léifctrei v:a innosm osn tq Cuo’iuls
lui ont donnés. II. 37. u. Voyt^ les planches de l’art mill-
C A T
taire, vol. I- Lieux où les anciens pfaçoient les catapultes
Suppl. I. 830. a.
CATAPHALQUE, décoration pour l’appareil & la repré-
fentation d’un tombeau. Etymologie de ce mot. II. 760 à
Voye{ ce mot dans fon véritable ordre alphabétique. *
CATAPPAS, ( Botan. ) amandier de l’ifle de Java. Plantations
qu’en font les habitans. Sa fleur & fon fruit, l ì -76a À
CATARACTE I p p É p É l de ce mot.
Ce que Meilleurs Rollm & de Maupertuis racontent Ymi
des cataraftes du Nil, l’autre de celles du fleuve Toméao
Les anciens les appelloient catadupes. Cataraftes du Rhin ’
du Nil, du Vologda, du Zaïre, de la riviere Niagara en
Canada. Defcription de cette derniere la plus fameufe de
toutes. II.' 769. a. Celle qu’en donne le P. Charlevoix. Catarafte
à trois lieues d’Albanie en Amérique. En général
dans les terres peu habitées , la nature eft brute & quel*
quefois difforme , & le lit des fleuves rempli de cataraftes
Ibid. b. Cataraftes du ciel qui s’ouvrirent pour le déluge*
Ibid. 770. a. ° *
Catara fies, cafcades naturelles : exemples cités. II. 730
b. Catarafte du fleuve Chingou. III. 34t. b. Catarafte de
la riviere Canada. II. 165. a. Celles duNiéper. XIII. 126.
b. Celles du Nil, voye[ l’article de ce fleuve.
Cataraffe courbe, à laquelle Newton donne ce nom. II
770. a.
,C ? taraiie- Obfervations fur la catarafte de M. Newton.
VIII. 372. a.
C a t a r a c t e , ( Omithol. ) oifeau qui approche beaucoup
du gannet. Sa defcription. II. 770. a.
C a t a r a c t e . ( Chirurg. ) Opinion des anciens fur cette
maladie. Defcription de deux fortes de cataraftes , la vraie
& la fauffe. Théorie commune fur cette maladie, qui l’explique
comme étant cauYée par l’opacité du cryftallin même.
a.77?' a‘ n Cette thébrie » le glaucome & la cataracte
font la meme choie. Preuve qu’on a donnée en faveur
de tette hypothefe. Comment raifonne M. de la Hire pour
appuyer l’ancien fyftême. Ce que rapporte M. Antoine en faveur
du fentiment oppofé. M. Littre a montré par un exemple
qu’il Y a des cataraftes diftinftes des glaucomes. Ibid. b. M.
de la Peyronie penfoit qu’il pouvoit y avoir des cataraftes
membraneufes. Signes de la maturité de la catarafte. Maniere
de faire l’opération. Ibid. 771. a. Ce qui fe pratique
après 1 opération. Exemple qui prouve le danger de s’ex-
pofer trop vite à la lumiere après l’abaifTement de la catarafte.
Ibid. b.
Cataraffe, de quelle maniere elle commence : opinion
des anciens fur la catarafte & le glaucome , abandonnée
par les modernes. IV. 527. b. VII. 705. *. Ceux-ci partagés
fur la caufe de la catarafte. III. 61. b. IV. 528. a. Comment
on diitingue à la vue le glaucome de la catarafte.
VII. 703. a. Caule de l’infonfibihté de Y iris dans'cette maladie.
Suppl. IV. 626. a. Précautions à prendre pour juger
de cette infenfibilité. 631. a , b. De l’état de la prunelle
dans la catarafte. 633. a. Infiniment appellé Jpeculum oculi
pour 1 opération de la catarafte. XV. 449. a. Aiguille pour
abattre la catarafte. I. 203. b: Opération qui confifle dans
1 extraction du cryilalhn : en quoi confifloit l’ancienne opération,
IV. 328. a y b. Défenfif qu’appliquoient les anciens
après 1 opération. 741. b. Reftrinaifs employés en pareil cas,
par Ambroifo Paré. XIV. 193. b. Hemalopiè caufée par
ime certaine maniere d’opérer. VIII. 110. a.
C a t a r a c t e , ( Maréchall. Y Suppl III. 40g. a. 414. a.
CATARRHE, (Médec. ) uege de cette maladie. Symptômes
de catarrhe. II. 771. b. Caufes de l’enrouement & de
la toux dans cette maladie. Autres fuites fâcheufes. Caufes
éloignées du catarrhe. Traitement de cette maladie. Lorf-
qu’il y a fievre & inflammation confidérable. Catarrhe fuffo-
quant. Ibid. 772. a.
Catarrhe, voye^ F LU X IO N , VI. 923. a , b. , &c. & RHUME.
XIV. 263. a t b,
CATARRHEUX. Angine catarrheufe. V. 978. b. Fievre
catarrheufe. VI. 723. b.
CATARTHIQUE , médicament qui fait évacuer les
humeurs par les felles. Etymologie du mot, voyez P u r g a t
i f . II. 772. a.
Catarthique, fievré. VI. 726. b.
CATASTASE, ( Poéjic) troifieme partie du poème dramatique
chez les anciens. II. 772- u. En qiiôi elle différé de
l’épitafe. Pourquoi elle a été appellée de ce nom. Ibid. b.
CATASTE, diverfes acceptions de ce mot. II. 772. b.
CATASTROPHE, ( Poifie) la quatrième partie des tragédies
anciennes, félon Scaliger. Cataflrophe fimple , qui
ne fuppofe aucun changement dans l’état des perfonriages.
Cataflrophe compliquée, par laquelle le principal perlon-
nage éprouve un changement de fortune. 'Le changement
s’appelle aufli péripétie, voye^ ce mot. Ses qualités font d’être
probable & néceflaire. Reconnoiflance fur laquelle une cataftrophe
eft quelquefois fondéç 'Ces qualités, il. 772. b. Cataf*
trophe qui réfudltteroit du fimple changement de fentimens
C A T C A T 247
o. de réfolutions d’un perfonnage. Le dénouement du Cmna
de Corneille eft de ce genre. Examen de la queftion, fi la
i*araftroDhc doit toujours tourner à l’avantage de la vertu.
Sentiment du P. le Boflii fur la nature de la cataftrophe. Ibid.
a " V o y t i D é n o u e m e n t , R é v o l u t i o n .
r ^ C a t a s t r o p h e , ( Belles-lettr. ) on n’attache plus à ce
mot que l’idée d’un événement funefle. Ariftöte femble
vouloir interdire- à la tragédie les dénouemens heureux.
Cependant il ne tenoit pas rigoureufement à cette doftrine.
Suppl. II. 270. Variations de cet auteur fur ce fujet. . Objet
moral de la tragédie , félon ce pliilofophe : c’efl d’habituer
l’ame aux impreflions de la terreur & de la pitic , pour
lui faire paroitre plus léger le poids de fes propres malheurs.
Comment Ariflote a cru éluder la difficulté que lui
faifoient ‘Socraté & Platon en reprochant à la tragédie d’aller
contre la loi qui veut que les bons foient récompenfés &
les médians punis. La tragédie ancienne n’avoit d’autre
but moral que la crainte des dieux , la patience & l’abandon
de foi-même aux décrets de la deftinée ; ce qui réfultoit
parfaitement d’une cataflrophe heureufe pour les médians
& malheureufe pour les bons. Exemples qui prouvent
que les poètes Grecs ne s’étoient pas fait une loi de terminer
la tragédie par une cataflrophe. Le fyftême de la
tragédie moderne plus propre à accorder la fin morale avec
la nn poétique. Ibid. b.
CATE, ( Comm.) gâteaux 'ou tablettes que les Indiens
préparent. Arbre dont ils tirent le fuc qui fort à ces gâteaux.
Maniéré de les préparer. Leurs propriétés médicinales. Voyez
K h a a t h .
CATECHESE, hotvXtws, inflruftion de vive voix. II.
773. a. L’origme des catechefes vient de Jefus-Chrift même.
Les apôtres & les peres ont fuivi fon exemple , comme cela
eft ici prouvé en détail. La charge de catécliifle étoit une des
pluS importantes. Ibid. b.
CATECHISTE, anciennement on choififloit quelquefois
les catechiftesrparmi les lefteurs. Pourquoi on les appelloit
nautologi. Leurs fonftions. Catéchiftes de l’école d’Alexandrie.
Autres écoles célébrés. Prêtres qui portent aujourd’hui
le nom de catechißes. H. 773. b.
CATÉCHUMÈNE, étymologie de ce mot. A qui l’on
jdonnoit ce nom dans la primitive églifo. Ce qui fe prati-
quoit à l’égard des catéchumènes, diftingués en parfaits & en
imparfaits, en écoutans & en agenouillés. On a ajouté à
ces .deux ordres celui eYorantcs, prians, & celui de compétentes
, demandant le baptême , celui de petnitentes , pénitens.
Autres diftinftions du cardinal Bona, & de Bingham. II.
774. a. M. Fleuri n’en diitingue que deux, les auditeurs &
les compétens, auxquels d’autres ajoutent les élus, &c. Cérémonies
par lefquelles on recevoit les catéchumènes: Tems
pendant lequel le catéchumenat a été pratiqué en orient &
en occident. Ibid. b.
Catéchumènes, aflemblée où l’on inflruifoit & l’on exami-
noit anciennement les catéchumènes. XIV. 816. a. Tems où
on les baptifoir. II. 63. a. Ils différoient quelquefois leur
baptême pendant plufieurs années. Ibid. Meile des catéchumènes.
VI. 683. b.
CATÉCHUMÉNAT, état des catéchumènes pendant qu’ils,
afoiroient au baptême.’ Durée du catéchuménat en différens
périodes. Ce terme abrégé quelquefois par les évêques,
.félon les circonflances. II. 774. b.
CATÉGORIE, ( Logiq. ) clafle d’êtres ou de maniérés
d’êtres, ü. 774. b. Catégories d’Ariflote. Traité de Porphyre
depradiedbilibus five univerfalibus. Remarques du P. Rapinfur
ce traité. Inutilité des catégories. Difficultés qu’on a eues
pour les bannir de la logique.ll. 773. a. — Voy. Suppl. 1. 114. b.
CATEIA, trait ou javelot dont les anciens Gaulois &
Germains fe fervoient à la guerre. Sa defcription. ü . 773. a.
CATEL, ( Guillaume ) fes ouvragés. XVI. 432. a. \
CATERGI, {Hiß. mod.) voituriers dans les états du
grand feigneur. Remarque fur les arrhes qu’ils donnent à
ceuxqu’ils- doivent conduire. II. 773. a.
CATEVALA, ( Botan. ) nom raalabare d’une efpece d’a-
loes. Suppl. n. 270. b. Ses différens noms. Sa defcription.
Lieux ou elle croît. Scs qualités. Maniéré de la claffer. Ibid.
3.71. a.
. CATHARES, ( Hiß. eccl. } nom que plufieurs foftes héré-
f ont donné. Les apotaftiques furent les premiers
appellés de ce nom. Enfuite les montanifles. . Autres foftes
ßln\S,at^fari^<s » des manichéens; H. 773. b.
. {Ambroife) dominicain. XV. 178\a.
Okf CHARMA , mot grec qui lignifie bàlayeure, ordure.
r * Â i u.r. C® m.ot emPloyé par S. Paul. XII. 370. a.
CATHÉDRALE, églifo épifcopale d’un lieu. Coutume
qui a donné lieu à ce nom. Il ne faut pas confondre les
dîlïpp? cathédrales avec les églifes qu’on nomme aujour-
bâtie« 1 Ce nom’ p i Yrai ^u il y en ait qui aient été
én 1 tems des apôtres. Le nom d’églife cathédrale n’eft
C H ! depuis le dixième fiecle. II. 773. b.
a e raltt qrjgine de ce mot. III. 13.¿.Différence entre
une églife colligiale & une cathédrale. 638. a. Cour qirarrée
devant les cathédrales. XI. 894. b. Condition néceflaire pour
obtenir une dignité dans une églifo cathédrale. ‘III. 136. ¿.
Eglifos cathédrales dont les chapitres font de chanoines régu-
hers. ,138. b. A qui appartient le droit de faire fonner lés
cloches dans les cathédrales. 344. a. Chapitre des cathédrales
180. b. Doyen d’une cathédrale. V. 94. a.
CATHÉDRATIQUE, (Hijl. mod.) droit qu’exigeoient
les évêques eh vifirant leur diocèfo. Conciles qui en parlent.
Dans quel tems il fut exigé en France. On l’a aufli
nommé fynodatique. Voyeç ce mot. Extenfion donnée au
mot cathédratique. II. 776. a.
CATHÉENS, terre des, XV. 363. b. 366. a.
CATHÉRÉTIQUES, ( Médec. ) remedes qui rongent les
chairs fongueufos ou baveufos. Etymologie du mot. ils font
aufli nommés farcophagcs. Indication de quelques-uns. IL
776. a.
CATHERINE, ( f ordre de S te. ) en Ruflie. Evénement qui
donna lieu à fon infutution en 1711. Marques de cet ordre.
Nombre des dames qui y font aggrégées. II. 776. d.
C a t h e r in e , ' {l'ordre de S te. ) voyet vol. II des pl. Blafon
pl. 23. Suppl. II. 271. a.
C a t h e r in e y ( Chevaliers de S''. Catherine du mont Sinaï)
fondation de cet ordre. II. 776. a. A quoi s’engageoient les
chevaliers. Quel étoit leur habit. Ibid. b.
C a t h e r in e du mont Sinaï , ( Chevaliers de S". ) voyeç
vol. II des pl. Blafon, pl. 23. Suppl. II. 271. b.
C a t h e r in e de Médicis, elle apporta en France le goût
des fêtes brillantes. VI. 377. b. Médaille où elle efl repré-
fontée dans les affres. XV. 369. a.
C a t h e r in e , femme de Pierre le grand. Son hiffoire. XTV.
436. b. Scc.
C a t h e r in e II , impératrice de Ruflie. Son inflruftion
pour un code de loix. Humanité qui regne dans cet ouvrage.
Suppl. ï. 137. b. 138. <2.
CATHETE, ( Archit. ) lignes appellées de ce nom. Ca~
thete en géométrie, cathetes d’incidence & de réflexion, en
catoptrique. Cathete d’obliquité. II. 776. b.
CATHETER, f. m. ( Chirurg. ) efpece de fonde. Etymologie
du mot. On l’appelle aufli algalie. Cependant quelques
auteurs réforventle nom de cathéter une fonde parti-
culiere qu’on décrit ici. II. 776. b.
CATHÉTÉRISME , opération qui confifle à introduire
une fonde dans la veflie. Maniéré de fonder un malade
pour la rétention d’urine. Diverfes maniérés, l’une qu’on
appelle par-dejfus le ventre , l’autre par le tour de maître, txa-
men des cas difficiles. H. 777. a. Du cathétérifme pour les
femmes. Ibid. b.
CATHOLICITÉ, ( Théolog. ) caraftere de la vraie églifo.
Chefs principaux d’où fe tire cette catholicité. II. 777. b.
Catholicité , doftrine catholique , attachement à cettç
doftrine. II. 777. b.
CATHOLICON, ( Pharmacie) épi thete de certains élec-
tuaires. Préparation du catholicon double de rhubarbe qu’on
appelle de Nicolas > félon la pharmacopée de Paris. IL 777 '. b.
Dofo de. cet éleftuaire. Erreur des anciens fur les propriétés
qu’ils attribuoient aux purgatifs, de ne purger chacurt
qu’une certaine efpece d’humeurs. Catholicon pour les cly-
lteres. Ibid. 778. a.
CATHOLIQUE, {Théolog.) pourquoi l’on attribue ce
titre à l’églifo. Dans quel tems ce titre lui fut donné. Paflage
de Polycarpe & d’Ignace, où elle eft caraftérifée de ce nom.
Magiftrats ou officiers anciennement appëllés catholiques. Les
patriarches d’orient ont pris le même titre. Origine de ce
titre pour les rois d’Efoagne. Ibid. 778 .a. Le même donné
à Philippe de Valois. Ibid. b.
CATI, ( Comm. ) poids de la Chine. Rapports du cari
avec les autres poids de la Chine & ceux de France. Cari
du Japon, de Batavia, de Cambaye. Càti chez les lapidaires
de l’orient. II. 778. b.
CATJANG RADI, ( Infeffolog. ) ou cfahe royal. Defcription
de cet animal. Sa claflification. Suppl. II. 271. b.
CATILINA, \Lucius) fon caraftere. VI. 37. a. VII. 837. b.
Part qu’il eut aux proferiprions de Sylla. XIIL 403. b.
CATILINAIRL, obfervation fur l’éxorde.de la première.-
VII. 148. tf.
CATILINETTES, {Jardin.)marguerites d’Efpagne. Leur
defcription. Leur culture. H. 778. b.
C ATIN ,( Chymie) 'efpece de baflin. Grand & petitcatin.
II.778. b.
CÂTINAT, {Nicolas, maréchal de) comment il fut traité
par Louis XIV. Suppl. III. 801. a, b.
CATIR, ( Tondeur) donner auk étoffes de laine une forté
d’apprêt. Deux manières de catir ; l’une à froid, l’autre à
chaud. Defcription de l’une 8c de l’autre. II. 778. b. La
maniéré de catir à chaud,eft abfolument mauvaife. Ordonnances
qui l’ont défendue. Autres ouvriers chez qui l’opération
de catir eft en ufage. Ibid. 779. a.
CATON , lé cenfeur, {Marcus Portius) caraftere & yiç