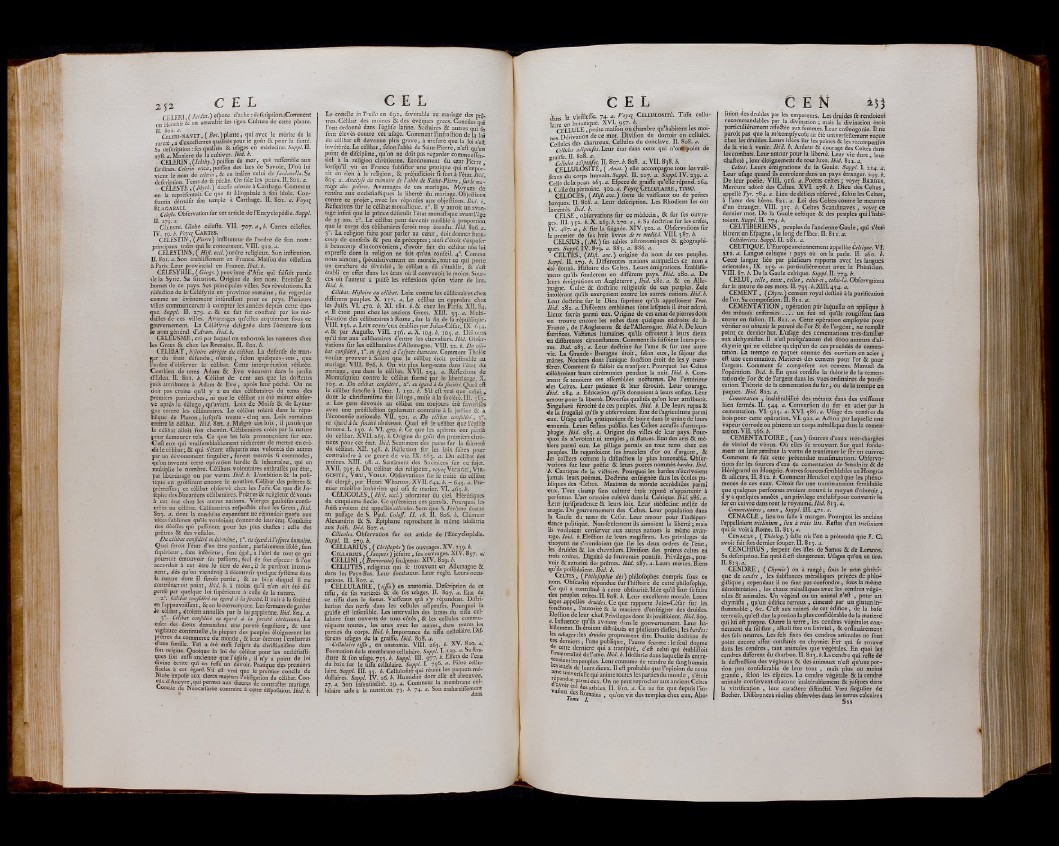
2 .-J 2 C E L
CELERI >( Jardin. ) efpece d’ache : defeription.*Comment
on blanchit & on attendrit les tiges. Culture de cette plante.
^ CEtau-NAVET, ( Bot. ) plante, cjuï avec le mérite de la
rareté Ia d’excellentes qualités pour'le gout & pour la fanté.
Sa defeription : les qualités & ufages en médecine. Suppl. II.
278. a. Maniéré de la cultiver.Ibid. b.
CELERIN, (Ichthy.) poiffon de mer, qui reffemble aux
fardines. Celerin erica, poiffon des lacs de Savoie^ D’où lui
vient le nom de celerin, Sx. en italien celui de fardanella. Sa
defeription. Tems de fa pèche. On fale les petits. IL 801. g
CÉLESTE, ( Myth. ) déeffe adorée à Cartilage. Comment
■on la repréfentoit. Ce que fit Eliogabale à fon idole. Con-
ftantin détruifit fon temple à Carthage. II. 801. a. Voye5;
É la g a b a l e . t
Cclejle. Obfervation fur cet article de ^Encyclopédie. Suppl.
II. 279. a.
C éleste. .Globe célefte. VII. 707.a , b. Cartes céleftes.
IV. i | b. Voye{ C a r t e s . -
CELEST1N, (Pierre) inftituteur de l’ordre de fon nom :
principaux traits qui le concernent. VIII. 912. a.
CÉLESTINS,ÇHift. ceci.)ordre religieux. Son-inititution.
U. 801. a. Son établiffement en France. Maifon des céleftins
à Paris. Leur provincial en France. Ibid. b.
- CÉLÉSYRIE, ( Géogr. ) province d’Afie qui faifoit partie
de la Syrie. Sa fituation. Origine de fon nom. Etendue &
bornes de ce pays. Ses principales villes. Ses révolutions. La
réduction de la Céléfyrie en province romaine, fut regardée
comme un événement intéreffant pour ce pays. Plufieurs
villes commencèrent à compter les années depuis cette époque.
Suppl. II. 279. a. 8c ce fait fut conftaté par les médailles
de ces villes. Avantages qu*elles acquièrent fous ce.
gouvernement. La Céléfyrie défignée dans l’écriture fous
Je nom général d'Aram. Ibid. b.
. CÉLEUSME, cri par lequel on exhortoit les rameurs chez
les Grecs & chez les Romains. IL 801. b.
CÉLIBAT, kiftoire abrégée du célibat. La défenfe de manger
du fruit défendu, n’étoit, félon quelques-uns, que
l ’ordre d’obferver le célibat. Cette interprétation réfutée.
Combien de tems Adam & Eve vécurent dans le jardin
d’Eden. II. 801. b. Célibat de cent ans que les doâeurs
juifs attribuent à Adam & E v e , après leur péché. On ne
doit pas croire qu’il y a eù des célibataires du tems des
premiers patriarches, ni que le célibat ait été mieux obfer-
vé après le déluge, qu’avant. Loix de Moi'fe & de Lycur-
gue contre les célibataires. Le célibat toléré dans la république
de Platon, jufqu’à trente - cinq ans. Loix romaines
contre le célibat. Ibid. 802.a.Malgré ces loix, il paroîtque
le célibat alloit fon chemin. Célibataires créés par la nature
pour demeurer tels. Ce que les loix prononçoient fur eux.
Ceft eux qui vraifemblablement tâchèrent de mettre en crédit
le célibat; & qui s’étant affujettis aux volontés des autres
par un dévouement fuigulier, furent trouvés fi commodes,
qu’on inventa cette opération hardie & inhumaine, qui en
multiplie le nombre. Célibats volontaires embraffés par état,
par libertinage ou par vertu. Ibid. b. L'ambition & la politique
en groflirent encore le nombre. Célibat des prêtres &
prêtrefles; ce célibat obfervé chez les Juifs. Ce que dit Jo-
fephe des Nazaréens célibataires. Prêtres & religieux dévoués
à cet état chez les autres nations. Vierges gauloifes confa-
crées au célibat. Célibataires refoeôés chez les Grecs, Ibid.
803. a. dont la conduite cependant ne répondoit guefe aux
idées fublimes qu’ils vouloient donner de leur état. Conduite
des déefTes qui paifoient pour les plus chaites : celle des
prêtres & des veftales.
Du célibat confidéré en lui-même, i°. eu égard à l ’efpece humaine.
Quel feroit l’état d’un être penfant, parfaitementUolé,fans
fupérieur , fans inférieur, fans égal, à l’abri de tout ce qui
pouiroit émouvoir fes pallions, fêul de fon efpece : fi l’on
accordoit a cet être le titre de bon, il le perdrait incontinent
, dès qu’on viendrait à découvrir quelque fyftême dans
la nature dont il feroit partie ; & au bien duquel il ne
contribuerait point, Ibid. b. à moins qu’il n’en eût été dif-1
penfé par quelque loi fupéricure à celle de la nature.
■-a0. Célibat confidéré eu égard à la fociété. Il nuit à la fociété
en l’appauvriffant, & en là corrompant. Les fermons de garder
Je célibat, ¿toient annullés par la loipappienne.Ibid. 804. a.
3°. Célibat confidéré eu égard à la Jociété chrétienne. Le
culte des dieux demandant une pureté finguliere, & une
vigilance continuelle, la plupart des peuples éloignèrent les
prêtres du commerce du monde, & leur ôterent l’embarras
d une famille. Tel a été àufli l’efprit du chrifHanifme dans
ion -origine. Quoique la loi du célibat pour les eccléfiafti-
ques foit auffi ancienne que l’églife, il n’y a point de loi
divine écrite qui en faffe un devoir. Pratique des premiers
«ecles.à cet égard. S’il eft vrai que le premier concile de
«icée unpofe aux clercs majeurs l’obligation du célibat. ConcS
Î-i SyrS?AqU1 W¡ 8 1 aux 8SS1 contrafter mariage,
voncile de Néocæfarée contraire à cette difpofition. lbid.b.
C E L
Le coftcile in Trullo en 692, favorable au mariage des prêtres.
Célibat des moines & des évêques grecs. Conciles qui
l’ont ordonné dans l’églife latine. Seâaires & autres qui fe
font élevés contre cet ufage. Comment l’infraétion de la loi
du célibat eft devenue plus grave, à mefure que la loi s’eft
invétérée. Le célibat, félon l’abbé de Saint-Pierre, n’eft qu’un
point dé difeipline, qu’on ne doit pas regarder comme effen-
tiel à la religion chrétienne. Etonnement du czar Pierre
lorfqu’il vit en Franco fubfifter une pratique qui n’importât
en rien à la religion, & préjudicioit fi fort a l’état. Ibid.
805. a. Analyfe du mémoire de l’abbé de Saint-Pierre, furie mariage
des prêtres. Avantages de ces mariages. Moyens de
rendre aux eccléfiaftiques la liberté du mariage. Objections
contre ce projet, avec les réponfes aux objections. Ibid. b.
Réflexions fut le célibat rtionaftique. i°. Il y auroit un avantage
infini que le prince défendît l’état monaftique avant l’âge
de 25 ans. 20. Le célibat peut devenir nuifible à proportion
que le corps des célibataires feroit trop étendu. Ibid. 806. a.
30. La religion faite pour parler au coeur, doit donner beaucoup
de confeils & peu de préceptes ; ainfi c’étoit s’expofer
à beaucoup d’inconveniens, d’avoir fait du célibat une loi
expreffe dont la religion ne fait qu’un confeil. 40. Comme
nous aimons, fpéculativement en morale, tout ce qui porte
un caraétere de févérité, le célibat a dû s’établir, & s’eft
établi en effet dans les états où il convenoit le moins. Sources
où l’auteur a puifé les réflexions qu’on vient de lire.
Ibid. b.
\ Célibat. Hifloire du célibat. Loix contre les célibataires chez
différens peuples. X. 117. a. Le célibat en opprobre chez
les Juifs. VI. 470. b. XI. 181. b.8c chez les Parfis. XII. 84.
a. 11 étoit puni chez les anciens Grecs. XIII. 93. a. Multiplication
des célibataires à Rome, fur la fin de la république.
VIII. 1 $6. a. Loix contr’cux établies par Jules-Céfar, IX, 654.
a. 8c par Augufte. VER. 156. a. X. 104. b. 105. a. Difcours
qu’il tint aux célibataires d’entre les chevaliers. Ibid. Obfer-
vations fur les célibataires d’Allemagne. VIII. 22. b. Du célibat
confidéré, i°. eu égard-à Vefpece humaine. Comment Thaïes
voulut prouver à Solon que le célibat étoit préférable au
mariage. VHL 876. b. On vit plus long-tems aans l’état du
mariage, que dans le célibat. XVII. ¿54. a. -Réflexions de
Montefquieu contre le célibat formé par le libertinage. X.
105. a. Du célibat confidéré, 20. eu égard à la fociété. Quel eft
le célibat funefte à l’état. L 150. b. S’il eft vrai que celui *
dont le chriftianifme fait l’éloge, nuife à la fociété. III. 383.
a. Les gens dévoués au célibat ont toujours été favorifes
avec une prédileétion également contraire à la juftice & à
l’économie nationale. VU, 301. a. Du célibat confidéré, 30.
eu égard à la fociété chrétienne. Quel eft le célibat que l’églife
honore. I. 150. b. VI. 470. b. Ce que les apôtres ont penfé
du célibat. XVII. 263. b. Origine du goût des premiers chré-,
tiens pour cet état. Ibid. Sentiment des peres fur la fainteté
du célibat. XII. 348. b. Réflexion fur les loix faites pour
contraindre à ce genre de vie. IX. 663. a. Du célibat des
moines. XIII. 98. a. Sentiment des Sociniens fur ce fujet.
XVII.39c. b. Du célibat des religieux,voye^V i e r g e ,V i r g
in i t é , Voeu , V o ile . Obfervations fur le traité du célibat
du clergé, par Henri Wharton. XVII. 642. b. - 643. a. Premier
mmiftre luthérien qui ola fe marier. VI. 463. b.
CÉLICOLES, ( Hijl. ceci.) adorateur du ciel. Hérétiques
du cinquième fiecle. Ce qu’étoient ces gens-là. Pourquoi les
Juifs avoient été appellés célicoles. Sens que S. Jérôme donne
au paffage de S. raul. Colojf. II. 18. 11. 806. b. Clément
Alexandrin & S. Épiphane reprochent la même idolâtrie
aux Juifs. Ibid. 807. a.
Célicoles. Obfervation fur cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. H. 279. b.
CELLARlUS, ( Chriflophe) fes ouvrages. XV. 230.b.
C ellarius , (Jacques) jéfuitc , fes ouvrages. XIV. 837. ai
CELLINI, ( Benvenuto) fculpteur. X IV. 829. b.
CELLITES, religieux oui fe trouvent en Allemagne &
dans les Pays-Bas. Leur fondateur. Leur réglé. Leurs occupations.
IL 807. a.
CELLULAIRE, ( tijfu) en anatomie. Defeription de ce
tiffu, de fes variétés & de fes ufages. II. 807. a. Etat de
ce tiffu dans le foetus. Vaiffeaux qui s’y répandent. Diftri-
bution des nerfs dans les cellules adipeuies. Pourquoi la
graiffe eft infenfible. Les intervalles des lames du tiflù cellulaire
font ouverts de tous côtés, & les cellules communiquent
toutes, les unes avec les autres, dans toutes les
parties du corps. Ibid. b. Importance du tiffu cellulaire. Différens
ufages de la graiffe. Ibid. 808. a.
•Cellulaire tiffu, en anatomie. VIII. 263. b. XV. 820. a.
Formation delà membrane cellulaire. Suppl. 1. t.20. ¿.Saitru*
ôure & fon ufage. 733. b. Suppl. III. 977. b. Effets de l eau
du bain fur le tiffu cellulaire. Suppl. I. 736. a- Fibre cellulaire.
Suppl. III. 35. b. Cellulofité qui réunit les paquets médullaires.
Suppl. IV. 26. b. Humidité dont elle eft abreuvée.
27. a. Son infenfibilité. 29. a. Comment la membrane cellulaire
aide à la nutrition. 73. b. 74. a. Son endurciffement
dans
CEE dans b vieiilciTe. 74. * H » C eilulosité Tiffn cellùiair.
en botanique XVI. 957. i.
C E L L U L E , peute maifon ou chambre qu habitent les moines
Dérivation de ce mot. Divifion du dortoir én cellules.
Cellules dès chartreux. Cellules du conclave. II. 808. ¿.
Cellules adipeufes. Leur état dans ceux qui n’on&poiiit de
graiffe. II. 808. a.
Cellules àdipeüfes. IL 807. b. 808. a. VIL 838. b.
CELLULOSITÉ, ( Anat. ) elle accompagne toüs les vaif-
Jeaux du corps humain. Suppl. H. 227. a. Suppl. IV. 239. a.
Celle de la peau. 263. a. Efpece de graiffe qu’elle répand. 264.
b. Celle du péritoine. 302. a. Voye[ C ellulaire , tissu.
CÉLOCfcS, {Uifit anc.) forte de vaiffeaux ou de petites
barques. II. 808. à. Leur defeription. Les Rhôdiens les ont
inventés. Ibid. b.
CELSË, obfervatioris fur ce médecin, & fur fes ouvrages.
III. 332. b. X. 269.b. h.70. a, b. Sa doftrine fur lescrifes,
IV. 487. a , b. fur la faignée. XIV. 302. a. Obfervations fur
le premier de fes huit livres de re medicâ. VIII. 387. b.
CELSIUS, (,M.) fes tables âftr'ônomiqties & géographiques;
Suppl. IV. 879. a. 883. a. 886. a.
CELTES, {Hift. anc. ) origine du nom de ces peuples.
Suppl. II. 279. b. Différentes nations auxquelles ce nom a
ete donné. Hiftoire des Celtes. Leurs émigrations. Etabliffe-
mens qu’ils fondèrent en différens pays. Ibid. 280. a. De
leurs émigrations en Angleterre , Ibid. 281. a. & en Allemagne.
Culte 8c doârine religieufe de ces peuples. Zele
intolérant qu’ils exerçoient contre les autres nations. Ibid. b.
Leur doétrine fur le Dieu fuprême qu’ils appelloient Teut.
Ibid. 282. a. Différens emblèmes fous lefquels il étoit adoré.
Lieux facrés parmi eux. Origine de ces amas de pierres dont
on trouve encore les reftes dans qüelques endroits de la
France, de l’Angleterre & de l’Allemagne. Ibid, b. De leurs
Sacrifices. Viétimes humaines qu’ils offroient à leurs dieux
'en différentes circonftances. Comment ils faifoient leurs prières.
Ibid. 283. a. Leur doârine fur l’ame 8c fur une autre
vie. La Grande-Bretagne étoit, félon eux, le féjour des
piânes. Nochers dont l’unique fonétion étoit de les y transférer.
Comment fe faifoit ce tranfport. Pourquoi les Celtes
célébraient leurs cérémonies pendant la nuit. Ibid. b. Comment
fe tenoient ces affemblees n oit urnes. De l’extérieur
ides Celtes. Leur patience & leur férocité. Leur courage.
''Ibid. 284. a. Education qu’ils donnoient à leurs enfans. Leur
amour pour la liberté. Diverfes qualités qu’on leur attribuoit.
’Singulière férocité de ces peuples. Ibid. b. D e leurs repas &
de la frugalité qu’ils y obfervoient. Etat de l’agriculture parmi
eux. Ufage qu’ils pra'tiquoient de boire dans le crâne de leurs
ennemis. Leurs feftins publics. Les Celtes accufés d’antropo-
phagie. Ibid. 283. a. Origine des villes de leur pays. Pourquoi
ils n’avoient ni temples, ni ftatues. Etat des arts & métiers
parmi eux; Le pillage permis en tout tems chez ces
Îieuples. Ils regardoient les bracelets d’or ou d’argent, &
es colliers comme la diftinétion la plus honorable. Obfer-
vations fur leur poéfie 8c leurs poètes nommés bardes. Ibid.
'b. Cantique de la viétoire. Pourquoi les bardes n’écrivoient
jamais leurs poëmes. Doéttine enfeignée dans les écoles publiques
des 'Celtes. Maximes de morale accréditées parmi
•eux. Tout champ fans culture étoit réputé n’appartenir à
perfonne. L’art oratoire cultivé dans la Celtique. Ibid. 286. a.
Leur jurifprudence & leurs loix. Leur médecine mêlée de
magie. Du gouvernement des Celtes. Leur population dans
la Gaule du tems de Céfar. Leur amour pour l’indépendance
politique. Non-feulement ils aimoient la liberté ; mais
ils vouloient conferver aux autres nations le même avantage.
Ibid. b. Eleétion de leurs magiftrats. Les privilèges de
titoÿenS ne s’étendbient que fur les deux ordres de l’état j
les druides & les chevaliers. Divifion des prêtres celtes en
trois ordres. Dignité de fouverain pontife. Privilèges »pouvoir
& autorité aes prêtres. Ibid. 287. a. Leurs moeurs. Biens
qu’ils poffédoient. Ibid. b.
C e l Te s , (Philofophie dès) philôfophes compris fous ce
nom. Obfcunté répandue fur l’hiftbire de cette philoiophie.
Ce qui a contribue à cette bbfcuritè.Idée qu’il faut fefùire
des peuples celtes. H. 808. b. Leur excellente morale. Leurs
foges .appellés druides. Ce que rapporte Jules-Céfâr fur lés
■cf1~ ons > 1 autorité & la maniéré d’enfeigher des druides.
Election de leur chef. Privilèges dont ils jouiffoient. Ibid. 809.
¿. Influence quils avoient dans le gouvernement. Leur habillement.
Ils ètoient diftribués en plufieurs daffes ; les bardes:
les cubages:les druides proprement dits. Double doftrine de
«es derniers, l’une publique, l’autre fecrete .-lefeul dogme
Je cette derniere qui a tranfpiré, c’eft celui qui établiffoit
immortalité de l’ame. Ibid. b. Idolâtrie dans laquelle ils entre-
l®aoient les peuples. Leur coutume de teindre de fang humain
autels de leurs dieux. Il eft probable que l’opinion de cette
éDC uîuverfelle qui anime toutes les parties du monde , s’étoit
d’à«0' a Parm> eux. On ne peut reprocher aux anciens Celtes
v a fio d pes al^ es- ^ra. a. Ce ne fut que depuis l’in-
es R°mains, qu’on vit des temples chez eux, Abo^
C E N
lition des druides par les empereurs. Les druides Ce reiidoient
recommàndables par lâ divination ; mais la divination étoit
particulièrement affectée aux femmes. Leur cofmogoiiie. Il ne
paroit paS qtie la métempfycofe ait été univerfell’ement reçue
chez les druides. Leurs idées für les peines & les rècohipenfeS
de lâ vie à venir. Ibid. b. Ardetir & courage des Celtes dans
les combats. Leur amour pour la liberté. Leur vie dure ; leur
chafteté ; leur éloignemetit de tout luxe. Ibid. 811. a.
Celtes. Leurs émigrations de la Gaule. Suppl. 1. 214: a.
Leur ufage quand ils entroient dans un pays étranger. 299. b.
De leur poéfie. VIII. 916. ¿..Poètes celtes ; voye^ Bardes.
Mercure adoré des Celtes. XVI. 278. b. Dieu des Celtes ;
appelle Tyr. 784, a. Lieu de délices réfervé, félon les Celtes;
à l’ame des héros. 821. a. Loi des Celtes contre le meurtrë
d’un étranger. VIII. 313. b. Celtes Scandinaves , voye^ce
dernier mot. De là Gaule celtique & des peuples qui l’habi-
toient. Suppl. II. 774. b.
CELTIBERIENS, peuples de l’ancienne Gaule, qui s’établirent
en Eipagne, le long de liber. II. 811. a.
Celtiberiens.Suppl.il. 201. a.
CELTIQUE. L'Europe anciennement àppellèe Celtique. VL
212. a. Langue celtique : pays où on la parle. II. 260.
Cetté langue liée par plufieurs rapports avec les langue^
orientales, IX. 239. a: particulièrement avec le Phénicien.
VIII. 87. b. De la Gaule celtique. Suppl. II. 77-4. b. .
CELUI, celle, ceux, celles, celui-ci, celui-là. Obfervations
fur la nature de ces mots. II. 793. b. XIII. 434. a.
CEMENT , (Chym.)cernent royal defuné à la purification
de l’or. Sa compofition. II. 811. a.
CEMENTATION , opération par laquelle on applique à
des métauk enfermés un feü tel qu’ils rougiflent fané
entrer en fùfion. H. 811. a. Cette opération employée pour
vérifier ou obtenir la pureté de l’or & de l’argent, ne remplit
point.ee dernier but. L’ufage des cementations trés-fàmilief
aux alchymiftes. Il n’eft prefqu’aiicun des 6boo auteurs d’al-
chymie qui ne célébré quelqu’un de ces procédés de cementation.
LÂ trempe en paquet connue des ouvriers en acier ;
eft une cementation. Matières des cemens pour l’or & pour
l’argent. Comment fe compofent ces cemens. Manuel de
l’opération. Ibid. b. En quoi confifte la théorie de la cementation
<de l’or & de l’argent dans les vues ordinaires de purification.
Théorie de la cementation du fer ; ou de la trenlpe en
paquet. Ibid. 812. a.
Cementation , inaltérabilité des métaux dans des vaiffeaux
bien fermés. II. 544. a. Converfion du fer en acier par lâ
cementation. VI; 913. a. XVI. 386. a. Ufage des cendres de
bois pôtir cette opération. V I. 922. a. Aftion par laquelle une
vapeur corrode bu pénétré un corps métallique dans la cementation.
V IL 366; b.
CEMENTATOIRE, (eau) fources d’eatix très-chargées
de vitriol de vénus.. Où elles fe trouvent. Sur quel fondement
on leur .attribue la vertu de tranfmuer le flr en cuivrer
Comment fe fait cette prétendue tranfmutation. Obfervations
fur les fources d’eau (je cementation de Smolnitz & dé
Hèrégrund en Hongrie. Autres fources feniblàbles en Hongrie
& ailleurs. IL 8xa; b. Comment Henckel explique les phénomènes
ae ces eaux. C’étoit fur une tranfmutation femblable
que quelques perfonnes avoient trouvé le moyen d’obtenir ;
il y à quelques années , un privilège exclufifpour convertir le
fer en cuivre dans totit le royaume. Ibid. 813. a.
Cementatoires , eaux, Suppl. III. 471 .a.
CENACLE , lieu bu falle à manger. Pourquoi les anciens
l’appelloient triclinium , lieu à trois lits. Reftes d’un triclinium
qui fe voit à Rome. 11. 813. a.
C én a c le , ( Théolog.) falle ‘où l’bh à prétendu que J. C;
avoit fait fon dernier fbuper. II. 813. a.
CENCHRUS , ferpent des ifles de Saihos & de Lemnos;
Sa defeription; En qubi il eft dangereux; Ufages qti’on en tire.
II.813: a.
CENDRE , ( Chythie) on à rangé ; fotis le ndni générique
de cendre , les fubftances métalliques privées de phlo-
giftique ; cependant il ne faut pas confondre, fous la même
dénomination , les chaux métalliques avec les cendres végé-,
taies & animales. Un végétal bu Un animal n’eft , pour uii
chymifte , qu’un , édifice terreux, cimenté par un gluten inflammable
, &c. C’eft aux ruines de cet édifice, de lâ bafë
terreufe, qu’eft due la portion la plus confidérable de la matière
qui lui eft propre. Outre la terre, les cendres végétales con-.
tiennent du fel fixe, alkali fixe ou lixiviel, & ordinairement
des fels neutres. Les fels fixes des cendres animales lie font
point encore affez conftatés en chyriiie; Fet qui fe trouve-
dans les cendres, tant animales que végétales. En qubi leS.
cendres différent ducharbon.H. 813. é. La cendre qui refte dé
la defiruétion des végétaux & des ânim&ux n’eft qu’une portion
peu confidérable de leur tout , mais pliis bu moins
grande, félon les efpeces. La cendre végétale & la cendré
animale confervent chacune inaltérablement & jiifques dans
la vitrification , leur caraâere diftinétif. Voeu fingulier de
Bccher. Différences réelles obfervées dans les terres calcaires