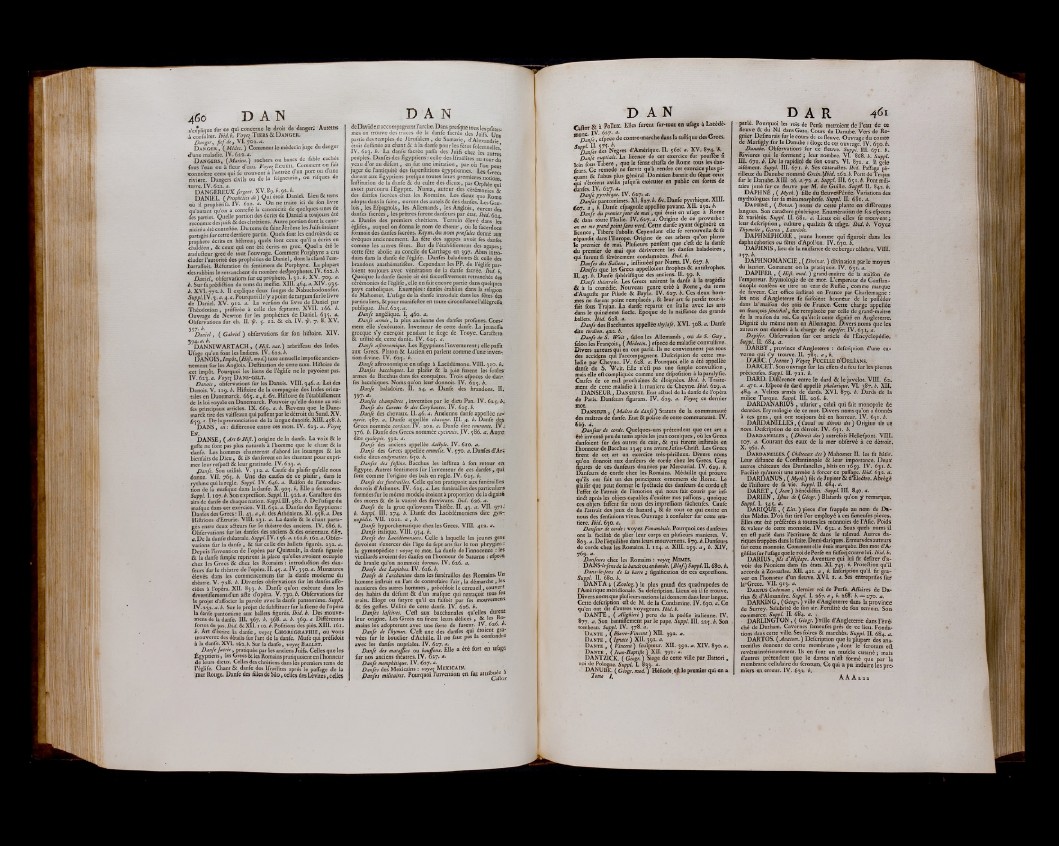
4 6 6 D A N
s’explique fbr ce qui concerne le droit de danger; Auteurs
à confulter. Ibid.b. Voy<i T i e r s & D a n g e r .
Danger, fief de, Vl. 7 0 2 . a.
D a n g e r , ( Médec. ) Comment le médecin juge du danger
d’une maladie. 1V-. 62a. a. . .
D AN G ER S , (Marine.) rochers ou bancs de fable caches
fous l’eau ou à fleur d’eau. Voyez Écueil. Comment on fait
connoitre ceux qui fc trouvent i l’erttréc d un port ou d une
riviere. Dangers civils ou de la feigneune, ou nfqucs de
terre. IV. 622. a. -
DANGEREUX fergent. XV.Sp.b.pi^b. .
DANIEL. (Prophétie! de) Qui étoit Daniel. Lieu&tcms
où il prophitiii. IV. 6m . •>. On ne traite ici de fon livre
qu'autant qu’on a conieAé la canomcité de quelques-unes de
fes parties. Quelle portion des écrits de Daniel a toujours été
reconnue des juifs & des chrétiens. Autre portion dont la cano-
nicité a été conteftée. Du tems de faint Jérôme les Juifs étoient
partagés fur cette dernierc partie. Quels font les endroits de ce
prophète écrits en hébreu j quels font ceux qu’il a écrits en
cbaidéen, & ceux qui ont été écrits en grec. Quel a été le
traduâeur grec de tout l’ouvrage. Comment Porphyre a cru
éluder l’autorité des prophéties de Daniel, dont la clarté 1 em-
barraffoit. Réfutation du fentiment de Porphyre. La plupart
des rabbins le retranchent du nombre desJprophetes.1V. 622. h.
Daniel, obfcrvations fur ce prophète. 1. 31 .b. XV. 709. a.
b. Sur fa prédiétion du tems du meflie. XIII. 464. a. XIV. 93 5.
b. XVI. 772. b. Il explique deux fonges de Nabuchodonofor.
Suppl. IV. 3. a. 4. a. Pourquoi il n’y a point de targum fur le livre
de Daniel. XV. 912. a. La verfton du livre de Daniel par
Théodotion » préférée à celle des feptante. XVII. 166. b.
Ouvrage de Newton fur les prophéties de Daniel. 63 5. a.
Obfcrvations fur ch. II. j/. 3. & ch. IV. ÿ . 7. 8. XV.
3 5D7*a niel, ( Gabriel) obfcrvations fur fon h•if«t oire. tXnIrVr.
394. a. b.
DANNIWARTACH, (Hif. rua.) arbriffeau des Indes.
Ufage qu’en font les Indiens. IV. 622. b.
DANOIS, Impôt, (Hifl. mod.) taxe annuelle impofée anciennement
fur les Anglois. Defti nation de cette taxe. Hiftoire de
cet impôt. Pourquoi les biens de l’églife ne le payoient pas.
IV. 62 3 . a. Voyei DANE-GELT.
Danois, obfcrvations fur les Danois. VHI. 346. a. Loi des
Danois. V. 119. b. Hiftoire de la compagnie des Indes orientales
en Danemarck. 665. a, b. De. Hiftoire de l’établifTement
de la loi royale en Danemarck. Pouvoir qu'elle donne au roi:
fes principaux articles. IX 669. a. b. Revenu que le Danemarck
tire des vaiffeaux qui partent par le détroit au Sund. XV.
¿><9.0. De la prononciation delà langue danoife. X11L 458. b.
DANS, en : différence entre ces mots. IV. 623. a. Voyej
En. - . '
DANSE, ( Art &Hifl.) origine de la danfe. La voix & le
gefte ne font pas plus naturels à l'homme que le chant & la
danfe. Les hommes chantèrent d’abord les louanges & les
bienfaits de Dieu, & ils danferenten les chantant pour exprimer
leur refpeâ & leur gratitude. IV. 623. a.
Danfe. Son utilité. VT312. a. Caufc du plaifir qu’elle nous
donne. Vil. 763. b. Une des caufes de ce plaifir, dans le
rythme qui la réglé. Suppl. IV. 646. a. Raifon de l’introduction
de la mufique dans la danfe. X. 905. b. Elle a fes accens.
Suppl. 1. 107. b. Son expreflion. Suppl. II. 922. a. Caraâere des
airs de danfe de chaque nation. Suppl.YÜ. 982. b. Dcl’ufage du
mafquc dans cet exercice. VII. 652. a. Danfes des Egyptiens:
Danfes des Grecs : 11. 43. a, b. des Athéniens. XI. 930. a. Des
Hiftrions d’Etruric. VIII. 2 3 1 . a. La danfe & le enant partagés
entre deux afteurs fur le théâtre des anciens. IV. 086. b.
Obfcrvations fur les danfes des anciens & des orientaux. 687.
a.De la danfe théâtrale. Suppl. IV. 156. a. i6id>. 162. a. Obfcrvations
fur la danfe, & fur celle des ballets figurés. 232. a.
Depuis l’invention de l’opéra par Quinault, la danfe figurée
& la danfe fimple reprirent la place qu’elles avoient occupée
chez les Grecs & chez les Romains : introduction des danfeurs
fur le théâtre de l’opéra. II. 43. a. IV. 350. a. Murmures
élevés dans les commcnccmcns fur la danfe moderne du
théâtre. V. 728. b. Divcrfes obfcrvations fur les danfes affo-
ciées à l’opéra. XII. 833. b. Danfe qu’on exécute dans les
divertiffemens d’un aâe d’opéra. V. 730. b. Obfervations fur
le projet d’aflbeier la parole avec la danfe pantomime. Suppl.
Iv. 232. a. b. Sur le projet de fubftituerfur lafeene de l’opéra
la danfe pantomime aux ballets figurés. Ibid. b. Des mouve-
mens de la danfe. III. 367. b. 300. a. b. 369. a Différentes
fortes de pas. Ibid. & Xll. no. b. Polirions des piés.XIII. i6x.
b. Art d’écrire la danfe, voye{ CH ORÉG RAPHIE , où vous
trouverez des détails fur l’art de la danfe. Mufe qui préfidoit
à la danfe. XVL 16a. b. Sur la danfe, voye{ B a l l e t .
Danfe facrée, pratiquée par les anciens Juifs. Celles que les
Égyptiens, les Grecs oc les Romains pratiquoient en l'honneur
de leurs dieux. Celles des chrétiens dans les premiers tems de
l’églife. Chant & danfe des lfraëlites après le paffage de la
jner Rouge. Danfe des filles de Silo, celles des Lévites, celles
DAN de David err accompagnant l’arche. Dansprefqiie tous les pfeati-i
mes on trouve des traces de la danfe facrée des Juifs. Une
partie des temples de Jérufalcm, de Samaric, d’Alexandrie
ctoit deftinée au chant & à la danfe pour les fêtes folcmnellcs’
IV. 62 3 . b. La danfe facrée pafia des Juifs cliez les autres
peuples. Danfes des Égyptiens : celle des lfraëlites au tour dit
veau d’or au défert, en fut une imitation, par où l’on peut
juger de l’antiquité des fuperftitions égyptiennes. Les Grecs
durent aux Égyptiens prefque toutes leurs premières notions.
Institution de la danfe & du culte des dieux, par Orphée qui
avoit parcouru l’Égypte. Ntima, auteur des cérémonies &
des danfes facrécs chez les Romains. Les dieux que Rome
adopta dans la fuite , curent des autels & des danfes. Les Gaulois,
les Efpagnols, les Allemands, les Anglois, eurent des
danfes facrées, les prêtres furent danfeurs par état. Ibid. 624.
a. Danfes des premiers chrétiens. Tcrrcin élevé dans les
églifes, auquel on donna le nom de choeur, où le facerdocé
formoit des danfes facrées. Étym. du nom preefules donné aux
évêques anciennement. La fete des agapes avoit fes danfes
comme les autres fêtes. But de rétabliffemcm des agapes;
cette fête abolie au concile de Carthage en 397. Abus introduits
dans la danfe de l’églife. Danfes baladoires & celle des
brandons anathématifées. Cependant les PP. de l’églifc partaient
toujours avec vénération de la danfe facrée. Ibid. b.
Quoique la danfe facrée ait été fucceflivemcnt retranchée des
cérémonies de l’églife, elle en fait encore partie dans quelques
pays catholiques. Exemples : danfes établies dans la religion
de Mahomet. L’ufage de la danfe introduit dans les fêtes des
particuliers, &pour manifefter en toute circonftancel’allégreiro.
publique. Ibid. 623.«.
Danfe angélique. I. 460. a.
Danfe armée, la plus ancienne des danfes profanes. Comment
elle s’exécutoit. Inventeur de cette danfe. La jeunefio
grecque s’y exerçoit pendant le fiege de Troye. Caraûcrc
oc utilité de cette danfe. IV. 625. a.
Danfe agronomique. Les Egyptiens l’inventerent; elle pafia
aux Grecs. Platon & Lucien en parlent comme d’une invention
divine. IV. 625. b.
Danfe aftronomique en ufage à Lacédémone. VIII. 310. b.
Danfes bacchiques. Le plaifir & la taie furent les feules'
armes de Bacchus dans fes conquêtes. Trois cfpeces de dan*
fes bacchiques. Noms qu’on leur donnoit. IV. 623. b.
Danfe baladoire. II. 24. a. Danfe des brandons. II,
397: %
Danfes champêtres , inventées par le dieu Pan. IV. 625. bl-
Danfe des Curetes 6* des Corybantes. IV. 625. b.
Danfe des chevaux. II. 46. a. Ancienne danfe appellée canaris.
587. a. Danfe ap p ellé e chacone. III. 4. b. Danfe des
Grecs nommée cordace. IV. 2 01. a, Danfe dite courante. IV;
376. b. Danfe des Grecs nommée cycinnis. IV. 386. a. Autre
dite cyclopée. 392. a.
Danfe des anciens appellée dailyle. IV. 610. a.
Danfe des Grecs appellée emmelie. V. 370. a. Danfes d’Ar?
cadie dites endymaties. 630. b.
Danfes des feftins. Bacchus les inftitua à fon retour en
Egypte. Autres icntimens fur l’inventeur de ces danfes, qui
font comme l’origine des bals en réglé. IV. 623. b.
Danfe des funérailles. Celle qu’on pratiquoit aux funérailles
des rois d’Athènes. IV. 623. a. Les funérailles des particuliers
formées fur le même modèle étoient à proportion de la dignité
des morts & de la vanité des furvivans. Ibid. 626. a.
Danfe de la grue qu’inventa Théfée. II. 43. a. VII. 971.'
b. Suppl. III. 274. b. Danfe des Lacédémoniens dite gym-
nopédie. VII. 1021. a , b.
Danfe hyporchematique chez les Grecs. VIII. 412. a.
Danfe italique. VIII. 934. b.
Danfe des Lacédémoniens. Celle à laquelle les jeunes gens
devoient s’exercer dés l’âge de fept ans fur le ton phrygien :
la gymnopédice : voye[ ce mot. La danfe de l’innocence : les
vieillards avoient des danfes en l’honneur de Saturne : efpece
de branle qu’on nommoit hormus. IV. 626. a.
Danfe des Lapithes. IV. 626. b.
Danfe de l'archimime dans les funérailles des Romains. Un
homme inftruit en l’art de contrefaire l’air, la démarche, les
maniérés des autres hommes, précédoit le cercueil, couvert
des habits du défunt & d’un mafque qui retraçoit tous fes
traits. Eloge ou fatyre qu’il en faifoit par fes mouvemens
& fes geftes. Utilité de cette danfe. IV. 626. b.
Danfes lafeives. C’eft aux bacchanales qu’elles durent
leur origine. Les Grecs en firent leurs délices , 6c les Ro*
mains les adoptèrent avec une forte de fureur. IV. 626. b.
Danfe de thymen. C’eft une des danfes qui étoient gravées
fur le bouclier d’Achille. Il ne faut pas la confondre
avec les danfes nuptiales. IV. 627. a. "
Danfe des mataffuis ou bouffons. Elle a été sort en ufage
fur nos anciens théâtres. IV. 027. a.
Danfe memphitique. IV. 627. a.
Danfes des Mexicains : voyez M e x i c a i n . f
Daifu miliuira. Pourquoi ïinveniion en fut
D A N
Caftor & à Pollux. Elles furent fur-tout en ufage à Lacédé-
^Danfiiefj)cce de contre-marche dans la taftique des Grecs.
SUPDanjts <bs Negres d’Amérique. II. 360.’ a. XV, 874. ’*.
Danfe nuptiale. La licence de cet exercice fut pouffée fi
loin fous Tibere , que le fénat chafla de Rome tous les danfeurs.
Ce remede ne iervit qu’à rendre cet exercice plus piquant
& l’abus plus général Domitien bannit du fénat ceux
qui s’étoient avilis jufqu’à exécuter en public ces fortes de
danfes. IV» 627. a.
Danfe pyrrhique. IV. 627« a.
Danfes pantomimes. XI. 827. b. De. Danfe pyrrhique. XIII.
607. a , b. Danfe espagnole appellée pavane. XII. 192. b.
Danfe du premier jour de mai, qui etoit en ufage à Rome
& dans toute l’Italie. IV. 627. a. Origine de ce proverbe :
on ne me prend point fans verd. Cette danfe ayant dégénéré en
licence, Tibere l’abolit. Cependant elle fe renouyella & fe
répandit dans l’Europe. Origine de ces arbres qu on plante
le premier de mai. Plufieurs penfent que c eft de la danfe
du premier de mai que dérivèrent les danfes baladoires ,
qui furent fi févérement condamnées. Ib’td. b.
Danfes des Saliens, inftituées par Numa. IV. 627. b.
Danfes que les Grecs appelloient ftrophes & antiftrophes.
II, 43. b. Danfe fphériftique des anciens. II. 39. b.
Danfe théâtrale. Les Grecs unirent la danfe à la tragédie
& à la comédie. Nouveau genre créé à Rome, du tems
d’Augufte par Pilade & Bayle. IV. 627. b. Ces deux hommes
ne furent point remplacés , & leur art fe perdit tout-à-
fait fous Trajan. La danfe reparut en Italie avec les arts
dans le quinzième fiecle. Epoque de la naiffance des grands
ballets. Ibid. 628. a. „ r \ r
Danfe des Bacchantes appellée thyiafe, XVI. 308. a. Danfe
dite tbrdion. 422. b.
Danfe de S. IVcit, félon les Allemands , ou de S. Guy ,
félon les François, ( Médecin. ) efpece de maladie' convulfive..
Divers auteurs qui en ont parlé. Ils ne conviennent pas tous
des accidçns qui l’accompagnent. Defcription de cette maladie
par Cheync. IV. 628. a. Pourquoi elle a été appellée
danfe de S. Weit. Elle n’eft pas une fimple convulfion,
mais elle eft compliquée comme une difpofition à laparalyfie.
Caufes de ce mal prochaines & éloignées. Ibid. b. Traitement
de cette maladie à la manière de Cheyne. Ibid. 629. a.
DANSEUR, D a n s e u s e . Etat aâuel de la danfe de l’opéra
de Paris. Danfeurs figurans. IV. 629. a. Voye^ ce dernier
mot.
D a n s e u r , {Maître de danfe) Statuts de la communauté
des maîtres de danfe. Eut & police de cette communauté. IV.
629. a.
Danfeur de corde. Quelques-uns prétendent que cet art a
été inventé peu de tems après les jeux comiques, où les Grecs
danfoient fur des outres de cuir, & qui furent inftitués en
l’honneur de Bacchus 1343 ans avant Jefus-Chrift. Les Grecs
firent de cet art un exercice très-périlleux. Divers noms
u’on donnoit aux danfeurs de corde chez les Grecs. Cinq
gures de ces danfeurs données par Mercurial. IV. 629. b.
Danfeurs de corde chez les Romains. Médaille qui prouve
qu’ils ont fait un des principaux ornemens de Rome. Le
plaifir que peut donner le fpeâacle des danfeurs de corde eft
l’effet de l’attrait de l’émotion qui nous fait courir par inf-
tinft après les objets capables d’exciter nos paflions, quoique
ces objets faffent fur nous des impreffions fâcheufes. Caufe
de l’attrait des jeux de hazard, & de tout ce qui excite en
nous des fenfations vives. Ouvrage à confulter fur cette matière.
Ibid. 630. a.
Danfeur de corde : voyez Funambule. Pourquoi ces danfeurs
ont la facilité de plier leur corps en plufieurs manières. V.
803. a. De l’équilibre dans leurs mouvemens. 879. b. Danfeurs
de corde chez les Romains. I. 114. a. XIII. 239. a, b. XIV.
769. a.
■Danfeurs chez les Romains : voye^ M im e s .
DAiiS'Iefensde la bande ou en bande. ÇBlaf.) Suppl. II. 680. b.
Dans-le-fens de la barre ; fignification de ces expreflions.
Suppl. II. 680. b.
DANTA ; ( Zoolog. ) le plus grand des quadrupèdes de
l’Amérique méridionale. Sa tlefcription. Lieux où il fe trouve.
Divers noms que plufieurs nations lui donnent dans leur langue.
Cette deferipuon eft de M. de la Condamine. IV. 630. a. Ce
qu’en ont dit d’autres voyageurs. Ibid. b.
DANTE, ( Alighieri ) pere de la poéfie italienne. IV.
877. a. Son bannifiement par le pape. Suppl. III. 223. b. Son
tombeau. Suppl. IV. 378. a.
D a n t e , 1 Biene-Vinctnt ) XII. 39a. a.
D a n t e , ( Ignace ) XII. 392. a.
D a n t e , ? Vincent ) fculpteur. XII. 392. a. XIV. 830. a.
D a n t e , ( Jean-Baptife ) XII. 392. a.
DANTZICK. ( Géogr. ) Siege de cette ville par Battori,
rP>dc Pologne. Suppl. I. 833. a.
DANUBE. ( Géogr. mod.) Héfiodc eft le premier qui en a
Tome 7,
D A R 461
Pourquoi ïm tois de Perfe mertoient de l’eau de ce
neuve Bc du Nil dans Gaza. Cours du Danube. Vors de Régnier
Defmarais fur le cours de ce fleuve. Ouvrage du comte
de Marfigly.fur le Danube : étage de cet ouvrage. IV. 630. b.
Danube. Obfervations fur ce fleuve. Suppl. III. 671. b.
Rivières qui le forment ; leur nombre. VL '868. b. Suppl.
III. 671. b. De la rapidité de fon cours. VI. 87t. a. Il gcle
aifément. Suppl. III. 671. b. Ses cataraétes. Ibid. Partage périlleux
du Danube nomme Grein. {Ibid. 262. b. Pont de Trajan
fur le Danube. XIII. 26. a. 72. a. Suppl. III. 63 t. b. Pont militaire
ietté fur ce fleuve par M. de Gtiille. Suppl. II. 842. b.
DAPHNÉ, ( Myth. ) fille du fieuve*Pénée. Variations des
mythologues fur fa métamorphofe. Suppl. II. 681. a.
D a p h n é , ( Botan. ) noms de cette plante en différentes
langues. Son caraélere générique. Enumération de. fes efpeces
& variétés. Suppl. IL 681. a. Lieux où elles fe trouvent ;
leur defcription, culture, qualités & ufage. Ibid. b. Voyea
Thymelée, Garou, Lauréate.
DAPHNÉPHORE , jeune homme qui figuroit dans les
daphnéphories ou fêtes d’Apollon. IV. 630. b.
DArHNIS, lieu de la naiffance de ce berger célébré. VUL
l l g i i
DAPHNOMÀNCIE, ( Divinat. ) divination par le moyen •
du laurier. Comment on la pratiquoit. IV. 631. a.
DAPIFER , ( Hift. mod. ) grand-maître de la màifon de
l’empereur. Etymologie de ce mot. L’empereur de Conftan-
tinople conféra ce titre au czar de Rufiie, comme marque
de faveur. Cet office inftitué en France par Charlemaene :
les rois d’Angleterre fe faifoient honneur de le pofteder
dans la'maifon des rois de France. Cette charge appellée
en françois Jénéchal, fut remplacée par celle de grand-maître
de la maifon du roi. Ce qu’étoit cette dignité en Angleterre.
Dignité du même nom en Allemagne. Divers noms que les
auteurs ont donnés à la charge de dapifer. IV. 631, a.
Dapifer. Obfcrvation fur cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. II. 684. a.
DARBY, province d’Angleterre : defcription d’une caverne
qui s’y trouve. II. 783. a, b.
D’ARC. ( Jeanne ) Voyer FUCÈLLE d ’O r l é a n s .
DARCET. Son ouvrage fur les effets du feu fur les-pierres
précicufes. Suppl. II. 711. b.
DARD. Différence entre le dard & le javelot. VIII. 6a,
a. 471. a. Efpece de dard appellé pkalarique. VI. 387. b. XII,
484. a. Velites armés de dards. XVI. 879. b. Dards de la
milice Turque. Suppl. III. 206. b.
DARDANAR1ÛS , ufurier, celui qui fait monopole de
denrées. Etymologie de ce mot. Divers noms qu’on a donnés
à ces gens , qui ont toujours été en horreur, IV, 63t. b.
DARDANELLES, ( Canal ou détroit des ) Origine de ce
nom. Defcription de ce détroit. IV. 631. b.
D a r d a n e l l e s , ( Détroit des ) autrefois Hellefpont. VIII.
107. a. Courant des eaux de la mer obfervé à ce détroit.
X. 361. b.
D a r d a n e l l e s . ( Châteaux des ) Mahomet II. les fit bâtir.
Leur diftance de Conftantinople & leur importance. Deux
autres châteaux des Dardanelles, bâtis en 1639. IV. 631. b.
Facilité qu’auroit une armée à forcer ce paffage. Ibid. 63 2. a.
DARD ANUS, ( Myth.) fils de Jupiter & d’Ëleâre. Aorégé
de l’hiftoire de fa vie. Suppl. II. 684. a.
DARET, (Jean) bénéaiâin. Suppl. III. 840. a.
D A RIEN, I f me de (Géogr.) Blafards qu’on y remarque.
Suppl. I. 345. a.
DARIQUE , ( Litt. ) pièce d’or frappée au nom de Darius
Médus. D’où fut tiré l’or employé à ces fàmeufes pièces.
Elles ont été préférées à toutes les monnoies de l’Afie. Poids
& valeur de cette monnoie. IV. 632. «.Sous quels noms il
en eft parlé dans l’écriture & dans le talmud. Autres da-
riques frappées dans la fuite. Demi-dariques. Erreurs des auteurs
fur cette monnoie. Comment elle étoit marquée. Bon mot d’A-
géfilasfurl’ufagequele roi de Pcrfe en faifoiicontre lui. Ibid. b.
DARIUS, fils d'Hiflape. Aventure qui lui fit defirer d’a-
yoir desPéoniens dans les états. XL 743. b. Protection qu’il
accorda à Zoroaftre. XII. 421. a , b. Infcription qu’il fit graver
en l’honneur d’un fleuve. XVI. 1. a. Ses entreprifes fur
la'Grece. VII. 913. a. _ •
D a r i u s Codoman , dernier roi de Perfe. Affaires de Darius
& d’Alexandre. Suppl. I. 267. a , b. 268. b. — 270. a.
DARKING, (Géogr. ) ville d’Angleterre dans la province!
de Surrey. Salubrité de fon air. Fertilité de fon terrein. Son
commerce. Suppl. II. 684. a. .
DARLINGtON, ( Géogr. ) Ville d’Angleterre dans l’évê-
ché de Durham. Cavernes fameufes près de <ce lieu. Fondations
dans cette ville. Ses foires & marchés. Suppl. II. 684. a.
DARTOS. (Anatom. ) Defcription que la plupart des ana-
tomiftes donnent de cette membrane , dont le ferotum eft
revêt» intérieurement. Us en font un mufcle cutané ; mais
d’autres prétendent que le dartos n’eft formé que par la
membrane cellulaire au ferotum. Ce qui a pu induire les pre-
! miers en erreur. IV. 63a. b%
A A A aaa