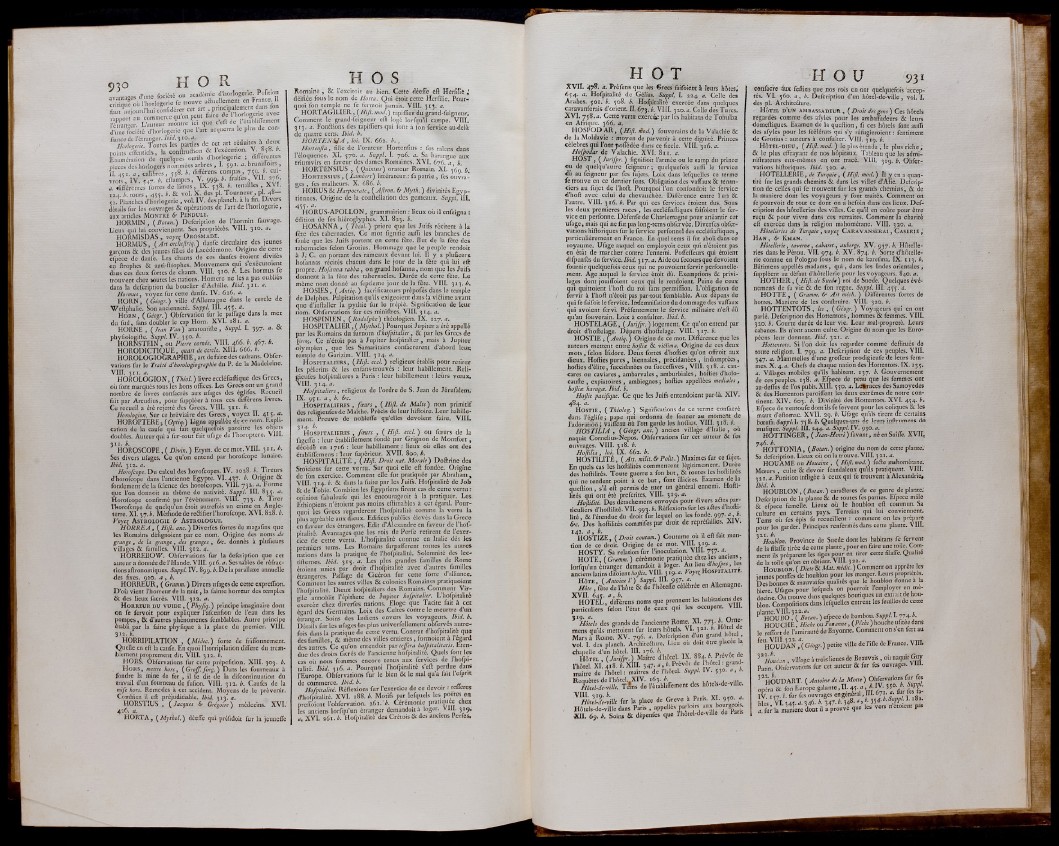
930 H 0 R
ihui’ àujourd-bui clnf.dérer cet c::sn:a r t . C. P ™ ' ^ “»“ 'e^ n:rl | g d’une L i é t é d'horlogerie que l’art acquerra le plus de cou-
fiance de l’étranger, lbid . 310. a.
Horlogerie, Toutes les parties de cet art réduites à deux
points cffemiels, la eondruSion & 1 exécution. V ; M ‘ .
¡Enumération de quelques outils d horlogerie ; différentes
pièces des horlogers nommées arbres, X. 591. a. brumflbirs,
Ht 4SI. Û calibres, <58. b. différens compas, 7« 1 . 4. cut-
v ro ts , IV . 547- *• effampes, ^ 999. é. fra .fe s, V IL 176.
n. différentes fortes de lim e s , IX. 538. h. tenailles, X V I .
1 1 4 . b. tours, 455- 1 & vol. X . des pl T o u rn e u r , pl. 4 8 -
<1. Planches d’horlogerie, vol. IV . des planch. à la fin. Divers
détails fur les ouvrages & opérations de l’art de l’horlogerie,
aux articles M o n t r e & P e n d u l e .
H O RM IN , (B o ta n .) Dcfcription de l’hormin fauvage.
Lieux qui lui convienpent. Ses propriétés. V I I I . 310. a.
HO RM 1S D A S , voyez O r o sm a d e .
H O RM U S , ( A r t orçhcflriq.) danfe circulaire des jeunes
garçons & des jeunes filles de Lacédémone. Origine de cette
efpéce de danfe. Les chants de ces danfes étoient diyifés
■en ftrophes & aoti-fttfophes.. Mouvemens qui s’exécutoient
daus ces deux fortes de ckants. V I I I . 310. ¿. Les hormus le
trouvent chez toutes les nations. Homere ne les a pas oubliés
dans la dcfcription du bouclier d’Achille, lb id . 3 1 1 . a.
Ho rmus, v o y e z fur cette danfe. IV . 626. a.
H O R N , (Géogr . ) ville d’Allemagne dans le cercle de
Weftphalie. Son ancienneté. Suppl. III. 45 5*
H o r n , (G é o g r .) Obfervation fur le paflage'dans la mec
du fu d , fans doubler lé cap Horn. X V I . 181. a.
HORNE , (J e a n V a n ) anatomifte , Suppl. I.
phyfiologifie. Suppl. IV . 3 50. b.
H O R N S T E IN , 01 "
397. a. 0C
_ ou Pierre cornée. V I I I . 4,66. b. 4 6 7 . b.
H Ô R O D IC T IQ U E , quart de cercle. XIII. 6 6 6 . b.
H O R O LO G IO G R A PH IE , art de faire des cadrans. Observations
fur le Traité d ’horologiographie du P. de la Madeleine.
V III. 3 1 1 . a.
H O R O L O G IO N , ( Théol. ) livre eedéfiaftique des G re c s ,
où font marqués tous les bons offices. Les Grecs ont un grand
nombre de livres confacrés aux ufages des églifes. Recueil
fait par Arcudius, pour fuppléer à tous ces différens livres.
C e recueil a été rejetté des Grecs. V I I I . 3 1 1 . b.
Horologion. Sur ce bréviaire des G r e c s , v o y e z I I . 415. <*•
H O R O P T E R E , 1 Optiq.) Ligne appellée de c e nom. Explication
de la caufe qui lait quelquefois paroître les objets
doubles. Auteur qui a fur-tout fait ufage de l’horoptere. V I I I .
' H O R p S C O P E , ( D iv in , ) Etym. de ce mot. V I I I . 3 1 1 . b.
Ses divers ufages. C e qu’on entend par horofeope lunaire.
lbid . 3x2. a.
___ ncopes. V l l l . 73
que l’on donnoit au thème de nativité. Suppl. III. 835. a.
Horofeope confirmé par l’événement. V I I I . 733* kà T irer
Vhorofcope de quelqu’un étoit autrefois un crime en Angleterre.
XI. 37. b. Méthode de reélifier l’horofcope. X V I . 828. b.
Voyer A s t r o l o g i e & A s t r o l o g u e .
H O R R E A , g H ifl. a n c .) Diverfes fortes de magafins que
les Romains délignoient par ce nom. Origine des noms de
grange , de la grange, des granges , (/c. donnés à plufieurs
villages & familles. V I I I . 312. a.
H O R R E BOW . Obfervations fur la defeription que cet
auteur a donnée de l’Iflande. V III. 916. a. Ses tables de réfractions
agronomiques. Suppl. IV . 899. b. D e la parallaxe annuelle
•des fixes. 920. a , b.
H O R R EU R , ( Gramm. ) Divers ufages de cette expreflion.
D ’où vient l’horreur de la n u it, la fainte horreur des temples
8c des lieux facrés. VIII. 312. a.
H o r r e u r d u v u i d e , ( P h y fiq .) principe imaginaire dont
on fe fervoit pour expliquer l’afcenfion de l’eau dans les
pompes, & d'autres phénomènes femblables. Autre principe
établi par la faine pnyfique à la place du premier. VIII.
312. b.
HORRIPILATION , (M é d e c .) forte de friffonnement.
Qu elle en eft la caufe. En quoi l’horripilation différé du tremblement
proprement dit. V I I I . 312. b.
HORS. Obfervations fur cette prépofition. XIII. 303. b.
H o r s , mettre hors, ( Groff. forg. ) Dans les fourneaux à
fondre la mine de fer , il fe dit de la difeontinuation du
travail d’un fourneau de fufion. VIII. 312. b. Caufes de la
mife hors. Remedes à cet accident. Moyens de le prévenir.
Combien il eft préjudiciable. lbid . 313. a.
HORSTIUS , ( Jacques fi* Grégoire ) médecins. X V I .'
426. a.
H O R .T A , (M y th o l. ) déeffe qui préfidoit fur la jeunefle
H O S
Romaine , & l’excitoit au bien. Ce tte déeffe eft Herfilie
déifiée fous le nom de Horta. Q u i étoit cette Herfilie. Pourquoi
fon temple ne fe fermoir jamais. VIII. 313. a.
H O R T A G IL IE R , (H i fl. mod.) rapiflier du grand-feigneur.'
Comment le grand-feigneur eft logé lorfqu’il campe. V I I I .
313. a. Fonétions des tapiffiers qui font à ion fervice au-delà
de quatre cens; lb id . b.
H O R T E N S J A , loi. IX . 6 6 2. b. ,
Hortenfla, fille de l’orateur Hortenfius : fes talons dans
l’éloquence. X I. 570. a. Suppl. I. 706. a. Sa harangue aux
triumvirs en faveur des dames Romaines. X V I . 676. a b.
H O R TEN S IU S , (Q u in tu s ) orateur Romain. X I . 569. b.
H o r t e n s iu s , ( Lambert) littérateur.: fa patrie , fes ouvrages
, fes malheurs. X. 686. b.
H O RU S 8c Harpocrate, (A f lr o n . 6» M y th . ) divinités Egyptiennes.
Origine de la conftellation des gémeaux. Suppl. 1IL
455- a - -
H O R U S -A P O L LO N , grammairien : lieux où il enfeignai
édition de fes hiéroglyphes. XI. 823. b.
H O S A N N A , ( T h é o l.) priere que les Juifs récitent à la
féte des tabernacles. C e mot fignifie aufli les branches de
faule que les Juifs portent en cette fête. But de la fête des
tabernacles félon Grotius. Hommage que le peuple rendoit
à J; C . en portant des rameaux devant lui. I l y a pluficur&
hofannas récités chacun dans le jour de la fête qui lui eft
propre. Hofanna rabba, on grand hofanna, nom que les Juifs
donnent à la fête des tabernacles. Duré e de cette fête. L e
même nom donné au feptieme jour de la fête. V I I I . 313. b.
H O S IE S , ( A n ù q . ) lacrificateurs prépofés dans le temple
de Delphes. Palpitation qu’ils exigeoient dans la viéiimc ayant
que d’inftaller la pythie fur le jrépié. Signification de leur
nom. Obfervations fur ces miniftres. V I I I . 314. a.
H O S P IN IEN , (R o d o lp h e ) théologien. IX. 1 2 7 .a .
H O S P IT A L IE R , ( My th o l. ) Pourauoi Jupiter a été appellé
par les Romains du furnom à hofoit alie r , 8c par les Grecs de
Itvtoi. C e n’étoit pas à Jupiter hofpitalicr, mais à Jupiter
olympien , que les Samaritains confacrcrent d’abord lcuç
temple de Garizim. V I I I . 314. a.
H o s p i t a l i e r s , (H i f l . e c c l.) religieux établis pour retirer
les pèlerins 8c les enfans-trouvés : leur habillement. Reli-
gieufes hofpitalicres à Paris : leur habillement : leurs voeux.
V I I I . 3 14 . *.
H o jp ita lie r s , religieux de l’ordre de S. Jean de Jérufalem.’
IX . 9 51 . a , b. &c.
.H o s p i t a l i è r e s , fa u r s , ( H if l. de Ma lte ) nom primitif
des rcligieufes de Malthe. Précis de leur hiftoire. Leur habillement.
Preuve de noblefle qu’elles devoient faire. V I I I .
314. b.
HOSPITALIERES , faturs , ( H ifl. eccl. ) ou feeurs de la
fogefle : leur établiflement fondé par Grignon de M on tfo r t,
décédé en 17 16 : leur habillement : lieux où elles ont des
établiflemens : leu r fupérieur. X V I I . 800, b.
H O S P IT A L IT É , ( H ifl. D r o it nat. Morale ) D o 61 ri ne des
Stoïciens fur cette v ertu . Sur quoi elle eft fondée. Origine
de fon exercice. Comment elle fut pratiquée par A brah am,
V I I I . 314. b. 8c dans la fuite par les Juifs. Hofpitalité de Job
8c de T o b ie . Combien les Egyptiens firent cas de cette vertu :
opinion fabuleufe qui les encourageoit à la pratiquer. Les,
Ethiopiens n’étoient pas moins eftimablcs à çet égard. Pourquoi
les Grecs regardèrent l’hofpitalité comme la vertu la
plus agréable aux dieux. Edifices publics éleVés dans la G rc c e
en faveur des étrangers. Edit d’A lexandre en faveur de l’hof-
pitalité. Avantages que les rois de Perfe retirent de l’exercice
de cette vertu. L ’hofpitalité connue en Italie dès les
premiers tems. Les Romains furpaflerent toutes les autres
nations dans la pratique de l’hofpitalité. Solcmnité des lec-
tifternes. lb id . 3 15 . a. Les plus grandes familles de Rome
étoient unies par droit d’hofpitalité avec d’autres familles
étrangères. Paflage de Cicéron fur cette forte d’alliance.
Comment les autres villes 8c colonies Romaines pratiquoient
l’hofpitalité. D ieu x hofpitaliers des Romains. Comment V ir gile
annoblit l’épithete de Jupiter hofpitalicr. L ’hofpitalité
exercée chez diverfes nations. Eloge que Tac ite fait à c e t
égard des Germains. L o ix des Ce ltes contre le meurtre d’uix
étranger. Soins des Indiens envers les voyageurs. Ibid. b.
Détails fur les ufagesdes plus univerfellement obfervés autrefois
dans la pratique de cette vertu. Contrat d’hofpitalité que
des familles, 8c même des villes entières, formoient à l’égard
des autres. C e qu’on entendoit par tejfera hofpitalitatis. Etendue
des droits facrés de l’ancienne hofpitalité. Qu els font les
cas où nous fommes encore tenus aux fervices de l’hofpi-
talité. lbid . 316. a . Pourquoi l’hofpitalité s’eft perdue dans
l’Europe. Obfervations fur le bien 8c le mal qu’a fait l’efprit
de commerce. Ibid. b. „
Hofpitalité. Réflexions fur l’exercice de ce devoir : teneres
d’hofpitalité. X V I . 188. b. Motifs par lefqucls les poetes en
preftoient l’obfervation. 2 6 1 . 'b. Cérémonie p™t,cP,é® e“ ez
les anciens lorfqu’un étranger demandoit à loger. V l l l . 3 19 ,
¡ I X V L 261. b. Hofpitalité des C r é t o i s 8c des anciens Pcrfes.
HOT X V I I . 478. a. Préfens que les Grecs foifoient à leurs hôtes,'
6 34. a. Hofpitalité de Gélias. Suppl. I. 224. a. C e lle des
Arabes. 301." b. 308. b. Hoipîralité exercée dans quelques
caravanferais d’orient. II. 673. b. V I I I . 320. a. Celle des Turcs.
X V I . 738. a. Ce tte vertu exercée par les habitans de Tobulba
en Afrique. 366. a.
I
fe
H O S P O D A R , (H i f l . tüod.) fouverains de la Valachie 8c
de la Moldavie : moyen de parvenir à cette dignité. Princes
célébrés qui l’ont poifédée dans ce fiecle. VIII. 316. a.
Hofpodar de Valachie. X V I . S u . a.
H O S T , ( Jurifpr. ) fignifioit l’armée ou le eamp du prince
ou de quelqu’autre feigneur ; quelquefois aufli le fervice
dû au feigneur par fes iujets. Loix dans lefquelles ce terme
fe trouve en ce dernier fens. Obligation des vaflaux 8c tenanciers
au fujet de l’hoft. Pourquoi l’on confondoit le fervice
d’hoft avec celui de chevauchée. Différence entre lu n 8c
l’autre. V I I I . 316. b. Par qui ces fervices étoient dus. Sous
les deux premières rac e s, les eccléfiaftiques faifoient le ferv
ic e en perfonne. Défenfe de Charlemagne pour anéantir cet
ufage , mais qui ne fut pas long-tems obfervéc. Diverfes obfervations
hiftoriques fur le fervice perfonnel des eccléfiaftiques,
particulièrement en France. En quel tems il fut aboli dans ce
royaume. Ufage auquel on employoit ceux qui n’étoient pas
en état de marcher contre l’ennemi. Poflcfleurs qui étoient
difpenfés du fervice. lbid. 317. a. Aide ou fecoursque devoient
fournir quelquefoisceux qui ne pouvoient fervir perfonnelle-
menr. A g e auquel le fervice étoit dû. Exemptions 8c privilèges
dont jouifloient ceux qui le rendoient. Peine de ceux
lui quittoient l’hoft du roi fans permiflion. L’obligation de
ervir à l’hoft n’étoit pas par-tout femblable. A u x dépens de
qui fe faifoit le fervice. Imfemnifation du dommage des vaflaux
qui avoient fervi. Préfentemeut le fervice militaire n’eft dû
qu’au fouverain. Loix à confulter. lbid . b.
H O S T E L A G E , (Jurifpr.") logement. C e qu’on entend par
droit d’hoftelage. Dépens dhoftelage. VIII. 317. b.
H O S T IE , ( A n t iq . ) Origine de ce mot. Différence que les
auteurs mettent entre hoftia 8c vidima. Origine de ces deux
m o ts, félon Ifidore. Deux fortes d’hofties qu’on offroit aux
dieux. Hofties pures , biennales, précidanées , indomptées,
hofties d’é lite , fuccidanées ou fucceflive s, VIII. 318. a. can-
carcs ou caviares , ambarvales, amburbiales, hofties d’holo-
caufte , expiatoires , ambiegnes ; hofties appellées médiales ,
hofliee harugat. lbid . b.
H o flic pacifique. C e que les Juifs entendoient par-là. X IV .
484. a.
H o s t ie , ( Théolog. ) Significations de ce terme cônfacré
dans l’églife j pape qui ordonna de fonner au moment de
l ’adoration ; vaifleaù où l’on garde les hofties. VIII. 318. b.
H O S T I L I A , ( Géogr. anc. ) ancien village d’I ta lie , ou
naquit Cornelius-Nepos. Obfervations fur cet auteur 8c fes
ouvrages. V I I I . 318. b.
H o ft ilia , loi. IX . 662. b. #
H O S T IL IT É , ( A r f. milit. 6* P o l i t . ) Maximes fur ce fujet.
En quels cas les hoftilités commencent légitimement. Durée
des hoftilités. T ou te guerre a fon b u t, 8c toutes les hoftilités
qui ne tendent point à ce b u t , font illicites. Examen de la
queftion, s’il eft permis de tuer un général ennemi. Hofti-
lités qui ont été preferites. V I I I . 319. a.
Hoflilité. Des détachcmens envoyés pour divers attes particuliers
d’hoftilité. V I I . 993. b. Réflexions fur les a&es d hofti-
li t é , 8c l’étendue du droit fur lequel on les fonde. 997. û , b.
& c . D e s hoftilités commifcspar droit de repréfailles. X IV .
142. a , b. * » *1 a c '
H O S T IZ E , (D r o i t coutum.) Coutume ou il elt tait mention
de ce droit. Orig’uie de ce mot. VIII. 3*9* a'
H O S T Y . Sa relation fur l’inoculation. VIII. 757- a- .
H O T E , (G ram m .) cérémonie pratiquée chez les anciens,
lorfqu’un étranger demandoit à loger. A u lieu d h o jp e s , les
anciens latins d io ien , hofiis. VIII. s .9 . Voyc^ H o s p i t a l i t é .
H ô t e , ( A n to in e l" ) Suppl. III. 957' n-
H ô t e , fête de l’hôte & de l’hôteffe célébrée en Allemagne.
X V I I . 64s. a , b. . .
H O T E L , différens noms que prennent les habitations des
particuliers félon l’état de ceux qui les occupent. V l l l .
3 ^Hôtels des grands de l’ancienne Rome. XI. 773 ¿ 0 rn' '
mens qu’ils mettoient fur leurs hôtels. V I . l e i . é. Hôtel de
Mars h Rome. X V . 796. n. Defeription dun grand h ô te) ,
v o l. I. des planch. Architeâure. Lieu ou doit être placée la
chapelle d’un hôtel. III. 176. b. . ,
H Ô T E L , (J u r ifp r .) Maure d’hôtel. IX . 884. ». Prévôt de
l’hôtel, x i ! 4 .8 . l x i i i . 3 4 7 .a | i p «fc t ô,! ^ r; nd;
maître de l’hôtel : maîtres de l’hôtel. Suppl. IV . 530. u , b.
RCS k W c-vÎ/&? TÜins de l’établilTement des hôtels- de-ville.
^ m l ì - ì c - v i lU fur la place de G re ve à Paris. XI. 930. u .
Hôtels-de-ville dans Paris , a p p e l lé s parloirs aux
X I I . 69. b. Soins 8c dépenfes que lhôtel-de-viUe de Paris
H O U 9 3 1
confacre aux feftins que nos rois en ont quelquefois 'acceptés.
V I . 360. 0 , b. Defeription d’un hôtel-de-ville, vol. I.
des pl. Architcéiure.
H ô t e l d ’u n a m b a s s a d e u r , (D r o i t des g en s ) Ces hôtels
regardés comme des afyles pour les ambafladeurs 8c leurs
domeftiques. Examen de la queftion, fi ces hôtels font aufli
des afyles pour les fcélérats qui s’y réfugieroient : fentiment
de Grotius : auteurs à confulter. V l l l . 319. b.
H ô t e l -d ie u , ( H ifl. mod. ) le plus étendu, le plus riche j
8c le plus effrayant de nos hôpitaux. Tableau que les admi-
niftrateurs eux-mêmes en ont tracé. V l l l . 319. b. Obfervations
hiftoriques. Ibid. 320. a.
H O T E L L E R IE , de Turquie, ( H ifl. mod. ) Il y en a quantité
fur les grands chemins 8c dans les villes d’A lie. Dcfcription
de celles qui fe trouvent fur les grands chemins, 8c de
la maniéré dont les voyageurs y font traités. Comment on
fe pourvoit de tout ce dont on a befoin dans ces lieux. D e f eription
des hôtelleries des villes. C e qu’il en coûte pour être
reçu 8c pour v iv re dans ces retraites. Comment la charité
eft exercée dans la religion mahométane. VIII. 320. a.
Hôtelleries de Turquie , voyc{ C a r a v a n s e r a i , C a s e r ie
H a n , 6* K h a n .
Hôtellerie, taverne, cabaret, auberge. X V . 937. b. Hôtelleries
dans le Pérou. V II. 974. b. X V . 874. b. Sorte d’hôtellerie
connue en Pologne fous le nom de karefma. IX. 113. b.
Bâtimens appellés madarns, q u i, dans les Indes orientales ,
fuppléent au défaut d'hôtellerie pour les voyageurs. 840. a.
H O TH E R , ( H ifl. de Sucde ) roi de Sucde. Quelques é v é nement
de fa vie 8c de fon regne. Suppl. III. 435. a.
H O T T E , ( Gramm. 6* A r t méch. ) Différentes fortes de
hottes. Maniéré de les conftruire. VIII. 320, b.
H O T T E N T O T S , les , (G é o g r .) Voyageurs qui en ont
parlé. Defeription des Hottentots, hommes 8c femmes. V I I I .
320. b. Courte durée de leur vie. Leur mal-propreté. Leurs
cabanes. Ils n’ont aucun culte. Origine du nom que les Européens
leur donnent. Ibid. 321. a.
Hottentots. Si l’on doit les regarder comme deftitués de
toute religion. 1. 799. a. Defeription de ces peuples. VIII.
347. a. Mammelles d’une groffeur prodigieufe de leurs femmes.
X. 4. a. Chefs de chaque nation des Hottentots. IX. 133.
a. Villages mobiles qu’ ils habitent. 137. b. Gouvernement
de cespeuples. 138. a. Efpece de peau que les femmes ont
au deflus cte l’os pubis. XIII. 330. a. Ldfc-aces des Samoyede9
8c des Hottentots paroiflent les deux extrêmes de notre continent.
X IV . 603. b. Divinité des Hottentots. X V I . 434. b .
Efpece de ventoufe dont ils fe fervent pour les coliques 8c les
maux d’eftomac. X V I I . 29. b. Ufage qu’ils tirent de certains
boeufs. Suppl. I. 758. b. Quelques-uns de leurs inftrumens de
mufique. Suppl. III. 244. a. Suppl. IV . 930. a.
H O T T IN G E R , ( Jean-Henri ) favant, né en Suifle. X V I I .
746. b. ,
H O T T O N IA , (B o ta n .) origine du. nom de cette plante.
Sa defeription. Lieux où on la trouve. VIII. 321. a.
H O U AM E ou Houaine , ( Hifl. mod.) fefte mahométane.
Moeurs , culte 8c devoir fcandaleux qu’ils pratiquent. VIII.
321 .a . Punition infligée à ceux qui fe trouvent à Alexandrie,
lbid . b. v .
H O U B LO N , (B o ta n .) carafteres de ce genre de plante.
Defeription de la plante 8c de toutes fes parties. Efpece mâle
8c efpece femelle. Lieux ou le houblon eft commun. Sa
culture en certains pays. Terreins qui lui conviennent.
Tems où fes épis fe recueillent : comment on les préparé
pour les garder. Principes renfermés dans cette plante. VIII.
^H o u b lon . Province de Suede dont les habitans fe fervent
de la filafle tirée de cette plante, pour en foire une toile. Comment
ils préparent les tiges pour en tirer cette filafle. Qualité
de la toile qu’on en obtient. VIII. 322^0.
H o u b l o n . ( Dicte 8c Mat. médic.) Comment on apprête les
jeunes poufles de houblon pour les manger. Leurs propriétés.
Des bonnes 8c mauvaifes qualités que le houblon donne à la
b ie r e . Ufages pour lefquels on pourroit 1 employer en médecine.
On trouve dans quelques boutiques un extrait de houblon.
Compofitions dans lefquelles entrent les feuilles de cette
^ H O U B O ? ( Botan. ) efpece de bambou. Suppl. 1.774* J*
H O U CH E , H ic h e o u Fonanne, (P ê ch e ) houche ufitéedans
le reflort.de l’amirauté de Bayonne. Comment on s en fert au
^ H O U D A N , ( Géogr. ) petite v ille de l’ifle de France. VIII*
H ü , village à trois lieues de Beauvais, oii naquit Gtiy
Patin. Obfervations fur cet auteur 8c fur fes ouvrages. V l l l .
3 1H O U DA R T . (A n to in e Je U M o t te ) Obfervations fur fes
' opéra 8c fon Europe g alante,II. 45-<■ feTfa-
IV . 1Ç7.É. fur fes ouvrages cngénéral, fll.<>7‘ -Ä S B K M J
bies v i w s . u. 446. b. 147. b. É ® « * é m 1 l S ; à. fô; la maniéré dont il a prouvé que les vers n étoient pas