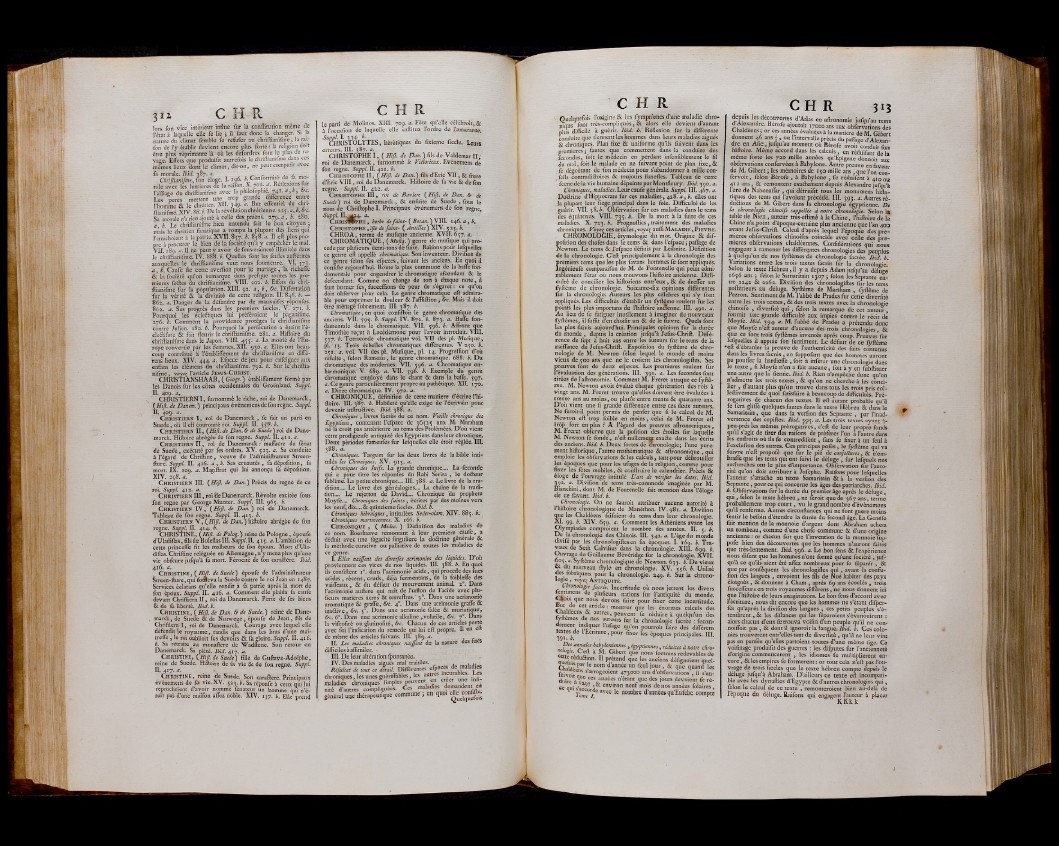
31 2 C H R C H R
lors fon vice intérieur influe fur la conflatutton même de
l’état à laquelle elle fe lie ; il faut donc la changer. Si la
nature du climat fémb'le fe refufer au chriftianifme, la rai-
fon de l’y établir devient encore plus forte : là religion doit
être plus réprimante là où les défordrés font le plus de ravage.
Effets que produifit autrefois le chriftianifme dansceS
mêmes lieux dont le climat, dit-on, ne peut compatir.avec
fa morale. Ibid. 3 87. a. . ___
Chriftianifme, fon éloge. I. 196. Conformité de fa mo-
raie avec les luiniercs Je laraifon. X.702. a. Reflexioçsfur
l'alliage du chrilliamlme avec la pMofopfae. 74>-" , », «*•
Les pères (nettem une trop grande différence entre
l'homme & le chrétien. XII. 349; "• But effenhel du chrt-
Ähinäfme XIV. 88. i. De la révélation chrétienne, aaj.
Sa morale n'a rien ajouté à ceüe des paîëns. a7o. à , i. ¿80.
a b. Le .chriftianifme bien entendu fait le bon citoyen ;
mais le chrétien fonàtique a rompu la plupart, dës :liê'ns.
l’atfachoient à la piîiie. XVII. ggjEK 8$8;*. Il eft .plùspro.
pre à procurer lé bien de la fociété qu’à y empêcher le mal.
VII. 189. a- Il nepêùt y avoir de fouveraineté illimitée dans
le ciirîffiàiiîfme. IV. 888. Qùellès font les feules aüfté'ritêà
auxquelles le Chriflàànifme veut nous foirmettrê. .V l r ^ i .
a , b. Caufe de cette averfiori pour lé màfîâge,' ‘la richeffe
& la fociété qti’on remarque dans prefque toutes les premières
feftes aù chriftianiime. VIII. 202. b. Eflets du chri-
ftiauifme fur là population. XIII. 9a- a»J> t Différtàtiôn
fur là vèiriiê & la divinité de cette religion. IL&t&J. —
862. a. Danger de la défendre par de mauÿaifes' rèponfes.
862. a. Ses progrès dans les premiers fiedes. V . 271. b.
Pourquoi les éclefliques lui préféroient le pagànifme.
‘276. b. Comment la providence protégea le chriftianifme
contre Julien. 280. b. Pourquoi la perfécution a &èint l’é-
cleétifme & fait fleurir le chriftianifine. 281. a. Hiitpire du
chriftianifme dans le Japon. VIE. 455. a. La moitié de l’Eu-
rope convertie par les femmes. XII. 930. a. Elles ont beaucoup
contribué à l’établiffement du- chriftianifme en diffé-
rens lieux. XlV. 444. a. Efpece de jeu pour erifeigner aux
enfons les élémens du chriftianifrtie. 792. b. Sur lë;çhriftiâ-
nifme,' voyez l’article Jesus-C h r is t .
CHRISTIANSHAAB, ( Géogr. ) établiffemenï formé par
les Danois fur les côtes occidentales du Groënland. Suppl.
n . 409. <z,
CHRISTIERN I , furnommé le riche, roi de Danemarck,
(Hiß. de Danem.) principaux événeniens de fon regne. Suppl.
Il, 409'* à.
C h r is t ie r n 1, roi de Danemarck , fe fait un parti en
Suede, où iieft couronné roi. Suppl. II. 357. b.
CHRISTIERN I I, (Hiß. de Dan.& de Suede) roi de Danemarck.
Hiftoire abrégée de fon regne. Suppl. II. 411. a.
C h r is t ie r n I I , roi de Danemarck : maffacre du fénat
de Suede, exécuté par fes ordres. XV. 523. a. Sa conduite
à l’égard de Chriftine, veuve de l’adminiftrateur Streen-
fture. Suppl. II. 416. a , b. Ses cruautés , fa dépofition, fa
mort. Ia . 109. a. Magiftrat qui lui annonça fa dépofition.
XIV. 298. a.
C h r is t ie r n IE. {Hiß. de Dan. ) Précis du regne de ce
roi. Suppl. 412. a.
C h r is t ie r n III, roi de Danemarck. Révolte excitée fous
fon regne par George Munter. Suppl. III. 965. b.
C h r is t ie r n IV , ( Hiß. de Dan. ) roi de Danemarck.
Tableau de fon regne. Suppl. II. 412. b.
C h r is t ie r n V , {Hiß. de Dan.) hiftoire abrégée de fon
regne. Suppl. II. 414. b.
CHRISTINE, {Hiß. de Polog. ) reine dé Pologne, époufe
d’Uladiflas, fils de Boleflas III. Suppl.II. 415. a. L’ambition de
cette princefle fit les malheurs ae fon époux. Mort d’Uladiflas.
Chriftine reléguée en Allemagne, n y mena plus qu’une
vie obfture jufqu’à fa mort. Férocité de ion caraétere. Ibid.
4 1^* a' < - . ,n
C h r i s t in e , ( Hiß. de Suede) époufe de l’adminiftrateur
iîtreen-fture, qui fomeva la Suede contre le roi Jean en 1487.
Services éclatans qu’elle rendit à fa patrie après la mort de
fon épôux. Suppl. II. 416. a. Comment elle plaida fa caufe
devant Chriftiern I I , roi de Danemarck. Perte de fes biens
& de fa liberté. Ibid. b.
C h r is t in e , {Hiß. de Dan. & de Suede.) reine de Dane-
t marck, de Siiede Kd e Norwege, époufe de Jean, fils de
Chriftiern I , roi de Danemarck. Courage avec lequel elle
défendit le royaume, tandis que dans les bras d’une maî-
treffe, le roi oublioit fes devoirs & fa gloire. Suppl. II. 416.
b. Sa retraite au monaftere de Wadftehe. Son retour en
Danemarck. Sà piété, lbid. 417. a.
C h r is t in e , {Hiß. de Suede) fille de Guftave-Adolphe,
reine de Suède. Hiftoire de fa vie & de fon regnë. Suppl.
II, 417. a. »
C h r is t in e , reine de Suede. Son caraftere. Principaux
événemens de fa vie. XV. 523. b. Sa réponfe à ceux qui lui
reprochoient d’avoir nommé fénateur un homme qui n’é-
toit pas d’ùnè mâifon aflez nôblë. XIV. 137. b. Elle prend
le parti de Molinos. XIII. 709. a. Fête qu’elle célébroit, &
à l’occafion de laquelle elle inftitua l’ordre de l’amarante.
^ h r j s V o l y t e s , hérétiques du fixieme fiede. Leurs
erreurs. III. 387. a.
CHRISTOPHE I , {Hiß. de Dan.) fils de Valdemar II,
roi de Danemarck, furnommé le ViElorieux. Evénemens de
fon regnë. Suppl. II. 421. b.
C h r is t o p h e I I , ( Hiß. de Dan.) fils d’Eric VU , & frere
d’Eric VIII, roi de Danemarck. Hiftoire de fa vie & de fon
regne. Suppl. II. 422. a.
CHRISTOPHE HI, roi de Bavure {Hiß. de Dan. 6* de
Suède) roi de Danemarck, & enfuite de Suede , fous le
nom de Chriftophe I. Principaux événeihens de fon regne,
Suppl. H.^24. a.
C h r i s w PHe , herbe de faint- ( Botan. )VIÏI. 146. at b,
C h r is t o ph e ,ifie de faint- { Antilles) XIV. 325 .b.
CHRÖA, terme de mufique ancienne. XVII. 657. a.
CHROMATIQUE , {Mufiq.) genre de mufiqüê qui procédé
par plufieurs demi-tons dë mite. Raifons pour lefquellês
ce genre eft appelle chromàtique. Son inventeur. Divinott de
ce genre félon fes efpeces, iuivant les anciens. Eri quoi il
conufte aujourd’hui. Route la plus commune de la baffe fort-
damentale pour engendrer le chromatique afeendant & le
defcendaiit. Comme ori change de ton à chaque note, il
faut borner fes. fücceflions de peut de s’égarer: ce qü’oh
doit obferver pour cela. Le genre chromatique eft admirable
pour exprimer la douleur & l’affliétion,- &c. Mais il doit
être ménagé fobrement; III. 387. b.
Chromàtique, en quoi confiftoit le genre cnromatique des
anciens. VII. 593. b. Suppl. IV. 872. b. 873. a. Baue fondamentale
dans le chromädqde. VII. 396. b. Affront que
Timôthée reçut à Lacédémone pour l’avoir introduit.' VlII.
337. b. Tetracorde chromatique vol. VII des pl. Muftquë,,
pl. 13. Trois échelles ’ chromatiques différerites. V 230. b.
231. a. vol. VII des pl. Mufiqiie, pl. 14. Ptogréifion d’où
réfulte, félon Rameau, le genre chromatique. 688. b. Du
chromàtique des modernes. Vil. 396. a. Chromatique enharmonique.
V. 689. a. VII. 396. b. Exemple dii genre
chromatique employé dans le chant & dans la baffe. 397.
a. Ce genre particulièrement propre au pathétique. XIL 170.
a. Dieze Chromatique. IV. 972. a.
CHRONIQUE, définition dé cette maniéré d’écrire l’hi-
ftoire. III. 387. b. Habileté qü’ëlle exige-de l’écrivain pour
devenir inftruftive. Ibid. 380; a.
Chroniques , livres facrés de ce nom. Vieille chronique des
Egyptiens, contenant l’efpace de 36323 ans. M. Marsham
ne la croit pas antérieure au tems des Ptolémées. D’où vient
cette prodigieufe antiquité des Egyptiens dans leur chronique.
Deux périodes fàmeufes fur leiquelles elle étoit réglée. IIL
388. a.
Chroniques. Targum fur les deux livres de la bible intir
tulés les Chroniques. XV. 913. a.
Chroniques des Juifs. La grande chronique.... La-fécondé
qui a pour titre les réponles du Rabi Serira , le doéteur
iublime. La petite chronique.... III. 388. a. Le livre de la tradition....
Le livre des généalogies.... La chàine de la tradition....
Le rejetton de David.... Chronique du prophète
Moyfe.... Chroniques des faints, écrites par des moines vers
les neuf, dix.... & quinzième fiecles. lbid. b.
Chroniques hébraïques, intitulées Seder-olam. XTV. 883. b.
■ Chroniques martiniennes. X. 166. b.
C h r o n iq u e , ( Midec. ) Définition des maladies de
ce nom. Boerhaave remontant à leur première caufe, a
déduit avec une fagacité finguliere la doôrine générale 8c
la méthode curative ou palliative de toutes les maladies de
ce genre. . . . »
L Elles naiffent des diverfes acrimonies des liquides. D’ou
proviennent ces vices de nos liquides. III. 388. b. En quoi
ils confiaient i°. dans l’acrimonie acide, qui procédé des lues
acides, récens, cruds, déjà fermentans, de la foiblefle des
vaiffeaux, & du défaut de mouvement animal 20. Dans
l’acrimonie auftere qui naît de l’urfion de l’acide avec plufieurs
matières âcres 8c terreftres.’ 30. Dans une acrimonie
aromatique 8c graffe, &c. 40. Dans une acrimonie graffe 8c
inaélive, &c. 3“. Dans une acrimonie falée 8c muriatique,
&c. 6°. Dans une acrimonie alkaline , volatile, &c. 70. Dans
la vifeofité ou glutinofité , &c. Chacun de ces àrticles porte
avec foi l’indication du remede qui lui eft propre. Il en eft
de même des articles fuivans. III. 389. a.
II. Les maladies chroniques naiffent de la nature des lues
difficiles à aflimiler. •
HI. De leur altération fpontanée.
IV. Des maladies aiguës nfaï traitées. ,
Ré fuit at de tout ce tutail. Différentes eipeçes e ma a ies
chroniques, les unes guériffables, les autres ® ^.
1 j- 1. •maladies chron. qu ? fimpks npuvent en crdécerra aunndee ntin ne-rrt
mté d autres compliquées, v-e* •
gtniral mje thérapeutique commune ; en quoi eUe
CHR S Quelquefois l’origine 8c les fymptômes d’une maladie chronique
font très-compliqués, 8c alors elle devient d’autant
plus difficile à guérir. lbid. b. Réflexion fur la différente
conduite que tiennent les hommes dans leurs maladies aiguës
8c chroniques. Plan fixe 8c uniforme qu’ils fuivent dans les
premières; foutes que commettent dans la conduite des
fécondés, foit le médecin en perdant infenfiblement le fil
du mal, foit le malade en ne fuivant point de plan fixe,8c
fe dégoûtant de fon médecin pour s’abandonner à mille conseils
contradictoires 8c toujours fùneftes. Tableau de cette
feene de la vie humaine dépeinte par Montfleury. lbid. 390. a.
Chroniques, maladies. Leur caufe générale. Suppl. III. 407. a.
Doélrine d’Hippocrate fur ces maladies, 428. a | b. elles ont
la plupart leur uege principal dans le foie. Difficulté de les
guérir. VIL 38. b. Obfervation fur ces maladies dans le tems
des équinoxes. VIII. 733. b. De la mort à la fuite de ces
maladies. X. 723. b. Prognoftics, traitement des maladies
chroniques. Voyerces articles, voyeç auifi Ma l a d ie , F ie v r e .
CHRONOLOGIE, étymologie du mot. Origine 8c dif-
pofition des chofes dans le tems 8c dans l’efpace ; paffage de
Newton. Le tems 8c J’efpace définis par Leibnitz. Définition
de la chronologie. Oeil principalement à la chronologie des
Îrentiers tems que les plus favans hommes fe font appliqués,
ngénieufe cômparaifon de M. de Fontenelle'qui peint admirablement
l’état où nous trouvons l’hiftoire ancienne. Difficulté
de concilier les hilloriens entr’eux, 8c de dreffer un
fyftême de chronologie. Soixante-dix opinions différentes
fur la chronologie; Auteurs les plus célébrés qui s’y font
appliqués. Les difficultés d’établir un fyftême roulent fur les'
points les plus importans de l’hiftoire ancienne. III. 491. a.
Au lieu de fe fatiguer inutilement à imaginer de-nouveaux
fyftêmes, il fuffit a’en choifir un 8c de le iuivre. Quels font
les plus ûtivis aujourd’hui. Principales opinions fur la durée
du monde, depuis la création jufqu’à Jefus-Chrift. Différence
de fept à huit ans entre les auteurs fur le tems de la
naiftance de Jefus-Chrift. Expofition du fyftême de chronologie
de M. Newton félon lequel le monde eft moins
vieux de 300 ans que ne le croient les chronologiftes. Ses
preuves font de deux efpeces. Les premières roulent fur
l’évaluation des générations. III. 391. a. Les fécondés font
tirées de l’aftronomie. Comment M. Freret attaque ce fyftè-
me. M. Newton avoit évalué chaque génération des rois à
vingt ans. M. Freret trouve qu’elles doivent être évaluées à
trente ans au moins, ou plutôt entre trente 8c quarante ans.
D’où vient une fi grande différence entre ces deux auteurs.
Ne feroit-il point permis de penfer que fi le calcul de M.
Newton eft trop foible en moins, celui de M. Freret eft
trop fort en plus ? A l’égard des preuves agronomiques,
M. Freret oblerye que la pofition des étoiles fur laquelle
M. Newton fe fonde, n?eft nullemem exaile dans les écrits
des anciens .lbid. b. Deux fortes dé chronologie; l’une purement
hiftorique, l’autre mathématique 8c aftronomique, qui
emploie les obfervations 8c les calculs, tant pour débrouiller
les époques que pour les ufages de la religion, comme pour
fixer les fêtes mobiles, 8c conftruire le calendrier. Précis 8c
éloge de l’ouvrage intitulé L’art de vérifier Us dates. lbid.
392- a- Divifion de tems très-commode imaginée par M.
Bianchini, dont M. de Fontenelle foit mention dans l’éloge
de ce favant. lbid. b.
Chronologie. On ne fouroit attribuer aucune autorité à
l’hiftoire chronologique de Manéthon. IV. 981. a. Divifion
que les Chaldéens foifoient du tems dans leur chronologie.
XI. 99. b. XIV. 639. a. Comment les Athéniens avant les
Olympiades comptoient le nombre des années. II. 3. b.
De la chronologie des Chinois. H3. 342. a. L’âge du monde
divifé par les chronologiflesen fix époques. I. 169. b. Travaux
de Seth Calvifius dans la chronologie. XIU. 699. b.
Ouvrage de Guillaume Bévéridge fur la chronologie. XVII.
a- Syftême chronologique de Newton. 633. b. Du vieux
j ftyle en chronologie. XV. 336. b. Utilité
des fobriquets pour la chronologie. 249. b. Sur la chronologie
, voye^ A n t iq u it é .
Chronologie facrée. Incertitude où nous jettent les divers
fentimens de plufieurs nations fur l’antiquité du monde.
Mioix que nous devons faire pour fixer cette incertitude.
Î - lS j i cet0art,cle : montrer que les énormes calculs des
Chaldéens 8c autres, peuvent fe réduire à quelqu’un des
lyftêmes de nos autours fur la chronologie focrée : fecon-
dement moquer lufage qu’on pourroit faire des différons
39Î i B*« les époques principales. III.
I f l " S * 1 , ¡ ¡ ¡ I l à noire "ch’rk
!• ffe 9 ,t clue nous f°mmes redevables de
auefJ ,0n' 11 Pfétend I f l les anciens défignoient quel-
ChalcU ^3r , n0m n^e un iour » & que quand les
füivoiï n sarro8eoient 473° ° ° ans d’obfervations , il s’en-
duire à CCS ann^es n ^rant quc des jours devoient fe ré-
ce miù’o^97 K environ neuf mois de nos années folaires,
Tome] aVCC nom^re d’années qu’Eufebe compte
C H R 3 1 3
É S Ë g É É jË g ï ïW » aftronomie ¡„rqn’an tems
r^ ÎS Ï Ï . ajoutoit 17000 ans aux obfervations des
Chaldéens, or ces années évaluées à la maniete de M Gibert
donnent 46 ans j , ou 1 intervalle précis du paffage d’AlexanÎ
i ®n AÎ rV JUfqUaUJmJ°men.t oil Bérofe avoit conduit fon
hiftoire. Meme accord dans les calculs, en réduifant delà
môme forte les 720 mille années qu’Epigene donnoit aux
obfervations confervées à Babylone. Autre preuve en foveur
de M. Gibert ; les mémoires de 150 mille ans, que l’on con-
fervoit, félon Bérofe , à Babylone , fe réduifent à 410 ou
411 ans, 8c remontent exaélement depuis Alexandre jufqu’à
l’ere de Nabonaffar, qui détruifit tous les monumens hilto-
riques des tems qui l’avoient précédé. III. 393. ¿.Autres ré-
duélions de M. Gibert dans la chronologie égyptienne. De
la chronologie chinoife rappellée à notre chronologie. Selon lÿ
mble de^ Nien , auteur tres-eftimé à la Chine, l’hiftoire de la
Chine n’a point d’époque «certaine plus ancienne que l’an 400
ayant Jefus-Chrift. Calcul d’après lequel l’époque des premières
obfervations chinoifes coïncidé avec celle des premières
obfervations chaldéennes. Confidérations qui nous
engagent à ramener les différentes chronologies des peuples
à quelqu’un de nos fyftêmes de chronologie facrée. lbid. b.
Variations entre les trois textes facrés fur la chronologie*
Selon le texte Hébreu, il y a depuis Adam jufau’au déluge
1636 ans ; félon le Samaritain 1307 ; félon les Septante entre
2242 8c 2262. Divifion des chronologiftes fur les tems
poftérieurs au déluge. Syftême de Marsham , fyftême de
Pezron. Sentiment de M. l’abbé de Prades fur cette diverfité
entre les trois textes, 8c des trois textes avec la chronologie
chinoife , diverfité qui, félon la remarque de cet auteur
fournit une grande difficulté aux impies contre le récit de
M°yfe- Ihid. 394. a. M. l’abbé de Prades a prétendu donc
que Moyfe n’eft auteur d’aucune des trois chronologies , &
que ce font trois fyftêmes inventés après coup. Preuves fur
lefquelles il appuie fon fentiment. Le défout de ce iVftême
•eft d’ébranler la preuve de l’authenticité des faits contenus
dans les livres facrés, en fuppofant que des hommes auront
pu pouffer la hardiefte , foit à inférer une chronologie dans
le texte, fi Moyfe n’en a foit aucune, foit à y en fubflituer
une autre que la fienrie. lbid. b. Rien n’empêche donc qu’on
n’admette les trois textes , 8c qu’on ne cherche à les concilier
, d’autant plus qu'on trouve dans tous les trois pris col-
leâivemeut de quoi fatisfoire à beaucoup de difficultés. Prérogatives
de chacun des textes. Il eft autant probable qu’il
fe fera gliffé quelques fautes dans le texte Hébreu 8c dans le ^
Samaritain, que dans la veriion des Septante , par l’inad- iP *
vertence des copifles. lbid. 393. a. Les trois textes ayant à-
peu-près les mêmes prérogatives, c’eft de leur propre fonds
qu’il s’agit de tirer des raifons de préférer l’un à l’autre dans
les endroits où ils fe contredifent, fans fe fixer à un feul à
l’exdufion des autres. Ces principes pofés, le fyftême qui va
fuiyre n’efl propofé que fur le pié de conjedures, 8c n’em-
brafte que les tems qui ont fuivi le déluge , fur lefquels nos
recherches ont le plus d’importance. Obfervation fur l’autorité
qu’on doit attribuer à Jofephe. Raifons pour lefquelles
l’auteur s’attache au texte Samaritain 8c à la verfion des
Septante , pour ce qui concerne les âges des patriarches. lbid.
b. Obfervations fur la durée du premier âge après le déluge ,
qui, félon le texte hébreu , ne feroit que de 367 ans, terme
probablement trop court, vu le grandnombre d’événemens
qu’il renferme. Autres circonflances qui ne font guere moins
fentir le befoin d’étendre la durée du fécond âge. La Genèfe
foit mention de la monnoie d’argent dont Abraham acheta
un tombeau, comme d’une choie commune 8c d’une origine
ancienne : or chacun fait que l’invention de la monnoie fup-
pofe bien des découvertes que les hommes n’auront foites
que très-lentement. lbid. 396. a. Le bon fens 8c l’expérience
nous difent que les hommes n’ont formé qu’une fociété, jufqu’à
ce qu’ils aient été affez nombreux pour fe féparér , 8c
que par conféquent les chronologiftes qui, avant la confù- .
bon des langues, envoient les fus de Noé habiter des pays
éloignés , 8c donnent à Cham , après 69 ans écoulés , trois
fucccflcurs en trois royaumes diffërens, ne nous donnent ici
que l’hiftoire de leurs imaginations. Le bon fens d’accord avec
1 écriture, nous dit encore que les hommes ne s’étant difper—
fés qu’après la divifion des langues , ces petits peuples s’étendirent
, 8c les diftances qui les féparoient s’évanouirent :
alors chacun d’eux fe trouva voifin d’un peuple qu’il ne con-
noiffoit pas , 8c dont il ignoroit la langue, lbid. b. Ces colonies
trouvèrent entr’elles tant de divenité, qu’il ne leur vint
pas en penfée qu’elles partoient toutes d’une même tige. Ce
voifinage produifit des guerres : les difputes fur l’ancienneté
d’origine commencèrent , les idiomes fe multiplièrent encore
, -8c les empires fe formèrent: or tout cela n’eft pas l’ouvrage
de trois fiecles que le texte hébreu compte depuis le
déluge jufqu’à Abraham. D’ailleurs ce texte eft incompatible
avec les dynaflies d’Egypte ,8c d’autres chronologies qui,
félon le calcul de ce texte , remonteroient bien au-delà de
l’époque du déluge. Raifons qui engagent l’auteur à placer
K K k k