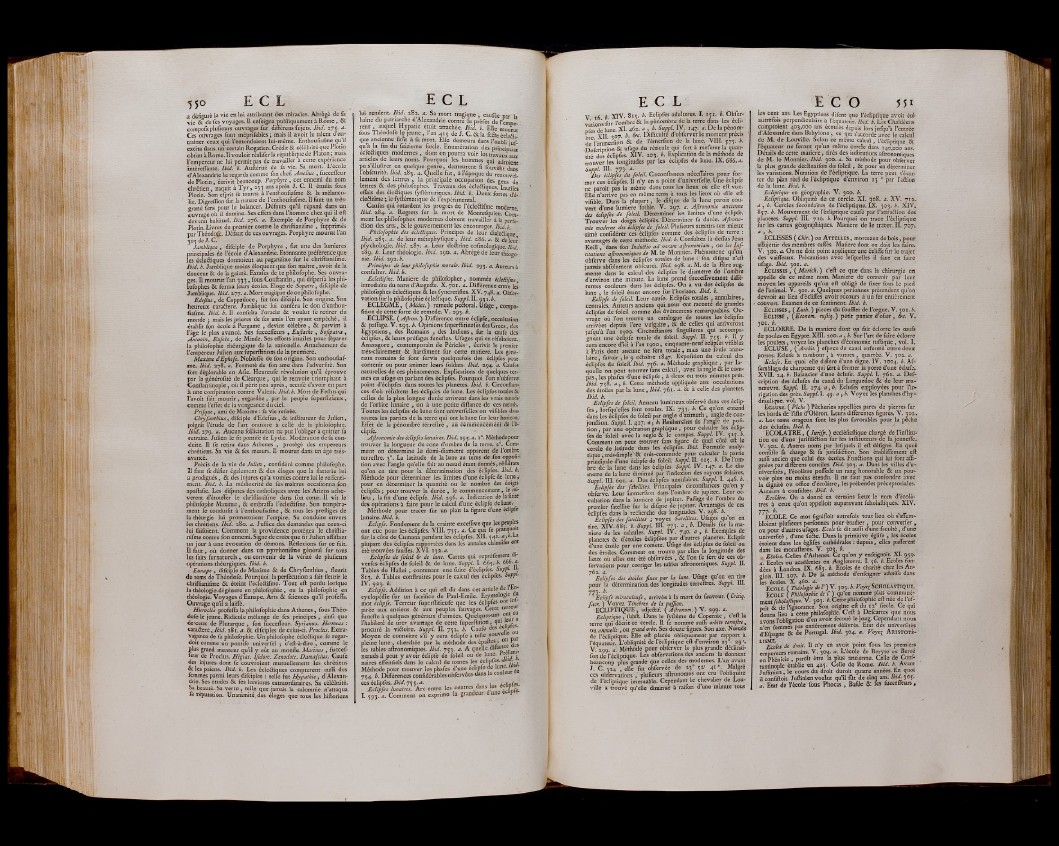
5 50 E C L
j défiguré la vie en lui attribuant des miracles. Abrégé de fa
vie & de fes voyages. Il enfeigna publiquement à Rome, &
compofa plufieurs ouvrages fur différens fujets. lbid. 275. a.
Ces ouvrages font méprifables ; mais il avoit le talent d’entraîner
ceux qui l’entendoient lui-même. Énthoufiafine qu’il
excita dans un certain Rogatien. Crédit & célébrité que Plotin
obtint àRome. Il vouloit réalifer la république de Platon jamais
l ’empereur ne lui permit pas de travailler à cette expérience
intéreflantè. lbid. b. Auftérité de fa vie. Sa mort. L école
d’Alexandrie le regarda comme fon cher. Amclius, fuccefleur
de Plotin, écrivit beaucoup. Porphyre , cet ennemi du nom
chrétien, naquit à T y r , 233 ans après J. C. Il étudia fous
Plotin. Son efprit fe tourna à 1 enthoufiafme & la mélancolie.
Digreflion fur. la nature de l’enthoufiafme. Il fout un très-
grand îens pour le balancer. Défauts qu’il répand dans un
ouvrage où il domine. Ses effets dans l’homme chez qui il eft
devenu habituel, lbid. 276. a. Exemple de Porphyre & de
Plotin. Livres du premier contre le dîriftianifme , fupprimés
parThéodofc. Défaut de ces ouvrages. Porphyre mourut l’an
503 de J. C.
Jamblique , difciple de Porphyre , fut une des lumières
principales de l’école d’Alexandrie. Etonnante préférence que
les écle&iques donnoient au paganifme fur le chriftianifme.
lbid. b. Jamblique moins éloquent que fon maître, avoit de la
douceur & de la gaieté. Extafes de te philofophe. Ses ouvrages.
Il mourut l’an 333, fous Conftantin, qui difperfa les phi-
lofophcs & ferma leurs écoles. Eloge de Sopatre, difciple de
Jamblique. lbid. 277. a. Mort tragique de ce philofophe.
Edefius, de Cappadoce, fut Ion difciple. Son origine. Son
heureux caraftere. Jamblique lui conféra le don d’enthou-
fiafme. lbid. b. U confulta l’oracle & voulut fe retirer du
monde ; mais les prières de fes amis l’en ayant empêché, il
établit fçn école à Pergame , devint célébré , & parvint à
l’âge le plus avancé. Ses fucceffeurs , Eufiathe , Sofipatra,
Antonin, Eufetc, de Minde. Ses efforts inutiles pour léparer-
la philofophie théurgique de la rationelle. Attachement de
l’empereur Julien auxfuperititions de la première.
Maxime tTEphefe. Nobleffe de fon origine. Son enthoufiaf-
me. lbid. 278. à. Fermeté de fon ame dans l’advcrfité. Son
fort déplorable en Aile. Heureufe révolution qu’il éprouve
par la généralité de Cléarque, qui le renvoie triomphant à
Conftantinople, où il périt peu après, accufé d’avoir eu part
à une confpirarion contre ValenS. lbid. b. Mort de Feflus qui
l’avoit fait mourir, regardée, par le peuple fuperflideux,
comme l’effet de la vengeance du ciel.
Prifque, ami de Maxime : fa vie retirée.
Chryfanthius, difciple d’Edefius, & inllituteur de Julien,
joignit l’étude de l’art oratoire à celle de la philofophie.
lbid. 279. a. Aucune follicitation ne put l’obliger à quitter fa
retraite. Julien le fit pontife de Lydie. Modération de fa conduite.
Il fe retira dans Athènes , protégé des empereurs
chrétiens. Sa vie & fes moeurs. Il mourut dans un âge très-
avancé.
Précis de la vie de Julieh, confidéré comme philofophe.
Il Éiit fe défier également & des éloges que la flatterie lui
a prodigués, & des injures qu’a vomies contre lui le reffenti-
ment. lbid. b. La médiocrité de fes maîtres occafionnafbn
apoilafie. Les difputes des catholiques avec les'Ariens achevèrent
d’étouffer le chriffianifme dans ion coeur. /Il vit le
philofophe Maxime, & embraffa l’écleétifme. Son tempérament
le conduifit à l’enthoufiafmc, & tous les preffiges de
la théurgie lui promettoient l’empire. Sa conduite envers
les chrétiens. lbid. 280. a. Juffice des demandes que ceux-ci
lui faifoient. Gomment la providence protégea le chriffianifme
contre fon ennemi.Signe.de croix que fit Julien affiffant
un jour à une évocation de démons. Réflexions fur ce fait.
U faut, où donner dans un pyrrhonifme général fur tous
les faits furnaturels, ou convenir de la vérité de plufieurs
opérations théurgiques. lbid. b.
Eunapt, difciple de Maxime & de Chryfanthius, fleurit
du tems de Théoaofe. Pourquoi la perfécution a fait fleurir le
chriftianifme & éteint l’écleétifme. Tout eff perdu lorfque
la-théologie-dégénéré en philofophie , ou la philofophie en
théologie. Voyages d'Eunape. Arts & fciences qu’il profeffa.
Ouvrage qu’il a laiffé.
Hier0des profeffa la philofophie dans Athènes, fous Théo*
dofe le jeune. Ridicule mélange de fes principes,. ainfi que
de'ceux de Plutarque , fon fuccefleur. Syrianus. Hermeas :
caraétere, lbid. 281 .a. 8c difciples de celui-ci.Produs. Extravagance
de fa philofophie. Un philofophe écleâique fe regar-
doit comme un pontife univerfel ; c’eff-à-dire, comme le
plus grand menteur qu’il y eût au monde. Marinus , fuçcef-
feur de Proclus. Hégias. lfidore. Zenodote. Damafdus. Caufe
des injures dont fe couvraient mutuellement les chrétiens
& les païens. lbid. b. Les écleétiques comptèrent aufli des
femmes parmi leurs difciples : telle fut Hypathie, d’Alexandrie.
Ses études 8t fes lumières extraordinaires. Sa célébrité.
Sa beauté.-Sa vertu, telle que jamais la calomnie n’attaqua
» réputation. Unanimité, des éloges que tous les hiftoriens
E C L
lin rendent. lbid. 2*2 a. Sa mort tragique, cauiêe par la
haine du patriarche d Alexandrie contre le préfet de remue
reur, auquel Hypatie étoit attachée. lbid. b. Elle mourut
fous Théodofe le jeune, l’an 413 de J. C. & la feâe écleéti
que ancienne finit à fa mort. Elle demeura dans l’oubli iuf
qu’à la fin du feizieme fiecle. Enumération des principaux
¿cl'ectiques modernes , dont on pourra voir les travaux aux
articles de leurs noms. Pourquoi les hommes qui aüroient
pu s’illuflrer en quelque genre, demeurent fi fouveht dans
l’obfcurité. lbid. 283. a. Quelle fut, à l’époque du renouvellement
des lettres , la principale occupation des gens de
lettres & des philofophes. Travaux des écleftiques. Inutiles
effais des éleétiaues iyftématiques. lbid. b. Deux fortes d’é-
cleétifme ; le fyffématique 8t l’expérimental.
Caufes qui retardent les progrès de l’écleâifme moderne.
lbid. 284. a. Regrets fur la mort de Montefquieu. Comment
les philofophes modernes doivent travailler à la perfe-
étion des arts, oc le gouvernement les encourager. lbid. b.
Philofophie des édcQiques. Principes de leur dialeffique
lbid. 283. a. de leur métaphyfique , lbid. 286. a. & de leur
pfychologie. lbid. 287. a. Leur doftrine cofmologique. lbid.
289. b. Leur théologie. lbid. 290. a. Abrégé de leur théogonie.
lbid. 292. b.
Principes de leur philofophie morale. lbid. 293. a. Auteurs à
confulter. lbid. b.
Ecleflifme. Maniéré de philofopher, nommée écleflifme,
introduite du tems d’Augufte. X. 701. a. Différence entre les
philofophes écleâiques 8c les fyncretiftes. XV. 748. a. Obfer-
vation fur la philofophie écleétique. Suppl. II. 931. b.
ECLEGME, ( Midec. ) remede peaoral. Ufage, compo-
fition de cette forte de remede. V . 293. b.
ECLIPSE. ( AJlron.) Différence entre éclipfe, occultationpaffage.
V . 293. b. Opinions fuperftitieufes des Grecs, des
Egyptiens, des Romains des Indiens, fur la caufe des
éclipfes, & leurs préfages funeftes. Ufages qui en réfultoient..
Anaxagore, contemporain de Péridès , écrivit le premier
très-clairement & hardiment- fur cette matière. Les géné-'
raux romains fe font fervis quelquefois des éclipfes pour-
contenir ou pour animer ieurs foldats. lbid. 294. a. Caufes
naturelles de ces phénomènes. Explications de quelques termes
en ufage en parlant des édipfes. Pourquoi l’on n’obferve
point d’écliofes dans toutes les planetes. lbid. b. Circonfian*,
ces d’où rélultent les éclipfes de lune. Les éclipfes totales 8c
celles de la plus longue durée arrivent dans les vrais noeuds-
de l’orbite lunaire , ou à une petite difiance de ces noeuds.
Toutes les éclipfes de lune font univerfelles ou vifibles dans
toutes les parties de la-terre qui ont la lune fur leur horizon.-
Effet de la pénombre terrefire , au commencement de Té-
dipfe.
AJlronomie des ¿dipfes lunaires. lbid. 29 3. a. 1°. Méthode pour
trouver la longueur du cone d’ombre de la terre.'a0. Comment
on détermine le demi-diametre apparent de l’ombre
terreftre. 30. La latitude de la lune au tems de fon oppofi-
tion avec l’angle qu’elle fait au noeud étant donnés, réfultats
qu’on en tire pour la détermination des éclipfes. lbid. b.
Méthode pour déterminer les limites d’une éclipfe de lune ,•
pour en déterminer la quantité ou le nombre des doigts
éclipfés ; pour trouver la durée , le commencement , le milieu
, la fin d’une éclipfe. lbid. 296. a. Indication de la fuite
des opérations à faire pour le calcul d’une éclipfe de lune.
Méthode pour tracer fur un plan la figure d’une éclipfe
lunaire, lbid. b.
Eclipfe. Fondement de la crainte exceflive que les peuples
ont eue pour les éclipfes. VIII. 733. a. Ce qui fe pratiquoit
fur la côte deCumana pendant les éclipfes. XII. 341.
plupart des éclipfes rapportées dans les annales chinoifes ont
été trouvées fauffes. X v l. 132. a. '
Eclipfes de foleil & de urne. Cartes qui repréfentent *-
verfes éclipfes de foleil & de lune. Suppl. I. 063. b. 606.
Tables de Hallei, contenant une fuite d’éclipfes. Suppl- lu
81.3. b. Tables conftruites pour ïe calcul des éclipfes. Suppl-
IV. 923. •b: ■ . j i»c .
Eclipfe. Addition à ce qui eft dit dans cet article de 1 tn-
cyclopédie fur un facrifice de Paul-Emile. Etymologie au
mot éclipfe. Terreur fuperftitieufe que les éclipfes ont in -
pirée aux anciens 8c aux peuples fauvages. Cette terreu^
funefte à quelques généraux d’armées. Quelques-uns ont,
l’habileté de tirer avantage de cette fuperftition » qui Jfu£
procuré la viéloire. Suppl. II. 7c 2. b. Caufe des écup
Moyen de connoître s’il y aura éclipfe à telle nouve
pleine lune , cherchée par la méthode des épaffes, ou p
les tables- aftronomiques. lbid. 733. a. A quelle durij?c,.. .
noeuds il peut y avoir éclipfe de foleil ou de lune. Vx
naires effentiels dans le calcul euentieis daee ttoouutteess liee»s cécdliippifeess--«- r'.y
Méthode pour trouver les phafes d’une éclipfe de lime. •
734. b. Différences cpnfidérables obfervées dans la cou
entre
I. 393. a. Comment on exprime la grandeur, d une
E C L
V 6 b XtV. 813. b. Eclipfes adultérés. I. 131. b. Ôbfer-
vJnnn’s fiir l’ombre & la pénombre de la terre dans les éclijbS
se OEXIIm 3<>7 x*i - m&Cm aDisffic «ulté dPobfe rver le mDoem 1en mt précêis
d e i’immerfion & de l’émerfion de la lune. VIII. 373. b.
■Defcription ufage du réticule qui fort à mefurer la quantité
des éclipfes. XIV. 203. b. Explication de la méthode de
trouver les longitudes par les éclipfes de lune. IX. 686.*.
Suppl- III. 773. a. , „ .
Des éclipfes du foleil. Circonftances néceflatres pour former
ces édipfes. Il n’y en a point d’univerfelle. Une éclipfe
ne paraît pas la même dans tous les lieux où elle eft vue.
Elle n’arrive pas en même tems à tous les lieux où elle eft
vifible. Dans la plupart, le difque de la lune paraît couvert
d’une lumière foible. V. 297. a. AJlronomie ancienne
des éclipfes de foleil. Déterminer les. limites d’une éclipfe.
Trouver les doigts éclipfés. Déterminer fa durée. AJlronomie
moderne des éclipfes de foleil. Plufieurs auteurs ont mieux
aimé confidérer ces éclipfes comme des éclipfes de terre :
avantages de cette méthode. lbid. b. Confultez là-deffus Jean
Keill ■, dans fon InduElïo ad veram ajlronomiam, ou les Inf-
titutions agronomiques de M. le Monnier. Phénomène queto
obferve dans les édipfes totales de lune :Mon dtfoue rieft
jamais abfolument obfcurci. lbid. 298. u. M. de la Hire augmente
dans le calcul des éclipfes le diametre de rombre
d’environ ufie minute. La lune prend fucceffivement différentes
couleurs dans les éclipfes. On a vu des éclipfes de
lune , le foleil étant encore fur l’horizon. lbid. b.
Eclipfe de foleil. Leur caufe. Eclipfes totales , annulaires >
centrales. Auteurs anciens qui nous ont raconté de grandes
édipfes de foleil comme des événemens remarquables. Ouvrage
où l’on trouve un catalogue de toutes les éclipfes
arrivées depuis l’ere vulgaire, Ôc de celles qui arriveront
jufqu’à l’an 1900. Circônftances fingulieres qui accompagnent
une écupfe totale de foleil. Suppl. II. 733. b. Il y
aura encore d’id à l’an 1900 , cinquante-neuf éclipfes vifibles
à Paris dont aucune ne fera totale , mais une feule annulaire
't favoir , le 9 oftobre 1847. Expofition du calcul des
éclipfes de foleil. lbid. 736. a. Méthode graphique, par laquelle
on peut trouver Ans calcul, avec la réglé & le compas,
les phafes d’une éclipfe , à deux ou trois minutes près.
lbid. 738. a , b. Cette méthode appliquée aux occultations
des étoiles par la lune, lbid. 761. u. & à celle des planetes.
lbid. b. '
Eclipfes de foleil. Anneau lumineux obfervé dans ces éclip-
fes, lorfqu’elles font totales. IX. 733. b. Ce qu’on entend
dans les éclipfes de foleil par angle tfazimuth, angle de conjonction.
Suppl. I. 427. a , b. Recherches de 1 angle de pofi-
tion , par une opération graphique , pour calculer l'es éclipfes
de foleil avec la réglé & le compas. Suppl. IV. 3X5- *•
Comment on peuc trouver fans figure de quel côté eft le
cercle de latitude dans les éclipfes. lbid. Formule analytique
, très-fimplev& très-commode pour calculer la partie
principale d’une éclipfe de foleil. Suppl. II. 113. é. De l’ombre
de la lune dans les éclipfes. SuppL IV. 147. a. Le diamètre
de la lune diminué par l’inflexion des rayons folaires,
Suppl. IIL 601. a. Des éclipfes annulaires. Suppl. I. 446. b.
Eclipfes des fdfelliies. Principales circonftances qu’on y
obferve. Leur imraerfion dans l’ombre de jupiter. Leur occultation
dans la lumière de jupiter. Paffage de 1 ombre du
premier fatellite fur le difque de jupiter. Avantages de ces
éclipfes dans la recherche des longitudes. V. 298. b. I
Eclipfes des fatellites ; voyez Satellites. Ufages qu’on en
tire. XTV. 683. b.-Suppl IIl. 773. a , b. Détails fur la manière
de les calculer. Suppl. ÎV. 740. a , b. Exemples de
planetes & d’étoiles éclipfêes par d’autres planetes. Eclipfe
d’une étoile par une comete. Ufage des éclipfes de foleil ou
des étoiles. Comment on trouve par elles la longitude des
lieux où elles ont été obfervées , & l’on fe fert de ces ob-
fervations pour , corriger les tables aftronomiques. Suppl. II.
762* W ■ m
Eclipfes des étoiles fixes par la lune. Ufage quon en tire
pour la détermination, des longitudes terreftres. Suppl. III.
7 7 3 .'b.
' Eclipfe miraculeufe, arrivée à.la mort du fauveur. ( Critiq.
facr. ) Voyez Ténèbres de la paffion.
ECLIPTIQUE, adjeâif. \Afironom.) V. 299. a. -■
Eclip tique, fubft. Dans le fyftême de Copernic , c’eft la
terre qui décrit ce cercle. Il le nomme aufli orbite terrefire
E C O 5 5 1
annuelle, ou grand orbe. Ses douze $gnes. Son axe. Noeuds
ie^ Elle | • ■ '
de l’écliprique.eft placée obliquement par rapport à
l ’équateur. L’obliqaité m
de l’écliptique eft d’environ 23 . 29 '.
V. 299. a. Méthode pour obferver la plus grande déclinaiou
. . à.Mùtnnde % ,w
fon de l’écliptique. Les obfervatipns des anciens la
beaucoup plus grande que celles des modernes. La
J. C. 324 elle fut obfervée de 230 32' 411 Malgré
ces obfervations , plufieurs aftronomes ont cru l’obliquité
de l’édiptique immuable. Cependant le chevalier de Lou-
ville a trouvé qu’elle diminue à raifon d’une minute tous
lès cent ans. Les Egyptiens difent que l’éclipttqüe avoit été
autrefois perpendiculaire à l’équateur. lbid. b. Les Clialdéens
complotent 403,000 ans écoulés depuis lors jufqu’à l’entrée
d Alexandre dans flabylone -, ce qui s’accorde avec le calcul
de M. de Louville» Selon ce même calcul, l’éctiprique &
l’équateur ne feront qu’un même cercle dans 140,000 ans;
Détails de cette matière , tirés des inftitutions aftronomiques
de M. le Monnier. lbid. 300. a. Sa méthode pour obferver
la plus grande déclinaifon du foleil, & pour en déterminer
les variations. Nutation de l’éeliptique. La terre peut s’écarter
du plan réel de l’écliptique d’environ 13 " par fa&ion
de la lune^ lbid. A
Eclipïtque en géographie. Vi 300. b.
Eclïptique. Obliquité de ce cercle. XL 308. a. XV. 712-.
a , b. Cercles fecondaircs de l’édiptique. IX. 303. b. XIV.
837. b. Mouvement de l’ècliptique caufé par l’attraélion des
planetes. Suppl. IIL 710. b. Pourquoi on trace l’écliptique
fur les cartes géographiques. Manière de le tràter. u . 707-.
ECUSSES ( Chin ) ou A t t e l l e s , morceaux de bois, pour
aflùjettir des membres caffés. Matière dont on .doit les ràirev
V. 3Ô0. a. On ne doit point appliquer tme édifie fur le trajet
des vaiffeaux. Précautions avec lefquelles il faut en faire
ufage. lbid. 301. a>
E c li s s e s , ( Maréck. ) c’eft ce que dans la chirurgie cil
appelle de ce même nom. Manière de contenir par leur
moyen les appareils qu’on eft obligé de fixer fous le pied
de l’animal. V. 301. a. Quelques perfonnes prétendent qu’oit
devrait au lieu d’éclifles avoir recours à Un fer entièrement
couvert. Examen de ce fentiment. lbid. b.
E c li s s e s , ( Luth. ) pièces du foufftet de l’orgue. V . 301. b.
E c li s s e , ( Eco nom. ntfiiq.') petit panier „dufier, &c. V.
30Ï. b.
ECLORRE. De la maniéré dont on' fait éclorre les oeufs
de poules en Egypte. XIII. 2OO. a , b. Sur l’art de faire éclorre
les poulets * voyez les planches d’économie ruftiqüe , vol. I.
ECLUSE, ( Archit.) efpece de canal enfermé entre deux
portes. Eclufe à tambour, à vannes , quarrée. V. 302. a.
Eclufe. En quoi elle diffère d’une digue. IV. 1004. b. Af-
femblage de charpente qui fert à fermer la porte d’une éclufo.
XVII. 24» b. Balancier d’nne éclufe. Suppl !.. 761. a. Defcription
des éclufes du canal du Languedoc & de leur manoeuvre.
Suppl II. 174. a , b. Eclufes employées pour l’iirrigation
des prés. Suppl I. 49. a , b. Voyez les planches d’hydraulique.
vol. V.
E c lu s e . ( Pèche ) Pêcheries appellées parcs de pierres fur
les bords de l’iile d’Oléron. Leurs différentes figures. V. 302.
a. Les tems orageux font les plus favorables pour la pêche
des éclufes. lbid. b.
ECOLATRE, ( Jurifp. ) eccléfiaftique chargé de Tinftitu*
tion ou d’une jurifdi&ion fur les inftituteurs de la jeunefle.
V. 302. b. Autres noms par lefouels il eft déflgné. En quoi
confifte fa charge & fa jurifdiction. Son établiflement eft
aulfi ancien que celui des écoles. Fondions qui lui font afli-
gnées par différens conciles. lbid. 303. a. Dans les villes d’u-
niverfités, l’écolâtre poflede un rang honorable & un pou*
voir plus Ou moins étendu. Il ne faut pas confondre avec
la dignité ou office d’écolâtre, les prébendes ptéceptoriales.
Auteurs à confulter. lbid. b.
Ecolâtre. On a donné en certains lieux le nom d’écolâ-
tres à ceux qu’on appelloit auparavant fcholaftiques. XIV.
777* b.
ECOLE. Ce mot fignifiôit autrefois tout lieu ou s’affem*
bloient plufieurs perfonnes pour étudier , pour converfer ,
ou pour d’autres ufages. Ecole fe dit aufli d’une faculté, d’une
univerfité , d’une fe&e. Dans la primitive églife , les écoles
étoient dans les églifes cathédrales : depuis, elles paflerent
dans les monafteres. V. 303. b. .
, Etoles. Celles d’Athenes. Ce qu’on y enfeignoit. XI. 939.
a. Ecoles ou académies en Angleterre. I. 36. b. Ecoles fondées
à Londres. IX. 683. b. Ecoles de charité chez les An-
glois. III. 207. b. De la méthode d’enfeigner admife dans
les écoles. X. 4^®- * . ,* .
E c o l e . ( Théologie deT) V. 303. b. Voye^SCHOLASf IQUE.
E c o l e î Philojopkie de T ) qu’on nomme plus communé»
ment fcholafiique. V. 303. b. Cette philofophie; eft née del’cf-
orit & de l’ignorance. Son origine eft du 12 fiecle. Ce qui
donna lieu à cette philofophie. C’eft à Defcartes que nous
avons l’obligation d’en avoir fecoué le joug. Cependant nous
rien fommes pas entièrement délivrés. Etat des univerfités
d’Efpagne & de Portugal. lbid. 304. a. Voye[ A r i s t o t é lism
e . p „ , ^ . . ■. .
Ecoles de droit. Il rfy en avoit point fous les premiers
empereurs romains. V. 304. a. L’école de Beryte ou Beroé
enPhénicie, paraît être la plus ancienne. Celle de Conf-
tanrinople établie en 423. Celle de Rome. lbid. b. Avant
Juitinien, le cours du droit durait quatre années. En quoi
il confiftoit. Juftmien voulut qu’il fût de cinq ans. lbid. 303.
Etat de l’école fous Phocas, Bafile 8c fes fucceffeurs ,