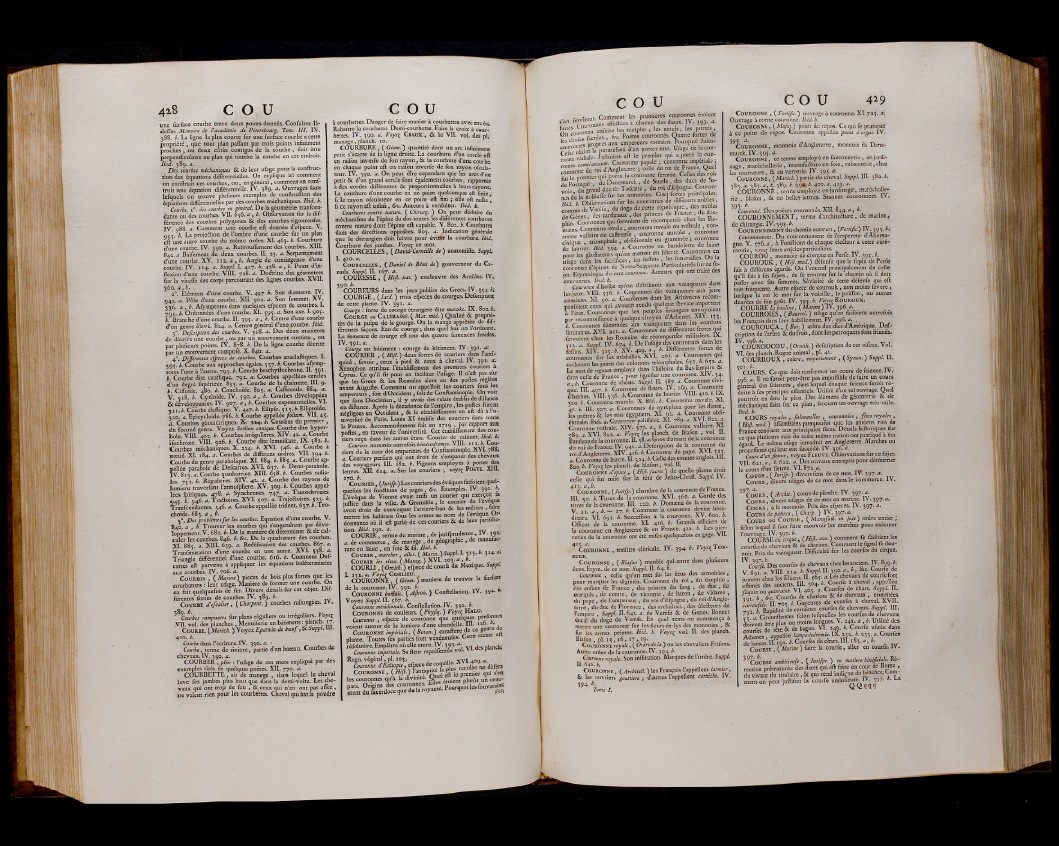
4 2 8 COU cou une furface courbe entre deux points donnés. Consultez là-
deflus Mémoire de Vacadémie de Pétersbourg. Tom. III. IV.
388. b. La ligne la plus courte fur une furface courbe a cette
propriété , que tout plan paffant par trois points infiniment
proches, ou deux cotés contigus de la courbe , doit être
perpendiculaire au plan qui touche la courbe en cet endroit.
Ibia. 389. a.
Des courbes mèchaniaues & de leur ufage pour la conltruc-
tion des équations différentielles. On explique ici comment
on conftruit ces courbes, ou, en général, comment on conf-
truit une équation différentielle. IV. 389. a. Ouvrages dans
lefquels on trouve plufieurs exemples de conftru&on des
équations différentielles par des courbes méchamques. Ibid. b.
Courbe. i°. des courbes en général. De la géométrie tranfcen-
dante ou des courbes. VIL 636. a , b. Obiervation fur la différence
des courbes polygones & des courbes rigoureufes.
IV.
7 988. a. Comment une courbe eft donnée d'efpece. V. I
3. b. La proje&ion de l’ombre d’une courbe fur im plan I
9T
eA une autre courbe du même ordre. XI. 463. b. Courbure I
d’une courbe. IV. 390. a. Rebrouffement des courbes. XHL I
$42. a Baifement ae deux courbes. II. 13. a. Serpentement I
d’une courbe. XV. 112. a , b. Angle de contingence d’une I
courbe. IV. 114. a. Suppl. I. 427. b. 428. a , ¿. Point d’ut- I
flexion d’une courbe. VllI. 728. a. Do&rine des géomètres I
fur la viteffe des corps parcourant des lignes courbes. XVII. I
360. « , ¿. , t v I
à courbettes. Danger de faire manier à courbettes avec excès»
Rabattre la courbette. Demi-courbette. Faire la croix à courbettes.
20. Elémens d’une courbe. V. 497 diametre. IV. I
942. a. Pôle d’une courbe. XII. 902. a. Son fommet. XV. I
336. a , b. Afymptotes dans quelaues efpeces de courbes. I. I
795. b. Ordonnées d’une courbe. XI. 595. a. Son axe. L 903. I
b. Branche d’une courbe. II. 395. a , b. Centre d’une courbe I
d’un genre élevé. 824. a. Centre général d’une fourbe. Ibid. I
3°. Defcription des courbes. V. 518. a. Des deux maniérés I
de décrire une courbe, ou par un mouvement continu , ou I
par plufieurs points. IV. 878. b. De la ligne courbe décrite I
par un mouvement compoiè. X. 840. a. I
40. Différentes efpeces de courbes. Courbes anaclamques. L I
395. b. Courbe aux approches égales. 3 57. b. Courbes afymp- I
totes l’une à l’autre. 795. b. Courbe brachyftochrone. II. 391. I
l. Courbe dite cauftique. 792. a. Courbes appellées cercles I
d’un degré fupérieur. 833. a. Courbe de la chaînette. W. 9. I
b. Ciffoide. 480. b. Conchoïde. 803. a. Calïinoîde. 884. a. I
V. 318. b. Cycloïde. IV. 390. a , b. Courbes développées
& développantes. IV. 907. a , b. Courbes exponentielles. VI.
3 11.b.Courbeélaftique. V. 447. b. Ellipfe. 315.b.Elhptoide. ]
320. a. Epicydoïde. 786. b. Courbe appellée folium. VII. 43.
a. Courbes géométriques. X. 224. b. Courbes du premier ,
du fécond genre. Voyez SeSion conique. Courbe dite hyperbole.
VIII. 402. b. Courbes irrégulières. XIV. 42. a. Courbe
ifochrone. VIII. 926. b. Courbe dite lemnifcate. IX. 382. b.
Courbes méchaniques. X. 224. b. XVI. 346. «.Courbe à
noeud. XI. 184. a. Courbes de différens ordres. VII. 394. b.
Courbe du genre parabolique. XI. 884. b. 883. a. Courbe appellée
parabole de Defcartes. XVL 637. b. Demi-parabole.
IV 813.«.Courbe quadratrice. XÜI. 638. b. Courbes radiales"
732. b. Régulières. XIV. 42. a. Courbe des rayons de
lumière traverfant l’atmofphere. XV. 309. b. Courbes appell
e s fpiriques. 478. § Synchrones. 747- a: Tautochrones.
«43. b. 946. «. Traôoires. XVL 307. «. Trajeftoires. 323. b.
Tranfcendantes. 346. a. Courbe appellée trident. 637. b. Tro-
choïde. 683. « , ¿. ,j '
j)es problèmes fur les courbes. Equation d une combe. V.
842. « , b. Trouver les courbes qui s’engendrent par développement.
V. 682. b. De la maniéré de déterminer & de calculer
les courbes. 846. b. &c. De la quadrature des courbes.
XI. 883. «. Xffl. 639. a. Rectification des courbes. 867. «.
Tranfmûtation d’une courbe en une autre. XVI. 358. a.
Triangle différentiel d’une courbe. 616. b. Comment Defcartes
ell parvenu à appliquer les équations indéterminées
aux courbes. IV. 706. «. 1
C ourbes , ( Marine ) pièces de bois plus fortes que les
courbatons : leur ufage. Maniéré de former une courbe. On
en fait quelquefois de fer. Divers détails fur cet objet. Différentes
fortes de courbes. IV. 389. b.
C ourbe d’efcalier, ( Charpent. ) courbes rallongées. IV.
3 "courbes rampantes fur plans réguliers ou irréguliers. Voyei
vn. vol. des planches, Menuiferie en bâtimens : planch. 17.
C ourbe. ( Maréch. ) Voyez Eparvin de bauf, 8c Suppl. 111.
'410. b. .
Courbe dans l’écriture. TV. 390. «. • ,
Courbe, terme de riviere, partie d’un bateau. Combes de
chevaux. IV. 390. «. ,
COURBER, plier : l’ufage de ces mots expliqué par des
exemples tirés .de quelques poètes. XII. 770. «.
COURBETTE, air de manege , dans lequel le cheval
leve fes jambes plus haut que dans la demi-volte. Les chevaux.
qui ont trop de feu , 8c ceux qui n’en ont pas affez,
ne valent rien pour les courbettes. Cheval qui bat la poudre
IV. 390. «. Voye^ C ro ix , 8c le VII. vol. des pli
manege, planch. 10.
COURBURE, ( Géom. ) quantité dont un arc infiniment
petit s’écarte de la ligne droite. La courbure d’un cercle eft
en raifon inverfe de fon rayon , 8c la courbure d’une courbe
en chaque point éft en raifon inverfe de fon rayon ofcula-,
teur. IV. 390. «. On peut dire cependant que les arcs d’un
petit 8c d’un grand cercle font également courbes, rapportés
à des cordes différentes 8c proportionnelles à leurs rayons:
La courbure d’une courbe en un point quelconque eft finie ;
fi le rayon ofculateur en ce point éft fini ; elle eft nulle »
fi ce rayon eft infini, &c. Auteurs à confulter. Ibid. b.
Courbures contre nature. ( Chirurg. ) On peut déduire du
méchanifine de l’épine du dos toutes les différentes courbures
contre nature dont l’épine eft capable. V. 802. b. Courbures
dans des directions oppoiées. 803. «. Indication générale 2ue le chirurgien doit fuivre pour èvitèr la courbure. Ibid.
lourbure des jambes. Voye{ ce mot.
COURCELLES, ( Dav'id-Comeille de ) anatomifte. Suppl.
I. 410. «.
COURCELLES, ( Daniel de Bémi de) gouverneur du Canada.
Suppl. II. 167. «.
COURESSE, ( Hifi. nat. ) couleuvre des Antilles. IV.
390. b.
COUREURS dans les jeux publics des Grecs. IV. 934. b'.
COURGE, (Jard. ) trois efpeces de courges. Defcription
de cette plante. IV. 391. «.
Courge : forte de courge étrangère dite macokc. IX. 802. b.
C o u r g e ou Ca leb a s se . ( Mat. méd.) Qualité 8c propriétés
de la pulpe de la gourge. On la mange apprêtée de différentes
laçons. Eau de courge ; dans quel but on l’ordonne.
1 La femence de comge eft une des quatre femences froides.
IV. 391. ai
Courge en bâtiment : courge de bâtiment. IV. 391. «:
| COURIER , ( Hift. ) deux fortes de couriers dans l’antiquité
, favoir, ceux à pied 8c ceux à chevaL IV. 391. «.
I Xénophon attribue l’établiffement des premiers couriers h
I Cyrus. Ce qu’il fit pour en faciliter l’ufage. Il n’eft pas sur
I que les Grecs 8c les Romains aient eu des poftes réglées
I avant Augufte. Comment on appelloit les couriers fous les
I empereurs, fo'it d’Occident, foitde Conftantinople. On voit
I que fous Diodétien, il y avoit des relais établis de diftance
I en diftance. Après la décadence de l’empire, les poftes furent
I négligées en Ôccident , 8c le rétabliffement en eft du à lu-
I niverfité de Paris. Louis XI établit des couriers dans toute
I la France. Accommodement fait en 1719 » Par raPRort aux
I poftes , en faveur de l’univerfité. Cet établiffement des cou-
I riers reçu dans les autres états. Courier de cabinet. Ibid. b.
!■ Couriers nommés autrefois hémérodromes. VIII. 1 1 1. b. Cou-
riers de la cour des empereurs de Conftantinople. XVL 780. I «. Couriers perfans qui ont droit de s’emparer des chevaux
I des voyageurs. III. 182. ¿. Pigeons employés à porter des
! lettres. 301. 614. «. Sur les couriers , voyeç P oste. X11L
^ C ourier, (Jurifp) Les couriers des évêques faifoient quel-: I quefois les fondions de juges, I &c. Exemples. IV. 391. b. L’évêque de Vienne avoit auffi un courier qui exerçoit la
I iuftice dans la ville. A Grenoble, le courier de léveque
I avoit droit de convoquer l’arriere-ban 8c les milices , taire
I mettre les habitans fous les armes au nom de 1 éveque. ur-
• donnante où d eft parlé de ces couriers 8t de leur |unfdic-,
tion. Ibid. 392. «. . . . , t v »«»'•
COURIR, terme de marine, de junfprudence, iv . 302.
a. de commerce, de manege, de géographie , de manufac-
ture en laine , en foie 8c fil. Ibid. b. |
C o u r ir , marcher , aller. ( Marin. ) Suppl. I. 313. b. 314. {g
C ourir les têtes. (Maneg. ) XVL 203. a >b.
COURU, ( Omith.) efpece de courli du Mexique. Suppl.
L 151.«. Voyez CORLIEU. » . , .
COURONNE, ( Géom. ) maniéré de trouver la furface
de la couronne. IV. 392. b. . ..
I C ouronne boréale. ( Afiron. ) ConfteUauon. IV. 39a- **
Voyez Suppl. H. 367. b.
Couronne méridionale. Conftellation. IV. 39a’ T
C ouronne de couleurs. ( Phyfiq• ) Voyez Halo.
Couronne , efpece de couronne oue quelques pe“ ° f
II voient autour de la lumière d’une chmdelle^. IU* ■• * , C o u ro n n e impériale, (Botan. ) cara<ftere de c g ^
I plante. Toutes fes parties font vénéneufes. Cette
I réfolutive. Emplâtre où eUe entre. IV. 303- *• y j des planchj
1| Couronne impériale. Sa fleur repréfentée vol. v r
I Regn. végétal, pl. 103, -u, YVI aoq.«.
1 îomonnc iM W i i reculée ne déféra
C ouronne, (Hift.) ^ [e premier qui s’en
I les couronnes qu à la divinité. Q t . ^ un orne. I S u t d°uTcrdoTe^ d ê îa 'ro ^ é . Pourquoi les fo n v e rg
COU cou 419
, KHiirent. Comment les premières couronnes etoient
* il,.tonnes affeftées à chacun des dieux. IV. .393- “■
« tC™.nÔnna enfuite les temples, les autels, les portes ,
On couion>“ ries poètes couro„„és. Quatre fortes de
leS '™ ,es oropres aux empereurs romains. Pourquoi Jules-
S r X im T a permiffion ‘d’en porter une. Ufage de lacoü-
& f i§ radiale. Juliinien eft le premier qui a porté la cou-
rome cam'lmcium. Couronne papale ; couronne impériale,
couronne du roi d'Angleterre ; celle du roi de France. Quel
fut le premier qui porta la couronne fermée. Celles des rois
de Pormgal , de Danemarck, de Stiede , des ducs de Savoie
dif grand duc de Tofeane , du roi d'Efpagnc. Couronne
s d e la nobleffe fur les armoiries. Cinq fortes prmcipales.
Ibid b. Obfervations fur les couronnes de différens nobles,
comme de Venife, du doge de .cette république, des nobles
de Gênes, des cardinaux , des princes de France , du dau,
phin Couronnes qui fervoient de récompenfe chea les Romains.
Couronne ovale, couronne navale ou roftrale , cou
ronne vallaire ou caftrenfe , couronne murale , couronne
cMque , triomphale, obfidionale ou gramuiée S couronne
de laurier. Ibid. 394. a. Couronne ou bandelette de laine
pour les gladiateurs qu’on mettoit en liberté. Couronnes en
Sfage dans les facriSces, les feftins , les.funérailles. De a
couronne d’épines de Notre Seigncur. Particularités fur ce fu-
jet. Etymologie du mot couronne. Auteurs qui ont traité des
couronnes. Ibid. b. . . . .
Comonm d’herbe qu’on diftribuoit aux vainqueurs dans
les ieux v r a . fié . b. Couronnes des vainqueurs aux (eux
néméens. XI. 90. u. C o u rW s dont les Athéniens recom-
penfoient ceux qui avoietft rendu quelque ftrvice important
à l'état. Couronnes que les peuples étrangers envovoient
par reconnoilfance à quelque citoyen d Athènes. XIV. 133.
b. Couronnes décernées aux vainqueurs dans les combats
littéraires. XVI. an .u . Couronnes de diffitentes fortes qui
-fervoient chea les Romains de réçompenfes nubtaires. IX.
c i,, a. Suppl. IV- 674. é. De l’ufaSé dés couronnes dans les
félins XIV. 323. *• XV. 409- “ , b- Différentes fortes de
couronnes fur les médaUles. XVI. aol. «. Couronnes qm
cachoient les joints des colonnes triomphales. 631. é.6;ïa.u.
Le mot de regarni employé dans 1 hiftoire du Bas-Empire 8c
dans celle de France , pour fignifiei-une couronne. XIV. 34.
a , é. Couronne de chêne. Suppl. IL 387- «. Couronne civique.
III. 497. b. Couronne de fleurs. IV. 169. «. Couronne
d’herbes. Vin. 336. é.Couronne de laurier. VlII.410-i.IX.
320. b. Couronne murale. X. 866. b. Couronne navale. XI.
47. b. III. 307. «. Couronnes de nymphæa pour les dieux,
les prêtres & les rois égyptiens. XI. 92. «• Couronne obfi.
dionale. 8aS. a. Couronne pabffaire. XI. 789. «. XVI. Saa. «.
Couronne roftrale. XIV. 377. «, *• Couronne vallaire XI.
789. a. XVI. 8aa. «. Vom les planch. de blafon , vol. 11.
Bandeau de la couronne. II. 38. «. Gros diamant de la couronne
du roi de France. IV. 941. <*. Defcription de la couronne du
roi d’Angleterre. XIV. 416. b. Couronne du pape. XVI. 3 x 3.
Couronne de baron. II. 324. b. Celle des comtes anglois. III.
800. b. Voyez les planch. de blafon, vol. II.
C ouronne d'épine, ( Hifi. facrée ) de quelle plante etoit
celle qui fut mite fur la tête de Jefus-Chrift. S
4'&OURONNE, ( Jurifp.) chambre de la couronne de France.
III. <0. b. Titres de là couronne. XVI. 360. a. Garde des
titres de la couronne. III. 220. ¿. Domaine de la couronne.
V. 21 . a b. — 27. b. Comment la couronne devint héréditaire.
VI. 691. b. Succeffion à la couronne. XV. 600. b.
Offices de la couronne. XI. 416. b. Grands officiers de
la couronne en Angleterre 8c en France. 422. b. Les pierreries
de la couronne ont été mifes quelquefois engage. Vil.
é| | C ouronne , tonfure cléricale. IV. 394- A Voye^ T onsure.
- .
CoürONNe , ( Fortifie.) ouvrage à couronne. XI. 725’. à
Ouvrage à corné couronné. Ibid. b.
COURONNE, ( Mufiq.) point de repos. Ce qui fe pratiqué
à ce point de repos. Couronne appellée point d’orgue. IV.
3 ^OURONNe , irtonnoie d’Angleterre, monnoiè de Danemarck.
C ouronne, ( Blafon ) meuble qui entre dans pluheurs
écus. Etym. de ce mot: Suppl. H. 64. ¿-
Couronne , celle qu’on met fur les écus des armoiries |
pour marquer les dignités. Couronne du roi, du dauphin >
des enfans -de France , des princes du fang , de duc, de
marquis , de comte, de vicomte , de baron , de vldame ,
du pape, de l’empereur, du roi d’Efpagne, du roi d’Angleterre
, du duc de Florence , des archiducs, des élefteurs de
l’empire , Suppl. II. 642. «. de Venife 8c de Genes. Bonnet
ducal du doge de . Venife. En quel tems on commença à
mettre une couronne fur les fleurs-de-lys des monnoies , 8c
fur les armes peintes. Ibid. b. Voyeç vol. II. des planch.
Blafon, pl. 1 3 , 1 6 , 1 7 , 19- . _ . .
C ouronne royale, ( Ordre de la ) ou les chevaliers Frifons.
AutVe ordre de la couronne. IV. 394. b.
Couronne royale. Son inftitution. Marques de l’ordre. Suppl.
11.6 k . b. WM
C ouronne , (ArchiteB. ) les François l’appellent /«rmnrr
8c les ouvriers gouttière ; d’autres l’appellent corniche. IV.
394- m
IV.’39$.<i. . . . r . a-- •
Couronne, ce terme employé eh fauconnerie, en jardinage
, maréchallerie, manufaélure en foie, rubannerie, chez
les touineurs, 8c en verrerie. IV. 393. a.
C ouronné, (Maréch.)partie du cheval.Suppl. IU. 382. b.
83. «. 383.«, b, 389. b. 39«. b. 400.«. 4*3- .
COURONNÉ , ternie employe en jardinage, marôchalle-
e , blafon, 8c en belles-lettres. Stances couronnées. IV.
^ ’bourefnné. Des poètes couronnés. XII. 844. a , b.
COURONNEMENT, terme d’architcâure, de marine,'
de chirurgie. IV. 393. b.
Couronnement du chemin couvert, (Fortifie.) IV; 293. bs
. t\.. 4» l’empereur d’Allemagne.
v. 370.«, O.jc-wiiv-iiv/«.» ¿leSeur à cette cérémoonmiee
,, vvooyyei?z lleeuurrss aarrtqjccilecsb ppaair tuicuuiluieur.s,.
COURÓU , monnoie dé Compte én Perfe. IV. 293. b.
COUROUK, ( Hifi. mod.) défenfe que le foplii de Perfe
fait à différens égards. On l’entend principalement de celle
qu’il fait à fés fujets, de fe trouver fur le chemin ou il doit
paffer avec fés feihmés. Sévérité de cette défenfe qui eft
très-fréquente. Autre efoece de courouk , non moins févere *
lorfque le roi le met fut la volaille, le poiffon, ou autres
denrées de fon goût. IV. 293. b. FoyerKovROVKi
COURRE la bouliney (Marine) IV. 396.«.
COURROIES, ( Bourrel. ) ufage qu’en faifoieilt autrefois
les François dans leur habillement. IV. 296.«. gBj
COUROUÇA, (Bot.) arbre des ifles d Amérique, üel-
cription de l’atbre 8c du fruit, dont les perroquets font friands*
ÏVC$URÔUCOÜ, (Omith.) defcription de cet oifeau. Vol.
VI. des planch. Regne animal, pl. 41- , „ . _ , „
COURROUX , colere , emportement , ( Synon. ) Suppl. IL
3°COURS. Ce qile doit renfermer ùn cours de fcience. IV;
206 « Il ne feroit peut-être pas impoffible de faire un cours
général des fciences , dans lequel chaque fcience feroit réduite
à fes principes effentiels. Utilité d*uiuel ouvrage. Quel
pourroit en être le plan. Des élémens de géométrie 8c de.
méchanique faits fur Ce plan, feroient un ouvrage tres-utile.
lb'td.b. ^ ,. ' . « .
COURS royales f folemnelles , couronnées , fetes royales ,
( Hifi. mod. ) affémblées pompeufes que les anciens rois de
France tenoient aux principales fêtes. Détails hiftoriques fur
ce que plufieurs rois de cette même nation ont pratiqué à 'cet
égard. Le même ufage introduit en Angleterre. Marches ou
proceffions qui leur ont fuccédé. IV. 396. b.
Cours d’un fleuve, voyez Fleuve. Obfervations fur ce fujet.
VII. 621.«, ¿.622. «.Des travaux entrepris pour détourner
le cours d’un fleuve. VI. 872. «.
C o u r s , (Jurifp.) divers fans de ce mot. IV. 397.
C o u r s , divers ufages de ce mot dans le commerce. IV.
39£oüRS , ( Archit. ) cours de plinthe. IV. .397* £
C ours , divers ulages de ce mot en manne. IV. 397. «.
C ours , à la monnoie. Prix des efpeces. IV. 397. «.
C ours de pannes, (Charp.) IV. 397. a. . _
C ours ou C o urse, (ManufaH. en foie) ordre entier,
félon lequel il faut faire mouvoir les marches pour exécuter
l’ouvrage. IV. 397. b. . . ,
COURSE du cirque, (Hifi. anc.) comment fe faifoient les
courfes de chevaux 8c de chariots. Comment le fignal fe don-
soit. Prix du vainqueur. Difficulté fur les courfes du cirque.
™Cour/c. Des courfes de chevaux chez les aiicieils. IV. 899. i;
V 891. « .Vili. Z14. i.i«?y/.ILi90.«, i , &c. Coiufe de
jumens chez les Eléens. D. 565. «-Les chevaux de courfefort
eftimés des anciens. IU. 3O4. i. Courfe i cheval . appellée
faquin ou quintaint. VI. 403. «. Courfes de chars. Suppl. II.
H i &c. Courfes de chariots & de chevaux nommées
W m tt a Gageures de courfes a cheval. XVII.
Rapidité de 'certaines courfes de chevaux;Suppl. III.
« a C;iirrccoonnftttaanncceess fîéelioonn- l1eUfq4UueUllUe«s l.e.s. c o--u-r-fe—s d- e chevaux
doivent être plus ôu moins.longues. V. 24t. «, b.
5.Ï
. courfes c
de tête 8c de bague. Vi. 249. ¿. Courfe
hevaux
.'Utilité des
ufitée dans
de lances.IL ipi. i . CourfésdecharUIl. 183.«, ê.
Course , (Marine) faire la courfe, aller en courfe. IV.
39CourSE amUliiufc, IJurifpr.) tu matitrt btuiffurlr. Rétention
prématurée des dates qui eft faite en cour de: Rome ,
du vivant du titulaire, 8c qui rend in d in e du bénéScc, Corn
. . .. . . . . . ira pntlrr. Ulfllùnftüié. IV. 297* i-a