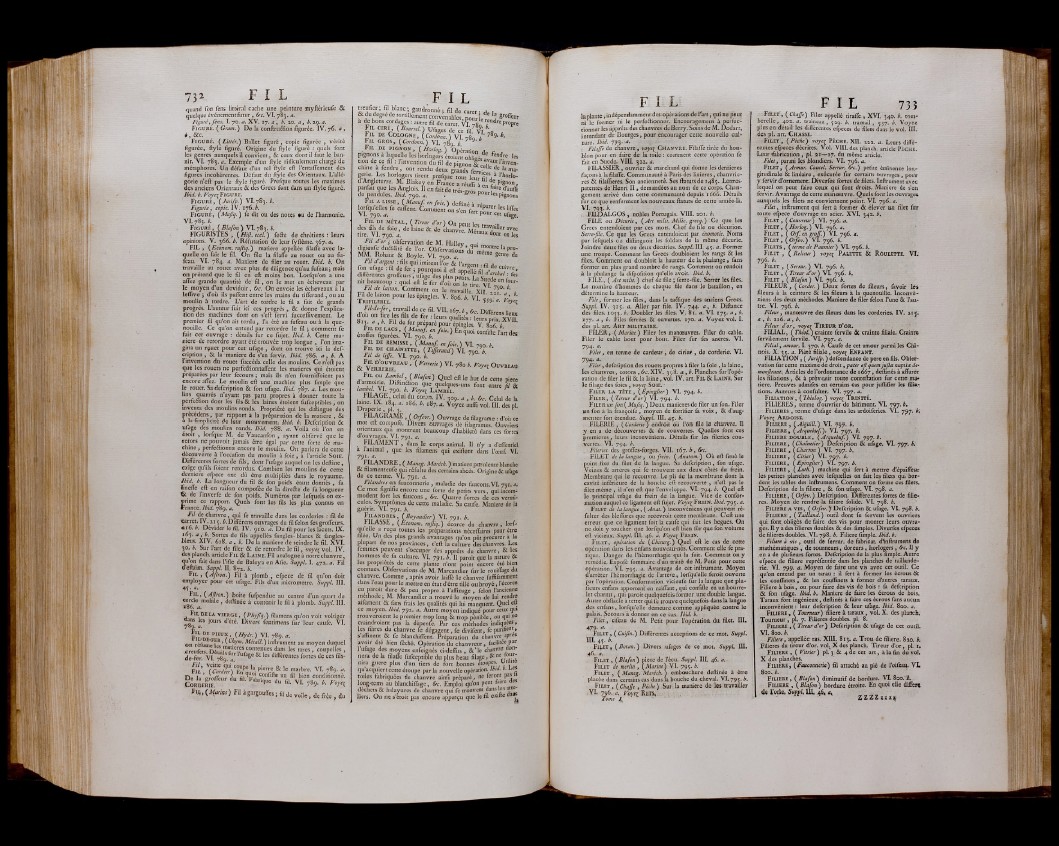
73: F I L
quand fon Cens littéral cache une peinture myftéricufc &
quelque événement futur, &c. V I. 703. a.
Figuré y fin s . I. 70. a. X V . 17. a , b. 20. a , b. %$, a.
Figure. ( -Grain. ) De la conftruélion figurée. IV. 76. a ,
è , &c.
F iguré. ( Littér.) Ballet figuré, copie figurée , vérité
figurée, flyle figuré. Origine du flyle figure ; quels font
les genres auxquels il convient, & ceux dont il faut le ban-
nir. v l. 783. a. Exemple d’un flyle ridiculement chargé de
métaphores. Un défaut d’un tel flyle efl l’entaffement des
figures incohérentes. Définit du flyle des Orientaux. L’allé-
§oric n’eft pas le flyle figuré. Prcfque toutes les maximes
es anciens Orientaux & des Grecs font dans un flyle figuré.
Ibid. b. Voyei Figure.
Figuré , ( Jurifp. ) VI. 783. b.
Figurée. copie. IV. 176. b.
F igu r e , (Mufiq. ) te dit ou des notes ou de l'harmonie.
VI. 783. b.
F iguré , ( Blafon ) V I . 783. b.
FIGURIStES , ( Hifl. eccl. ) feéle de chrétiens : leurs
opinions. V . 366. b. Réfutation de leur fyftême. 367. a.
FIL -, ( F.conom. rufliq.) matière appellée filafle avec laÎ[
uelle on fait le fil. On file la filafle au rouet ou au fu-
eau. V I. 784. a. Maniéré de filer au rouet. Ibid. b. On
travaille au rouet avec plus de diligence qu’au fufeau ; mais
on prétend que le fil en efl moins bon. Lorfqu’on a une
aflez grande quantité de f i l , on le met en écheveau par
le moyen d’un dévidoir, &c. On envoie les écheveaux a la
leflive ; d’où ils paffent entre les mains du tifferand, ou au
moulin à tordre. L ’art de tordre le fil a fait de grands
progrès. L’auteur fuit ici ces progrès , & donne l’explication
des machines dont on s’eft fervi fucceflivement. Le
premier fil qu’on ait tordu, l’a été au fufeau ou à la quenouille.
Ce qu’on entend par retordre le fil j comment fe
fait cet ouvrage : détails fur ce fujet. Jbid. b. Cette maniéré
de retordre ayant été trouvée trop longue , l’on imagina
un rçuet pour cet u fage, dont on trouve ici la defeription,
& la maniéré de s’en fervir. Jbid. 786. a , b. A
l ’invention du rouet fuccéda celle des moulins. Ce n’eft pas
que les rouets ne perfeétionnaflent les matières qui étoient
préparées par leur fecours ; mais ils n’en fournifloient pas
encore aflez. Le moulin efl une machine plus fimple que
le rouet. Sa defeription & fon ufage. Jbid. 787. a. Les moulins
quarrés n’ayant pas paru propres à donner toute la
pérfeaîon dont les fils & les laines étoient fufceptibles, on
inventa des moulins ronds. Propriété qui les diuingue des
précédens, par rapport à la préparation de la matière, &
a la funplicité de leur mouvement. Jbid. b. Defeription 8c
ufage des moulins ronds. Ibid. 788. a. Voilà où l’on en
¿toit , lorfque M. de Vaucanfon , ayant obfervé que le
retors ne pouvoir jamais être égal par cette (orte de machine
5 perfectionna encore le moulin. On parlera de cette
découverte à l’occafion du moulin à fo ie , à l’article Soie.
Différentes fortes de fils, dont l’ufage auquel on les deftine,
exige qu'ils foienr retordus. Combien les moulins de cette
derniere efpece ont dû être multipliés dans le royaume.
Jbid. b. La longueur du fil & fon poids étant donnés, fa
nnefle cft en raifon compofée de la direéte de fa longueur
de 1 inverfe de fon poids. Numéros par lefquels on exrime
ce rapport. Quels font les fils les plus connus en
rance. Jbid. 789. a.
F i l de chanvre, qui fe travaille dans les corderies : fil de
’carret. IV. 215. b. Différais ouvrages du fil félon fes groffeurs.
«16. b. Dévider le fil. IV . 910. a. Du fil pour les lacets. IX.
a * y ' Sortes de fils appcllés fanglcs-blancs & fangles-
bleus. XIV. 618. a . b. D e là maniéré de teindre le fil. A V I .
30. b. Sur l’art de filer & de retordre le f i l , voye{ vol. IV.
des planch. article Fil 8c L a ine. Fil analogue à notre chanvre,
au?on fait dans l’ifle de Baleya en Afie. Suppl. I. 47a. a. Fil
d’eftaim. Suppl. II. 872. b.
F i l , ( Aflron. ) Fil à plomb , efpece de fil qu’on doit
employer pour cet ufage. Fils d’un micromètre. Suppl. III.
43. a.
Fi l , ( Aflron.) boîte fufpendue au centre d’un quart de
cercle mobile , deflinée à contenir le fil à plomb. Suppl. III.
Fil d elà v ie r g e , (Phy fiq. ) filamens qu’on voit voltiger
ns les jours d’été. Divers fentimens fur leur caufe. V I.
789. a.
PIEU? , ( Hydr. ) V I. 789. a.
a n réfum"„Ff R * ' ^Aynt. Mitall. ) inflrument ait moyen duquel
ereufets D ^ i nrt,eï»CV :ontcnucs dans *es tarcs > coupelles ,
de-fer. VI. 789 a ^ *cs différentes fortes de ces fils-
F i l* ' c t S L ,«r\CplI^C ^ I),Crre & Ie marbre. V I. 789. a.
D e la 'erofleur du fil^Pk^0n 6 un — I)‘cn conditionné.
CORDERIE dU 1 dU a V L 789. 1 ■
gr
i
f i l , , (M a r in e ) F ilà g a rg o u ffc s ifiU c v o ile , d e f r é e , du
F I L
à de bons cordages : autre fil de caret. V ? 780 z repr°I>r«
F i l c i r é , {M o u n d .) Ufages de ce fil. v î 7R t
F i l de C o lo g n e , {C o r J n n .) VI. . g / / 7®9- *•
F i l GROS, ( Cordonn. ) VI. 780 b
F i l de p ig n o n , ( Horlog. ) ‘Opération .1 I
pgnons à laquelle les horlogers ¿ „ ¡ cm obigés Îv " Î 6 1
non de ce fi : l'invention du fil de pignon & cen 1 !nve"-
clune à fendre, ont rendu deux grands fm n ? S la ”>»■
gene. Les horlogers tirent pfefqne tout S S Î I'l,0r,° -
a Angleterre. M. Blakey en France a réulfl S en 6 - 1 1 1 1
parfait que les Anglots. Il enfaitde très-gros » S ' ' / ®
de pendules. Ibid. 790. a. • p r lc sP«gnons
F i l A LISSE, ( Manuf. en f i l , . ) deftlné à ¿A
¡ o r a l e s fe caffent. C om iem L
F i l de MÉTAL, ( Tireur d ’o r ) On Deur ! . . ;
des fils de foie , de laine 8c de chanvre. Mètaix d o t " a? c
tire. V I. 790. a. dont on les
F i l d'or ; obfervation de M. Hallev nui
digienfe duililiti de l’or. Obfervatiora du pr° '
MM. R o ta it & Boyle. V I. 79o ! T me «fe
F i l d'argent : fils qui imitent l’or & l’areenr ■ fil 1
fon ufage : fil de fe r ; pourquoi« efl apnf « 4 ¿ 1 ]■ 'I T ' e ’
différentes groffeurs' ufage des plus peins La SueX f
nit beaucoup : q„el efl le fer d’où on le tire V I Ü i
n i i A i-«)mrricnt on le travaille. XII 2 2 i° 'a /
t r i f i l e r i e . *>our l i i i l p | i m m
Filrde-fir , travail de ce fil. VII, 167 b n <n I
g 0U ° n ¿ eFMSdfi,Sf dc H I M •• leurs prix!*Xvïf
813. a , b. Fil de fer préparé pour épingles. V. 806 b
F i l de REMISSE , ( Manuf. en f i l , . ) VI. 700 4
A7L j E|^HAv F i l de hfle. VtIE. T7T9E0’. Wb. W W V I- 790- L
8c V erremeREAU' ( rO T ‘ r ii) V L 780 ° F V * “ 0
H’J m o V . L n n - 1 ‘J - Blaf m ^ 0 “ el cft 1 but PS « n o pi«e
darmome. Oiflinflion que quelques-uns font entre f il Sc
¿ ,‘ t ' V I ’ 79°- *• r °y eC Lambel.
î.in i n P E ô “ lui 11 c? ,,n0’ I v - 3° 9* I , p H Celui de la
laine. IX. 184. a. 186. b. 187. a. Voyez anfli vol. III. des pl.
Draperie , pl. 3. r
F lLAGR AME ,{O r f e v r .) Ouvrage de filagrame : d’où ce
mot efl compofé. Divers ouvrages de filagrames. Ouvriers
orientaux qui montrent beaucoup d’habileté dans ces fortes
d ouvrages. VI. 791. a.
FILAMENT , dans le corps animal. Il n’y a d’eflentiel
à 1 animal, que les filamens qui exiflent dans l’oeuf. VI.
791- a
F ILAN D R E , ( Maneg. Maréch. ) matière purulente blanche
ol filamenteufe qui réfulte des certains abcès. Origine & ufage
de ce terme. VI. 791. a.
Filandres en fauconnerie, maladie des faucons. VI. 791. a.
Ce mot fignifie encore une forte de petits vers, qui incom-
modent fort les faucons , &c. Quatre fortes de ces vermi-
cules. Symptômes de cette maladie. Sa caufe. Manière de la
guérir. VI. 791. b.
F i la n d r e s , ( Boyaudier) VI. 791. b.
FILASSE , ( Econom. rujliq.) éco rce du chanvre , lorf-
t t3 rC^U toutes ^es préparations néccffaires pour être
filce. Un des plus grands avantages qu’on pût procurer à la
plupart de nos provinces, c’eft Ta culture des chanvres. Les
femmes peuvent s’occuper des apprêts du chanvre, & les
hommes de fa culture. VI. 791 .b . Il paroît que la nature &
les propriétés de cette plante n’ont point encore été bien
connues. Obicrvations de M. Marcanuicr fur le rouillage du
chanvre. Comme , après avoir laiffé le chanvre, fuffifamment
dans l’eau pour le mettre en état d’être tillé ou broyé, l’écorce
eu paroit dure & peu propre, à l’affinage , félon l’ancienne
méthode j M. Marcandier a trouvé le moyen de lui rendre
aifément & fans frais les qualités qui lui manquent. Quel cft
ce moyen. Jbid, 792.yy* . »«. Autre nuire moyen indiqué muique pour ceux bs«*nnt
1
frn ilV flrn ie n f l<> nn>minr rm n Iah a fi, AH fit
trouverqient le premier trop long & trop pénible, ou qui
craindroient pas la dépenie. Par ces méthodes indiqué«
les fibres du chanvre fe fe purifie«
€ flnlnflllf R/ Ia Klnn/'liiiT’. ..,. D . lL -1_ .1 -- . l i .n l l^ B DI
es norcs au enanvre le dégagent, le divifent, lepurinci
s'affinent & fe blanchiflent. Préparation du chanvre ap
avoir été bien féché. Opération du chanvreur, facilitée 1
l’ufage des moyens enfeignés ci-deffus , & ‘ Ie chanvre a*
nera de la filafle fufceptiblc du plus beau filage, & ne roi
nira guere plus d’un tiers de fort bonnes étoupes. Util
qu’acquiert cette étoupe parla nouvelle opération. Jbid. b.
toiles fabriquées de chanvre ainfi préparé, ne feront pa
long-tans au blanchiffage, 6*c. Emploi qu’on peut faire '
déchets & balayures de chanvre qui fe trouvent dans les ai
tiers. On ne s’etoit pas encore apperçu que le fil exifte d
F I L
la p la n t e , indépendamment des opérations de l'art, qui ne peut |
ni le former ni le perfectionner. Encouragemens à perfectionner
les apprêts des chanvres de Bcrry. Soins de M. Dodart,
intendant de Bourges, pour encourager cette nouvelle culture.
Jbid. 79^. 'a‘ • ' !,é ;
;• Filajfe de chanvre, voye{ C h a n v r e . Filafle tirée du houblon
pour en faire de la toile : comment cette opération fe
fait en Suède. VIII. 322. ».
FILASSIER, ouvrier & marchand qui donne les dernieres
façons à la filafle. Communauté à Paris des linieres, chanvric-
res & filaflieres. Son ancienneté. Ses fiatutsde 1485. Lettres*
patentes de'Henri I I , demandées au nom de ce corps. Changement
arrivé dans cette communauté depuis ï6 6 6 . Détails
iur ce que renferment les nouveaux ftatuts de cette année-là.
VI. 793. b.
F ILD A LG O S , nobles Portugais. VIII. 201. b.
FILE ou Décurie, ( A n milit. Milic. grecq. ) Ce que les
Grecs entendoient par ces mots. Che f de nie ou décurion.
Serre-file. Ce que les Grecs entendoient par énomotie. Noms
par lefquels on diflinguoit les foldats de la même décurie.
Joindre deux files ou deux décuries. Suppl. III- 45. ». Former
une troupe. Comment les Grecs doubloient les rangs & les
files. Comment on doubloit la hauteur de la phalange, fans
former un plus grand nombre de rangs. Comment on rendoit
à la phalange la difpofition qu’elle avoit. Ibid. b.
F ILE, ( Art milit. ) chef de file ; ferre-file. Serrer les files.
Le nombre d’hommes de chaque file dans le bataillon, en
détermine la hauteur.
File y former les files, dans la taftique des anciens Grecs.
Suppl. IV . 315. ». Aller par file. IV. 744. » , b. Diftance
des files. ion> Doubler les files. V . 81. ». VI. 173. » , b.
177. » , b. Files ferrées & ouvertes. 170. ». V o y e z vol. I.
des pl. art. A r t m ilita i re .
F ILE R , ( Marine) Filer les manoeuvres. Filer du cable.
Filer le cable bout pour bout. Filer fur fes ancres. V I.
794- .
F ile r , en terme de cardeur, de cirie# , de corderie. VI.
794. ».
F ile r , defeription des rôuets propres à filer la fo ie , la laine,
les chanvres, cotons, &c. X IV. 398. » , b. Planches fur l’opération
de filer le fil & la laine, vol. IV. art. F il & L aine. Sur
le filage des foies, voyeç Soie. •
F i l e r l a t ê t e , ( Epinglier ) VI. 794. b.
F ile r, ( Tireur d 'or ) VI. 794. b.
F i l e r un fon ( Mufiq. ) Deux maniérés de filer un fon. Filer
un fon à la françoife, moyen de fortifier fa v o ix , & d’augmenter
fon étendue. Suppl. III. 45. b.
FILERIE , ( Corderie ) endroit où l’on file le chanvre. Il
y en a de découvertes & de couvertes. Quelles font ces
premières, leurs inconvéniens. Détails fur les fileries couvertes.
VI. 794. b.
, Fileries des groffes-forges. VII. 167. b , 6*c.
FILET de la langue , ou frein. (Anatom. ) Où efl fitué le
point fixe du filet de la langue. Sa defeription, fon ufage.
Veines & arteres qui fe trouvent aux deux côtés du frein.
Membrane qui le recouvre. Le pli de la membrane dont la
cavité inférieure de la bouche efl recouverte , n’eft pas le
filet même , il n’en efl que l’enveloppe. VI. 794. b. Quel efl
le principal ufage du frein de la langue. Vice de conformation
auquel ce ligament efl fujet. Voye{ F re in . Ibid. 793. ».
F i l e t de la langue, ( Anat. ) inconvéniens qui peuvent ré-
fulter des bleffures que recevroit cette membrane. C ’eft une
erreur que ce ligament foit la caufe qui fait les begues. On
ne doit y toucher que lorfqu’on efl bien fur que fon volume
efl vicieux. Suppl. 111. 46. ». Voye{ Frein.
F i l e t , opération du ( Chirurg.) Quel efl le cas de cette
opération dans les enfàns nouvcau*nes. Comment elle fe pra- -
tique. Danger de l’hémorrhagie qui la fuit. Comment on y
remédie. Expofé fom maire d’un traité de M. Petit pour cette
opération. VI. 795. ». Avantage de cet inflrument. Moyen
d’arrêter l’hémorrhagie de l’artere, lorfqu’elle feroit ouverte
par l’opération. Conformation vicicufe fur la langue que plusieurs
enfans apportent'en naiffant, qui confifte en un Bourrelet
charnu, qui paroît quelquefois former une double langue.
Autre obftacle à tetter qui fe trouve quelquefois dans la langue
des enfans, lorfqu’cllc demeure comme.appliquée contre le
palais. Recours à donner en ce cas. Jbid. b.
• F i le t , cifeau de M. Petit pour l’opération du filet. III.
479- a‘
F i l e t , ( Cuifin.) Différentes acceptions de ce mot. Suppl.
III. 43. b.
F i l e t , ( Botan. ) Divers ufages de ce mot. Suppl. IIL
46. ».
F i l e t , ( Blafon) piece de l’écu. Suppl. III. 46. ».
F i l e t de merlin, ( Marine| VI. 793. b.
F i l e t , ( Maneg. Maréch. \ embouchure deflinée à être
placée dans certains cas dans la bouche du cheval. V L 79j . b. !
F i le t , ( C ha fje, Pêche) Sur la manicrc de les travailler
Y I. 796. ». Voyei RtTS<
Tome I s
F I L 733
F îLET, ( Chajfe) Filet appelle tirafle , XVI. 340. b. tom-
b ercllc, 402. ». traîneau, 320. b. tramail, 337. b. V o y e z
plus en détail les différentes elpeces de filets dans le vol. IIL.
des pl. art. C hasse.
F il e t , (P ê ch e ) voyez Pèche. XII. 222. ». Leurs différentes
efpeces décrites. Vol. VIII. des planch. article Pêche.
Leur-fabrication t pl. 21— 27. du même article.
F ile t , parmi les blondiers. VI. 796. ». >
File t , (Armur. Coutel. Serrur. & c .) petite éminence longitudinale
& linéaire, exécutée fur certains ouvrages, pour
y fervir d’ornement. Diverfes fortes de filets. Inflrument avec
lequel on peut faire ceux qui font droits. Maniere de s’en
fervir. Avantage de cette manoeuvre. Quels font les ouvrages
auxquels les filets ne conviennent point. V I. 796. ».
F ile t , inflrument qui fert à former & élever un filet fur
toute efpece d’ouvrage en acier. X V L 342. b.
F ile t, (Couvreur) VI, 796. ».
F ile t, (Hor log .) VI. 796. ».
Filet , ( Orfi en grojf.) VI. 796. ».
F il e t , (O r f iv .) VI. 796. b.
FlLETS , ( terme de Paumier) VI. 796. b.
F ilet , ( Relieur ) voyei Palette & Roulette. V I .
796. b.
Fi l e t , (Serrur.) VI. 796. b.
F il e t , ( Tireur d’o r ) V L 796. b.
F ilet , ( Blafon ) VI. 796. b.
FILEUR, (Corder.) Deux fortes de fileurs, favoir les
fileurs à la ceinture & les fileurs à la quenouille. Inconvéniens
des deux méthodes. Maniere de filer félon l’une & l’autre.
VI. 796. b.
Ftleur y manoeuvre des fileurs dans les corderies. IV. 213.
» , b. 2 16 . a y b.
Ftleur d ’or y voyez TIREUR D’OR.
F ILIA L, ( Théol.) crainte fervile & crainte filiale. Crainte
fervilement fervile. VI. 797. ».
F ilia l y amour. I. 370. b. Caufe de cet amour parmi les Chinois.
X. 33. ». Piété filiale, voyez Enfant.
FILIA T IO N , ( Jurifp. ) defeendance de pere en fils. Obfer-
vation fur cette maxime de droit, pater efl quem ju fla nuptiee de-
monflrant. Articles de l’ordonnance de 1667, deflmés à afiùrer
les filiations, & à prévenir toute conteftation fur cene metiere.
Preuves admifes en certains cas pour juflifier les filia-,
tions. Auteurs à confulter. V I. 797. ».
F iliat ion , ( Théolog. ) voye[ T rinité.
FILIERES, terme aouvrier de bâtiment. V I. 797. b.
Filieres , terme d’ufage dans les ardoiferies. V I . 797. b.
Voye{ A rdoise,
tiliere , (A ig u ill.) V I. 797. b.
FlLIERE, (A r q u e b u f) . VI. 797. b.
Filiere d ou ble, (A rq u e b u f) VI. 797. b.
FlLIERE, (Chamelier) Defeription & ufage, VI. 797. b.
F i l i e r e , (Charron) VL 797. b.
Filiere , ? Cirier) VI. 797. b.
F iliere, (Epinglier) V I . 797. b.
Filiere , ( Luth. ) machine qui fert à mettre d’épaifleur
les petites planches avec lefquelles on fait les filets qui bordent
les tables des inftrumens. Comment on forme ces filets.
Defeription de la filiere , & fon ufage. V I. 798. ».
Filiere , ( O r fiv .) Defeription. Différentes fortes de filie-,
res. Moyen de renore -la filiere folide. VI. 798. b.
Filiere a v is , ( Orfiv. J Defeription & ufage. V L 798. b.
Filiere , (Tailtand.) outil dont fe fervent les ouvriers
qui font obligés de faire des vis pour monter leurs ouvrages.
Il y a des filieres doubles & des Amples. Diverfes efpeces
ae filieres doubles. V I. 798. b. Filiere fimple. Ibid. b.
Filiere à v i s , outil de ferrur. de fabricar, dlnftrumens de
mathématiques, de tourneurs, doreurs, horlogers , &c. Il y
.en a de plufieurs fortes. Defeription de la plus fimple. Autre
efpece de filiere repréfentée dans les planches de taillanderie.
VI. 799. ». Moyen de faire une vis avec cet outil. Ce
qu’on entend par un tarau : il fert à former les écrous &
les couflinets, & les couffinets à former d’autres taraux.
Filiere à bois, ou pour faire des vis de bois : fa defeription
8c fon ufage. Jbid. b. Maniere de faire les écrous de bois.
Taraux fort ingénieux, deftinés à faire ces écrous fans aucun
. inconvénient : leur defeription & leur ufage. Jbid. 800. ».
Filiere , ( Tourneur) filiere à taraux, vol. X. des planch.
Tourneur , pl. 7. Filieres doubles, pl. 8.
Filiere , ( Tireur d ’o r ) Defcripuon & ufage de cet outil.
V I, 800. b.
Filiere, appellée ras. XIII. 813. ». Trou de filiere. 820. b.
Filieres du tireur d’or. vol. X des planch. Tireur d’o r , pl. 1.
Filiere , ( Vitrier) pl. 3 & 4 de cet a r t , à la fin du vol.
X des planches.
Filiere, (Fauconnerie) fil attaché au pié de l’oifèau. V L
i 800. b. . .
F iliere, (B la fo n ) diminutif de bordure. VI. 8oo. b.
F iliere , (B la fo n ) bordure étroite. £n quoi elle differ*
de l’orle, Suppl. UL 46,
Z Z Z Z z z z ç