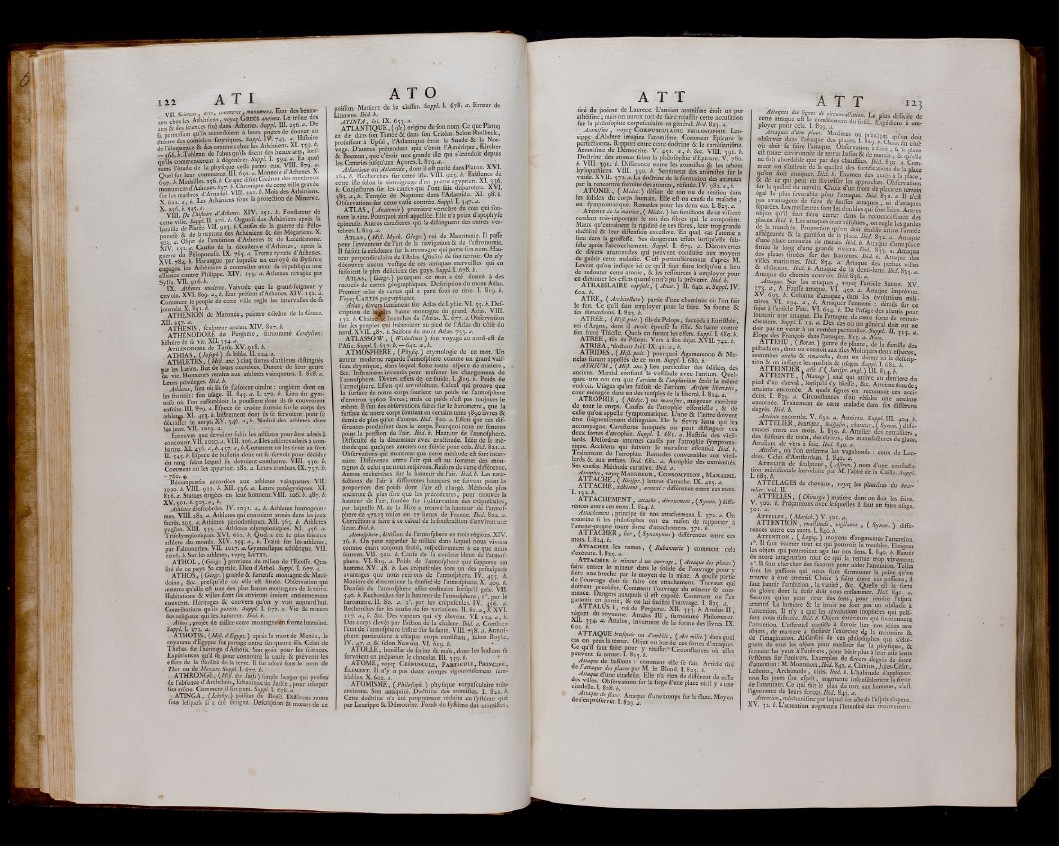
1 2 . 2 A T I
VIT Sciences, arts, commerce, monumens. Etat désbeaux-
chez les Athéniens, voyei G r e c s anciens. Le trône des
Zts 8c des fciences fixédans Athenès. Suppl. III. 236. a. De
la permiiTion qu’ils accordoient à leurs .poetes de donner au
théâtre des comédies fatyriques. Suppl.IV. 743- çHiftoire
de l’éloquence & des.orateurs chez les Athémens. XI. S 59-
— <66.¿..Tableau de l’abus qu’ils firent des beaux-arts, lorl-
qu’ils commencèrent à dégénérer. Suppl. I. Ï94- “ - Enjpiel
rems l’étude de la phyfique ceffa parmi eux. VIII 879. a.
Ouel fut leur commerce. III. 692. a. Monnoie d Athènes. X.
<Lh t Médailles. 156. é. Ce que difoitCicéron des nombreux
097. a.meuarn 1 ¿ Chronique de cette ville gravée
fi.r"S"mmbres d'A'runlel'. « »«- A Mois des Athéniens.
X. 622. a, b. Les Athéniens fous la proteéhon de Minerve.-
X’v íu 'vlVúlioirc d’Atienes.XIV. ¡ ¡ S b. Fondateur de
cette ville. Suppl. H.W&. b. Orjueil des Athéniens après la
bataille de Platée. VU. 913. b. Caufes de la guerre du Pélo-
nonefe & de la rupture des Athémens & des Mégartens. X.
ïo î a- Objet de l’ambition d’Athènes & de Lacédémone.
XIV. Caufes de la décadencé d’Athenes, après la
guerre du Pèloponefe. IX. 765. a. Trente tyrans d’Athenes.
X V ! 784. b. Harangue par laquelle un envoyé de Byfance
engagea les Athéniens à contra&er avec fa république une
alliance contre Philippe. XIV. 159. a. Athènes ravagée par
Sylla. VII. 916. b. _
IX. Athènes moderne. Vaivode que. le grand-feigneur y
envoie. XVI. 809. a, b. Etat préfent d’Athenes. XIV. 152. a.
Comment le peuple de cette ville regle les intervalles de fa
journée. X. 851. ¿. ' ¡ , , . i ,
ATHENION de Maronée, pemtre celebre de la Grece.
XD. 257. a . VT, r « ,
ATHENIS, fculpteur ancien. XIV. 017. b.
ATHÉNÔDORL de Pergame, furnommé Cordylion:
hiftoire de fa vie. X H j 54-
A t h é n o d o r e de Tarie. XV.910.
ATHIAS, (Jofeph) fa bible. H. 224. a.
ATHLETES, (Hifl. anc.) cinq fortes dathletes dilbngués
par les Latins. But de leurs exercices. Dureté de leur genre
de vie. Honneurs rendus aux athletes vainqueurs. I. 818. a.
Leurs privilèges, lbid. b. |
Athletes, lieu ou ils fe fanoient omdre. : onguent dont on
les frottoir: fon ufage. H. 845 .a: I. 270. b. Lieu du gym-
nafe où l’on raffembloit la poufiiere dont ils fe couvraient
enfuite. III. 879. a. Efpece de croûte formée fur le corps des
athletes. XI. 453.¿.Infiniment dont ilsfe fervoient poùrfe
décrafier le corps.XV. 546..a,¿..Nudité des athletes dans
Iss jeux, v i l . 1019.*. . , . j§
Epreuves que dévoient iiibir les athletes pour etre admis à
concourir. VU. 1020. a. VIU. 106.4. Des athletes admis à combattre.
XI. 436. a, b. 457. a, b. Comment on les tiroit au fort.
U. 545. p Efpece de bulletin dont on fe fervoit pour décider
du rang félon lequel ils devoient combattre. VIU. 530. b.
Comment on les apparioir! 282. a. Leurs combats. IX. 757. b.
- j$o. 4.
Récompenfes accordées aux athletes vainqueurs. VII.
1020. b. VIU. 911. b. XU. 536. a. Leurs panégyriques. XI.
816.4. Statues érigées en leur honneur .VIU. io6.‘ b. 487. b.
XV. 501. ¿.503.4, b.
Athletes diolcoboles. IV. 1031. a, b. Athletes homogram-
mes. VIU. 282.4. Athletes qui couraient armés dans les jeux
facrés. 295. 4. Athletes périodoniqués. XII. 363. b. Athletes
púgiles. Xffl. 35 3. (t. Athletes olympioniques. XI. 456. 4.
Trifolympi.oniques.XVl. 662. b. Quel a été le plus fameux
athlete du monde. XIV. 255. 4 , ¿. Traité fur l à athletes,
par Falconerius. VII. 1017. 4. Gymnailique athlétique. VII.
101-6. ¿.Sur les athletes, voye^ Lutte.
A THOL , ( Géogr. ) province du milieu de l’Ecoffe. Qualité
de ce pays. Sa. capitale. Dieu d’Athol. Suppl. I. 677.4.
ATHOo, ( Géogr,) grande & fameufe montagne de Macédoine,
&c. prefqu’ifle où elle eft fituée. Obfervation qui
montre qu’elle eft une des plus hautes montagnes de la terre.
Habitations & villes dont íes environs étoient anciennement
couverts. Héritages 8c couvens qu’on y voit aujourd’hui.
Contributions qu ils paient. Suppl. I. 677. 4. Vie & moeurs
des religieux qui les habitent, lbid. b.
Athos , projet de tailler cette montagneien forme humaine.
Suppl. 272. 4.
• ATHOTIS, (Hijl. d’Egypt. ) après la mort de Menés, le
royaume d’Egypte fut partagé entre fés quatre fils. Celui de
Tnebes fut l’héritage d’Athotis. Son goût pour les fciençes.
Expériences qü’il fit pour connoître la çauie & prévenir les-
effets de la itérilité de la terre. Il fut adoré fous le nom de
- Thot ou de!Mercure. Suppl. I. 677. b.
ATHRONGE, (Hijl.des Juifs)Simp\e berger qui profita’
de l’abfence d Archelaüs, Ethnarque de Judée, pour ufurper
fon trône. Comment il fut puni. Suppl. I. 678.4.
. ATINGA, ( Ichthy.) poiffon du Brefil. Différens no
fous lefqueis il a été défigné. Défcription 8c moeurs de
A T O
poiffon. Manière de le claffer. Suppl. I. É78. a. Erreur de
Linnæus. lbid. b.
ATI NI A , loi. IX.653.4.
ATLANTIQUE, (ifle) origine de fon nom. Ce que Platon
en dit dans fon Timée & dans fon Critéas. Selon Rudbeck,
profeffeur à Upfal, l’Atlantique ¿toit la Suede & la Norvège.
D’autres prétendent que c’étoit l’Amérique, Kircher.
& Becman, que c’étoit une grande iüe qui s’étendoit depuis
les Canaries jufqu’aux Açores. I. 819. a.. '
Atlantique ou Atlantide, dont il eft parlé dans Platon. A V I .
|-J 64. b. Recherches fur cette iile. VlII. 923. b. Exiftence de
cette iile félon le témoignage d’un prêtre égyptien. XI. 336.
b. Conjeélures fur les caufes qui l’ont fait diiparoîtrc. XVI.
383.4, b. Temple de Neptune dans l’Atlantide. XI. 98. b.
Obfervations. fur cette vafte contrée. Suppl. I. 347- a.
A TLAS, ( Anatomie) première vertebre du cou qui fou-
tient la tête. Pourquoi ainfi appellée. Elle n’a point d’apophyfe
épineufe. Autres caraéleres qui la diftinguent des autres vertèbres.
1.819. a. .
A t la s , (jlift. Mÿth. Géogr.) roi de Mauritanie. U paffe
pour l’inventeur de l’art de la navigation 8c de Paftronomie.
Il faifoit fa réfidence fur la montagne qui porte fon nom. Hauteur
perpendiculaire de l’Atlas. Qualité de fon terroir. On n y
découvre aucun veitige de ces antiques merveilles qui en
fàifoient le plus délicieux des pays. Suppl.ï. 678. b.
A t l a s , (Géogr.) pourquoi ce nom a été donné à des
recueils de cartes géographiques. Défcription du mont Atlas.
Premier atlas de cartes qui a paru fous ce titre. I. 819. b.
Voyer CARTES géographiques.
Atlas, diversfentimens fur Atlas deLybie. VI. 35. b. Def-
cription de lqjj^us haute montagne du grand Atlas. VIII.
13 2. b. Chaînasse branches de l’Atias. X. 077. 4. Obfervation
fur les peimles qui habitoient au pied de l’Atlas du côté du
nord. XVII. 487. b. Saifons du mont Atlas. 733.4.
ATLASSO W , ( Wolodimir) fon voyage au nord-eft de
l’Afie. Suppl. 1. 637. b. — 642. 4 , b.
ATMOSPHERE, (Phyfiq.) étymologie de ce mot. ’Un
auteur moderne regarde l’atmofphere comme un grand vaif-
feau chymique, dans lequel flotte toute efpece de matière, *
8cc. Inftrumens inventés pour mefurer les changemens de
l’atmoiphere. Divers effets de ce fluide. I. ^19. b. Poids de
l’atmoiphere. Effets qiii eirréfultent. Calcul qui prouve que
la furface de notre corps foutient un poids de 1 atmofphere
d’environ 33600 livres; mais ce poids n’eft pas toujours le
même. 11 fuit des obfervations faites fur le baromètre, que la
furface de notre corps foutient en certains tems 3890 livres &
demie de plus qu’en d’autres. lbid. 820. a. Effets que ces différences
produifent dans le corps. Pourquoi nous ne fentons
point la preflion de l’air. lbid. b. Hauteur de l’atmoijphere.
Difficulté de la déterminer avec exactitude. Idée de la méthode
que quelques auteurs ont fuivie pour cela .lbid. 821.4.
Obfervations qui montrent que cette méthode eft fort incertaine.
Différence entre l’air qui eft au fommet des montagnes
8c celui que nous reipirons. Raifons de cette différence.
Autres recherches fur la hauteur de l’air. Ibid.b. Les raréfactions
de l’air à différentes hauteurs ne fuivent point la
proportion des poids dont l’air eft chargé. Méthode plus
ancienne 8c plus iure que les précédentes, pour trouver la
hauteur de l’air, fondée fur i’pbfervation des crépufculcs,
par. laquelle M. de la Hire a trouvé la hauteur de l’atmof-
phere.de 37223 toifes ou 17 lieues de France. lbid. 822. a.
CorreCtion à faire â ce calcul de la fouftraCtion d’environ une
lieue. lbid. b.
Atmofphere, divifion de l’atmofphere en trois régions. XIV.
16. b. On peut regarder le milieu dans lequel nous vivons
comme étant toujours froid, refpeCtivement à ce que nous
fentons. VU. 320. b. Caufe de la couleur bleue de l’atmof-
phere. VI. 819. a. Poids de l’atmofphere que fupporte un
homme. XV. 48. b. Les crépufculês font un des prîhcipaux
avantages que nous retirons de l’atmofphere. I v . 455. ¿.
Maniéré de déterminer la denfité de l’atmoiphere. X. 409. b.
Denfité de l’atmofphere affez ordinaire lorfqu’il gele. VU.
340. ¿.Recherches fur la. hauteur de l’atmôfphere; i°. par le
baromètre. JI. 80. a. 20. par les crepufcules. IV. 456. a.
Recherches fur les caufes de fes variations. II. 81. a , 0. XVI.
117. 4,. b. 8cc. Des vapeurs qui s’y élevent. VI. 124. 4 , ¿.
Des corps élevés par l’aCtion de la chaleur. lbid. a. Combien
l’étât de l’atmofphere influe fur la fanté. VIII. 738. a. Atmofphere
particulière à chaque corps confiftant, félon Boyle,
IV. 47. 4. & félon Newton. VI. 619. b. •
ATOLLE, bouillie -de farine de maïs, dont les Indiens fe
fervoient en préparant le chocolat. III. 3 59. b.
ATOME,voye[ C r é pu s c u l e , P a r t i c u l e , Pr in c i p e ,
É lémen t . Il n’y a pas deux atoiqes rigoureufement fem-
blables. X. 602. 4.
ATOMISME, ( Philofoph. ) phyfique corpufculaire très-
ancienne. Son antiquité. DoCtrine des atomiftes. I. 822. b.
Cette doCtrine n’a été proprement réduite en fyftème que
par Leucippe 8c Démocrite. Fonds du fyftême des atomiftes >
ATT tiré du poème de Lucrèce. L’ancien atomifme étoit un pur
athéifme; mais on auroit tort de faire rejaillir cette accufation
fur la pliilofophie cotpufculaire en général. Ibid. 823. a.
Atomifme, voyeç CO R PU SC U LA IR E PH ILO SOPH IE . Leu-
cippe d Abdere imagina l’atomifine. Comment Epicure le
perfectionna. Rapport entre cette doCtrine & le cartéfianifme.
Atomifme de Démocrite. V. 431. 4 , b. 8cc. VIU. 391. b.
DoCtrine des atomes félon la plulofopltie d’Epicure. V. 780.
b. VIU. 391. b. Différence entre les atomiftes & les athées
hylopatluens. VIU. 390. b. Sentiment des atomiftes fur le
vuide. XVH. 372.4. La doCtrine de la formation des animaux
par la rencontre fortuite des atomes, réfutée. IV. 982.4, ¿.
ATONIE , ( Médec. ) défaut de ton ou de tenfion dans
les folides du corps humain. Elle eft ou caufe de maladie ,
ou fymptomatique. Remedes pour les deux cas. I. 823. a.
A ton ie .de la matrice, ( Médec.) les fondions decevifcere
rendent très-important le ton des fibres qui le compofent.
Maux qu’entraînent la rigidité de ces fibres, leur trop grande
duCtilité 8c leur diftenfion exceflive. *En quel cas l’atonie a
lieu dans la grofleiTe. Ses dangereux "effets lorfqu’elle fub-
fifte après l’accouchement. Suppl. I. 679. a. Découvertes
de divers anatomiftes qui peuvent conduire aux moyens
de guérir cette maladie. C ’eft particulièrement d’après M.
Levret qu’on indique ici ce qu’il faut faire lorfqu’on a lieu
de redouter cette atonie, & les reflources à employer pour
en diminuer les effets quand on n’a pu la prévenir. Ibid. b.
ATRABILAIRE cap fuie', ( Anat. ) II. 640. a. Suppl. IV.
602. b.
ATRE, ( Architecture ) partie d’une cheminée où Ton fait
le feu. Ce qu’il faut employer pour le faire. Sa forme &
fes dimenfions. I. 823. b.
ATRÉE, (Hifl.poét.) filsdePelops, fuccédaàEurifthée,
roi d Argos, dont il avoit épouie la fille. Sa haine contre
fon frere Thiefte. Quels en furent les effets. Suppl. 1. 680. b.
ATRÉE , fils de Pélops. Vers à fon fujet. X vÜ . 742. b.
ATRIBA, ’doCteur Juif. IX. 41. a, b.
ATRIDES, (Hifl.poét. ) pourquoi Agamemnon & Me-
nelas furent appellés de ce nom. Suppl. 1. 680. b.
ATRIUM, (Hiß. anc.) lieu particulier des édifice^ des
anciens. Martial confond le veftibule avec l’atrium. Quelques
uns ont cru que T atrium 8c T impluvium étoit le même
endroit. Ufages qu’On faifoit de l’atrium. Atrium libertatis,
cour ménagée dans un des temples de la liberté. ! 824. 4.
ATROPHIE , (Médec.) ou marafme, maigreur extrême
de tout le corps. Caufes de l’atrophie effentielle , & de
celle qu’on appelle fymptomatique. L’une & l’autre doivent
être foigneufement diftinguées. De là fievre lente qui les
accompagne. Cara&eres auxquels on peut distinguer ces
deux fortes d’atrophie. Suppl. I. 681. 4. Hefrifie des vieillards.
péfordres internes caufés par l’atrophie fymptomatique.
Accidens qui fuivent le marafme effentiel. Ibid. b.
Traitement de l’atrophie. Remedes convenables aux vieillards
& aux enfans. Ibid. 682. 4. Atrophie des extrémités.
5es caufes. Méthode curative. Ibid. a.
Ma i °R euR > C onsom pt ion, Marasme.
A T T A ru é * ^ Jurifpr.) lettres d’attache. IX. 413. a.
•t , , Gèrent, annexé : différence entre ces mots.
1. 132. b.
ATTACHEMENT, attache , dévouement, ( Synon. ) différences
entre ces mots: L 824. b.
Attachement, principe de nos attachemens. I. 372. 4. On
examine fi les philofophcs ont eu raifon de rapporter à
1 amour-propre toute forte d’attachemens. 371. b.
v '« ^ ^ » ^ur * ( Synonymes ) différences entre ces
mots. I. 824. b.
A tt a ch e r les rames, ( Rubannerie ) comment cela
s exécute. 1 .823.4.
_ A t ta ch e r . U mintur à un ouvrage, (Attaquedes places1
fiiire entrer le mineur dans le folide de l’ouvraee pour v
faire une breche par le moyen de la mine. A quelle partie
de (ouvrage doit fe Élire cet attachement. Travaux qui
doivent précéder. Comment l’ouvrage du mineur fe commence.
Dangers auxquels il eft expofe. Comment on l’en
& on lui (àcilite l’ouvrage. I. 8at. a.
ATTALUS I , roi de Pergame. XII. 353; b. Attalus n ,
régent du royaume. Attalus III , furnommé Philometor!
& * . 334. a. Attalus, inventeur de la forme des livres. IX.
ATTAQUË bmfqu-c ou d-embUe, ( Art mllù. ) dans quel
Ce Z l T £ mer' 0U bm P ces fortes d’anaqïes.
pmivent fem m ^ f s l , S M i
p a r T T e lÆ î t . H 1
¿ n i M?“ ' CIla<leUe- 9 ^ n’a r ie n d e d if fé r e n t d e c e l le
citadcÎi“ !.?^ / ’ “0"5 k ^ d l"'e Pla“ 0ilil y aUne
dcfénprtfer^î. tgT p i ”?sf fur 1C flanC’ U°ye"
;fôyer;Xçtl^A T ■” T ^ u difficile—1 2 3
plus de Attaques d’une place. Maximes nn ruiUi: :ifi ' V .
obferver dans l’attaque des places. 1. Lci. ¿PChob- d" A°ï
où doit fe faire l’attaque. Obfervation à Edre fi k *1
eft tonte environnée de terres baffes & de marais", & aE
ne foit abordable que par des chauffées. lbid. 830 « Corn
ment on s’inftruit de la qualité des forfifications de la place
quon doit attaquer. lbid, b. Examen des accès i la place
r ne ce qui peut en favorifer lés approches. Obfervations
lur la qualité du terreim Choix d’un front déplacé en terrein
égal le plus favorable pour l’attaque. lbid. 831. a. Il n’eft
É S n/antageux de faire de feuffes attaques, ni d’attaques
féparées. Les meilleures font les doubles qui font bées. Autres
i ü W SM m «“ 0 entrer dans la reconnoiffanée des
places. lbid. b Les attaques étant réfolues, on réglé les gardes
de la tranchée Propomon qu’on doit établir fntre l’trmée
affiégeante & la garmfon de ta place, lbid. 83a. a. Attaque
¿ « £ f e emo“ r<:e 1 mfrlis- ï « *• Attaque d’une p l i e
ituee le long dune grande nviere. lbid. 833. a. Atmoue
des places limées fur des hauteurs. lbid. b. Attaque lies
•Y*Ues maritimes /¿¡d.834. u.-Attaque des petites villes
& chateaux. lbid. i. Attaque de la demi-lune. lbid. 8 ïî ,
Attaque du chemin couvert. lbid. 8^6. a.
Attaque. Sur les attaques , vqyrj l’article SlEGE XV
VI’ 450. a. Attaque imprévue!
X V . 693■ b. Colonne d attaque, dans les évolutions mili.
“ ,.res; ,yA- ' 94- u , b. Attaquer l ’ennemi : détails fur ce
fujet à lamde Feu. VI. 614. b. De l’ufage des abattis pour
foutemr une attaque. De l’attaque de cette forte de retranchement.
Suppl. 1. 12. a. Des cas où un général doit ou ne
aoit pas en venir à un combat particulier. Suppl. II. «i< a
Eloge des François dans l’attaque. 813. 4. Note. *
ATTEHU, (Botan.) genre de plante, de la frmille des
piitachiers, dont on connoîtaux ifles Moluques deux efpeces
nommées attehu & rima-tehu, dont on donne ici la defcriD-
. tl° " les quaUtés & ufages. Suppl. I. 682. b.
• AJ T T, E,N.T E’ ?C MMa 'n edg\e )J umriaJ>l rq- ui arrive aSu3 d4e *r■rière du
pied dun cheval, lorfqu’il s’y bleffe, &c. Atteinte fourde •
atteinte encornée. A quels, fignes on reconnoît ces accidens.
1. 839. 4. Circonftances d’où réfulte une atteinte
encornée. Traitement de cette maladie dans fes différens
degrés. lbid. b.
At,ein,e- 1 m 404. b.
A l 1 , boutique, magafin, chantier, (Synon.) dift'érences
entre ces mots. L 839. b. Attelier des tcrraflîers
des faneurs de train, des ciriers, des manufaétures deelace
Atteliers de v'ers à foie. lbid. 840. a.
Attelier, où l’on enferme les vagabonds : ceux de Londres.
Celui d’Amfterdam. ! 840. 4.
. A ttelier de fculpteur, ( Aflron. ) nom d’une conftella-
tion méridionale introduite par M. l’abbé de la Caille. Suppl
1. 683. b. • rr ’
ATTELAGES de chevaux, voye{ les planches du bour- *
relier, vol. II.
ATTELLES, ( Chirurgie ) matière dont on doit les faire.
V. 300. b. Précautions avec lefquelles il faut en faire ufaee"
. 301.^4, " • . ; 0
A tt el les , (Maréch.) V .301. p.
ATTENTION, exaüitude, vigilance , ( Synon. ) différences
entre ces mots. L 840. b.
o A ttention , ( Logiq, ) moyens d’augmenter l’attention.
1 . 11 faut écarter tout ce qiii pourroit la troubler. Eloigner
les objets qui pourroient agir fur nos fens. ! 840. b. Bannir
de notre imagination tout ce qui la remue trop vivement.
20. Il faut chercher des fecours pour aider l’attention. Telles
font les paillons qui nous font furmonter la peine qu’on
trouve à être attentif. Choix à faire entre ces paillons; il
faut bannir l’ambition , la Vanité, &c. Quelle eft la forte
de gloire dont le defir doit nous enflammer. lbid. 841. a.
Secours qu’on peut tirer des fens, pour rendre l’eijjrit
attentif. La lumière 8c le bruit ne font pas un obftacle à
l’attention. U n’y a que les révolutions inopinées qui puif-
fent -nous diftraire. lbid. b. Objets extérieurs qui foutiennent
l’attention. L’effentiel confifte a favoir lier nos idées aux
objets, de maniéré à faciliter l’exercice dg la mémoire 8c
de l’imagination. Abfùrdité dé cès philoiophes qui s’éloignent
de tous les objets pour méditer fur la phyfique &
ferment les yeux à" l’univers, pour bâtir plus à leur aile leurs
fyftêmes fur l’univers. Exemples de divers degrés de force
d’attention : M. Montmort, lbid. 842.4. Clavius, Jules-Céiâr
Léibnitz, Archimede, cités. Ibid.b. L’habitude d’appliquer!
tous les jours fon efprit, augmente infenfiblement la force
de l’attention. Ce qui fait lé plùs de tort aux hommes, c’eft
l’ignorance dê leurs forcés: lbid. 843.4.
Attention, mechanifme par lequel cet afre de l’eiprit s’opère..
XV, 32. b. L’attention augmente l’intenfité des mouvemens'