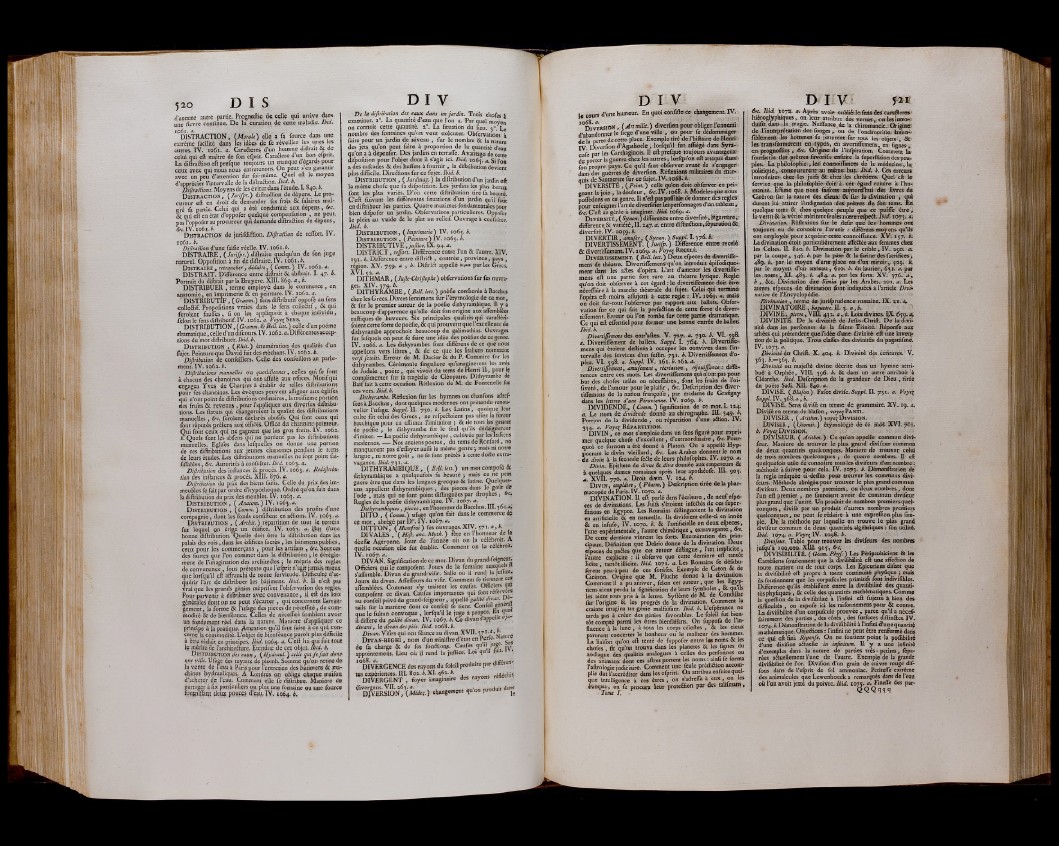
5 a o D I S
d’aucune autre partie. Prognoftic de celle qui arrive dans
une fievre continue. De la curation de cette maladie. Ibid.
^DISTRACTION, {.Morale) elle a ffi .ffiurce f e une
extrême facilité dans tes idées de fe réveiller les. Mnes les
autres. IV. xo6x. a. Carafteres d’un honjme diftrait oç de
celui qui eft maître de fou efprit. Caraûere dun bon efpnt.
La dmraôion eft prefque toujours un manque d égards pour
ceux avec qui nous nous entretenons. On peut s en garantir
avec un peu d’attention fur foi-même. Quel eft le moyen
d’apprécier l’intervalle de la diftraôion. Ibid. A
Diftra fiions. Moyens de les éviter dans 1 étude. 1.840. b.
D istraction , ( Jurifpr. ) diftraâion de dépens. Le procureur
eft en droit de demander fes frais & falaires malgré
fa partie. Celui qui a été condamné aux dépens, 8-c.
8c qui eft en état d’oppofer quelque compenfatiop , ne peut.
p a s l’oppofer au procureur qui demande diftraftion de dépens,
&c.\v. \o6y.b.
D istraction de jurifdiôion. Diflraflion de reflort. IV .
1061. b.
Diflraflion d’une faille réelle. IV. 1061.0.
DISTRAIRE, ( Jurifpr.) diftraire auelqu’un de fon juge
naturel. Oppofition à fin de diftraire. IV. 1061. b.
D i s t r a i r e , retrancher, déduire, { Comm. ) IV. 1062. a.
DISTRAIT. Différence entre ffiftrait 8c abftrait. I. 47. b.
Portrait du diftrait par la Bruyere. XIII. 869. a, b.
DISTRIBUER, terme employé dans le commerce, en
anatomie, en imprimerie & en peinture. IV. 1062. a.
DISTRIBUTIF, (Gramm.) lens diftributif oppofé au fens
colleâif. Propofitions vraies dans le fens collectif, & qui
feraient fàpffes , fi on les appliquoit à chaque individu,
félon le fens diftributif. IV. 1062. a• V>yt{ Sens..
DISTRIBUTION, {Gramm. €f Bell.lett.) celle d’un poëme
dramatique, celle d’un difeours. IV. 1062. a. Différentes acçep-
tlons du 'mot diftribue'r. Ibid. b.
D istribution , (IVtét.) énumération des qualités d’un
fujet. Peinture que David fait des méchans.IV. 1062. b.
Dijlribution de confejllers. Celle des confeifters au parlement.
IV. 1062. b.
Diftributions manuelles ou quotidiennes, celles qui fe font
à chacun des chanoines qui ont afiifté aux offices. Motif qui
engagea Yves de Chartres à établir de telles diftriburionç
pour fes chanoines. Les évêques peuvent affigner aux églifes
qui n’ont point de diftributions ordinaires, la troifieme portion
des fruits & revenus , pour l’appliquer aux diyerfes diftributions.
Les ftatuts qui changeraient la qualité des diftributions
manuelles, $c, feroient déclarés abufifs. Qui font ceux qui
fpnt réputés préfens aux offices. Office du chanoine-pointeur.
Qui font ceux qui ne gagnent que les gros fruits- IV. 1062.
b. Quels font Ips abfens qui ne perdent pas les diftributions
manuelles. Eglifes dans lefqueUes on donne une portion
de ces difiributions aux jeunes chanoines pendant le tems
de leurs études. Les diftributipns manuelles ne fopt ppi.nt fai-
fiffables, (te. Autorités à confulter. Ibid. 1063. a.
Dijlribution des inftances & procès. IV. 1063. a. fledijlribju-
iion des infiances & procès. XIII. 876. a.
Dijlribution du prix des biens faifis. Celle du prix des immeubles
fe frit par ordre d’hypotheque. Ordrô qu on fuit dans
la diftribution du prix des meubles. IV. 1063. a.
D istribu t io n, (Anatom.) IV. 10^3.4.
D i s t r i b u t i o n , ( Comm. ) diftribution des profits d’une
compagnie, dont les fonds confident en aétion». IV. ;<>$3.4.
D is t r ib u t io n , ( Archit. ) répartition de tout le îerrçin
fur lequel on érige un édifice. IV . 1063. a. Rut d’une
bonne diftribution. Truelle doit être la diftribution dans les
palais des rois, dans les édifices facrés , les bâtimens publics,
ceux pour les commerçans , pour les artifans, 6v. Sources
des fautes que l’on commet dans la diftribution -, le dérèglement
de l’imagination des architeftes ; le mépris des réglés
de cpnyenance, fous prétexte que l ’efprit n’agit jamais mieux
que lorfqu’jl eft affranchi de toute fervitude. Difficulté d’ac-
quérir l’àrt de diftribuer les bâtimens. Ibid. b. J1 n’eft pas
vrai que les grands génies méprifeqt l’obfervatipn des réglés-
Pour paryeqir à diftribuer avec convenance, il eft des lpix
générales dpnt OU ne peut s’écarter , qui concernent barran-
gement, là forme & l’ufage des pièces (Je néceflité, de comr
rtiodité & de bienféance. Celles de néceffitè femblent avoir
un fopdempnt réel dans la nature. Maniéré d’appliquer ce
principe à }a pratique. Attention qu’il faut faire à ce qui concerne
là conimodité. L’objet de bienlèaqcp paroit plus difficile
à être réduit gn principes. îbul-1064. a> Ç ’eft lui qui fait tout
le mérite de Varchjreéhire. Çtendup de cet objet. Ibid. b.
Di stribution des eaux, ( IJydraul. ) cçlle qui Je fait dan*
une ville. Ufage des tuyaux de plomb. Somme qu’op retire de
la vente de feau a paris pour l’entretien des bâtimens. 8c machines
hydrauliques. A Londres on oblige chaque maifon
d’acheter 4 ç l’eau. Comment' elle fe mûribue. Mapjere de
partager à f e particuliers ou plus une fontaine ou une fource
fouçniffant deux pouces d’eau. IV. 1964. b.
D I V
De ta dijlribution des eaux dans un jardin. Trois cliofes £
examiner.^ i°. La quantité d’eau que l’on a. Par quel moyen
pn connoît cette quantité. 20. La fituation du lieu. 30. Le
nombre des fontaines qu’on veut exécuter. Observations à
faire pour un jardin de niveau , fur le nombre & la nature
des jets qu’on peut faire à proportion de la quantité d’eau
qu’on a à dépenier. Des jardins en terraffe. Avantage de cette
difpofitton pour l’objet dout il s’agit ici. Ibid. 1065. a- S» l’on
a des cafcades & des buffets à fournir, la diftribution devient
plus difficile. Directions fur ce fujet. Ibid. b.
D i s t r i b u t i o n , ( Jardinag. ) la diftribution d’un jardin eft
la même chofe que fa difpofition. Les jardins les plus beaux
font les plus variés. D’où cette diftribution tire fa beauté.
Ç’eft fuivant les différentes fituations d’un jardin qu’il faut
en diftribuer les parties. Quatre maximes fondamentales pour
bien difpofer un jardin. Obfervations particulières. Oppofer
le plein au vuide & le plat au relief. Ouvrage à coniiiltcr.
Ibid. b.
D i s t r i b u t i o n , ( Imprimerie) IV. 1065.b.
D i s t r i b u t i o n , ( Peinture ) IV. 1063. b.
DISTRIBUTIVE JuJlice. IX. 94. *
DISTRICT, rejfort. Différence entre l’un & l’autre. XIV.
iQi. b. Différence entre diftriét, contrée, province, pays,
région. XV. 759. a , b. Diftrict appellé mut par les Grecs.
XVI. 52. a.
DITHMAR, ( Jujle-Chrijlophe ) obfervations fur fes ouvra-
^ DITHY^^MBE, ( Bell. leu. ) poéfie confacrée à Bacchus
chez les Grecs. Divers fentimens furl’étymologte de ce mot f
8c fur le premier auteur de la poéfie dithyrambique. Il y a
beaucoup d’apparence qu’elle doit fon origine aux affemblées
ruftiques de buveurs. Six principales qualités qui caraftén-
foient cette forte de poéfie, oc qui prouvent que l’excellence du
dithyrambe approchoit beaucoup du galimathias. Ouvrages
fur lefquels on peut fe frire une idée des poéfies de ce genre.
IV. 1066. a. Les dithyrambes font différons de ce que nous
appelions vers libres., & de ce que les Italiens nomment
yerfi feiolti. Erreur de M. Dacier 8c du P. Commire fur les
dithyrambes. Cérémonie fmgulicre qu'imagineront les amis
de Jodele , poète , qui vivoit du tems de Henri II, pour Je
complimenter fur fa tragédie de Cléopatre. Dithyrambe de
Brif frit à cette oçcaûon. Réflexion de M. de Fontenclle fur
ces vers. Ibid. h.
Dithyrambe. Réflexion fur les hymnes ou chanfons adref-
fées. à Bacchus, dont quelques modernes ont prétendu renou*
yeliêr l’ufage. SuppL II. 730. b. Les Latins, quoique leur
culte fut celui des Grecs, ne refpe&oient pas aiïez la fureur
bacchique pour en eftimer l’imitation ; & de tous les genres
de poéfie , le dithyrambe fut le ieul qu’ils dédaignèrent
d’imiter. — La poéfie dithyrambique, cultivée par lesitriiens
modernes. — Nos anciens poètes, du tems de Ronfard, ne
manqueront pas d’eflâyer auffi le même genre, mais ni notre
langue, ni notre goqt, ne fe font prêtés à cette doéle extra-
yggançe. Ibid. j x i . a.
DITHYRAMBIQUE, ( BdLlett.) un mot compolé 8e
dithyrambique a quelquefois fa beauté j mais ce .né peut
guere être que dans les langues grecque & latine. Quelques-
uns appellent dithyrambiques , des pièces dans le goût <Je
l’ode , mais qui ne font point diftinguées par ftrophes, ve.
Réglés de la poéfie dithyrambique. I v . 1007.^.
Dithyrambiques, pièces, en Phpnneur de Bacchus. III. 361.4;
DITO , ( CommS ufaae qu’on frit dans le commerce de
çe mot, abrégé par D°. IY- 1067. a.
D1TTON , ( Humfroi ) fes ouvrages. XIV. 371. a, b.
DlVALES , ( Hijl. anc. Myth. ) fête en l’honneur de la
déefle Agéronne. Jour de l’année oh on la célébroit. A
quelle occafion elle fur établie. Comment on la célébroit.
IV. 1067. a. . .
DIYÀN. Signification de ce mot. Divan du grand-feigneur.
Officiers qui lp compofent. Jours de Ja femaine auxquels 1
s’affemble. Divan du grandrvifir. Salle où il rend la juiiice.
Jours du divan. Affefleurs du vifir. Comment fe tiennent ces
affemblées. Comment s’y traitent les caufes. Offieiers
compofent ce divan. Caufes importantes qui font refermes
au confeil privé du grand-feigneur, appellé gojtbé divan. U ~
tails fur la manière dont ce confeil fe tient. Confeil généra
que le fultan convoque , lorfqu’il le juge à propos. En qu
il différé du galïbé divan. IV. 1067. b. Ce divan s’appelle oj ?
divani , le divan des pies. Ibid. 1068. b. ,
Divan. Vifir s qui ont féance au divan. XVII. A
Divan -B EGH I , nom d’tjn miniftre d’état en F®“ ®* <-eÇ
de fa charge 8c de fes fondions. Caufes 5 ta/
appointemehs. Lieu où U rond la juftiee. Loi qu il lui • «.
I0DIV£RGENCE de* rayons du foleil prodoire par iilfimn-
■“ ¿ S nT ; R i m a i t * , d« rayons rdfUcW
D I V
le cours d’nne humeur. En quoi cohMe de changement. IV.
1<rh « n s 10s , \Artmilu.) diverfion pour obliger l'ennemi
d’abandonner le fiege d'nne ville , Ou pour fe dédommager
de la perte de cette-place. Exemple tire de l hiftoire de Henri •
IV Diverfion d’Agathode, lorfqu’il fùt affiégé dans Syra-
eufe par les Carthaginois. Il eft prefque toujours avantageùx>
de porter la guerre chez les autres, loriqu’on eft attaqué dansi
fon propre pays. Ce qu’il fout obfervec avant de S’engager
dans des guerres de diverfion. Réflexions militaires.dn jiiar-
quis de Santaçrux fur ce fujet. IV. 1068. b.
DIVERSITÉ, {Peint. ) celle qulon doit obferver en peignant
la joie, la douleur, 6*c.IV. 1068. b. Modeles.que nous
poffédons en ce genre. Il n’eftj>as poflihletdèdbnnet desregles
pour enfeigner l’art de diverfiner leîpetfonnages d’un, tableau y
&c. Ceft àu génie à imaginer. Ibid. 1069-.a; ...
D iv e r s i t é x{Synom)différence entre diverfité,bigarrüre,:
différence,8c variété, H. 247. a. entre diftin&ion, fépararion&;
diverfité; IV. 1039. A
DIVERTIR, amufer, (Sy/ion.);Suppl. L 376. bï
' DIVERTISSEMENT. ( Jurifp. ) Différence entre recelé.
8c divertiflemem. IV. 1069. a. Voyeç. Re celé. _
D ivertissement. ( Bell. leu. ) Deux efpeces de ffivemffe-
mens de théâtre. Divertiffemens* qu’on introduit épifodiqne*'
ment dans les ailes d’opéra. L’art d’amener les cüvcrtiffe-
mens eft une partie fort rare au théâtre lyrique. Réglé
qu’on doit obferver à cet égard :1e divertifferaent doit être
néceffaire à la marche théâtrale, du, fujett Celui qui terminé
l’opéra eft moins affujetti à cette réglé : 1Y. 10091 a. mais
on doit fur-tout l’obferver par rapport aux ballets^ Obfer-
vation fur ce qui fait la perfeâion de cette forte'de diver-
tiffement. Erreur où l’on tombe fur- cette partie dramatique.
Ce qui eft effentiel pour former une bonne entrée de baUeti
Ibid.b. '
Divertijfemcns des entr’a&es. V. 727. a. 730. b. V L 59R
a. Divertiffement de ballets. Suppl. I. 764* b% Divertiffe-
mens qui étoient deftinés à occuper les convives • dans Kn-
tcrvalle des fervices. d’un feftin. 731. b, Divertiffemens d’o-
péra. VI. 398; a. Suppl. IV. 161. b. 162. a.
Divertiffement, amufement , récréationrtjouijjance :. diffë»
ronces entre ces mots. Les divertiffemens qui n^ntpas potrn
but des chofes utiles ou néceflàirès , font les fruits de l’oir
fiveté, de l’amour pour le plaifir , &c, Defcription des divertiffemens
de la nation françoife, par madame de Grafigny
dans les lettres d'une Péruvienne. lV. 1069. b.
DIVIDENDE, {Comm.) fignification de ce mot.1. 124*
a. Le nom de dividende donne au chirographe. IU. 349- A
Portion de la dividende , ou répartition d’une aétion. IYi
334. a. Voye^ RÉPARTITION.
DIVIN, ce mot s’emploie dans un fens figuré pour exprimer
quelque chofe d’excellent, d’extraordinaire , &c. Pourquoi
ce lurnom a été donné k Platon. On a appellé Hyp-
pocrate le divin vieillard, &c. Les Arabes donnent le nom
• de divin à la fécondé fefte de leurs philofophes. IV. 1070. a.
Divin. Epithete de divus 8c diva donnée aux empereurs 8e
à quelques dames romaines après leur apothéofe. III. 903.
a. XVII. 770. a. Droit divin. V. 124. b.
D iv in , emplâtre, ( Pharm.) Defcription tirée delà pharmacopée
de Paris. IV. 1070. a. .
DIVINATION. Il eft parlé dans l’écriture , de neuf efpeces
de divinations. Les Juifs s’étoient infeûés de ces fuper-
ftitions en Egypte. Les Romains diftinguoient la divination
en artificielle 8c en naturelle. Ils ëivifoient celle-ci en innée
& en infiife, IV. *070. b. & l’artifidelle en deux efpeces,
l’une expérimentale, l’autre chimérique , extravagante, &e.
De cet« derniere vinrent les forts. Enumération des prin-
cipaux. Définition que Delrio donne de la divination. Deux
efpeces de paâes que cet auteur diftingue , l’un implicite ,
l’autre expiieité : il obierve que cette derniere eft tantôt
licite, tantôt illicite. Ibid. 1071. a. Les Romains fe défabu-
ibrent peu-à-peu de ces fottifes. Exemple de Caton oc de
Çicéron. Origine que M. Pluche donne à la divination.
Comment il a pu arriver, félon cet auteur, que les Egyptiens
aient perdu la fignification de leurs fymbolès ,8 c quiU
les aient tous pris à la lettre. Syftême de M. de Condillac
fur l’origine & les progrès de la divination. Comment la
crainte imagina un génie malfàifanr. Ibid. b. L’efpérance ne
tarda pas à créer des génies favorables. Le foleil fut bientôt
compté parmi les êtres bienfrifans. On fupuofa de l’influence
à la lune , > à tous les corps céleftes , 8c les cieux
Ïarurent concerter le bonheur ou le malheur des hommes,
.a liaifon qu’on eft tenté de fuppofer entre les noms 8c les
chofes , fit qu’on trouva dans les planetes 8c les fignes du
zodiaque des qualités analogues à ceUes des personnes ou
des animaux dont ces aftres portent les noms : amfi fe forma
l’aftrologie judiciaire. Comment une feule prédiéhpn accomplie
dut l’accréditer dans les efprits. On attribua enfuite quelque
intelligence à ces êtres, on s’adreffa à eu x , on les
évoqua , on fe procura leur protcétion par des taliimam*
Tome I.
d i v m
(te. Uni. 10714. a. Après avoif oublié le fens des caraâeres
hiéroglyphiques,. on leurrattribu* des vertus:, on lesiowoH
duifît dans la magie. Naiffance.de: la chiromancie.:Cfcigtne:
de l’interptèration des fonges , ou, de l’onwopritie; Infem>
fiblemcnt les homme» fe-jètterenc-.fùr tous les objets , &
les transformeront en types, en avertiflumens, en’ fignes,.
en- progttoftics , &c. Origine de l’infpirarion. Comment 1»
fourberie des prêtres favorifa- enfuite la fuperftition des peuples.
La pbilofophier, les connoifiances de là- médecine, la
politique,. concoururent:au même but; Ibid. h. Ces erreurs
introduites chez-; les juifs 8t chez les chrétiens; Quel eft le
fervicc que la; philoiQphi&.'doiti à.'cet': égard rendre^ à l’humanité.
Eftime que-nous faiibns aujourd’hui des livres de
Çicéron^ÎUr-_ la- nature des dieux 8c fur la divination , mû
durent lui-attirer l’indigaation rdefi prêtres de fon. tems. En
quelque tertis; 8c. cheaquelquepeuple que ce puifie être,
la-vertli 8clarvérité méritentfeules notre refpeft. Ibid. 1073. ai
Divination, Réflexions fur le .defir qué les> hommes- ont
toujours- eu de connoître l’avenir c: différons moyens qu’ils
ont employé»! pour acquérir cette connoifiance. XV. 237. b.
La divinatiométoit particulièrement affëâiée'aux femmes chez
les Celtes. U. 810. b. Divination par le crible , IV. 190. a.
par la-coupe, 346^ b. par la pâte 8c la farine des facrifices,
489, b«^ par .le» moyen d’une glace ou dhinimiroirv 329; h
par le moyen d’un anneau y 6io. b. du laurier,. ifyti-ai par
les noms , XL 483. b. 484. a. par les forts.' XV; 376. a ,
b ,. 8cc. Divination dite Sim'ut par les Arabes- 201. a. Les
autre» efpeces de divination font indiquées à, l’article Divination
de l'Encyclopédie.
Divination , terme de juriiprudence romaine. IX. 2t. a*
DIVINATOIRE', baguette. II. 3. a , b.
DIVINE , pierre; VIÏL 432; a , b. Loix divines. ÇL 639. a.
DIVINITE. De la divinité de Jefus-Chriû. De 1^-cfivi*-
nité dans les perfonnes de la fainte Trinité; Réponfe aux
athées qui prétendent que l’idée d’une divinttè eft une invention
delà politique. Trois daffes des divinités du paganifmè.
IV. 1073. a.
Divinité du Chrift. X. 404. b. Divinité dès écritures. V.
363. ¿.—363. b.
. Divinité ou' majefté divine décrite dans un hymne attribué'
à Orphée., VIII. 396. b. 8c dans un autre attribué à
Cléanthe. Ibid. Defcription de la grandeur de Dieu, tirée
da poète Sadj. XII. 840. a.
DIVISE {Blafon) Fafcc divife.Suppl. II. 731. a. Voyè[
Suppl. IV. 368.4, b.
DIVISÉ. Sen» divifè en terme de grammaire. XV. 19. a.
Divifé en termpjdeblafon, voye^P a r t i .
DIVISER, ( Arithm. ) voye[ D i v i s io n .
D i v i s e r , ( Géomêt. ) étymologie de ce mot XVI. 701.
b. Voyez D i v i s io n .
DIVISEUR, f Arithm. ) Ce qu’on appelle commun drvi-
feur. Maniéré de trouver- le plus grand divifew commun
de deux quantités quelconques.- Manière de trouver celui
de trois nombres, quelconques ,. de quatre nombres. Il eft
quelquefois utile de connoître tous les diviiêurs d'un nombre:
méthode à fuivre pour cela. IV. 1073. b. Démonftration de'
la réglé indiquée ci-deflùs pour trouver les communs divi-
feurs. Méthode abrégée-pour trouver le plus, grand commun
divifeur. Deux nombres psemiers, ou deux nombres, dont
l’un eft premier , ne fauroient avoir de commun divifeur
plus grand que l’unité. Un produit de nombres premiers quelconques
, uivifé par un produit d’autres nombres premiers
quelconques, ne peut fe réduire' à une expreffioa plus fira-
ple. De la méthode par laquelle on trouve le plus grand
divifeur commun de deux, quantités algébriques : fon milité.
Ibid. IO 74 . a, Voye{ IV. 1098. b.
Divffeur. Table pour trouver les divifeur» des nombres
jufqu’à 100,000. XlIL 913 , &c.
DIVISIBILITÉ. ( Géonu Phyf.) le s Péripatétidens 8c les
Cartéfiens fouriennent que la divifibilité eft une affeéfion de
tpute matière ou de tout corps. Les Epicuriens difern que
la divifibilité eft propre à toute continuité phyfique j mû»
ils foutiennent que le» corpufcules primitifs font indivifibles.
Différence qu’ils établiffent entre la divifibilité des quantités
phyfiques , & celle des quantités mathématiques. Comme
la queftion de la divifibilité à l’infini eft fujette à bien des
difficultés , on expofe ici les raifonnemens pour 8c contre.
La divifibiUté d’un corpufcule prouvée , parce qu’il a nécef-
fairoment des parties , des côtés , des furfaccs diftin&es. IV.
1074. b. Démonftration de la divifibilité à l’infini d’une quantité
mathématique. Objeétions : l’infini ne peut être renfermé dans
ce,qui eft fini. Réponfe. On ne foutient point la poflibilité
d’une divifion aâuelle in infinitum. Il y a une infinité
d’exemples dans la nature de parties très-petites, fépa-
rées anueUement l’une de l’autre. Exemple de la grande
divifibilité de l’or. Divifion d’un grain de cuivre rouge dif-
fous dans de l’efprit - de fel ammoniac. Petiteffe extrême
des-animalcules que Lewenhoeck a remarqués dans de l’eau
où l’on avoit jette du poivre. Ibid. 1073. a. Fineffe des par-
. Q Q Q q q q