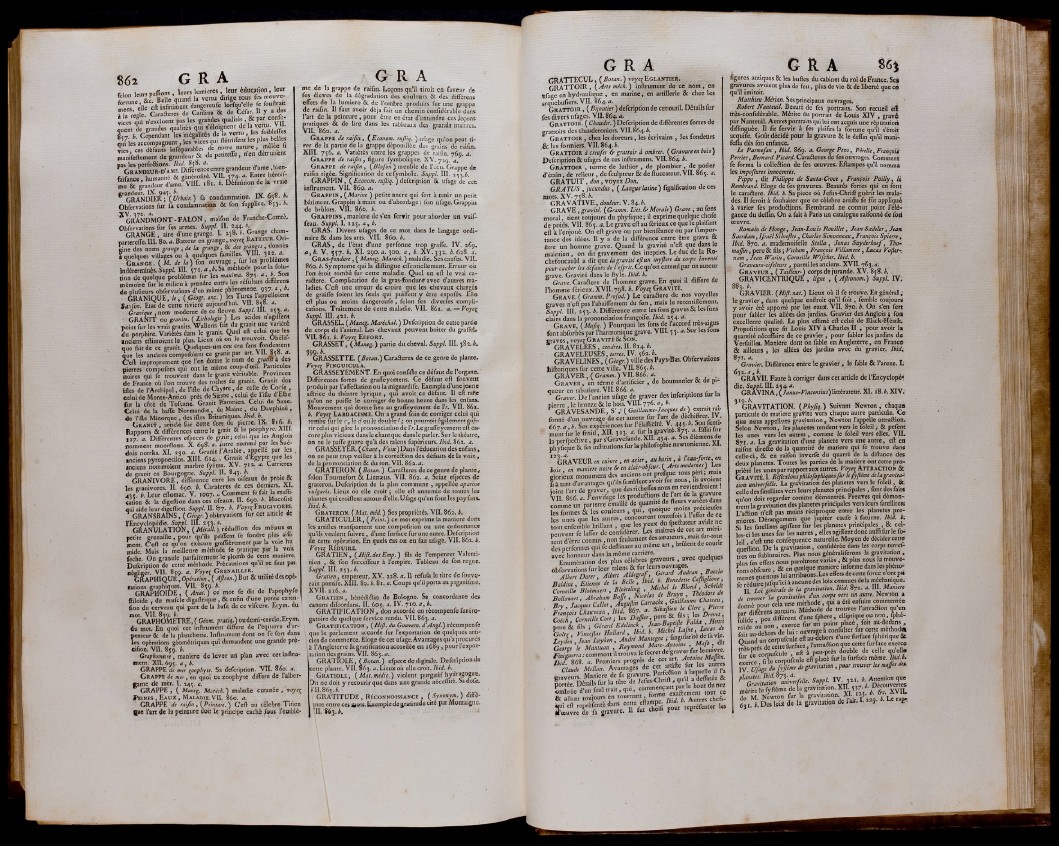
86î G R A
ni" elle eft infiniment dangereufe lorfqu’elle lè fouftrait £ S de Caulina & d e f e f a r . 11 y a dea
vices qui n’excluent pas les grandes qualités, & p a r c0^ '
quant de grandes qualités qui s’éloignent
2 ,7 . b. Cependant les inégalités de la v e r tu , le i foiWe es
J i 1m ormmnaenent. les vices qui flétnflent les plus
G R A
fi
v ie s , ces défauts inséparables de notre natu re_
mamfeftcment de grandeur Sc de p e t i t e * , n en détruitent
‘ '’ g ^ r a n o e i^ ^ ’as^Diff^rénceentre grandeur d’ame , bien-
faifance humanité 8c générofité. V I I . 574. a - Enttre héroif-
me & grandeur d’am e V I I I . 181. A Définition de la vraie
* r G R A N d ÎÊ I ? !^ Urbain ) fa condamnation. IX . 698. ;A
Obfervauons fur fa condamnation 8c fon fuppucc. »53. b.
X G R AN DM O N T - F A L O N , maifon de Franche-Comté.
Obfervauons fur fes armes. Suppl. II. 244- *• .
G R A N G E , aire d’une grange. 1. 238. b.
partere lfe.lll. 80. a. Batteur en grange, « w Ba t t e u r . O r igine
des noms grange ; de la grange, & d e, grange, .donné s
i quelques villages ou à quelques familles. V I I I . ?»*•*■
G r a n g e . ( A i . de l a ) fon ouvrage , fur les problèmes
Indéterminés.Suppé III. 371. a ,é .S a méthode p ou r la fo lu -
tion de quelque problèmes fur les maxtma. 873. a . b . t s o a
mémoire fur le milieu à prendre entre les réfultats d.fféren.
de plufieurs obfervations d’un même phenomene. 937* tf.» 4
G R A N IQ U E , U , ( Glogr. apc. ) les Turcs lappello.cnt
San fon. Etat de cette rivicre aujourd but. VII. o<o. a.
Granique , nom moderne de c e fleuve. Suppl. 111^ 233. a,
• G R A N IT ou granité. ( Lithologie ) Les acides nagiffent
point fur les vrais granits. V a l le r is fut du granit une variété
Su porphire. Variétés dans le granit Q u e l eft celui que les
inciens efttmoicnt le plus. Lieu* oa on le trouvoit. Obélif-
que fait de ce granit. Quelques-uns ont cru fans fondement
que les anciens compofoient ce granit par art. r lL ju O a .a é
C ’eft improprement que l’on donne le nom de g ra d lf* des
pierres compofées qui ont le même coup-dceil. Particules
noires qui fe trouvent dans le granit véritable. Provinces
de France oh l’on trouve des roches de granit. Granit des
Ules de l’Archipel, de l’ifle dé Ç ç y t " , de celle de Corfe ,
celui de Monte-Antico près deSierne .c e lu i d e li i le dElbc
fur la côté de Tofcane. Granit Raromen. Celui de Saxe-
Ce lu i d e là baffe Normandie, du Marne du Dauphiné,
de Tille Minorquc , des iûes Britaimques. Ibtd. A
G r a n it , article fur cette fort* a c pierre. IX . o i 6 .b e
Rapports 8c différences entre le grnit 8c le porphyre. XIII.
1 2 7 . a . Différentes efoeces de g r iiit; celui que les Anglois
nomment moorrtone. X . 698. 4. iu tre nommé par les Suédois
norrka. XI. 430. a. Granit i ’A rab ie, appellé par les
anciens pyropoedlos. XIII. 614.1. Granit d Egypte que les
anciens nommolent marbre fyénte. X V . 712. a. Carrières
de granit en Bourgogne. Suppl. 11. 843. b. .
G R A N IV O R E , différence enre les oifeaux de proie &
les granivores. H. 690. b. Caraécres de ces derniers. XI.
433“ b. Leur eftomac. V . 1007... Comment fe fait la maflt-
cation 8c la digeftion dans ces ofeau*. II. 690. b. Mucofné
qui aide leurdlgeftion. Suppl. II. I77. b. Voyee F r u g iv o r e .
G R AN S B A IN S , ( G io ir . ) obfcrvations fur cet arncle 4e
l ’Encyclopédie. Suppl. l u . 253. «.
G R A N U L A T IO N , {M é ta ll.) réduflion des métaux en
petite grenaille, pour qu’ils puiffent fe fondre plus aifo
ment. C ’eft ce qu on exécute grofliérement par la voie nu
mide. Mais la meilleure méthode fe pratique par la voie
feche. On granule parfaitement le plomb de cette manière.
Defcription de cette méthode. Précautions qu il ne faut pas
" ^ '^ P H I Q U E ^ O g i r S ' Î c AJlron.) But & utilité des opê
” G W llK 5 > iï)E S, ( A m M ce mot fe dit de l’apophyft
fliloïde , du mufcle digaftrlque, 8c enfin d’une petite exten-
Con du cerveau qui part de la bafe, de ce vifeere. Etym. du
^ G R A PH ^ iv IE T R E , ( Glom. protia.) oudcml-cercle.Etym.
du mot. En quoi cet inftrümcnt difïere de l’éqjierre darÎenteur
8c de la planchette. Inftrümcnt dont on fe fert dans
es opérations géométriques qui demandent une grande prç-
cifion. VII. 839. b. , .
Graphomttre, manière de le v e r uri plan a v e c cet înitru-
«nent. XII. 693. a , b. .
GRAPPE de mtr zpopfiytt. Sa defcription. V I I . 860. a.
G r a p pe dt m tr , en quoi ce zoophyte diffère de l’alber-
gamc de mer. 1. 243. a.
G R A P PE , ( Mantg. Maréch.) 1 maladie cu tanée, voyc{
R eines , E a u x , M aladie. VII. 860. a.
G RAPPE de raifin, (P e in tu re .) C ’eft au célébré Titien
gue l’art de la peinture doit le principe caché fous Tcuiblémèlée
me de la grappe de raifin. Leçons qu’ il -droit en faveur de
fes éleves de la dégradation des couleurs 8c des différens
effets de la lumiere 8c de l’ombre produits fur une grappe
de raifin. Il faut avoir déjà fait un chemin confidérablc dans
l ’art de la peinture, pour être en état d’entendre ces Jeçons
pratiques 8c de lire dans les tableaux des grands maîtres.
V IL 860. 4*. 6
G r a p p e de raifin , ( Econom. rufliq. ) ufage qu’on peut tirer
de la partie de la grappe dépouillée d e s grains de raifin.
XIII. 736. a. Variétés entre les grappes de raifin. 769. a.
G r a p p e de raifin , figure fymbolique. X V . 729. a.
G r a p p e de raifin , ( B la f o n ) meuble de Tecu. Grappe de
raifin tigée. Signification d c c e fym b o le . Suppl. 111. 233.b.
G R A P P IN , ( Econom. rufiiq. ) defcription 8t ufage de cet
infiniment. V I I . 860. a.
G r a p p in , ( Marine ) petite ancre qui fert à tenir un petit
bâtiment. Grappin à main ou d’abordage : fon ufage. Grappin
de brûlots. V I I . 860. b.
G r a p p in s , maniere de s’en fervir pour aborder un vaif-
feau. Suppl. I. 123. <s, b. •
. G R A S . D iv er s ufages de ce mot dans le langage ordinaire
8c dans les arts. v i l . 860. b.
G R A S , de l’état d’une perfonne trop graffe. IV . 269.
a , b. V . 337. b, X I. 290. a. 300. a y b. X V . 332. b. 628. a.
G ra s -fondure, ( Mancg. Marceli.') maladie. Sescaufes. V IL
860. b. Symptôme qui la diftingue effenticllement. Erreur où
l’on étoit tombé fur cette maladie. Q u e l en eft le vrai ca-
raétere. Complication de la gras-fondure' avec d’autres maladies.
C ’eft une erreur de croire que les chevaux chargés
de graiffe foient les feuls qui puiffent y être expofés. Elle
eft plus ou moins dangereufe, félon ics diverles complications.
Traitement de cette maladie. V I I . 861. a. — Voyc^
Suppl. III. 42 1. b.
GRASSEL. ( Ma nte. Maréchal. ) Defcription de cette partie
du corps de l’animal. Les chevaux peuvent boiter du graffeL
V I I . 861. b. Voyez EEFORT.
G R A S S E T , ( Maneg. ) partie du cheval. Suppl. III. 382.A»
399. b.
G R A S SE T T E . ( Botan. ) Ca raâeres de ce genre de plante.
Voy ez PlNGUICULA.
G R A S SE Y EM EN T . En quoiconfiftc ce défaut de l’organe.
Différentes fortes de graffeyemens. C e défaut eft fouvent
produit par l’affeâation oü la mignardife. Exemple d’une jeune
a â rice du théâtre ly r iq u e , qui avoit ce défaut. 11 eu rafe
qu’on ne puiffe le corriger de bonne heure dans les en fans.
Mouvement qui donne lieu au graffeyément de IV. V I I . 8 6i.
b. Voyez L a bd a c ism e . On a grand foin de corriger celui qui
tombe lur le c , le d ou le doublé/,' on pourrait également guérir
celui qui gâte la prononciation de IV. Legraffeycment eu encore
plus vicieux dans le chant que danslc parler. Sur le théâtre,
on ne lepaffe guere qu’à des talcns fupérieurs. Ibid. 862. a.
G RASSEYER. ( Chant, V o ix ) Dans l’éducation des enfaris,,
on ne peut trop veiller à la correétion des défauts de la v o ix ,
de laprononciation Sc du ton. V I I . 862. a.
G R A T E R O N . (B o ta n . ) Caraétercs de ce genre de plante y
félon Tourncfort 8c Linnæus. V I I . 862. a. Seize efpeces de
grateron. Defcription de la plus commune , appellée aparine
vulgaris. Lieux où elle croît ; elle eft ennemie de toutes les
plantes qui croifient autour d’elle. Uiàge qu’en font les payfans.
Ibid. b.
G r a t e r o n . {M a t . m id .) Ses propriétés. V I I . 862. b.
G R A T IC U L E R , { P e in t .) ce mot exprime la maniere dorit
les artiftes tranfportent une compofitiop ou une ordonnance
qu’ils veulent fu iv re , d’une fur face fur une autre. Defcription
Je cette opération. En quels cas on en fait ufagè. V I I . 862. b.
Voyez R éd u ir e .
G r A T I E N , ( H ijl. des Emv. ) fils de Tempcreur Valcnti-
nien , 8c, fon fucceffcur à 1 empire. Tableau de fon regne.
Suppl. III. 233. b.
G ratien, empereur. X V . 228. a. I l refufa le titre de fouve-
rain pontife.XlII. 80. b . S i . a . Coups qu’ilpprta aupaganifme,
X V I I . ai.6. a.
G r a t ie n , bénédiélin de Bologne. S% concordance dç»
canons difeordans. II. 603. a. IV . 7 10 . a , b.
G R A T IF IC A T IO N , don accordé en récompenfefurerò-
gatoire de quelque ferviçe rendu. VII. 863. a.
G r a t if ic a t io n , {H i f l .d u Gouv em .d A n g l.) récompenfe
que le parlement accorde fur l’exportation de quelques arti-
I d e s de commerce. Eloge de cet ufage.Avantages qu’a procurés
à l’Angleterre la gratification accordée en 1609, pour Texpor-
:ation des grains. VII. 863. a.
G R A T lO L E , (B o ta n . ) efpece de digirale. Defcription de
cette plante. V I I . 063. a. Lieux où elle croît. Ibid. b.
G k a t i o l e , ( Mat. m i die. ) violent purgatif hydragogut.
On ne doit y recourir que dans une grande n é c c f f i t é . Sa dole.
y iI.8 6 c .A -
G R A T IT U D E , R êco n n o issa n c e , {S y n o n ym .) diffé-
tnce entre ces « o ts , Exemple de gratitude che par Montaigne.
a i , 863. a
G R A
G R A T T E C U L , ( B otan. ) voyez EGLANTIER.
G R A T T O IR , ( A r t s mich. ) infiniment de ce n om , en
ufage en hydraulique , en marine, en artillerie Sc chez les
a r q u e b u f i e r s . V I I . 8 6 4 . <z. ■
G r a t t o ir , ( Bijoutier ) defcription de c e t outil. D étails fur
fes divers ufages. Y I I . 864. a. - ,
G r a t t o ir . ( Chauder. ) Defcription de différentes fortes de
grattoirs des chauderoniers. V I I . 864. A
G r a t t o ir , chez les doreurs, les éc rivains, les fondeurs
J&, les fermiers. V I I . 864. b.
GRATTOIR à creufer & grattoir â ombrer. ( Gravure en bois )
Defcription & ufages de ces inftrumens. V I I . 864. A
G r a t t o ir , terme de luthier , de plombier, de potier
¿ ’¿tain, de relieur, de fculptcur Sc de ftuccateur. V I I . 863. a.
G R A T U I T , d o n , v o y e z D o n .
G R A T U S , ju cu n d u s , {L a n g u e'la tin e ) fignification de ces
mots. X V . 738. A
G R A V A T I V E , douleur. V . 84. A
G R A V E , gravité. {Gramm. L it t . & M o ra le ) Grave ; au fens
m o ra l, tient toujours du phyfique; il exprime quelque chofe
de poids. V I I . 863. a. Le grave eft au férieux ce que lcplaifant
eft à l’enjoué. O n eft grave ou par bienféance ou par 1 importance
des idées. Il y a de la différence entre être grave &
être un homme grave. Quand la gravité n’eft que dans le
maintien, on dit gravement des inepties. L e duc de la Rochefoucauld
a dît que la gravité eft un myfiere du corps inventé
pour cacher les défauts de l e f p r i t .C c qu’on entend.par un auteur
grave. Gravité dans le ftyle. Ibid. A
Grave. Caraélere de l’homme grave. En quoi'il différé de
l ’homme férieux. X V I I . 798. A Voy c{ G r a v it é .
G r a v e . ( Gramm. P ro fo d .) L e cara&ere de nos voyelle s
graves n’eft pas l’abaiffement du fo n , mais le retentiffement.
Suppl. III. 233. A Différence entre lésions graves 8 c les fens
clairs dans la prononciation françoife. Ibid. 234. a '.
G r a v e , {Mu fiq . ) Pourquoi les fens de raccord très-aigus
font abforbés par 1 harmonique grave. V I I I . 33 .a . Sur les fon»
g ra v e s , voyeç G r a v it é & So n .
G R A V E L É E S , cendres. II. 814. A
G R A V E L E U S E S , terres. IV . 362. b.
G R A V E L IN E S , ( Géogr.) v ille des Pays-Bas. Obfervations
liiftoriques fur cette ville. V I I . 863. A
G R A V E R , ( Gramm. ) V i l . 866. a. . e , .
G r a v e r , en tdrme d’artificier , de boutonmer oc de pi-
queur en tabatière. V IL 866. a . . . . . . *
Graver. D e l’ancien ufage de graver des infcnpttons fur la
b le r r c , le bronze & l e bois. V I IL 776. a , b. ,
G R A V E S A N D E , S ’ , ’ ( Guillaume-Jacques de ) extrait rationné
d’un ouvrage de cet auteur fur 1 art de déchiffrer. IV .
667. a b. Ses expériences fur l’élaflictté. V - 445-f f S“ ' *?"“ •
m a lt fur le f ro id ,X I I . 313. u. fur la gravité. 875. «J-Effat fur
la perfpeélive, par s'Gravefande.XII. 434- 4. Ses élémentide
phyfique & fes inftitutlons fur la philofophie newtomenne. XI.
1 ^ R A V E U R en, cuivre , en a c ie r , au burin, i l'ea u .for te, en
lo ir en manier, noir , & en clair-obfeur.X A n s modernes) Les
stlorieux monumens des anciens ont preftpte tous pér i, mats
î . i tant d^vantages qu’ils femblent avoir Ær nou s, ils avoteu
oiat î'art de g r a v e r / q u e desricheflesnousen revtendrotent!
V° ‘ 866 a. f ’envifâge les produaions de fart de la gravure
tom me un parterre Imaillé de quanntéde fleurs variées dans
les fo rm « £ les couleurs , q u i, quoique motus précteufes
les unes que les autres, concourent toutefois à 1 effet de ce
tou t enfemble brillant , que
* ’ W - r de courir
obferva.ion5 fur Audran , Baecio
A lb er t D u r e r , Albert A U c g a ^ i B in id l l l i C a jlig lion ,,
François C ha u veau , Ibtd. o o y .u . j firevet
£ r e & f i b
PG o ï r , r ,n e ,(la s Ho llard , Ibid. b. M .M
I c y d e t t , Jean L u y k en , A n d r l Maneegn,M i *
George le Mantuan , Raymond M a r c-A p tom , , M a JO, m
a ^ v r c T ' û s r a t r e . I l fut choifi pour «préfenter les
G R A 863
figures antiques 8c les buftes du cabinet du roi de France. Se»
gravures avoient plus de fe u , plus de vie 8c de liberté que c é
qu’il imitoit.
M atthieu Mérian. Ses principaux ouvrages. .
Robert Nanteüil. Beauté de fes portraits. Son recueil eft
tfés-confidérable. Mérite du portrait de Louis X IV , gravé
par Nanteuil. Autres portraits qui lui ont acquis une répüratioii
diftineuée. I l fit fervir à fes plaifirsla fortune qu’il s’étoit
acquile. Goût décidé polir la gravure 8cledeffin qu’il mant.
fefia dés fon enfance.
L e Parme fa n , Ibid. 869. a. George P e n s , P ¿relie, Frahçoii
Perrier, Bernard Picard. Caraâeres de fes ouvrages. Comment
fe forma la collection de fes oeuvres: Eftampes qu’il nomma
les impoflurcs innocentes.
Pippo , dit Philippe de Santa-Croce , François P o i l ly , It
Rembrand. Eloge de fes gravures. Beautés fortes qui en font
le caraétere. Ibid. b. Sa piece où Jefus-Chrift guérit les malades.
I i ferait à fouhaiter que ce célébré artifte fe fut appliqué
à varier fes productions. Rembrand ne connût point l’élégance
du deiltn. O n a fait à Paris un catalpgüe raifonné de Coii
teuvre:
Romain de H o og e, Jean-Louis RouiUet, Jean Sadeler, Jean
Saerdam, Ifiracl Silve flr e, Charles Simonneau, François S pierre i
Ibid. 870. a. madëmoifeile S t e l la , Jonas Suyderhoef, Tho-
maffim > pere 8c fils ; Vichem, François Villamene, Lucas Vofttr-
nàm , Jean W a r in , Corneille JVifcher. Ibid. b:
Graveurs-cifeleurs , parmi les anciens. X V I I . 763.4*.
G r a v e u r , { T a i lle u r ) corps de jurande. X V . 838. A •
G R A V IC EN TR IQ U E , ligne , {A fir o n om .) Suppl. IV ;
883. A
GR A V IE R . { JTift.nat.) Lieux où il fe trbuve. Eli général ;
le g ra v ie r , dans quelque endroit qu’il fo i t , femble toujours
y avoir été apporté par les eaux. V I I . 870. A Ori s’èn fert
pour fabler les allées îles jardins. Gravier des Anglpis \ fon
excellente qualité. Le plus eftimé eft celuj de Black-Héath.
Propofitions que fit Louis X IV à Charles I I , pour avoir la
quantité néceffaire de ce gravier ; pour fabler les jardins de
Verfailles. Maniéré dont on fable en Angleterre, en France
Sc ailleurs j les allées des jardins avec du gravier. Ib id,
87 Î. a.
Gravier. Différence entre le g ra v ie r , le fable 8c l’arene. L ’
'632.4*, b. ' ■ - .
G R A V I I . Faute à corriger dans cet article de l’Enfcyclopé*i
die. Suppl. III. 234. a. , . • •.
. G R A V IN A , ( Janus-Vmcentius) littérateur. X I. 18. b. XIV,'
f la .b . ■ . ,
G R A V IT A T IO N . { P h y f iq .) Suivant N ew to n , chaque
particule de matière gravite ver9 chaque autre particule. C e
que nous appelions gravitation, Newton l’appelle attraftion-
se lon Newton j les planètes tendent vers le io le il, 8c pefent
les unes vèrs les autres, comme le foleil vers elles. V I I .
871. a. La gravitation d’une planete vers une autre, eft en
raifon direâe de la quantité de matierè qui fe trouve dan»
celle-ci, 8c en raifon inverfe du quarré de la diftance des
deux planetes. Toutes les parties de la matière ont cette propriété
les unes par rapport aux autres. Voyez A t t r a c t io n S c
G r a v it é . I. RéflexionsphibÇophiquesfur lefyftcme d c la erav itai
tion univerfelle. La gravitation des planetes vers le fo le il, 8c
celle des fatellites vers leurs planetes principales , font des fait»
qu’on doit regarder comme démontrés. Preuves qui démontrent
la gravitation des planetes principales vers leurs fatellites*
L ’aftion n’eft pas moins réciproque entre les planetes premières.
Dérangement que iupiter caiife à faturne. Ibid. b;
S i les fatellites agiffent fur les planetes principale^, 8c celles
ci les unes fur les autres, elles agiffent donc aûffi furie fo-
leil c’eft urte cohféquence naturelle. M oyen de décider cette
mieftion. D e la gravitation, confidérée dans les corps terref-
fres ou fublunaires. Plus nous généraUferons la gravitation ,
plus fes effets rtous paraîtront variés ,• 8c plus nous a trouve-
rons obfcure, 8c en quelque manière informe dans les phénomènes
quenous lui attribuons.Les effets decette force n ont pii
fo réduire jufqu’ici à aucune des loix cjmnues delà méclrantque,
II L o i générale de la gravitation. Ibtd. 872. 4*. IIL Maniéré
de trouver la gravitation ¿ u n corps vers un autre. Newtôn a
doiiné pour cela une méthode, nu» a été enfime commentée
nar différens auteurs. Méthode de trouver lattraftion qu un
B u t e peu différent d’une fphère, elhptiqueou n on , fphé-
ï ï k J n o n , exerce fur un point placé, foit au-dedans,
ro de ou n » ouvrage à confulter fur cette méthode
O u r d u n o t p u f c ù k X u - L h o r t é’unc fur face fphérique &
S o r é s de cette furfece, l’attraflton qtle cette furface exerce
trés-pres eft j pcu.pr ès double de celle q u e lle
C k corpufcule eft placé fur la furface m tm c lbid.b.
L , du M im e de gravitation, pour trouver Us mages det e x e r c e , - .
IV . Vfage d u M '
planè tes ;lbtd.97% .d- . . . - , , y , , Attention que
Gravitation univer f • f P / ^1^.3 , Découvertes
m ér ire le fy fiêm ed e la g raV ita io n . X a 337- • & X V I1 .
de M. Newton fur la gravitauon. X l. i y - » u
$3 ï , b. Des loiX do la gravitation de 1 air. 1. 2 .9 ™