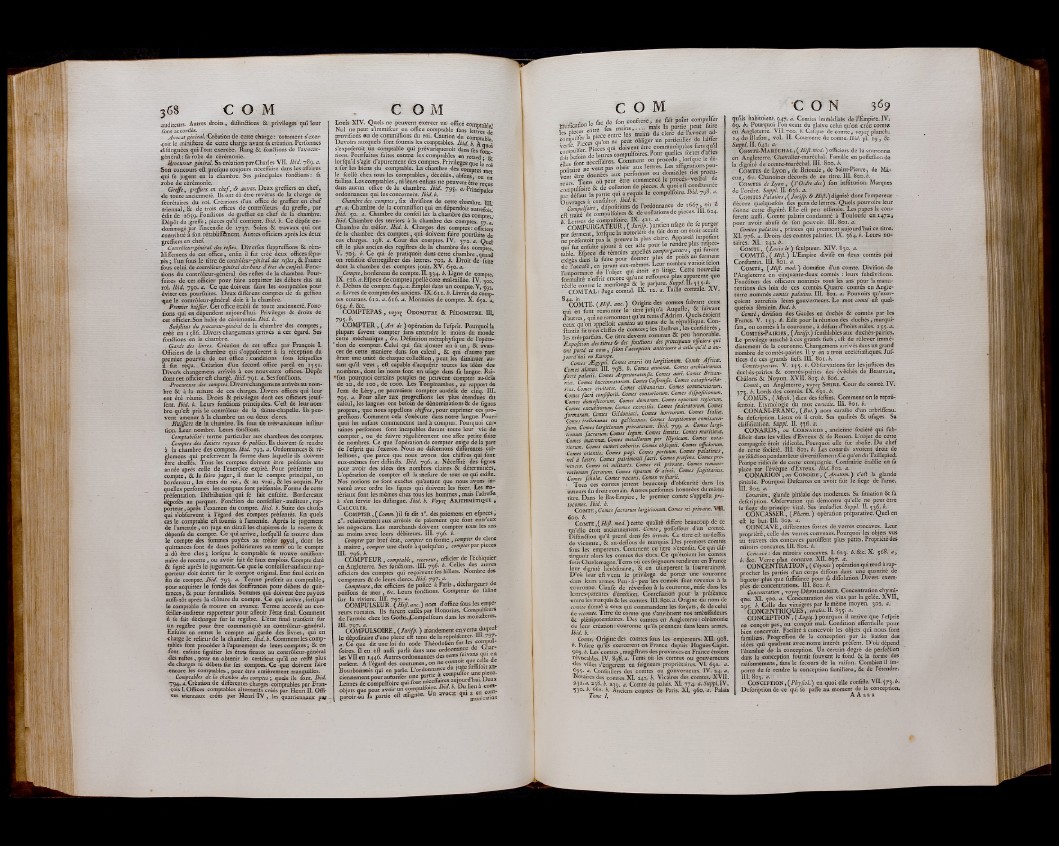
3 ^ 3 COM COM auditeurs. Autres droits, diflinôions & privilèges qui leur
•font accordés.
Avocat général. Création de cette charge : comment s’exer-
-çoit le minilterc.de cette charge avant-la création. Perfonnes
diftinguées qui l’ont exercée. Rang & fondions de l’avocat- !
général : fa robe de cérémonie.
procureur général. Sa création -par-Charles VU. Ibid. 789. a.
Son concours eft.prefque toujours néceffaire dans les affaires
qui fe jugent en là chambre. Ses principales fonctions : fa
robe de cérémonie. _ ■
Greffe, greffiers en chef, ¡& autres. Deux greffiers en chef,
de toute ancienneté. Ils ont dû être revêtus de la charge de
fecrétaires du roi. Créations d’un office de greffier en chef
triennal, & de trois offices de contrôleurs du greffe, par
¿dit de *639. Fondions de greffier en chef de la chambre.
Dépôt du greffe ; pièces qu’il contient. Ibid. b. Ce dépôt endommagé
par rincendie.de 1737. Soins & travaux qui ont
contribué à fon rétablilfëment. Autres officiers après les deux
greffiers en chef. . ,
•Contrôleur-général des reftes. Diverfes fuppreffions & réta-
bliffemens de cet office, enfin il fut créé deux offices fépa-
ïés; l ’un fous le titre de contrôleur-général des refies , & l’autre
fous celui de contrôleur-général dès-bons d'état du confeiL Fonctions
du contrôleur-général des reftes de la chambre. Pour-
fuites de cet officier pour faire acquitter les débets dus au
roi. Ibid. 790. a. Ce que doivent faire les comptables pour
éviter ces pourfuites. Deux différens comptes de fa geftion
■que le contrôleur-général doit à la chambre.
..Premier huijjier. Cet office établi de toute ancienneté. Fonctions
qui en dépendent aujourd’hui. Privilèges & droits de
cet officier.Son habit de cérémonie. Ibid. b.
Subfiitut du procureur-général de la chambre1 des comptes,
créé en 3 586. Divers changemens arrivés à cet égard. Ses
fondions en la chambre.
, Garde des livres. Création de cet 'office par François I.
Officiers de la chambre qui s’oppoferent à la réception du
premier pourvu de cet office : conditions fous leiquelles
H fut reçu.. Création dhin fécond office pareil en i<$i.
Divers changemens arrivés à ces nouveaux offices. Dépôt
dont cet officier eft chargé. Ibid. 791. a. Ses fondions.
■Procureurs des comptes. Divers changemens arrivés au nombre
& à -la -nature de ces charges. Divers offices qui -leur
ont été réunis. Droits & privilèges dont ces-officiers jouif-
fent. Ibid. b. Leurs fondions principales. C ’eft de leur nombre
qu’eft pris le contrôleur aè la fainte-chapelle. Us peuvent
amener à la chambre un ou deux clercs.
■Huiffiers de la chambre. Ils font de très-ancienne inftitu-
rion. Leur nombre. Leurs fondions.
. Comptabilité : terme particulier aux chambres des comptes.
■ Comptes des deniers royaux & publics. Us doivent fe rendre
à la chambre des comptes. Ibid. 792. a. Ordonnances & ré-
glcmens qui preferivent la forme dans laquelle ils doivent
etre dreffés. Tous les comptes doivent être préfentés une
année après celle de l’exercice expiré. Pour préfenter un
compte, & le faire juger, il faut le compte principal, un
boraereau, les états du roi, & au vrai, oc les acquits. Par
quelles perfonnes les comptes font préfentés. Forme de cette
préfentation. Diftribution qui fe fait enfuite. Bordereaux
dépofés au .parquet. Fondion du confeiller - auditeur, rapporteur,
après l’examen du compte. Ibid. b. Suite des choies
qui s’obfervent à l’égard des comptes préfentés. En quels
cas le comptable eft fournis à l’amende. Après le jugement
de l’amende , on juge en détail les chapitres de la recette &
dépenfe du compte. Ce qui arrive, lorfqu’il fe trouve dans
le compte des fommes payées au tréfor royal, dont les
quittances font de dates poftérieures au tems’ où le compte
a dû être clos ; lorfque le comptable fe trouve omiffion-
naîre de recette, ou avoir frit de faux emplois. Compte daté
- & figné après le jugement. Ce que le confeiller-auditeur rapporteur
doit écrire fur le compte original. Etat final écrit en
fin de compte. Ibid. 793. a. Terme preferit au comptable,
pour acquitter le fonds des fouffrances pour débets de quittances
, & pour formalités. Sommes qui doivent être payées
auffi-tôt après la clôture du compte. Ce qui arrive,-lorfque
le comptable fe trouve en avance. Terme accordé au confeiller
auditeur rapporteur pour, afféoir l’état final. Comment
-il fe fait décharger fur le regiftre. L’état final tranferit fur
un regiftre pour être communiqué au contrôleur-général.
Enfuite on remet le compte au garde des livres, qui en
•charge le relieur de la chambre. Ibid. b. Comment les comp-
-tables font procéder à l’apurement de leurs comptes ; & en
-font enfuite fignifier les états finaux au contrôleur-général
-des reftes, pour en obtenir, le certificat qu’il ne refte plus
de charges nj débets fur fes comptes. Ce que doivent faire
encore les comptables, pour être entièrement tranquilles.
Comptablest; de la chambre des comptes', quels ils font. Ibid.
794- ¿.Création de différentes charges comptables par François
L Offices comptables alternatifs créés par Henri II. Offices
triennaux créés par Henri I V , les quatriennaux paf
Louis XIV. Quels ne peuvent exercer un office comptable
Nul ne peut s’immifeer en office comptable fans lettres ch»
provifions eu de commiffions du roi. Caution du comptabl
Devoirs auxquels font fournis les comptables. Ibid. b. A au6*
s’expoferoit un comptable qui prévariqueroit dans fes fon0*
tions. Pourfuites faites contre les comptables en retard • &•
lorfqu’il s’agit d’apurement des comptes. Privileges que le r
a fur les biens du comptable. La chambre -des comptes met
le fcellé chez tous les comptables, décédés, abfens, ou en
faillite. Les comptables, ni leurs enfans ne peuvent être reçus
dans aucun office de la chambre. Ibid. 793. a, Principales
ordonnances qui les concernent. Ibid. b.
Chambre des comptes , fix divifibns de cette chambre, Jft;
47. a. Chambre de la commiffion qui en dépendoit autrefois.
Ibid. 50. a. Chambre du confeil lez la chambre des comptes!'
Ibid. Chambre des terriers à la chambre des comptes. 37. a.
Chambre du tréfor. Ibid. b. Charges des comptes : officiers
de la chambre des comptes ,qui doivent faire pourfuite de
ces charges. 198. a. Cour des comptes. IV. 372. <*. Quel
eft le plus ancien des regiftres de la chambre des comptes.
V. 703. b. Ce qui fe pratiquoit dans cette chambre, quand
on refofoit d’enregiftrer des lettres. 702. h. Droit - de • fuite
dont la chambre des comptes jouit. XV. 630. a.
. Compte, bordereau de compte. II. 334. b. Ligne de compte.
IX. 526. ¿.Efpece de compte appellé cote mal-taillée. IV. 300.
b. Débats de compte. 649. a. Emploi dans un compte. V. 392.
а. Livres de comptes des anciens. >IX.di 1. b. Livres de comptes
courans. 6x2. a. 616. a. Monnoics de compte. X. 632. a
б.34. b.Scc.
COMPTERAS, voyei O d o m f . t r e & P é d o m e t r i . m »
793. b.
COMPTER, ( Art de ) opération de l’efprit. Pourquoi la
plupart favent compter fans entendre le moins du monde
cette méchanique, &c. Définition métaphyfique de l’opéra-
'tion de compter. Celui qui fait ajout» un à un, & avancer
de cette maniéré dans fon calcul, & qui d’autre part
ôtant une unité de chaque collection, peut, les diminuer autant
qu’il veut, eft capable d’acquérir toutes les idées des
nombres, dont les ‘noms font en ufage dans fa langue. Rri-
* fon pourquoi certains peuples ne peuvent compter au-delà
de 20, de 100, de 1000. Les Toupmambes, au rapport de
Jean de Lèry, ne pouvoient compter au-delà de cinq. III.
795. a. Pour aller aux progreffions les plus étendues du
calcul, les langues ont befoin de dénominations & de fignes
propres, que nous appelions chiffres, pour exprimer ces progreffions.
Comment cela s’exécute dans notre langue. Pour4
quoi les enfans commencent tard à compter. Pourquoi cer-,
taines perfonnes font incapables durant toute leur vie de
compter, ou de fuivre régulièrement une affez petite fuite
de nombres. Ce que l’opération de compter exige de la part
de l’efprit qui l’exerce. Nous ne difeemons differentes collections,
que parce que nous avons des chiffres qui font
eux-mêmes fort diftinâs. Ibid. 796. a. Néceffité des fignes
pour avoir des idées des nombres claires & déterminées.
L’opération de compter eft la mefure de tout ce qui exifte.
Nos notions ne font exaCtcs qu’autant que nous avons inventé
avec ordre les fignes qui doivent les fixer. Les matériaux
font les mêmes chez tous les hommes, mais l’adreffe.
à s’en fervir les diftingue. Ibid. b. Voyc^ A r i t h m é t i q u e ,
C a l c u l e r . :
C o m p t e r , (Comnu)il fe dit i°. despriemens en efpeces,
20. relativement aux arrêtés de paiement que font entr eux
les négocians. Les marchands doivent compter tous les ans
au moins avec leurs débiteurs. III. 796. b.
Compter par bref état, compter en forme, compter de clere
à maître , compter une chofe à quelqu'un, compter par pièces
III. 796. b. , .
COMPTEUR, comptable, receveur, officier de 1 échiquier
en Angleterre. Ses fondions. 1III. 796. ¿^ Celles des autres
officiers des comptes qui reçoivent fes billets. Nombre des
compteurs & de leurs clercs. Ibid. 797-f- ,
Compteurs,dix officiers de police à Paris, déchargeurs de
poiffons de mer , &c. Leurs fondions. Compteur de frime
fur la riviere. IIÎ. 797. a. .
COMPULSEUR. ( Hifi.anc.) nom d’office fous les empereurs
romains. Ils forent caffés par Honorius. Compulfeurs
de l’armée chez les Goths. £ompulfeurs dans les monafteres.
C(?Mi ULSOIRL , ( Jurifp. ) mandement eo ym u duquel
le dépofitrire d’une piece eft tenu de la repréfenter. III- 797-
a. Ce que dit une loi du code Théodofien fur les compu -
foires. H en eft auffi parié dans une ordonnance e ar*
les VII en 1446. Autres ordonnances des tems .
parlent. A l’égard des coutumes, on ne
Bourbonnais qui en parle. L’ordonnance du mg
'^nnement pour aj^rifer une i ^ aujourd’hui.
gpSg l partie eft offignee. Un ayueat qu. gggjg
C O M C O N 369
■ . » 1» lie de fon confrère, ne fait point compulfer
WliiiiCation le >a ^ la partie peut faire
les pièces f„ £LCe entre les mains du clerc de l’avocat adm
m m m ■i i S Pièces q t«ii dto*iv*e nt être cUo"m muniquées ffan sla qifuf? i.lï
S E de lettres compulfoires. Pour quelles fortes dMes
i ïL font nécelfaires. Comment on procédé .lorfque le dé-
notoire ne veut pas obéir aux lettres. Les affignat.onspeu-
vëm étre données aux perfodnes ou domiciles des procureurs.
Tems oïl peut être commencé le procès-verbal de
g a i & «>ümon de pieces. A quoi eft condamnée
‘ Séfiiut la partie qui a requis le compulfoire. Ibid. 798. u.
Ôuvraaes à confultet'. Ibid. b. |
Compulfoire, difpofitibns de 1‘ordÖnnance de 1667, oug|
eft traité de compulfoires & de collations de pieces. III. 624.
h Lettres de compulfoire. IX. 411. a.
COMPURGATEUR, ( Jurifp. ) ancien ufage de fe purger
Dar ferment, lorfque la notoriété du fait dont on etoit accufé
ne préfentoit pas la preuve la plus claire. Appareil “npeff“" 1
qui fut enfuite ajouté à cet aéle pour le rendre plus .respectable
Efpece de témoins appellés compurgauurs i qui furent
exigés dans la fuite pour donner plus de poids au ferment
de l’accufé, en jurant eux-mêmes. Leur nombre vartoit félon
l’importance de l’objet qui étoit en linge. Cette nouvelle
formalité n’offrit encore qu’une reffource plus apparente que
réelle contre le menfonge & le paqure. W U - » !-**
COMTAL ? Juge comtal. IX. 12. a. Taille comtale. XV.
4COMTE. ( Hifi. anc. ) Origine des comtes fuivant ceux
qui en font remonter le titre jufqu’à Augufte, & fuivant
d’autres, qui ne remontent qu’au tems d Adrien. Quels étoient
ceux qu’ort appelloit comités au tems de la repubhque. Con-
ftantin fit trois claffes de comtes; les ffiuftres, les confidérés ,
les très-parfaits. Ce titre devenu commun & peu honorable.
Expofition des titres & des fonSions des principaux officiers qui
vnt porté ce nom, félon l'acception antérieure à celle qutl a aujourd'hui
en Europe. . . . „ ac.-
Cornes Ægypti. Cornes ararii ou largttionum. Lomts AJrtctz.
Cornes alanus. III. 798. b. Cornes annona. Cornes archiatrorum
facri palatii. Cornes Argentoratenfes. Cornes aun. tomes Bntan-
nia. Cornes buccinnatorum. Cornes Cafirenfis. Cornes cataphraaa- .
rius. Cornes civitatis. Cornes clibanarius. Cornes commerciorum.
Cornes facri confifiorïi. Cornes contariorum. Cornes difpofittonum.
Cornes domefiieorum. Cornes domorum. Cornes equorum regiorum.
Cornes excubitorum. Cornes exercitûs. Cornes faderatorum. Cornes
formarum. Cornes' Gildoniaci. Cornes horreorum. Cornes Italia.
Cornes italicianus ou gallicanus. Cornes largitionum comitaten-
fium. Cornes largitionum privatarum. Ibid. 799. a. Cornes largitionum
facrarum. Cornes legum. Cornes limitis. Cornes maritimte.
Cornes matronce. Cornes metallorum per Illyricum. Cornes nota-
riorum. Cornes numeri cohortis. Cornes obfequii. Cornes officiomm.
Cornes orientis. Cornes pagi. Cornes portuum. Cornes palatinus,
vel à latere. Cornes patrïmonïi facri. Cornes prtefens. Cornes pro-
vincitx. Cornes rei militaris. Cornes rei privata. Cornes remune-
rationum facrarum. Cornes riparum & alyei. Cornes fagittanus.
Cornes fcholtt. Cornes vacans. Cornes veftiarii. _ • ’
Tous ces comtes jettent beaucoup d’obfcurité dans les
auteurs du droit romain. Autres perfonnes honorées du même
titre. Dans le Bas-Empire, le premier comte s’appella pro-
to corne s. Ibid. b. ___
C o m t e , Cornes facrarum largitionum. Cornes rei privata. V t l .
¿00. b. ’ ‘ ' i
C o m t e , {Hifi. mod.)cette qualité différé beaucoup de ce
Ïu’elle étoit anciennement. Comte, poffeffeur d’un comté.
>iftinétion qu’il prend dans fes armes. Ce titre eft au-deffus
de vicomte, & au-deffous de marquis. Des premiers comtes
fous les empereurs. Comment ce titre s’étendit. Ce qui dif-
tinguoit alors les comtes des ducs. Ce qu’étoient les comtes
fous Charlemagne.Tems où ces feigneurs rendirent en France
leur dignité héréditaire, & en ulùrperent la fouverrinetè.
D’où leur eft venu le privilège de porter une couronne
«ans leurs armes. Peu-à-peu les comtés font revends à la
couronne. Claufe de réverfion à la couronne, mife dans les
lettres-patentes d’éreétion. Conteftatidn pour la préféahee
entre les marquis & les comtes. III. 800.0. Origine du nom de
comité donné à ceux qui commandent les forçats, & de celui
de vicomte. Titre de comte que s’attribuent nos ambaffadeurs
& plénipotentiaires. Des comtes en Angleterre : cérémonie
de leur création : couronne qu’ils prennent dans leurs armes.
Ibid. b.
Comte. Origine des comtes fous les empereurs^ XIL 908.
b. Police qu’ils exercerent en France depuis Hugues Càpèt.
9°9- b. Les comtes, magiftrats des provinces en France étoient
révocables. IV. 898.«. Tems où les comtes ou gouverneurs
ries villes s’érigèrent en feigneurs propriétaires. VI. 692. a.
695. f . Confeillers des comtes ou gouverneurs. IV. 44. a.
"Notaires des comtes. XL 242. b. Vicaires des comtes.'XVII.
232ia. 238. b. 239. a. Comte du palais. XI. 774. a.Suppl.IV.
53°* ^662. b. Anciens comtes ae Paris. XI, 960.-4. Palais
Tome I,
qu’ils habitoient. 947. a. Comtes immédiats de l’Empire. IV;
©9. bi Pourquoi l’on ceint du glaive celui qu’on crée comte
en Angleterre. VII. 700. b. Calque de comte * voye\ planch;
14 du Blafon, vol. II. Couronne de comte; Ibid. pl. 19, &
Suppl. IL 642« a:
G Om T È -M a réG H A L i ( Hifi. ttiodi ) officiers de là couronne
en A n g le te r re .1 Chevalief-maréchal. Famille en poffeffionde
la dignité de comte-maréchal. III. 800. b.
C o m t e s de Lyon , de Brioude, de Saint-Pierre; de Mâ-
eon, &c. Chanoines dédorés de ce titre. III. 800. b.
COMTES de Lyon, ( l’Ordre des) fon inftitutiom Marques
de l’ordre. Suppl. II. 636. ai
C o m t e s Palatins, ( Jurifp. & Hifii) dignité dont 1 empereur -
décore quelquefois des gens de lettres. -Quels pouvoirs leur
donne cette dignité« Elle eft peu eftimée. Les papes la confèrent
auffi. Comte palatin condamné à Touloufe en 1472*
pour avoir abufé de fon pouvoir. III. 801. a.
Comtes palatins, princes qui prennent aujourd’hui ce titrei
XL 7761 a. Droits des comtes palatins. IX. 364. b. Leurs notaires.
XI. 242. b.
. C o m t e , (Louis le) î culpteur. XIV. 830. a.
COMTE, ( Hifi. ) L’Empire divifé en deux comtés par
Conftantin. III. 801. a.
C o m t é , (Hifi. mod.') domaine d’un comte. Divifion de
l’Angleterre en cinquante-deux comtés : leurs fubdivifions.
Fondions des officiers nommés tous les ans pour la manutentions
des loix de çes comtés. Quatre comtés en Angleterre
nommés comtés palatins. III. 801. a. Pouvoirs qu’exer-
çoient autrefois leurs gouverneurs. Le mot comté eft quelquefois
féminin. Ibid. b.
Comté i divifion des Gaules en duchés & comtés par les
Francs. V. 133. b. Edit pour la réunion des duchés, marqui-
fats i ou comtés à la couronne, à défaut d’hoirS mâles. 1 qfi.ai
C o m t é s -P a i Ri ES , (Jurifp.) femblables aux duchés-pairies.
Le privilège attaché à ces grands fiefs, eft de rélever immédiatement
de la couronne. Changemens arrivés dans un grand
nombre de comtés-priries. Il y en a trois eccléfiaftiques. Justices
de ces grands fiefs. III. 801. b:
Comtés-p air tes. V. 13 3. b. Obfervâtions fur les juitices des
duchés-pairies & comtés-priries des évêchés de Beauvais,
Clûlons & Noyon. XVII. 803. b. 806. a.
Comté, en Angleterre, voyeç S h i r e . Cour de comté. IV.
373. b. Lords des comtés. IX. 691. b.
COMUS, ( Myth. ) dieu des feftins. Comment on le repré-:
fentoit. Etymologie au mot comédie. III. 801. b.
■ CONANl-FRANC, (Bot.) nom caraïbe d’un arbriffeau.'
Sa defeription. Lieux où il croît. Ses qualités & ufages. Sa
clafiïfication. Suppl. II. 336. ai . ,
CONARDS, ou C o r n a r d s , ancienne fociété qui fub-
fiftoit dans les villes d’Evreux & de Rouen. L’objet de cette
compagnie étoit ridicule. Pourquoi elle fut abolie. Du chef
-de cette fociété. III: 801. b. Les conards avoient droit de
jurifdiâion pendantleur divertiffement.Ce qu’en dit Taillepied:
Pompe ridicule de cette compagnie. Confrairie établie en fa
place par l’évêque d’Evreux. Ibid. 802. a.
CONARION, ou C o n o ïd e , ( AnatomA c’eft la glande
pinéale. Pourquoi Defcartes en avbit frit le fiege de l’ame.
III. 802; a.
Çonarion, glande pirtéale des modernes. Sa fituation & fa
defeription. Observation qui démontre qu’elle ne peut être
le fiege du principe vital. Ses maladies. Suppl. II. 336. b.
CONCASSER, (Pharm. ) opération prèparative. Quel en
eft le but. III. 802. a.
CONCAVE, différentes fortes de verres concaves. Leur
propriété, celle des verres convexes.Pourquoi les objets vus
au travers des concaves paroiffent plus petits. Propriété des
miroirs concaves. III. 802. b.
Concave : des miroirs concaves. 1. 623. b. &c. X. 568. a,
b. &c. Verre plan concave. XIL 607. a.
CONCENTRATION, ( Ckymie ) opération qui tend à rapprocher
les parties d’un corps diffous dans une quantité de
liqueur'plus que fuffifahte pour fa diffolution. Divers exemples
de concentrations. III. 802. b.
Concentration, voyrç D é p h l e g m e r . Concentration chymi-
qne. XI. 300. a. Concentration des vins par la gelée. XVII,
293 b. Celle des vinaigres par le même moyen. 302. a.
CONCENTRIQUES, cercles. II. 833'. a.
CONCEPTION, ( Ivgiq. ) pourquoi il arrive que l’efprit
ne conçoit pas, ou conçoit maL Condition effentielle pour
bien concevoir. Facilité à concevoir les objets qui nous font
familiers. Progreffion de la conception par la liaifon des
idées qui quadrent avec notre intérêt prefént. D’bù dépend
l’étendue de la conception. Un certain degré de pèrfedion
dans la conception fournit fouvent le fond & la forme des
raifonnemens, fans le fecours de la raifon. Combien il importe
de fe rendre la conception familière, & de l’étendre;
III. 803. a.
C o n c e p t i o n , (Phyftol.) en quoi elle confifte. VIL 573. éi
Defeription de ce qui le paffe au moment de la conception*