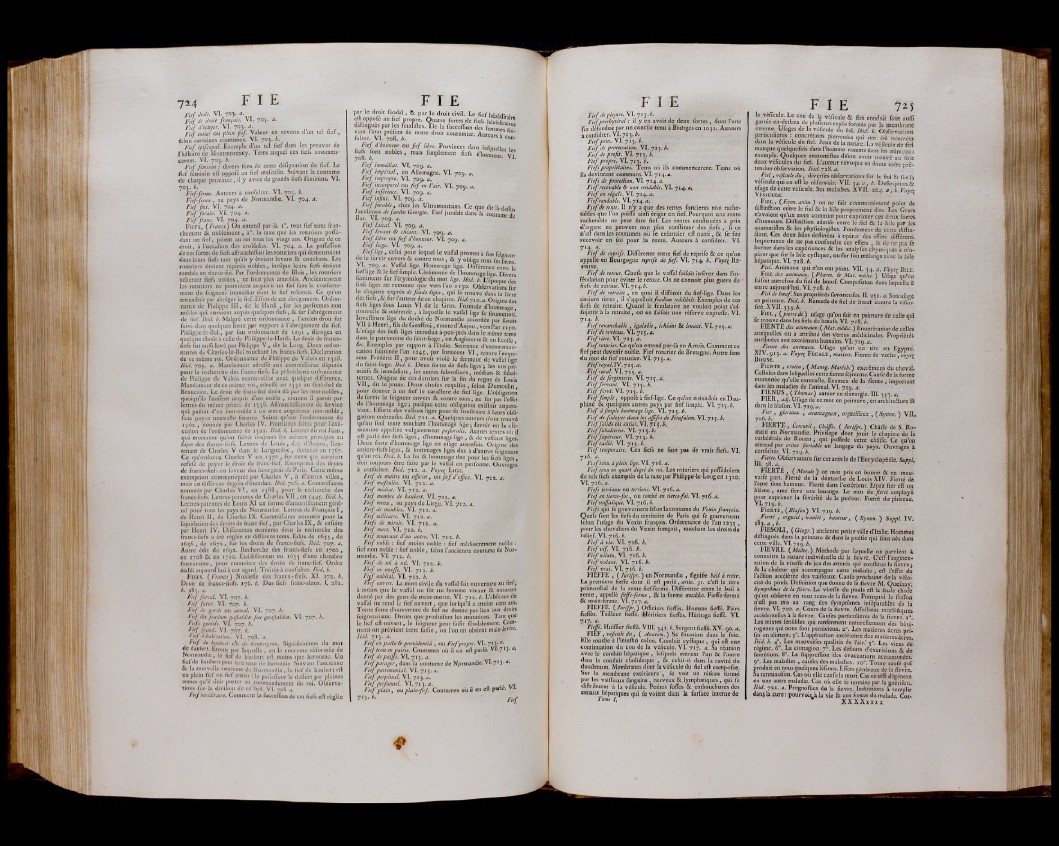
7*4 F I E F I E
F u t droU. VI. 703. «.
F ie f de droit français. V I . 703. a.
F ie f d'éçuyer. VI. 703. a.
F ie f entier ou plein fief. Valeur en revenu dun tel fief ,
Selon certaines coutumes. V I. 703. é.
F ie f ¿pifcopal. Exemple d’un tel fief dans les preuves de
l'hiftoirc de Montmorency. Tems auquel ces fiefs commencèrent.
VI. 703. b.
F ie f féminin : divers fens de cette défignation de fief. Le
f ie f féminin cft oppofé au fief mafeulin. Suivant la coutume
de chaque province, il y avoir de grands fiefs féminins. V I.
703. b.
Fief-ferme. Auteurs à confultcr. VI. 703. b.
Fief-ferme, au pays de Normandie. VI. 704. a.
F ie f fini. VI. 704. a.
F i e f forain. VI. 7° 4- 4*
F ie f franc. VI. 704. a.
F ie f s , ( Francs) On entend par-là 1". tout f ie f tenu franchement
& noblement, a", la taxe que les roturiers poffé-
dant un fief, paient au roi tous les vingt ans. Origine de ce
droit, à l’occafion des croifades. VI. 704. a. La poffcffion
de ces fortes de fiefs affranchiffoit les roturiers qui demeuroient
dans leurs fiefs tant qu'ils y étoient levans & couchans. Les
roturiers étoient réputés nobles, lorfquc leurs fiefs étoient
tombés en tierce-foi. Par l’ordonnance de Biois, les roturiers
achetant fiefs nobles, ne font plus annobüs. Anciennement
las roturiers ne pouvoicat acquérir un fief fans le confcntc-
ment du feigneur immédiat dont le fief rclcvoit. Ce qu’on
entendoit par abréger le fief. Effets de cet abrégement. Ordonnance
de Philippe I I I , dit le Hardi , fur les perfonnes non
nobles qpi auraient acquis quelques fiefs, & fur l’abrègement
de fief. Ibid. b. Malgré cette ordonnance , l’ancien droit fut
fuivt dans quelques lieux ppr rapport à l’abrègement du fief.
PJiilippc-le-Bel, par fou ordonnance de 1291 , dérogea en
quelque chofc à celle de Philippc-lc-Hardi. Le droit de francs-
nefs fut aufli levé par Philippe V , dit le Long. Deux ordonnances
de Charles-lc-Bcl touchant les francs-ficfs. Déclaration
de ce même roi. Ordonnance de Philippe de Valois en 1328.
Ibid. 705. a. Mandement adreffé aux commiffaires députés
pour la recherche des francs-fiefs. La précédente ordonnance
de Philippe de Valois rcnouvelléc avec quelque différence.
Mandement de ce même roi, adreffé en 1331 au fénéchal de
Bcaucairc. Le droit de franc-fief étoit dû par les non-nobles,
quoiqu'ils l’eufTcnt acquis d'un noble , comme il parait par
lettres du même prince de 1338. Affranchiffemcnt de fcrvicc
qui paffoit d’un non-noble à un autre acquéreur non-noble,
fans payer nouvelle finance. Suites qu’eut l’ordonnance de
130a , donnée par Charles IV. Pouriuitcs faites pour l’exécution
de l’ordonnance de 1322. Ibid. b. Lettres du rai Jean,
qui montrent qu’on fuivit toujours les mêmes principes au
lu jet des francs-fiefs. Lettres de Lou is, duc d’Anjou, lieutenant
de Charles V dans le Languedoc, données en 1367.
C e qu'ordonna Charles V en. 13 70 , fur ceux qui auraient
refuié de payer le droit de franc-fief. Exemption des droits
d e francs-fiefs en faveur des bourgeois de Paris. Cette même
exemption communiquée par Charles V , ¡1 d’autres villes,
mais en différens degrés d'étendue. Ibid. 706. a. Commiffaires
nommés par Charles V I , en 1388, pour la recherche des
francs-fiefs. Lcttrcs-patcntcs de Charles V I I , en 1445. Ibid. b.
Lcttrcs-patcntcs de Louis XI en forme d’amortiffement général
pour tous les pays de Normandie. Lettres de François I ,
de Henri I I , de Charles IX. Commiffaires nommés pour la
liquidation des droits de franc-fief, par Charles IX , & enfuite
par Henri IV. Différentes manières dont la recherche des
francs-fiefs a été réglée en différens terns. Edits de 1635, de
1656 , de 16 72 , fur les droits de francs-fiefs. Ibid. 707. a.
Autre édit de 1692. Recherche des francs-fiefs en 1700,
en 1708 8c en 1710. Etabliffement en 1633 d’une chambre
fouvcrainc, pour connoitre des droits de franc-fief. Ordre
établi aujourd'hui à cet égard. Traités à confultcr. Ibid, b.
Fiep s . ( Francs ) Noblcffc des francs - fiefs. XI. 172. b.
Droit de francs-fiefs. 1 76 . b, Des fiefs franc-alcux. 1, 282.
b. 283. a.
F ie f furent. VI. 707. b.
F i e f futur. V I. 707. b.
F ie f de garde ou annal. V I. 707. b.
F ie f dit Jeudum gajlaldia feu guafaldict. VI. 707. b.
Fiefs gentils. VI. 707. b.
F ie f grand. VI, 707. b.
l ' i f d'habitation. VI. 708. a.
F ie f de haubert o\i de haubergeon. Significations du mot
de haubert. Erreur par laquelle, en la coutume réformée de
Normandie, le fier de haubert cft moins que baronnie. Un
fiel de haubert peut être tenu de baronnie Suivant l’ancienne
8c la nouvelle coutume de Normandie, le fief de haubert cft
un plein f ie f OU fief entier : j | pofieffeur le deiferr par pleines
armes qu’il doit porter au commandement du roi. Obferva-
tions fu r la diviiion de ce fief, VI, 708 a.
F ie f héréditaire. Comment la fucccffiondc ces fiefs cft réglée
par le droit féodal, 8c par le droit civil. Le fief hérédinî
cft oppofé au fief propre. Quatre fortes de fiefs hé réd i?
diftingués par les feudiftes. D e la fucccftion des fcmmelT*
notrc * * couwn,icr-
F i e f d'honneur ou f i , f libre. Provinces dans IcfcmclW !..
08 i ’ l*mplcnlcm fiefs d’honneur. VI
F i e f immédiat. V I . 709. a.
F i e f impérial, en Allemagne. V I. 709. a.
F i e f impropre. V I. 700. a.
F i e f incorporel ou f i e f m l ’air. VI. 709. a.
F i e f inférieur. VI. 709. a.
F i e f infini. V I. 709. a.
F i e f jumble, clic/, les Ultramontains. Ce que dit li-dom.
Jacobums d iifm a o Gtorpo. Fief jurable dans la coutume d,
liar. VI, 709. a.
F i e f laical. V I. 709. a.
F i e f levant 6* chéant: VI. 709. a.
F i e f libre ou fie f Honneur. V l, 709. a.
F i e f liege. VI. 709. a.
F i e f lig e. celui pour lequel le valfal promet à fon feicncnr
de le fervir envers & contre tous , & y oblige tous fesSiens.
fi.fi-7 'H P fi î ï “1 '««• Hommage Itra. Différence entre le
Uct lige 8e le fief fimple. Cérémonie de l’hommage lige Divers
fenumens fur l’étymologlc du mot lige. Ibid. b. L’Aoque des
fiefs liges ne remonte que vers l’an 11301 Obfcrvations fur
le chapitre exprès de feudo lig io , qui fe trouve dans le livre
des fiefs, & fur l’auteur de ce chapitre. Ibid. 710. a. Origine des
fiefs liges fous Louis V I dit le Gros. Formule d’hommage
Oc. Exemples par rapport à fltalic. Sentence d’excommunication
fulminée l’an 1243, Par Innocent V I , contre ¡’empereur
Frédéric I I , pour avoir violé le ferment de vaffal lige
du faint-fiege. Ibid. b. Deux fortes de fiefs liges ; les uns primitifs
8c immédiats, les autres fubordinés, médiats & fubal-
ternes. Origine de ces derniers fur la fin du regne de Louis
V I I , dit le jeune. Deux chofcs requifes, félon Dumoulin,
pour donner à un fief le caraftcrc de fief lige. L’obligation
de fervir le feigneur envers 8c contre tous, ne fut pas l’effet
de l’hommage lig e} puifque cette obligation exiftoit auparavant.
Efforts des vaflàux liges pour fe fouftrairc à leurs obligations
onéreufes. Ibid. 7 11. a. Quelques auteurs n’ont trouvé
qu un fcul texte touchant l’hommage lige j favoir en la clémentine
appclléc vulgairement pàfioralis. Autres textes où il
cft parlé des fiefs liges, d’hommage lige , 8c de vaffaux liges.
Deux forte d hommage lige en ufage autrefois. Origine des
arricre-ficfs liges, 8c hommages liges dus h d’autres leigncurs
qu’au roi. Ibid, b. La foi 6c hommage due pour les fiefs liges,
doit toujours être faite par le vaftal en perfonne. Ouvrages
à confultcr. Ibid. 7 12 . a. Voyt[ L ig e .
F i e f de maître ou officier, ou f i e f d ’office. VI. <712 a.
• F i e f mafeulin. VI. 712. a.
F i e f médiat. VI. 712. a.
I 'i c f membre de haubert. VI. 7x2. a.
-F ie f menu, au pays de Liege. VI. 7x2. a.
F i e f de meubles. V l. 712. a.
F i e f militaire. VI. 7x2. a.
Fiefs de miroir. VI. 712. a.
F i e f mort. VI. 7x2. b.
F i e f mouvant d u n autre, VI. 712. b.
F i e f noble : fief moins noble : fief médiocrement noble :
fief non noble : fief noble, félon l’ancienne coutume de Normandie.
VI. 712. b.
F i e f de nà à nû. VI. 7x2. b.
F i e f en nuejfe. VI. 7 x2. b.
F i f f oubliai. VI. 712. b.
F i e f ouvert. La mort civile du vaftal fait ouverture au fief,'
à moins que le vaftal ne fût un homme vivant & mourant
donné par des gens de main-morte. VI. 712. b. L’abfcnce du
vaffal ne rend le fief ouvert, que lorfqu’il a atteint cent ans.
Toute forte d'ouverture de fier ne donne pas lieu aux droits
feigncuriaiix. Droits que produisent les mutations. Tant que
le fief cft ouvert, le feigneur peut faifir féodalcmcnt. Comment
on prévient cette wifie, ou l’on en obtient main-levée.
Ibid. 713. a.
F i e f ex paflo 0 provident id , ou Fiefpropre. VI. 7*1' a‘
F ie f tenu en pairie. Coutumes où il en cft parlé. VL 7* 3, w*
F i f f depaijfe. VI. 7x3. a,
Fiefparagert dans la coutume de Nprmandie. Y l.7‘ 3,tf*
F i e f patrimonial, V I. 7x3.0.
F i e f perpétuel. VI. 713.0.
F i e f perfonnel. VI. 713. 0. u VI
F i e f p lain, ou plain-fief. Coutumes où »1 en cft parle, vx.
7'3 ' f üf
&
F I E
'Fief de pltjure. V I. 7 x 3. é. > I
Fiefpresbytéral : il y en avoit de deux fortes, dont l’une
fut défendue par un concile tenu à Bourges en 1031. Auteurs
à confultcr. V I. 713. b.,
F i e f pria. VI. 713. b.
F i e f de procuration. VI. 713. b.
F i e f de profit. VI. 713. b.
F i e f propre. V l. 7 1 3 . b.
Fiefs propriétaires. Tems où ils commencèrent. Tems où
ils devinrent communs. V I, 714.0.
Fiefs de proteilion. VI. 714. o.
F i e f rccevdblc O non rendable. VI. 714. a,
F i e f en régalé. VI. 7x4. a.
F i e f retidable. VL 7x4. o.
F i e f de rente. Il n ÿ a que des rentes foncières non racho-
tablcs qtic l’on puific ainfi ériger en fief. Pourquoi une rente
rachctablc ne peut être fiefT Les rentes conftituécs à prix
«l’argent ne peuvent non plus conftituer des fiefs , fi ce
ji’cft dans les coutumes où le créancier cft nanti, & fc fait
recevoir en foi pour la fente. Auteurs à confultcr. VI.
7 *4-, *-
F i e f de reprife. Différence entre fief de reprife 8c ce qu’on
appelle-en Bourgogne reprife de fief. V I. 714. b. Voyeç Rep
r is e .
F i e f de retout Claufc que le vaffal faifoit inférer dans l’in-
féodation pour éviter le retour. On ne connoît plus guère de
fiefs de retour. V I. 714.b.
F i e f de retraite , en quoi il difféfoit du fief-lige. Dans les
anciens titres, il s’appclloit feudum reddibile. Exemples de ces
fiefs de retraite. Quand le feudataire ne vouloit point s’af-
fujettir à la retraite, oti en faifoit une réferve expreffe. VI.
7 *4' ,
F i e f rtvanchable , égalable, échéant & levant. V I. 7i3.iT.
F i e f de revtnue. VI. 713. a.
F i e f riere. V I. 713. a.
F i e f roturier. C e qu’on entend par-là en Artois. Commentée
fief peut devenir noble. Fief roturier de Bretagne. Autre fens
«lu mot de fief roturier; V I. 713. a,
Fiefroyal. IV. 713. a.
F i e f rural. VI. 713. a.
l ' i é f de fergenterie. VI. 7x3. d,
F i e f firvant. VI. 7x3. b.
, F i e f fervi. VI. 7x3. b.
F i e f fimple j oppofé à fîcf-ligc. Ce qu’ori enteridoit en Dau-
phiné 8c quelques autres pays par fief fimple. VI. 713. b.
F i e f à fimple horttmage lige. V l. 7x3 .b .
F i e f de fodoyer dans les affifes de Jérufalem. V I. 713. b.
F ie ffo lid e ou entier. V f. 713. b,
F i e f fubalterne. VI. 713. é;
F i e f fupérieur. VI. 7x3. b.
F i e f taillé. VI. 713. b.
F i e f temporaire. Ces fiefs no font pas de vrais fiefs. VI.
716. a.
F i e f te/lu à plein lige. VI. 716. a.
F i e f tenu en quart degré du roi. Les roturiers qui poffédoient
de tels fiefs ckcmptés de la taxe par Philippe-le-Long en 1320.
V I. 716. a.
Fiefs terriaux ou tttrieris. VI. 716. a.
F i e f en tierce-foi, ou totnbé en tierce-foi. V I. 7 16. d.
F i e f vaffalique. VI. 7 16 . b.
Fiefs qui fe gouvernent felon la coutume du Vexin français.
Quels font les fiefs du territoife de Paris qui fc gouvernent
félon l’ufage du Vexin françois. Ordonnance de l’an 1233 ,
pour les chevaliers du Vexin françois, touchant les dfoitsda
relief. VI. 716. b.
F i e f à vie. V l. 7 16. b.
F i e f v if. VI. 716. b.
■ F i e f vilain. VI. 716. b.
F i e f volant. VI. 7x6. b.
F i e f vrai. VI. 716. b.
FIEFFE , ( ju rifpr. ) en Normandie , fignifie bail i rente.
La premiere neffe dont il eft parlé, artie. 31. c’eft le titre
primordial de la rente fief ferme. Différence entre le bail à
ten te , appelle fiéffe-ferme, & la formé muablc. Ficffe-fermé
6c main-terme. VI. 7 1 7 . a.
FÏEFFÉ. ( Jurifpr. ) Officiels fieffés. Nomme fieffé. Pairs
fieffés. Tailleur fieffé, héritiers fieffés. Héritage fieffé. VI.
7-* 7* &
Fieffé. Huifticr fieffé. VIII. 341. b. Sergent fieffé. X V . 90. a.
F IE F , veficule fiu , ( Anatom. ) Sa fituation dans le foie.
Elle touche à l’inteftiii colon. Conduit cyftiquc , qui eft une
continuation du cou de la véftcule. VI. 717. a. Sa réunion
avec le Conduit hépatiqUc , lcfquels entrent l’un 8c l’autre
dans le conduit cholidoquc , oc celui-ci dans la cavité du
duodenum. Membranes dont la véftcule du fiel eft compofée.
Sur la membrane .extérieure , fé voit tin réfeau formé
par les vaiffeaux fanguins , nerveux 8c.lymphatiques, qui fe
distribuent à la véftcule. Petites foffes 8c embouchures des
canaux hépatiques qui fe voient dans la furfacc interne de
Tome /,
TTr I 11 , r . ' '-F1'» wrmes par la memorane
interne. Ufagcs de la yéficulc du fiel, Ib id lb . Obfcrvations
particulières : concrétions picrrçnfes qui ont été trouvées
dans la véficule du frcl. Jeux de la nature. La véftcide du fid
manque quelquefois dans l’homme comme dans les anim; ux •
exemple. Quelques anatomiftos difent avoir trouvé au foie
deux véficulcs du fiel. L ’auteur révoque en doute cette prétendue
dbfervati on. Ibid.7\%. a.
F i e l , véficule d u , diverfes obfcrvations fur le fi cl 8c fur la
véficule qui en cft le réfervoir. V IL 1 4 .a , b. Dcfcription 8c
ufage de cette véficule. Scs maladies. XVII. 204. a ; b. Voyez
V é s i c u l e . . J v
( F-Cf n‘ anim. ) on fie fait communément point de
diltinction entre le fiel 8c la bile proprement dite. Les Grecs
n.avoient qu’un nom commun pour exprimer ces deux fortes
d humeurs; Diftinélion admife entre le fiel 8c la bile par les
aiiatomiftes 8c les pliyfiologiftcs. Fondement de cette diftin-
Jtion. Ces deux biles deftinées à opérer des effets différens.
Importance de ne pas confondre Ces effets , 8c de ne pas fe
borner dans les expériences 8c les analyfes chymiquds à n’opérer
que fur la bile cyflique, ou fur fon mélange avec la bile
hépatique. VI. 7x8. b.
Fiel. Animaux qui n’en ontpôi/it. VII. 34. à. Vbyer B i l e .
F ie l des animaux. ( Pharm. & Mat. médic.) Ufaec qu'ori
faifoit autrefois du fiel de boeuf; Compofition dans laquelle il
entre aujourd’hui. VI. 718. b.
F iel de boeuf Ses propriétés favoneufes. II. z é x . a. Son ufagô
en {peinture. Ibid. b. Remede de fiel de boe u f contre la vifeo-
fité. XVII. 339. b.
F ie l , [ pierre de ) ufage qu’on fait en peinture de celle qui
le trouve dans les fiels de boeufs. V I. 718. é.
FIENTE des animaux. ( Mat. médic.) Enumération de celles
auxquelles on a attribué des vertus médicinales. Propriété^
attribuées aux cxcrémcns humains. VI. 719. a.
^ ¡ c m e des animaux. Ufage qu’on en tire en Egypte,
X IV . 9 13,4; V iy t { F é c a l e , matière. Fiente de vache, voyez
B o u s e . j v
Fi E.NTE , crotin, fMancg. Marée h:") éxerêmens du cheval.
Cellules dans Icfqucllcs cette fiente féjourne. Caufc de la forme
maronnéc qu’elle contrailc. Examen de la fiente, important;
dans les maladies de l’animal. VI. 7x9.4.
FIENUS, ( Thomas) auteur en chirurgie. III. 333.4.
FIER, adj. Ufage de ce mot en peinture : en architcÂurc &
dans le blafon. VI. 719.4,
Fier , glorieux , avantageuxI orgüeilleux , (S y n o n .) V I I ,
7x6. b. x '
FIERTE i Cercueil j Chdffe. ( Jurifpr. ) Châffc de S. Ro-
maul en Normandie. Privilège dont jouit le chapitre de là
cathédrale de Rouen y qui poffede cette chdffe. Ce qu’on
entend par crime fiertable en langage du pays. Ouvrages à
confultcr. VI. 719. é. .
j « Obfcrvations fur cet article de l’Encyclopédie. SetppL
FIERTÉ , ( Morale ) ce mot pris cri bonne 8c en riiau-
yaifc part. Fierté de la démarche de Louis XIV. Fierté dé
1 ame fans hauteur. Fierté dans l’extérieur. Efprit fier cft un
blamc, ame ficrc une louange. Le mot de fierté employé
pour exprimer la févérlté de la pudeur. Fierté du pincead,
VI. 719. b.
F ie r t é , ( Blafon) VI. 7x9. b.
.Fierté j orgueil i vanité i hauteur * ( Synon. ) Suppl. ÎV .
ï8 l. 4 , b.
frE S p k J . ( Glogr. ) ancienne petite v ille d’Italie. Horfirties
diftmgués dans la peinture 8c dans la poéfte qui font nés dans
cette ville. VI. 719. b.
FIEVRE. ( Mèdec. ), Méthode par laquelle oh parvient à
connoitre la nature individuelle de la fievrè. C ’cft P<üigttien-
tation de la vîteffe du jeu des ancres qui conftitue la nevre ;
8c la chaleur qui accompagne cette maladie, eft l’effet de
l’aétion accélérée des vaiffeaux. Çaufe prochaine de la vélocité
du pouls. Définition que donne de la fièvre M. Quefnay.
¿symptômes de la fievre. La vlteffe du pouls cft la feule chofe
qu’on obferye en tout tems de la fievre. Pourquoi le friffon
n’eft pas mis au rang des fymptôme's inféparables de la
fievre. VI. 720. a. Cours de la fievre. Affeftions morbifiques
accidentelles à la fievre: Caufes particulières de la fievre. x°.
Les mixtes fenfiblcs qui renferment naturellement des hé té*,
rogenes qui nous font pernicieux, a0. Les matières âcres prr-
fes en aliment. 30. L’application extéHoürc des maticrcs4 cres
Ibid. b. 40. Les mauvaifes qualités de l’air;* 30. Les vices de
régime. 6°. La Contagion. 7®. Les défauts d’excrétions 8c de
fccrétions. 8 . La fupprefiion des évacuations accoutumées.
9°. Les maladies, caufes des maladies. xo°. Toute caufe qui
produit en nous quelques léfions. Effets généraux de la fievre*
Sa tcrminaifon. Cas ou elle caufc la mort. Cas où cHh dégénéré
én une autre maladie. Cas où elle fc termine par la guerifon.
Ibid. 7 21. 4. Prognoftics de la fievre. Indications à remplir
dan$ la cure : pourvoir à la vie & aux forces du. malade.
X X X X x x x x