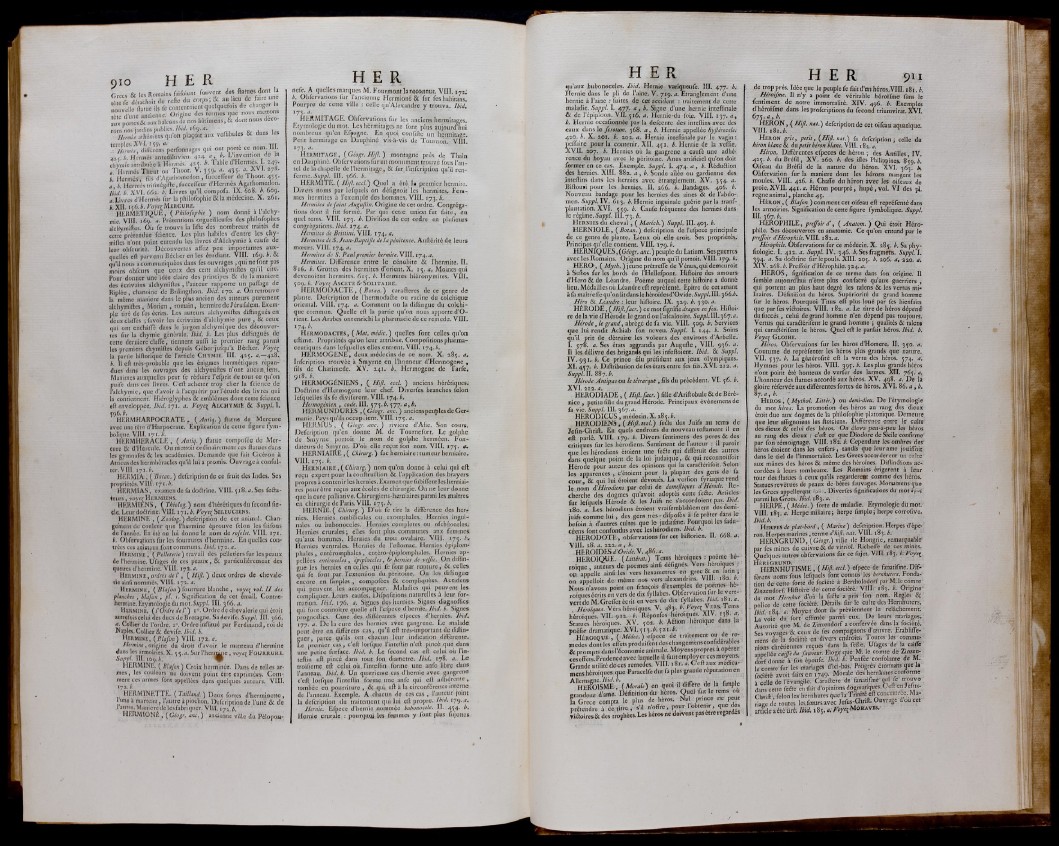
9io H E fi G re c, & 1« Roma'«» faifoicnt <ou« nt d® fta*1uc*«-^0"Ìine
t£tc re détacltoit illi refte du c o rp s & au lieu de faire un^
uniiVGIle ftatue ils fe comcntoient quelquefois de ebang.
Z dime anekm,e. Orione de» terme» nue non» menons
aux none» & aux Mlcons de no» b ltiinen», & dont nous dico-
fon» no» jardin» oublie». IM . 1 6 9 . t t . , ' - , ,
Hermès athéniens qu’on plaçdit aux vcftibulcs oc dans les
temple^ X'V’E 1 (0( <i' , . TiTT
. Hermès, différens perfonnages qui ont porté ce nom. III.
I. /JflfflH a Mll.wi «II. P » | V'M • ■ .
At<. 6. Hermès antédiluvien. 424* a > Ê$ L invention <1
la
chyniic attribuée ?i Ucrm ès. 6. Table d Hermes. I.
249.
a, Hennés T licu t ou Tboot. V . 359. a . 435. n. X V I . »78.
L Hermès, fil» d’Agaibomcdon , fucccfleur de Ihoot. 433.
a b. Hermès trifmégiftc, fucccfleur d’Hcrmes Agalhomcdon.
¡bit/ b. X V I . CO l. b. Livre» qu’il conipofa. IX. (Ï08. b. 609.
n. L'ivre» d'Hermès fur la philofophic & la médecine. X . 16 1.
b. XII. i(<> *. l o f t M e r cu r e.
H L RM L T IQ ü L , (P h ilo fo p h ic ) nom donné a lalchy-
mic. VIII. 169. n. Prétentions orgueillcufcs de» pliilofopltcs
iileliyiniïlès. Où fe trouve la lifte de» nombreux iraité» de
cctic prétendue fcience. Le» plu» habile» d’entre le» ehy-
jniilc» n’ont point entendu les livres d’A lch ymic îi caufc de
leur obfcurité. Découvertes affe/, peu irmjortantcs auxquelles
cft parvenu Bêcher en les étudiant. VIII. 16 g. b. 8c
qu'il nous a communiquées dans fes ou v ra g e s , qui ne (ont pas
moins obfcurs que ceux des cent alchymiftcs qu’il cite.
Pour donner une idée claire des principes 8c de la manière
des écrivains alchymiftcs, l’auteur rapporte un paftage de
R ip lé e, chanoine de Brilingthon. Ibid. 170. a. On retrouve
la même manière dans le plus ancien des auteurs purement
alchymiftcs, Morien , romain, hcrmiredc Jérufalcm.Exemple
tiré de (es écrits. Les auteurs alchymiftcs diftingués en
deux clàfi'cs ; lavoir les écrivains d’a lchymic p u re , 8c ceux
qui ont cnchâffé dans le jargon alchymique des découvertes
fur la chymic générale. Ibid. b. Les plus diftingués de
cette dcrnicre claftc, tiennent aufli le premier rang parmi
les premiers chymiftes depuis G éb c r ju lqu ’à Bêcher. V o y t [
la partie hiftorique de l’article C h ym ie . III. 425. 4 ,-4 2 8 ,
b. 11 cft tréj-probablc que les énigmes hermétiques répandues
K
dans les ouvrages des alchymiftcs n’ont aucun, iens.
Maximes auxquelles peut fe réduire l’cfprit de tout ce qu’on
puife dans ces livres. C ’eft acheter trop cher la fcience de
l’alcliymic, que d'avoir à l’acquérir par l'étude des livres qui
la contiennent. Hiéroglyphes 8c emblèmes dont cette fcience
eft enveloppée. Ibid. 17 1 . a. V oy tç A l c h ym ié 8c Suppl. 1.
596. b.
H E RM H A R PO C R A T E , { A n t h j . ) ftatue de Mercure
avec une tête d’Harpocrate. Explication de cette figure fym-
bolique. VIII. 17 1 .6 .
HKRMHERACLK , ( A n t iq . ) ftatue compoféc de Mercure
8c d’H erculc. O11 mettoit ordinairement ces ftatues dans
les gymnafes 8c les académies. Demande que fait Cicéron h
Atticusdcs hcrmhéraclcs qu’il lui a promis. Ou vrage it conful-
ter. VIII, 171. b.
HK RM IA, ( IJatan. ) defeription de ce fruit des Indes. Ses
propriétés. V IR . 171.6.
HERM1A S , examen de fa doélrine. VIII. 318. a. Ses feéla-
tcur*, voyez H ÈR Ml EN s.
H ERM ILN S, (.Théo log. ) nom d’hérétiques du fécond fie-
clc. Leur doélrine. V III. iy v .lt . Voycç Sei.eu cien s .
HERMINE , ( Zoolog. ) defeription de cet animal. Changement
de couleur que l'Iiarminc éprouve félon les faifons
de l’année. En été on lui donne le nom de rofelet. VIII. 171.
b. Obfervations fur les fourrures d’hermine. En quelles contrées
ces animaux font communs. Ibid. 17a. a.
Herm ine, ( Pelleterie) travail des pelletiers fur les peaux
de l'hermine. Ufages de ces p e au x, 8c particulièrement des
queues d'hermine. VIII. 172.4.
Herm ine, ordres d e l ’ , { h i ß . ) deux ordres de chevalerie
ainfi nommés. VIII. 172.4.
H ermine, ( B la fon ) fourrure blanche , v o m vol. I I des
planches, blafon , p l. /. Signification de cet email. Contre-
hermine. Etymologie du m ot.Su ppl. III. 266. a.
Hermine. ( l'Ordre d e l ') 1". Ordre de chevalerie qui étoit
autrefois celui des ducs de Bretagne. Sa devife. Suppl. III. 366.
a. Collier de l’ordre. 20. Ordre tnllitué par Ferdinand. roi de
Naples, Collier 8c devife. Ibid, b.
Hermine, ( B la fon ) VIII. 172. a.
Hermine, origine du droit d avoir le manteau d'hermine
dans les armoiries. X . 5 5 .4. Sur l’hermine, voyez F o u r r u r e .
Suppl. 111.109. b.
HERMINE. ( Blafon | Croix hcrminée. Dans de telles armes
, les couleurs ne doivent point être exprimées. C om ment
ces armes font appcllécs dans quelques auteurs. VIII.
*72. b.
HF.RMINETTE. ( Tailland. ) Deux fortes d’hcrinincttc,
uno h marteau. 1 autre à piochon. Defeription de l’une 8c de
1 autre. Manière de lesfabriquer. VIU. 17a. é .'
HF.RM10N É , ( Oéogr. une, ) ancienne ville du Pélopou-
HER
nefe. A quelles marques M. Fourmont la reconnut. V I I I . 172:
b. Obfervations fur l'ancienne Hcrmioué 8c fur fes habitans.
Pourpre de cette ville : celle qu’A lcxandrc y trouva. Ibid.
1 7 3 .4 . ,
H E RM IT A G E . Obfervations fur les anciens hermitages.
Etymologie du mot. Les hèrmitages ne font plus aujourd hui
nombreux qu’en Efaagnc. En quoi confifte un hcrmitage.
Petit hcrmitage en Dauphiné vis-â-vis de Tournori. V l î i .
173. 4 .
H e r m it a g e , {G éo gr . H i f l . ) montagne prés de Thain
en Dauphiné. Obfervations fur un monument trouvé fous l’autel
de la chapelle de l’hcrmitagc, 8c fur l'infcriimon qu'il renferme.
Suppl. III. 366. b.
HERMITE. ( IJ if l.c c c l.) Q u e l a é t é ,1« premier hcrmitc.
D ivers noms par lcfqucls on déftgnoit les hcrmitcs, Femmes
hermites à l’exemple des hommes. V I IL 173. b.
Hcrmitcs de fa in t Auguflin. Origine de cet ordre. Congrégations
dont il fut formé. Par qui cette union fut fa ite, en
quel tems. VIII. 173. b. Divition de cet ordre en pluficurs
congrégations. Ibid. 174. 4 .
Hermites de B rittini. V I I I . 174. 4 ,
Hermites de S . Jean-Baptifle de lapénitence. Auftérité de leurs
moeurs. V I I I . 174. a.
Hermites de S . P a u l premier h e rm i le .Y lll. 174.4.
Hermites. Différence entre le cénobite 8c l’hcrmitc. II.
816. b. Grottes des hermites d’orient. X. 13. a. Moines qui
devenoient hcrmitcs. 61 3. b. Hcrmitcs hiéronymites. V I I I .
509. b. Voyez A sce te &• So l it a ir e .
H E R M O D A C T E , ( Botan. ) cnraélercs de ce genre de
plante. Defeription de l’hcrmouafle ou racine du colchique
oriental. V U 1. 174. 4 . Comment on la diftingue du colchique
commun. Q u elle cft la partie qu’on nous apporte d 'O -
rient. Les Arabes ont enrichi la pharmacie de ce rcpicde. V I I I .
174. b.
H e rm o d a c t e s , ( Mat. médic. ) quelles font celles qu’on
cftime. Propriétés qu’on leur attribue. Compofitions pharmaceutiques
dans lcftuicllcs elles entrent. V IU . 174. b.
H E RM O G E N E , deux médecins de ce nom. X . 283. a .
Infeription trouvée à Smyrnc en l’jionncur d’H crinogene ,
fils de Charimede. X V . 241. h. Hcrmogenc de fa r fe*
9 18. b.
HERM0 G ÉN 1E N S , ( H ijl. eccL } anciens hérétiques:
Doélrine d’Hcrmogenc leur chef. Diverfes branches félon
lefquelles ils fe diviferent. V I I I . 174. b.
Hermogénien , code. III. 575. b. 5 7 7 .4 , b.
H ERM UN D U RES , ( Géogr. anc. ) anciens peuples de G ermanie.
Pays qu’ils occupaient. V III. 1 7 3 . 4 .
H E RM U S , ( Géogr. u n e . ) rivicre d’Afic. Son cours.
Defeription qu’en donne M. de Tournefort. Le golphc
de Smyrnc portoit le nom de golphe hcrmécn. Fondateurs
de Sjnyrnc. D ’où elle reçut Ion nom. VIII. 177. tf*
H E R N IA IR E ,( Chirurg.) fac herniaire : tumeur herniaire.
V I I I . 175. b.
H e rn ia ir e , ( Chirurg. ) nom qu’on donne à celui qui eft
reçu expert pour la conftruélion 8c l’application des brayers
propres a contenir les hernies. Examen que fubiftent les herniaires
pour être reçus aux écoles de chirurgie. On ne leur donne
que la cure palliative. Chirurgicns-hcrniaircs parmi les maîtres
en ch irurgicdcParis .VIII. 175. A.
HERNIE. ( Chirurg. ) D ’où fe tire ia différence des hcrr
nies. Hernies ombilicales ou cxomphalcs. Hernies inguinales
ou bubonoccles. Hernies cpmpletcs ou ofché.ocelcs.
Hernies crurales; elles font plus communes aux femmes,
q u ’aux hommes. Hernies du trou ovalairc. V I I I . 1 7 s . A.
Hernies ventrales. Hernies de l’cftomac. Hernies épiplom-
pha lc s, cntéroinphajcs, cntéro-épiplomphalcs. Hernies appcllécs
entéroccles , épiploceles, b hernies de vejfte. On diftingue
les hernies en celles qui fe foRtpar rupture, 8c celles
qui fe font pa r l’cxtcniion du péritoine. On les diftingue
encore en fimplcs , compofécs 8c compliquées. Accidcns
qui peuvent, les accompagner. Maladies qui peuvent les
compliquer. Leurs caufcs. Difppfnioas naturelles à leur formation.
Ibid. 176, 4. Signes des hernies. Signes diagnoftics
qui font connohrc quelle cft l’cfpecc d’hernre, Ibid. b. Signes
prpgnoftics. Cure des différentes cfpcccs d’hcrnics. Ibid.
177. 4. D e la cure des hernies avec gangrené. L e malade
peut être en difféfctis cas , qu’il cft tres-important de diftin-
g u e r , parce qu’ils ont , chacun . leur indication différente.
Le premier c a s , c’eft lorfque l’inteftin n’eft pincé ,que dans
une petite furfacc. Ibid. b. Le fécond cas cft celui où l’inteftin
eft pinçé dans tou* fon diamètre. Ibid. 178. a,. Le
troificme eft celui où. l'intcftin forme une an fe libre dans
l’anneau., Ibid, b. Un quatrième cas d'hernie avec gangrené
ç’cïj; lorfque l'intcftin forme une anfc qui cft adhérente,
tombée en pourriture , 8ç qui cft it la circonférence interne
de l’anneau. Exemple. A chacun de ces cas , l’auteur joint
la defeription du traitement qui lui cft propre. Ibid. 179 .4.
Hernie. Efpccc d’hernie nommée bubonocele. II. 4$4. b.
Hernie crurale : pourquoi les femmes y font plus fujettes
HER qu’aux buboneceles. Ibid. Hernie variqueufe. III. 47 7. b.
Hernie dans le pli de l’aine. V . 7 19 .4 . Etranglement d’une
hernie & l’aine : fuites de cet accident : traitement de cette
maladie. Suppl. I. any. a , b. Signe d’une hernie intcftinale
& de l'épiploon. V II. ç i 6. a. Hernie-du foie. VIII. 137. 4 ,
b. Hernie occafionnée par la defeente des inteftins avec des
eaux dans le ferotum. 368. a , b. Hernie appciléc hyfléroccla
420. b. X . 201. b. 202. 4 . Hernie inteftinale par le vagin :
neffaire pour la contenir. XII. 4 5 1 . b. Hernie de la veftie.
X V I I . 207. b. Hernies où la gangrène a caufé une adhérence
du boyau avec le péritoine. Anus artificiel qu’on doit
former en ce cas. Exemple. Suppl. L 474. a , b. Réduélion
des hernies. XIII. 882. 4 , b. Sonde ailée ou gardienne des
inteftins dans les hernies avec étranglement. X V . 354. 4.
Biftousi pour les hernies. IL 2C6. b. Bandages. 406. b.
Nouveau bandage pour les hernies des aines 8c de l’abdomen.
Suppl. IV . 6 13. b. H ernie inguinale guérie par la tranf-
olautation. X V I . C39. b. Caufe fréquente des hernies dans
Je régime. Suppl. III. 73. b.
H ernies du ch e v a l, ( Maréch.’) Suppl. III. 403. b.
H E R N IO L E , { B o ta n A defeription de l’cfpccc principale
de ce genre de plante. Lieux où elle croit. Ses propriétés.
Principes qu’elle contient. V IU . 179. b.
H E RN IQU E S >{Géogr. a n c.) peuple du Latium. Ses guerres
avec les Romains. Origine du nom qu’il portoit. V III. 179. b.
H E R O , ( Myth. ) jeune prêtreffe de Vénus, qui demeuroit
à Seftos fur les bords de 1 H ellcfpont. Hiftoire des amours
d’Hcro & de Léandre. Poëme auquel cette hiftoire a donné
lieu. Médailles où Léandre cft repréfenté. Epitre de cet amant
à fa maitreffe qu’on lit dans le héroïdesd’0.viae.S4/>/7/.lII. 366.6.
Héro 8c Léandre : leur hiftoire. IX. 329. b. 330.4.
H É R O D É , ( H ifl.fa c r . ) ce mot (\wi\nc dragon en feu . Hiftoi-
rc de la vie d’H érode le grand ou l’alcalonite. Suppl. 111.367.4.
Hérode t le grand, abrégé de fa vie. V IIL 509. b. Services
que lui rendit Achiab fon neveu. Suppl. L 144. b. Soins
qu’il prit de détruire' les voleurs des environs d’Arbellc.
1. 378. 4 . Ses états aggrandis par A u gu fte , V I I I . 936. a.
I l les délivre des brigands qui les infeftoient. Ibid. 8c Suppl.
IV . 9 31, b„ C e prince élu préfident aux jeux olympiques.
X I . 457. b. Diftribution de fes états entre fes f ils .X V l. 212. 4 .
Suppl. II. 887. b.
Hérode A n t ip a s ou le tétrarqut, fils du précédent. V I . 36. b.
X V I . 212 .4. .
H E R O D IA D E , ( H ifl.fa c r . ) fille d’A riftobulc 8c de Bérénice
, petite fille du grand Hérode. Principaux évènemens de
û vie. Suppl. III. 367.4.
H E R O D IC U S , médecin. X. 283. b.
H E R O D IE N S , ( H ifl. ec c l.) feéle des Juifs au tems de
Jefus-Chrift. En quels endroits du nouveau teftament il en
eft parlé. V I I I . 179. b. Divers fentimens des peres 8c des
critiques fur les hérodiens. Sentiment de l’auteur : il paroi t
Su e lc s hérodiens étoient une feéle qui différoit des autres
ans quelque point de la loi judaïque, 8c qui reponnoiffoit
Hérode pour auteur des opinions qui la caraélérifoit. Selon
le s apparences , c’étoicnt pour la plupart des gens d e fa
c o u r , 8c qui lui étoient dévoués. La verfton fÿriaquc rend
lç nom üHérodiens par celui de domefliquts d Hérode. l i e -
cherche des dogmes qu’avoit adoptés cette feéle. Articles
fur lcfquels Hérode 8c les Juifs ne s’accordoient pas .Ib id .
180. 4 . Les hérodiens étoient vraifemblablemejit des demi-
juifs comme l u i , des gens très - difpofés à- fe prêter dans le
befoin h d’autres cultes que le judaïfme. Pourquoi les fadu-
céens font confondus avec les hérodiens. Ibid. b.
H E R O D O T E , obfervations fur cet hiitorien. 11. 66» . 4.
V I I I . 28. 4 . 2 2 2 .4 , b.
HEROIDESrfOvn/iè V . 486. a.
H E R O ÏQ U E . { L i t t é r a l) Tems héroïques : poeme héroïque
auteurs: de poèmes ainfi défignés. Vers-héroiaucs :
o n appelle ainft les vers hexamètres en .grec « en latin ;
on appclloit de même nos vers alexandrins. VIU. 180. b.
Nous n’avons point en françois d’exemples de poèmes hé-
roïquesécrits en vers de dix fyllabes. Obfervation fu r ie vert-
v e r t de M. G reifet écrit en vers de dix fyllabes. Ibid. 18 1.4.
Héroïque,. Vers héroïques. V . 483. b. Voyc^ V ers. Tems
héroïques. V I I . 9 1 1 . 4. Réponfos héroïques. X IV . 138. o.
Statues héroïques. X V . Soa. h. Aflion héroïque dans la
poéfie dramauque. X V I , 5 1 3 .L 32». é.
H é r o ï q u e , ( M t ii c . ) efpcce dé traitement ou de remèdes
dont les e f f e t s produïfcntdeschangemfensconndérablcs
& prompts dan» l’économie animale. Moyenspropres à opérer
cescffcts. Prudence avec laquelle il faut employer ces moyens.
Grande utilité de ces romedes. VIII. 181. a. C e f l aux médica-
mens héroïques que Paracelfe dut fa plus grande réptitauon en
( Morale') en quoi il diffère de la (impie
erandetui d’ame. Définition du liéros. Q u e l (ut le tems où
la Grè ce compta le plus de héros. Nul prince ne peut
prétendre h ^ e t i t r e , s’il n’o ffre , pour l’obtemr, que des
y ié lo ïrc s& d c s trophées.Les héros né doivent pas étteregardés
HER 9 1 1
de trop près. Idée que le peuple fe fait d’on héros.VIII. 181. b.
Héroifme. Il n’y a point de véritable héroïfme fans le
fentiment de notre immortalité. X IV . 496. b. Exemples
d’héroïfme dans les proferiptions du fécond triumvirat. X V I .
673. a , b.
H E R O N , ( H ifl. n a t.) defeription de cet oifeau aquatique.
V I I I . 181.6.
H éro n g r is , p e t it , {H i f l. n a t.) fa defeription; celle du
héron blanc 8c Au petit héron blanc, v III. 182.4.
Héron. Différentes efpeces de héron ; des Antilles IV .
423. 6. du B ré fil, X V . 260. 6. des ¿îles Philippines. 839.6.
Oifeau du Bréfil de la nature du héron. XVI. 363. ét
Obfervation fur la maniéré dont les hérons mangent les
moules. V I I I . 426. 6. Chaffe du héron avec les oiieaux de
p ro ie .X VII. 4 4 1 .4 . Héron pourpré, h u p é ,v o l. V I des pl.
regne animal, planche 43.
H éron , ( Blafon ) comment cet oifeau eft repréfenté dans
les armoiries. Signification de cette figure fymbolique, Suppl.
III. 3 6 7 .6.
HEk OPHILE , preffoir d ’ , ( Anatom. ) Q u i étoit Héro-
philc. Ses découvertes en anatomie. C e qu’on entend par le
prcjfoir d ’Hérophile.YIII. 182.4.
Hérophile. Obfervations fur ce médecin. X . 283. 6. Sa phy-
fiologie. 1. 412. 4 . Suppl. IV . 346. 6. Ses fragmetis. Suppl. I .
304. 4 . Sa doélrine fur le pouls. XIII. 203. 6. 206. 4 . 220. 4 .
X IV . 268.6. PrciToir d’Hérophile. 324.4.
H E R O S , lignification de ce terme dans fon origine. Il
femble aujourd hui n’être plus confacré qu’aux guerriers ,
qui portent au plus haut degré les talons 8c les vertus militaires.
Définition du héros. Supériorité du grand homme
fur le héros. Pourquoi Titus eft plus loué par fes bienfaits
que par fes viéloircs. VIII. 182. 4 . Le titre de héros dépend
du fucc és, celui de grand homme n’en dépend pas toujours.
Vertus qui caraélériient le grand homme ; qualités & talcns
qui caraaérifent le héros. Q u e l eft le parfait héros. Ibid. 6.
Voyez G lo ire.
Héros. Obfervations fur les héros d’Homere* II. 330. a.
Coutume de repréfenter les héros plus grands que nature.
V I I . 337. 6. La générofité eft la vertu des héros. <74. et.
Hymnes pour les héros. VIII. 393. 6. Les plus grands héfos
n’ont point été honteux de verfer des larmes. XII. 763. a.
L’honneur des ftatues accordé aux héros. X V . 498. a. D e là
gloire réfervée aux différentes fortes de héros. X V I . 8 6 .4 ,6 .
0 7 .4 ,6 .
H é r o s , {M y tho l. L ittér .) ou demi-dieu. D e l’étymologie
du mot héros. La promotion des héros au rang des dieux
étoit due aux dogmes de la philofophie platonique. Demeure
que leur aflignoient les ftoïciens. Différence entre le cuire
des dieux 8C celui des héros. O n ¿leva peu -à-peu les héros
au rang des dieux : c’eft ce que Diodore de Sicile confirme
par fon témoignage. VIII. 182.6. Cependant les ombres d es '
héros étoient dans les enfers, tandis que leur ame jouifToit
dans le ciel de l’immortalité. Les Grecs accordèrent un culte
aux mânes des héros & même des héroïnes. Diftinélions accordées
à leurs tombeaux. Les Romains érigerent à leur
tour des ftatues h ceux qu’ils regardèrent comme des héros.
Statues revêtues de peaux de bètes fauvageS. Monumens que
les G recs appelleront »fp« Diverfes fignifications du mot «pwç
parmi les G recs. Ibid. 183.4.
HERPE, ( Médec. ) forte de maladie. Etymologie du mot.
V III. 183. 4 . Herpe miliaire; herpe fimple; herpe corrofrve.
Ibid.b. ' _ '
H e r pe s de plat-bord, ( Ma r ine ) defeription. Herpes d’éperon.
H erpes marines, terme tThifl. nat. VIII. 18 3 .6.
HE RN G RU N D , {Géogr .) ville de Hongrie, remarquable
par fes mines de cuivre 8c de vitriol. Richefîe de ces minés.
Quelques autres obfervations fur ce fujet. VIII. 183. brVoye,£.
H érég run d . _
H E RNHU TISME, ( H if l.e c c l.) e ip e c e de fanatifme.Différons
noms fôus lefquels font connus1 les hernhuters. Fondation
d e cette forte de fociété à Bertholodorf par M. le comte
Zinzendorf: Hiftötre de1 cette fociéré. VIII: 183. 6. Origine'
du mot Hernhur d’où la feéle a pris fon noni. Régies 8ç
police de cette fociété. DétailsTur lé culte des-Hernhuters.
Ibid 184. d.-Moyen dont ils préviennent le relâchement:
La voie du fort cfttmée parmi eux. D e leurs mariages.
Autorité que M. de Zinzendorf a confervée dans la fociété.
Ses voyages 8c ceux de fes compagnons d’oe uvre. Erabhffe-
mens de la fociété en divers endroits. Toutes lés communions
chrétiennes reçues dans là feße. Ufages de la caiffe
appcllèc coiffe du fouveur Elogq q i« M. le comte de Z,«en-
dorf donne I fon époofe. Ibid. f . P en fie confolante de M.
le comte fur les nttariages dlci-bas. Progrès ètomuns que la
fociété avoit faits-eo 1749. Morale des hernhutes conforme
it celle de l’évangile. Caraflere de fanarifmé qtn fe trouve
dans cette fefte en fait d’opinions dogmatiques. C eff en feras-
Clirift1. félon ie» Ircrdhntes que la’Trinité eft concentrée, M ariage
de toutes les,feeursavcc Jefus-CKrift. Ouvrage d ou cet
arü clca étéùré . Ibid, 183. a: ^ M o r a v e s .