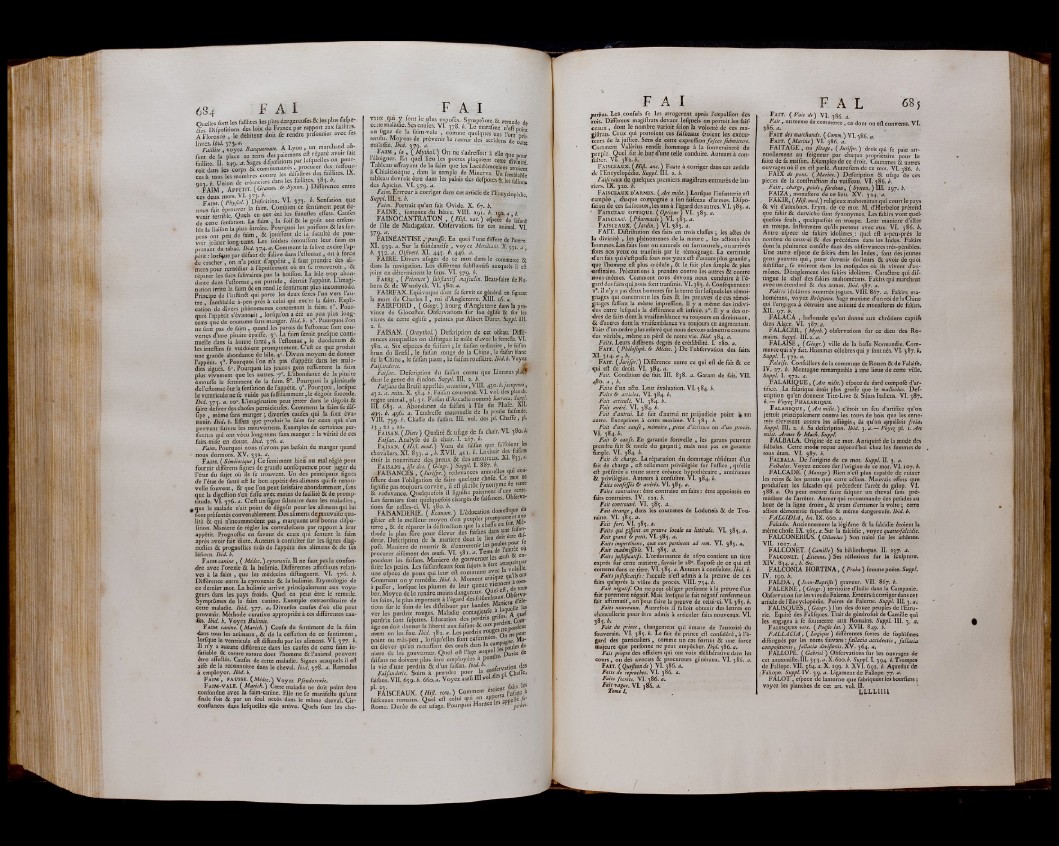
6 8 4 F A I F A I
Q u e lle s font les faillites les plus dmgereufes & les plus fufpe-
Ucs. Dlfpofuions des loin de France par rapport aux faillites.
A Florence , le débiteur doit fe rendre prifonmer avec fes
^Faillite| v o y e i Banqueroute. A Lyon , un marchand ab-
fent de la place au tems des paiemens çft répute avoir fait
failli
rait
ces à toiu. «s mci.iui vs g P S B |es 6UHks JgS B
lent .piace ¡reins uCS --- - -,
■fiiUlite. lit 249. a. Sages dlfpofuions par lefquelles on pour-
roit dans les corps & communaut^ ,-prMnrer des rdrour- É tous les membres e o n i r e les déf « desFadUtes. IX.
n ^ Z % t X G ^ : i ' S y n o n . ) Difeencc entre
CCF Î r ( « Æ 3S fit .lo n . VI. m . i. Scnfation que
nous fait éprouver la faim. Combien ce fentiment peut de-
venir terrible. Quels en ont été les funeftes effets. Caufes
de cette fenfation. La faim, la foif 8c le goût ont enfem-
ble la liaifon la plus étroite. Pourquoi les poiflons & les 1er-
pens ont peu de faim, 8c jouiffent de la faculté de pouvoir
jeûner long-tems. Les foldats émouflent leur faim en
prenant du tabac. Ibid. 374. ¿. Comment la falive excite l’appétit
■ lorfa11«*- par défaut de falive dans l’eftomac, ou a force
de cracher , on n’a point d’appétit, il faut prendre des ali-
'mens pour remédier à l’épuilement où on fe trouvcroit, »8ç
réparer les fucs falivaires par la boiflon. La bile trop abondante
dans l’eftomac,ou putride, détruit l’appétit. L imagination
irrite la faim & en rend le fentiment plus incommode.
Principe de llnftinft qui porte les deux fexes l’un vers l’autre
, lemblable à-peu-pres à celui qui excite la faim. Explication
de divers phénomènes concernant la faim. i°. Pourquoi
l’appétit s’évanouit, lorfqu’on a été un peu plus long-
tems que de coutume fans manger. Ibid. b. a®. Pourquoi l’on
ne lent pas de faim, quand les parois de 1 eftomac font couvertes
d une pituite épaiffe. 30. La faim ferait prcfque conri-:
nuelle dans la bonne fanté, ft l’eftomac, le duodénum 8c
les inteftins fe vuidoient promptement. C’cft ce que produit
une grande abondance de bile. 40. Divers moyens de donner
l’appétit. 30. Pourquoi l’on n’a pas d’appétit dans les maladies
aiguës. 6°. Pourquoi les jeunes gens reffentent la faim
plus vivement que les autres. '7°* L’abondance de la pituite
¿moufle le fentiment de la faim. 8°. Pourquoi la plénitude
del’cffomac ôte la fenfation de l’appétit. 90. Pourquoi, lorfque
le ventricule ne fe vuide pas fuffifamment, le dégoût fuccede.
Ibid. 375. a. io°. L’imagination peut jetter dans le dégoût 8c
faire defirer des chofes pernicieufes. Comment la faim fe dif-
fipe , même fans manger ; diverfes caufes qui la font évanouir.
Ibid. b. Effets que produit la faim fur ceux qui n’en
peuvent fuivre les mouvemens. Exemples de certaines perr
fonnes qui ont vécu long-tems fans manger : la vérité de ces
faitS/mife en doute. Ibid. 376. a.
Faim. Pourquoi nous n’avons pas beioin de manger quand
nous dormons. XV. 33a. a.
F a im . ( Sémeiotique) Ce fentiment bien ou mal réglé peut
fournir différens fignes de grande conféquence pour juger de
l ’état du fujet où ils fe trouvent. Un des principaux ffgncs
de l’état de fanté eft le bon appétit des alimens qui fe renouvelle
fouvent, 8c que l’on peut fatisfaire abondamment,fans
que la dieeftion s’en fafle avec moins de facilité 8c de promptitude.
Vl. 376. a. C’eft un ligne falutaire dans les maladies,
■.que le malade n'ait point de dégoût pour les alimens qui lui
lont préfentés convenablement. Des alimens dejnauvaifc qualité
8c qui n’incommodent, pas, marquent une bonne diipo-
fuion. Maniéré de régler les convalefcens par rapport à leur
appétit. Prognoftic en faveur de ceux qui Tentent la faim
après avoir tait diete. Auteurs à confulter fur les fignes diag-
noffics 8c prognoffics tirés de l’appétit des alimens 8c de fes
léfions. Ibid. b.
F a im canine, ( Médec. ) cyronexie. 11 ne faut pas la confondre
avec l’orexie 8c la bulimie. Différentes affrétions relatives
à la faim, que les médecins diftinguent. VI. 376. b.
Différence entre la cyronexie 8c la bulimie. Etymologie de
ce dernier mot La bulimie arrive principalement aux voya-
?eurs dans les pays froids. Quel en peut être le rcmede.
ymptômes de la faim canine. Exemple extraordinaire de
cette maladie. Ibid. yjy. d. Diverfes caufes d’où elle peut
provenir. Méthode curative appropriée à ces différentes caufcs.
Ibid. b. Voyez Bulimie.
F a im canine. (Maréch. ) Caufe du fentiment de la faim
dans tous les animaux, 8c de la ceffation de ce fentiment,
lorfque le ventricule eft diftendu par les alimens. VI. . 3 77. b.
H n v a aucune différence dans les caufes de cette faim in-
fatiablc 8c contre nature dont l’homme 8c l’animal peuvent
être affeétés. Caufes de cette maladie. Signes auxquels il eft
aifé de la reconnoitre dans le cheval. Ibid. 378. a. Remedes
à employer. Ibid. b.
F a im , f a u s s e . (Médec.) Voyez Pfeudorexic.
FAIM-VAJ.E. (Maréch.) Cette maladie ne doit point être
confondue avec la faim-canine. Elle ne fe manifefte qu’une
feule fois 8c par un feul accès dans le même cheval. Cir-
conftançcs dans lefquelles elle arrive. Quels font les chevaux
qui y font le plus expofés. Symptôme,8c remede
cette malatuc. Ses caufes. VI. , 7S. 4. Le maralmc n’e ffi| j§
Î8"?,dc î? Fxttn-vale , comme quelques uns l’ont ï ï
tendu. Moyens de prévenir le retour des accidens de i Z
maladie. Ibid. 379. a. : ' IC
„„Faim , la , ( Mythol.) Ôn ne s’adrefloit à elle que pour
léloigner. En quel lieu les poëtcs plaçoient cette divUé
iableau effrayant de la faim que les Lacédèmoniens avoient
à Chialcioëque , dans le temple de Minerve. Un fcmblablc
tableau devrait être dans lés palais des defpotes & les fallon»
des Apicius. VI. 379. 4.
Faim. Errreur à corriger dans cet article de l'Encyclopédie
Suppl. III. z. b. ;r'- ■ 1
Faim. Portrait qu’en fait Ovide. X. 67. b.
FAINE, femence du hêtre. VIII. 191. b. 102 a b
FAINOCANTRATON | ( Hijl'. nat.) efpccc de’ léfard
de l’île de Madagafcar. Obfervations fur cet animal. VI
379- a- . '
FAINEANTISE y'parejfe. En quoi l’une différé de l’autre.
XI. 939. a. Sur la fainéantifé , voyez Mendiant. X. 331. a ,
b. 332. a. Oifiveté. XI. 445. b. 440. a.
FAIRE. Divers ufages de ce mot dans le commerce 8c
dans la navigation. Les différens fubftantifs auxquels il eft
joint en déterminent le fens. VI. 379. b.
F a i r e , ( Peinture ) fubjlantif mafculin. Beau-faire de Ru-
bens 8c de Wandyck. Vl. 380. a.
FAIRFAX.Equivoque dont fe fervit ce général en fignant
la mort de Charles I , roi d’Angleterre. XlU. 16. a.
FAIRFORD, ( Géogr. ) bourg d’Angleterre dans la province
de Gloceftcr. Obfervations fur Ion églife 6c fur les
vitres de cette églife , peintes par Albert Durer. Suppl. III.
2. b.
FAISAN. ( Ornythol. ) Dcfcription de cet oifeau. Différences
auxquelles on diftingue le mâle d’avec la femelle. VI.
380. a. Six efpeccs de faifar.s ; le faifan ordinaire, le faifan
brun du Brefil, le faifan rouge de la Chine, le faifan blanc
de la Chine, le faifan paon, le faifan rouffâtre. Ibid. b. Voyez
Faifandcrie.
Faifan. Defcription du faifan cornu que Linnæus plafy
dans le genre du dindon. Spppl. III. 2. b.
Fai fans du Brefil appellésjacoutins, VIII. 430. b.jacupema,
432. d. mitu. X. 584. b. Faifan couronné. VI. vol. des planch.
regne animal, pl. 31. Faifan d’Arcadie nommé katraca. Suppl.
IIL 683. a. Abondance de fàifans à l’île du Phâfc. XII.
495. b. 496. a. TendrcfTe maternelle de la poule failandc.
' I. 799. b. Chaffe du faifan. III. m 1 vol. des pl. Chaffe, pL
^ F a i s a n . (Dicte) Qualité 8c.ufage de fa chair. VI. 380.é/
Faifan. Analyfc de fa chair. I. 267. b.
F a i s a n . (Hijl. mod.) Voeu du faifan que faifoient les
chevaliers. XI. 833. * , b. XVII. 4” - 1 La cha,r | | Ja,fans
étoit la nourriture des Dreux 8c des amoureux. Al. 033. •
F a i s a n s , ijle des. ( Gcogr.) Suppl. 1. 887* .
FATSANCES , ( Jurifpr. ) redevances annuelles qui con-
fiftent dans l’obligation de faire quelque chofe. Ce mot
figniffe pas toujours corvée, il eft plutôt fynonyme de r
8c redevance. Quelquefois il ffgnifie paiement d u n e rente.
Les fermiers font quelquefois chargés de faifances. Ubie
tions fur celles-ci. VI. 380. b. ..
FAISANDERIE. (Econom.) L’éducation domeftique ou
gibier eft le meilleur moyen d en peupler prmnptem
terre , 8c de réparer la deftruélion que la chaffe en
thode la plus fure pour élever des faifans dans u
derie. Defcription de la manière dont le lieu doi ^
pofé. Maniéré de nourrir 8c d’entretenir les pou P ^
procurer uifémem des oeuf, VI.
pondent les faifans. Maniéré de gouverner les , r
fuite les petits. Les faifandeaux font fujets à être ^0jajuc.
une cfpcce de poux qui leur eft commune avec
Comment on y remédie. Ibid. b. Moment i tomtions
fur ie foin de les diftribuèr par bandes. . ^ucjjc les
ver les perdrix rouges. Maladie contagieule 4 .
perdrix font fujettes. Education des perdrix grn • g |g g
âge on doit donner la liberté aux faifans 8c aux pe ' jent
ment on les fixe. Ibid. 382. a. Les perdrix roug ^ peut
point ou très-peu , lorfqu’clles font en fe rm é es . Maen
élever qu’en ramaflant des oeufs dans la ca . r “ ,uicsde
nierc de les gouverner. Quel eft l’âge auquiei ß ur£c de
faifans ne doivent plus être employées â pon
la vie d’une perdrix 8c d’un faifan. Ibid. b. _fCI.vation des
Faifanderie. Soins à prendre pour la « . ÇhafTe,
faifans. VII. 65 9. b. 660. a. "Voyez aufti III y . •
P1' f 1 'iSCEAUX. (Hiß. r om . ) Comment i tow 'fo g i
faifeeaux romains. Quel eft celui qui c° PP. appelle fu’
Rome. Durée de cet ufage. Pourquoi Horace les vv
F A I F A L 685
verbot. Les.confuls fe les arrogerent après l’expulfion des
rois. Différens magiftrats devant lefquels on portoit les fàif-
ccaux , dont le nombre varioit félon la volonté de ces magiftrats.
Ceux qui portoient ces faifeeaux étoient les exécuteurs
de la iuftice. Sens de cette expreflion fafees fubmittere.
Comment Valérius rendit hommage à la fouveraineté du
peuple. Quel fut le but* d’une telle conduite. Auteurs à con-
fultcr. VL 382. b.
F a i s c e a u x . (Hiß. ane.) Faute à corriger dans cet article
de l'Encyclopédie. Suppl. III. 2. b.
Faifeeaux de quelques premiers magiftrats entourés de lauriers.
IX. 320. b.
F a i s c e a u x d ’a r m e s . (A n milit. ) Lorfque l’infanterie eft
campée , chaque compagnie a Ton fatfceau d’armes. Difpo-
fùion de ces faifeeaux, les uns à l’égard des autres. VI. 383. a.
F a i s c e a u o p t i q u e . (OptiqueYVI. 383. a.
F a i s c e a u . (Pharmacie ) VI. 383. a.
F a i s c e a u x . (Jardin.) VI. 303. a.
FAIT. Diftribution des faits en trois claffes ; les aôes de
la divinité , les phénomènes de la nature , les aftions des
hommes. Les faits font ou naturels ou furnaturels, ou arrivés
fous nos yeux ou tranfmis par le témoignage. La certitude
d’un fait quis'eftpaffé fous nos yeux eft aautant'plus grande,
que l’homme eft plus crédule, 8c le fait plus fimple 8c plus
ordinaire. Précautions à prendre contre les autres 8c contre
nous-mêmes. Comment nous devons nous conduire à l’égard
des faits qui nous font tranfmis. VI. 383. b. Conséquences:
z*. il n’y a pas deux hommes fur la terre fur lefquels les témoignages
qui concernent les faits 8c les preuves de ces témoignages
taffent la même impreflion. U y a même des individus
entre lefquels la différence eft infinie. 20. Il y a des ordres
de faits dont la vraifemblance va toujours en diminuant,
8c d’autres dont la vraifemblance va toujours en augmentant.
Fait.« d’un ordre plus relevé què nous devons admettre comme
des vérités, même au péril de notre vie. Ibid. 384. a.
Faits. Leurs différens degrés de crédibilité. I. 180. a.
F a i t .. (Philofoph. fi* Mcdec. ) De l’obfcrvation des faits:
XI. 314. a , b.
F a i t . (Jurifpr.) Différence entre ce qui eft de fait 8c ce
qui eft de droit. Vl. 284. a.
Fait. Condition dc[ fait. III. 838. a. Garant de fait. VII.
480. a y b.
Faits d’un afte. Leur évaluation. VI. 384. b.
Faits & articles. VI. 384. b.
Fait articulé. VI. 384. b.
Fait avéré. VI. 384. b.
Fait (Fautrui. Le fait d’autrui ne préjudicie point « un
autre. Exceptions à cette maxime. VI. 384. b.
Fait d’une caufe , mémoire , pièce d’écriture ou d’un procès.
VI. 384. b.
Fait & caufe. En garantie formelle , les garans peuvent
prendre fait 8c caufe du garanti ; mais non pas en garantie
iimplc. VI. 384. b.
Fait de charge. La réparation du dommage réfultant d’un
fait de charge , eft tellement privilégiée fur l’office , qu’elle
eft préférée à toute autre créance hypothécaire , antérieure
8c privilégiée. Auteurs à confulter. V l. 384. b.
Faits confejfés & avérés. VI. 385. a.
Faits contraires: être contraire en faits: être appointés en
faits contraires. IV. 121. b.
Fait eontrouvé. VI. 385. a.
Fait étrange, dans les coutumes de Loduneis 8c de Touraine.
m m M
Fait fort. VI. 385. a.
Faits qui gijfent en preuve locale ou littérale. VI. 383. a.
Fait grand v petit. VI. 385. a.
Faits impertihenst quee non pertinent ad rem. VI. 385. a.
Fait ina'dmiffible. V l . 285. a.
‘Faits iuflifieatifs. L’ordonnance de 1670 contient un titre
exprès fur cette matière, favoir le 28e. Lxpofé de ce qui eft
contenu dans ce titre. VI. 285. a. Auteurs à confulter. Ibid. b.
Faits jußificatifs : l’acculé n’eft admis à la preuve de ces
faits qu’après la vifite du procès. VIII. 754. o.
Fait négatif. On ne peut obliger perfonne à là preuve d’un
fair purement négatif. Mais lorfque le fait négatif renferme un
fait affirmatif, on’jbcut faire la preuve de celui-ci. VI. 385. b.
Faits nouveaux. Autrefois il falloit obtenir des lettres en
chancellerie pour être admis i articuler faits nouveaux. VI.
385. b.
Fait du prince y changement qui émane de l’autorité du
fouverain. VI. 385. b. Le fait du prince eft confédéré,â l’égard
des particuliers, comme un cas fortuit 8c une force
majeure que perfonne ne peut empêcher. Ibid. 386. a.
Fait propre des officiers qui ont voix délibcrative dans les
cours, ou des avocats 8c procureurs généraux. VI. 386. a.
F a i t . ( Queßion de ) VI. 386. a.
Faits de reproches. V l. 306. a.
Faits fecrets. VI. 386. a.
Fait vague. VI. 206. a.
Tome /,
FAit. ( Voit de ) VI. 386. a.
Fait, en terme do commerce, ce dont on eft convenu. VI.
306. a.
F a i t des marchands. ( Comm.) VI. 286. a
Fait. (Marine) VI. 386. a.
FAITAGE, ou fitage y (Jurifpr.) droit qui fe paie annuellement
au feigneur par chaque propriétaire pour le |
faite de fa maifon. Exemples de ce droit. Coutumes oc autres
ouvrages où il en eft parlé. Autre fens de ce mot. VL 386. b.
FAIX de pont. (Marine.) Defcription 8c ufage de ces
pièces de la conftruftion du vaifteau. VI. 386. b.
Faix y charge, poids , fardeau, ( S y non. ) III. 197. b.
FAIZA, monaftere de ce lieu. XV. 324. a.
FAKIR, ( Hijl. mod. ) religieux mahométan qui court le pays
8c vit d’aumônes. Etym. de ce mot. M. d’Herbelot prétend
que fakir 8c derviche font fynonymes. Les fakirs vont quelquefois
feuls, quelquefois en troupe. Leur maniere d’aller
en troupe. Inftrumens qu’ils portent avec eux. VI. 386. b.
Autre cfpece de fakirs idolâtres,: quel eft à-peu-près le
nombre de ceux-ci 8c des précédons dans les Indes. Fakirs
dont la pénitence confffte dans des obfervances très-pénibles.
Une autre efpcce de fakirs dans lei Indes, font des jeunes
gens ^pauvres qui, pour devenir doéleurs 8f avoir de quoi
fiibfifter, fe retirent dans les mofquées où ils vivent a aumônes.
Dérèglement des fakirs idolâtres. Caraétere qui distingue
le chef des fakirs mahométans. Fakirs qui marchent
avec un étendard 8c des armes. Ibid. 387. a.
Fakirs idolâtres nommés jogues. VIII. 867. a. Fakirs mahométans,
voyez Religieux. Sage maxime d’un roi de la Chine
gui l’engagea à détruire une infinité de monafteres de fakirS.
XII. 97. b.
FALACA , baftonade qu’on donne aux chrétiens captifs
dans Alger. VI. 3 Zy.a.
FALACER, (Myth.) obfervations fur ce dieu des Romains.
Suppl. III. 2. a.
FALAIbE , (Géogr.) ville de la baffe Normandie. Commerce
qui s’y fait. Hommes célébrés qui y font nés. VI. 387. b.
Suppl. I. 572. ».
Falaife. Confcillcrs de la commune de Rouen 8c de Falaife:
IV. 27. b. Montagne remarquable à une lieue de cette ville.
Suppl. I. <72. a.
FALARIQUE, (Art milit.) efpecede dard compofé d’artifice.
La fabrique ¿toit plus grofie que le malleolus. Defcription
qu’en donnent Tite-Live 8c Silius Italicus. VI. 387.
b. — Voyc{ P h a l a r i q u e .
F a l a r i q u e , (Art milit.) c’étoit un feu d’artifice qu’on
jettoit principalement contre les tours de bois que les ennemis
élevoient contre les affiégés, 8c qu’on appelloit frela.
Suppl. III. 2. b. Sa defcription. Ibid. 3.a.— Voye^ pl. 1 .A n
milit. Armes & Mach. Suppl.
FALBALA. Origine de ce mot. Antiquité de la mode des
falbalas. Cette mode reçue aujourd’hui chez les femmes de .
tous états. VI. 387. b.
F a l b a l a . De l’origine de ce mot. Suppl. II. 3. a.
Falbalas. Voyez encore fur l’origine de ce mot. VI. 107. b.
FALCADE. (Manege) Rien n’eft plus capable de ruiner
les reins 8c les jarrets que cette aélion. Mauvais effets que
produifent les falcades qui précèdent l’arrét du galop, v l.
388. a. On peut encore faire falquer un cheval fans préméditer
de 1 arrêter. Auteur qui recommande des pefades au
bout de la ligne droite, 8c avant d’entamer la volte ; cette
aâion démontrée fuperflue 6c même dangereufe. Ibid. b.
FALCIDIA y loi. IX. 660. a.
Falcidie. Anciennement la légitime 8c la falcidie étoient la
même chofe. IX. 365. a. Sur la falcidie, voyez quarte-falcidie.
FALCONERIUS. (Oflavius) Son traite fur les athletes.
VII. 1017.».
FALCÓNET. (Camille) Sa bibliothèque. II. 237. a.
F a l c o n e t . ( Etienne. ) Ses réflexions fur la fculpture.
XIV. 834.üyb.bC.
FALCONIA HORTINA, ( Proba) femme poète. Suppl.
IV. 190. b.
FALDA , (Jtan-Baptijlt) graveur. VII. 867. b.
FALERNE, ( Géogr. ) territoire d’Italie dans la Campanie.
Obfervation fur les vinsac Falerne. Erreurs à,corriger dans cet
article de l’Encyclopédie. Poires de Falerne. Suppl. IIL3. a '.
FALISQUES, ( Géogr. ) l’un des douze peuples de l’Etru-
rie. Equité des Falifques. Trait de généralité de Camille qui
les engagea à fe fouraettre aux Romains. Suppl. III. 2. a. %
F a l i s q u e s vers. ( Poéfit lat.) XVII. 849. b.
FALLACIA, ( Logique) différentes fortes de fophifmes
diftingués' par les noms fuivans: fallacia accidentis, fallacia
compojiiionis, fallacia divifionis. XV. 364. a.
FALLOPE. (Gabriel) Obfervations fur les ouvrages de
cet anatomifte.III. 233.¿ .X.600.é. Suppl. I. 394. ¿.Trompes
de Fallope. VII. 564.». X. 199. b. XVI. 692. b. Aqueduc de
fFahopc. Suppl. Iv . 30. a. Ligament de Fallope. 77. a.
FALOT, efpece tic lanterne que fabriquent les bourfiers:
voyez les planches de cet art. vol. IIL
L L L l l l l