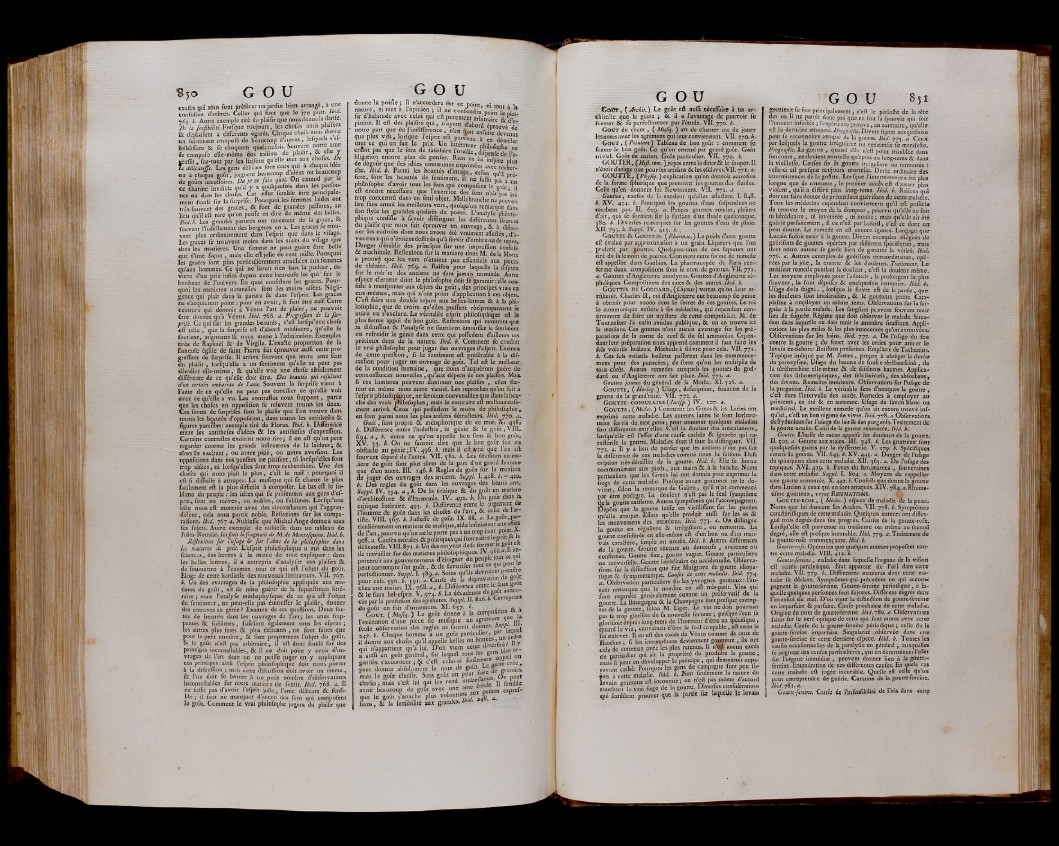
S 50 G O U
cnu fes mù nôus font préférer un jardin bien arrangé, à une
confufion d’arbres. Celles qui font que le jeu p la ît . Ibid.
y6<. b. Autre exemple tiré du plaifir que nousdonne la danie.
Lie la fcnfibïlité. Prefque toujours, les chofes nous plailent
& déplaifent à différents égards. Chaque chofe nous donne
un fenriment conipofé de beaucoup d’autres , lefqueis s ai-
fbibliflcnt & fe choquent quelquefois. Souvent notre«am
fe compofe elle-même des raifons de plaifir, oc el e j
céuilit, fur-tout par les liaifons qu’elle met aux chofes. D e
h JUicattfft. Les gens déliiats font oeuxam à chaque idée
ou à chaque goût , joignent beaucoup cMées ou beaucoup
de goûts acceifoires. D u j e n t fa is On entend par là
ce charme invifible qu'il y a quelquefois dans les perfon-
nes ou dans les choies. Cet effet fcmble être P«n«P»k-
nient fondé fur la furprife. Pourquoi les femmes laides ont
trés-fouvent des grâces, & font de grandes pafTions au
Heu qu’il eft rare qu'on puiife en dire de même des belles.
Ibid.b. Les grandes parures ont rarement de la grâce, oc
fou vent l’Jiabillement des bergeres en a. Les grâces fe trouvent
plus ordinairement dans l’efprit que dans le vifage.
Les grâces fe trouvent moins dans les traits du vifage que
dans les manieres. Une femme ne peut guère être belle
que d’une façon , mais elle eil jolie de cent mille. Pourquoi
les grâces font plus particulièrement attachées aux femmes
qu’aux hommes. Ce qui ne feroit rien fans la pudeur, devient
d’un prix infini depuis cette heureufe loi qui ‘ fait le
bonheur de l’univers. En quoi confiftent les grâces. Pourquoi
les manieres naturelles font les moins aifées. Négligence
qui plaît dans la parure & dans l’efprit. Les grâces
ne s’acquicrent point : pour en avoir, il faut être naïf. C ette
Ceinture qui donnoit à Vénus l’art de plaire, ne pouvoit
être donnée qu’à Vénus. Ibid. 766. a. Progreffion de la furprife.
Ce qui fait les grandes beautés, c’eft lorfqu’une chofe
eil telle , que la furprife eil d’abord médiocre, qu’elle fe
fondent, augmente & nous mene a l’admiration. Exemples
tirés de Raphaël & de Virgile. L’exafte proportion de la
fameufe églife de faint Pierre fait éprouver auiîi cette pro-
greifion de furprife. Il arrive fouvent que notre ame fent
du plaifir, lorfqu’elle a un fentiment qu’elle ne peut pas
démêler elle-même, 8c qu’elle voit une chofe ablblument
différente de ce qu’elle aoit être. D e s beautés qui réfultent
d'un certain embarras de lame. Souvent la furprife vient à
l’ame de ce qu’elle ne peut pas concilier ce qu’ellë voit
avec ce qu’elle a vu. Les contralles nous frappent, parce 2ne' les enofes en oppofition fe relevent toutes les deux,
¡es fortes de furprifes font le plaifir que l’on trouve dans
toutes les beautés d’oppofitlon, dans toutes les antithefes 8c
figures párenles : exemple tiré de Florus. Ibid. b. Différence
entre les antithefes d’idées 8c les antithefes d’exprefiion.
Certains contralles excitent notre rire ; il en eil qu on peut
regarder comme les grands inflrumens de la laideur} 8c
alors ils excitent, ou notre pitié, ou notre averfion. Les
oppofitions dans nos penfôes ne plaifent, ni lorfqu’elles font
trop aifées, ni lorfqu’elles font trop recherchées. Une des
chofes qui nous plaît le plus, c’e il le naïf : pourquoi il
eil fi difficile à attraper. La mufique qui fe chante le plus
facilement eil la plus difficile à compofer. Le bas cil le fu-
blime du peuple : les idées qui fe préfentent aux gens d’ef-
prit-, font ou naïves, ou nobles, ou fublimés. Lorfqu’une
idée nous eil montrée avec des circonfiances qui l’aggran-
diflent, cela nous paroît noble. Réflexions fur les compa-
raifons. Ibid. 7 6 7 a. Nobleffe que Michel-Ange donne à tous
fes fujets. Autre exemple de noble fie dans un tableau de
Jules-Komain. Ici finit lefragment de M .d e Montcfquieu. Ibid.b.
Réflexions fu r Iufage & fu r Cabus de la philofophie dans
les matières de goût. L’efprit philofophiquc a mis dans les
fciencjs, des bornes à la manie de tout expliquer : dans
les belles lettres, il a entrepris d’analyfer nos plaifirs 8c
de foumettre à l’examen tout ce qui eil l’objet du goût.
Eloge de cette hardiefTe des nouveaux littérateurs. VII. 767.
b. Un des avantages de la philofophie appliquée aux matières
du g o û t , eil de nous guérir de la fuperflition littéraire
; mais l’analyfe méthaphyfique de ce qui eil l’objet
du fentiment, ne peut-elle pas émouffer le plaifir, donner
des entraves au génie ? Examen de ces queilions. Deux fortes
de beautés dans les ouvrages de la r t ; les unes frap-
{antes 8c fublimes, faififient également tous les efprits ;
es autres plus fines 8c plus délicates, ne font faites que
pour le petit nombre, 8c font proprement l’objet du goût.
Si le goût n’eil pas arbitraire, il eil donc fondé fur des
principes inconteltables, 8c il ne doit point y avoir d’ouvrages
de l’art dont on ne puiife juger en y appliquant
ces principes : ainfi l’efprit philofophiquc doit nous porter
à la difeuflion ; mais cette difeuflion doit avoir un terme,
8c l’on doit fe borner à un petit nombre d’obfervations
inconteilables fur notre maniere de fentir. Ibid. 768. a. Il
ne fuffit pas d’avoir l’efprit jufte, l’ame délicate 8c fenfi-
ble ; il faut ne manquer d’aucun des fens qui compofent
le goût. Comment le vrai pliilofophe jugera du plaifir que
G O U
donne la poéfie ; il n’accordera for ce point, ni tout ô U
nature, ni tout a 1 opinion ; il ne confondra ooml U •
fir d’habitude avec « l in gui eft .purement arbitraire & f t
ptnton. 11 elï des f e g g j t » : , . « ayan, d’abord éprouvé de
notre part que de 1 indifférence , n'en ÿ n t enfuife devenus
que plus y t îs .lo r fq u e Iefpnt eft parvenu 1 eu démékr
.ont ce qui en fan le prix, Un littérateur philofophe u"
crftnt pas que le foin de (atisfairc l’oreille,
bhgatton encore plus de penfer. Rien ne lt,i i„fpire D, ° '
de dégoût que des idées commune, exprimée, avec r e c C
Che. U ,d . i . Parmi les beautés d’tmage., celles qu’il „ré-
fe re , font les beautés de fentiment. 11 ne fuSt
pmlofopne d avoir tous les fens qui compofent l<* eoùt- i!
efl encore néceffaire que l’exercice des fens n’ait * pas’¿ti
trop concentré dans un feul objet. Mallebranche ne pouvoit
bre fans ennui les meilleurs v e r s , quoiqu’on remarque dans
fon ily le les grandes qualités du poëte. L’analyfe philofo-
plnque eonfifie à favoir diftinguer les différentes fources
du plaifir que nous fait éprouver un ouvrage, 8c à discerner
les endroits dont nous avons été vraiment affeftés, d’av
e c ceux qui n’étoientdeilinés qu’à fervir d’ombre ou de repos.
Danger d établir des principes fur une impreffion confufe
8c machinale. Réflexions fur la maniéré dont M. de la Motte
a prouvé <Iue les vers n’éioient pas effentiels aux pièces
de théâtre. Ibid. 769. a. Raifon pour laquelle la difpute
fur le mérite des anciens ne fera jamais terminée. Aune
efoece d’erreur dont le philofophe doit fe garantir : elle confine
à tranfporter aux objets du g oû t, des principes vrais eu
eux-mêmes, mais qui n’ont point d’application à ces objets.
C ’eil faire une double injure aux bellcs-lettres 8c à h phi-
lofophic, que de croire qu’elles puiflent réciproquement fe
mûre ou s’excliire. Le véritable eforit philofophique eft le
plus ferme appui du bon goût. Réflexions qui montrent que
la difeuflion 8c l’analyfe ne fauroient émoufier le fentiment
ou refroidir le génie dans ceux qui poffedent d’ailleurs ces
précieux doos de la nature. Ibid. b. Comment fe conduit
le vrai philofophe pour juger des ouvrages d’eforit. Examen
de cette quemon, fi le fentiment efl préférable à la dif-
eufiion pour juger un ouvrage de goût. T e l efl le malheur
de la condition humaine, que nous n’acquérons guère de
connoifTances nouvelles , qu’aux dépens de nos plaiurs. Mais
fi ces lumières peuvent diminuer nos plaifirs , elles flattent
en même teins notre vanité. Les reproches qu’on fait à
l’efprit philofophique, ne feroient convenables que clans la bouche
des vrais jmilofophes ; mais le contraire eft mallieureufe-
ment arrivé. Ceux qui pofiedent le moins de philofophie,
en font parmi nous les plus ardens détracteur*. Ibid. 7 70 . a.
G o û t , fens propre 8c métaphorique de ce mot.. A . 438.
b. Différence entre i’induflrie, le génie 8c le g o û t ,V llI .
604. a , b. entre ce qu’on appelle bon fens 8c bon goûr.
A V . 33. b. On ne fauroit dire que le bon goût foit un,
obflacle au g én ie ;IV . 496. b. mais il efl vrai que l’un eft
fouvent féparé de l’autre. V I I . 58a. b. Les décifions en manière
de goût font plus sûres de la part d’un grand homme
que d’un autre. IIL 146. b. Réglés de goût for la manicre
de juger des ouvrages des anciens. Suppl. I. 418. b.— 420.
b. Des réglés du goût dans les ouvrages des beaux arts.
Suppl. IV , 594. a , b. D e la critique 8t du goût en matière
d’architefture 8c d’harmonîe. IV . 49a. b. Du goût dans la:
critique littéraire. 493. b. Différence entre le jugement de
l’Homme de goût dans les chofes de l’a r t , 8c celui de ar-
tifle. V IIL 567. b. JuflefTe de goût. IX. 88. a. Legout,particulièrement
en matière de mufique,aide infiniment aux e e
de l’a rt, pourvu qu’on ne le porte pas à un trop haut P°‘n£ * *
908. a. Caufes morales 8c politiques qui font naître le goüt pcla
délicateffe. VIII. 871. é. Un des moyens defe former« gouteit
de travailler for des matières philofophiques. * -
porterait aux gouvernemens d’éloigner du peuple tou
peut corrompre fon g oû t, 8cde fevorifer tout ce q »p
perfectionner. Suppl. I. 589. a. Soins qu ils devrai P
pour cela. 590. b .< 9 x .a . C *u ( c de la dépravat.Pi« du jour
chez une nation. I a . 768. a , b. Différence entre le ®
8c le faux bel-eiprit. V . 974. b. La décadence
cée par la profufran des épithetes. Suppl. 11. 8i 6 .b .C P •
du eoût en fait d’ornemens. XI. 657. b. ~ .
G o x jt . ( M u f,,. ) Le goût donne 5 la t a É t M
l’exécution d’une picce de mufigue un agrèmem q
feule obfervation des réglés ne lauroit donner, w p p - '
247. b. Chaque homme a un gout particulier, pa H
¡1 donne aux chofes qu’il appelle belles ou bonnes, .
qui n’appartient qu’à lui. D ’où vient cette diverlitc t
a auffi un goût général, for auquel on
ganifés s’accordent; §c ce ft celui-ci f«ljjen} cré e,
peut donner absolument le nom de gout. e grandes
mais le goût choifir. Sans goût on (Jn peiIt
chofes ; mais c’eil lui qui les rend intér ^ ^ fcmble
avoir beaucoup de goût avec etites exprefque
le goût s’attache plus volontiers _ ^
fions, 8c la fenfibilité aux grandes. Dia . w
$
G OU
G o ü r , ( Archit.) Le goût efl auffi néceffaire à un -ar-
ŸbiteCle que le génie ; oc il a l’avantage de pouvoir fe
former 8c fe perfectionner par l’étude. VII. 770. b.
G o u t du chant, ( Mufiq. ) art de chanter ou de jouer
les no tes avec les agrémens qui leur conviennent. VII. 770. b.
G o u t , {Peinture') Tableau de bon goût : comment fe
forme Je bon goût. Ce qu’on entend par grand goût. Goût
trivial. Goût de nation. Goût particulier. VII. 770; b.
GOUTER,, ( / lift . rom. ),repas entre le dîner 8c le fouper. Il
n’étoit d’ufage que pour les anifans 8c les efdaves.VII. 7 7 1 .0 .
G O U T T E , (Phyfiq. ) explication qu’on donnoit autrefois
de la forme fphérique que prennent les gouttes des fluides.
Celle qu’en donnent les Newtoniens. VII. 771. a.
Gouttes, caufes de la rondeur qu’elles aneClent. I. 848.
b. X V . 454. b. Pourquoi les gouttes d’eau fufpenduos ne
tombent pas. II. 629. a. Petites gouttes rondes, pleines
d’air, qui fe forment fur la furface d’un fluide quelconque. •
80. b. Diverïes remarques fur les gouttes d’eau de pluie.
CIL 793. b. Suppl. IV. 41 c. b. ,
G o u t t e 8c G o u t t a s . (Pharmac.) Le poids d’une goutte
c £ évalué par approximation à un grain. Liqueurs que l’on
proferit par gouttes. Quelques-unes de ces liqueurs ont
tiré de là le nom de gouttes. Comment cette forme de reniede
efl appellée dans Gaubius. La pharmacopée de Paris renferme
deux compofitions fous le nom de gouttes. VII. 7 7 t .
a . Gouttes d’Angleterre anodynes. Gouttes d’Angleterre cé-
pbaliques. Compofitions des unes 8c des autres. Ibid. b.
G o u t t e s d e G o d d a r d , ( Chymie) vertus qu’on leur at-
tribuoit. Charles- I I , roi d’Angleterre eut beaucoup de peine
à obtenir pour 20000 écus le fecret de ces gouttes. Le roi
le communiqua enfuite à fes médecins, qui cependant continuèrent
de faire un myflere de cette compofition. M. de
'Toiirnefort l ’a enfin rendue publique, 8c on en trouve ici
la maniéré. Ces gouttes n’ont aucun avantage fur les préparations
de la corne de cerf 8c du fel ammoniac. Cependant
leur préparation nous apprend comment il faut faire les
fels volatils huileux. Méthode à fuivre pour cela. VII. 7 7 1 .
b. Ces fels volatils huileux pafleteçt dans les commence-
mens pour des panacées ; de forte qu’on les multiplia de
tous cotés. Autres remedes auxquels les gouttes de goddard
ou d’Angleterre ont fait place. Ibid. 772. a.
Gouttes jaunes du général de la Mothe. XI. 526. a.
G o u t t e , ( Horlog. ) Ufaee, defeription, fituation de la
goutte de la grand’roue. VII. 772. a.
G o u t t e - c o n su l a i r e (Ju r ifp .) IV . 107. a.
G o u t t e , ( Médec. ) Comment les Grecs 8c les Latins ont
exprimé cette maladie. Les auteurs latins fe font barbarc-
ment fervis du mot gutta, pour nommer quelques maladies
fort différentes entr’elles. C ’eft la douleur des articulations,
îorfqu’elle eft l’effet d’une caufe cachée 8c ignorée qui ca-
ra&erife la goutte. Maladies dont il faut la diftinguer; VIL
772. a. Il y a lieu de penfer que les anciens n’ont pas fait
la différence de ces maladies comme nous la faifons. Dcfc
cription très-détaillée de la goutte. Ibid. b. Elle fc borne
communément aux pieds, aux mains 8c à la hanche. Noms
particuliers que les Grecs lui ont donnés pour exprimer le
fiege de cette maladie. Prefque aucun goutteux ne le devient,
félon la remarque de Galicn, qu’il n’ait commencé
par être podagre. La douleur n’eft pas le feul fymptôme
de la goutte exiflante. Autres fymptômes qui l’accompagnent.
Dépôts que la goutte laide en vieilliffant fur les parties
qu’elle attaque. Effets qu’elle prodyit auffi fur les os &
les mouvemens des membres. Ibid. 773. 4. Oit diflingue
la goutte en régulière 8c irréguhere , ou remontee. La
goutte confidérée en, elle-même eft d’un bon ou d’un mauvais
caraftere, fimple ou nouée. Ibid. b. Autres différences
de la goutte. Goutte récente ou douteufe , ancienne ou
confirmée. Goutte fixe, goutte vague. Goutte^particulière
ou univerfélle. Goutte héréditaire ou accidentelle. Obferva-
fions for la diflinftion que fait Mufgrave de goutte idiopa-
tique 8c fymptomatique. Caufes de ,cettç maladie. Ibid. 774.
a Obfervation particulière fur les yvrognes goutteux : lau-
icur remarque que le nombre en eft très-petu. Vins qui
font regardés généralement comme un préfcrvatif de la
goutte. La Bourgogne 8c la Champagne font prefque exemptes
de la goutte, félon M. Liger. Le vin ne doit pourtant
pas fe trop glorifier de fa nouvelle fortune ; puifquc 1 eau le
glorifioit depuis long-tems de l’honneur d’être un fpécifique,
quand le v in , convaincu d’être le feul coupable, eft venu Je
fui enlever. Il en efl des excès de Vénu«; comme de ceux de
Bacchus ; fi les intempérans deviennent goutteux , ils ont
cela de commun avec les plus retenus. Il n W aucun exces
en particulier qui ait la propriété de produire la goutte ;
mais il peut en développer le principe, qui demeurait auparavant
caché. Pourquoi les gens de campagne font peu fu-
iets à cette maladie. Ibid. b.. Non feulement la nature du
levain goutteux eft inconnue; on n’eft pas même d accord
touchant le vrai fiege de la goutte. Dxverfes confiderations
qui femblent prouver que la parue fur lamelle le levai«
G O U 851
goutteux fe fixe principalement, c’cft le périoile de îh tète
des os. U ne paroît donc pas que ce foit la fynovie qui foie
1 humeur infectee ; l expérience p rouve, au contraire, qu’elle
efl la dernière attaquée. DiaghojUc. Divers figues auxquels on
peut fe rccohnoitre attaqué de la goutte. Ibid. 775. à Ceux
par lefqueis la goutte irrégiiliere 0.1 rémontée fe manifeflc.
Prognofiic. La goutte , quand e lle n’eft point troublée dans
fon cours, ne devient mortelle qu’après un long-tems 8c dans
la vieilleffe. Caufes de la goutte irrégulière ou remontée î
celle-ci efl prefque toujours mortelle. Durée.ordinaire des
intermittences de la gofitte. Lorfque l’intermittence a été plus
longue que de coutume, le premier accès efl d’autant plus
violent, qu’il a différé plus long-tems. Ibid. b. Raifons qui
doivent faire douter de prétendues guérifons de cette maladie.
Tous les médecins cependant conviennent qu’il efl poffibla
de trouver le moyen de la dompter, pourvu qu’elle ne foit
ni héréditaire , ni invétérée , ni nouée ; mais qu’elle ait été
guérie parfaitement, fi ce n’e il par Lafard * c’eft ce dont o n
peut douter. Le remede en efl encore-ignoré. Langage que
Lucain fàifoit tenir'à la goutte. Divers exemples allégués de
guérifons de gouttes opérées par différens fpécifiques, mais
dont notre auteur fe garde bien de garantir la vérité. Ibid*
776. a. Autres exemples de guérifons extraordinaires, opé »
rées par la jo ie , la crainte & les douleurs. .Traitement. Le
meilleur remede pendant la douleur | c’eil la douleur même.
Les moyens employés pour l’adoucir, la prolongent le plus
fouvent, la font dépofer 8c quelquefois remonter. Ibid. b.
Ufage de la faigndw , lorfque la fievre eft de la partie, que
les douleurs font intolérables, 8c le goutteux jeune. Cata-
plafme à employer en même tems. Obfervations fur la fai-
gnée à la partie malade. Les fangfuçs peuvent fouvent tenir
Heu de faignée. Régime que doit obferver le malade. Situation
dans laqnelle on doit tenir le membre fouffrant. Applications
les plus utiles 8c les plus innocentes qu’on a trouvées,’
Obfervations fur les bains. Ibid. 7 7 7 . a. D e l’ufage du feu
contre la goutte ; du fouet avec les orties pour attirer le
levain en-dehors/ Boitions preferites. Emplâtre de Tachenius.
Topique indiqué par M. James, propre à abréger la durée
du paroxyfme. Ufage du baume de foufre térébentbiné , de
la térébenthine elle-même & de différens baumes. Application
des Hthotntriptiques, des fels lixiviels, des abforbans ,
des favons. Remedes intérieurs. Obfervations fur l’ufage de
la purgation. Ibid. b. L e véritable fens d’attaquer la goutte «
c’cft dans l’intervalle des accès. Remedes à employer au
printems, en été 8c en automne. Ufage du favon blanc ou
médicinal. Le meilleur remede qu’on ait encore trouvé juf-
qu’ic i, c’eft un bon régime de vivre. Ibid. 778. a. Obfervations
dcSydenhamfur l’ufnge du lait 8c des purgatifs.Traitementde
la goutte nouée. Celui de la goutte remontée. Ibid. b.
Goutte. L ’huile de cacao appaife les douleurs de la goutte.’
IL ço2. a. Goutte aux mains.. JIL 348. b. Les goutteux font
quelquefois guéris par la dyffenterie. V. 170. b. Spécifiques
contre la goutte. VII. 643. b. X V . 443. a. Danger de l’ufage
du quinquina dans cette maladie. XII. 363. a. D e l’ufage des
topiques. XVI. 419. b. Feves du baronareca , fouveraines
dans cette maladie. Suppl. I. 804. a. Moyens de rappeller
une goutte remontée. A. 442. b. Confeils que donne la goutte
dans Lucien à ceux qui en font attaqués. ¡XIV. 784. a. Rhunu-
tifme goutteux, voyc^ R h u m a t i s m e .
G o u t t e - r o s e , ( Médec.) efpccc de maladie ae la peau«’
Noms que lui donnent les Arabes. VII. 778. b. Symptômes
caraâérifliques de cette maladie. Quelques auteurs ont diflin-
gué trois degrés dans fes progrès. Caufes de la goutte-rofe.
Lorfqu’elle efl parvenue au troifieme ou même au fécond
degré, elle efl prefque incurable. Ibid. 779. a. Traitement de
la'goutte-rofe commençante. Ibid. b.
Goutte-rofe.' Opération que quelques auteurs propofent contre
cette maladie. VIII. 412. b.
Gouttc-fereinc,, maladie dans laquelle l’organe de la vifiotl
efl rendu paralytique. Etat apparent de l’oeil dans cette
maladie. V il. 779. b. Différentes1 manières dont cette maladie
fe déclare. Symptômes qui précèdent on qui accompagnent
la goutte-fereine. Goutte-fereiné périodique , à laquelle
quelgucs perfonnes font fujettes. Différens degrés dans
1 intenfué du mal. D ’où vient la diflinftion de goutte-fereine
en imparfaite 8c parfaite. Caufe prochaine de cette maladie.
Origine du nom de goutte-fereine. Ibid. 780. a. Obfervations)
faites fur le nerf opdque de ceux qui .font morts avec cette
maladie. Caufe de la goutte-fereine périodique ; celle d > la
goutte-fereine imparfaite. Singularité .obfervée dans une
goutte-fereine de cette derniere efpece. Ibid. b. Toutes les
caufes occafionnelles de la paralyfie en général, auxquelles
fe joignent dés caufes particulières, qui en déterminent l’effet
fur l’organe immédiat , peuvent donner lieu à la goutto
fereine. Enumération de ces différentes caufes. En quels cas
Cette maladie efl jugée incurable. Quelle efl celle qu’on
peut entreprendre de guérir. Curation de Ja goutte-fereine.
Ibid. 781. a. (
Goutte-fereine. Caufe de l’infenfibiiité de l’iris dans cettç