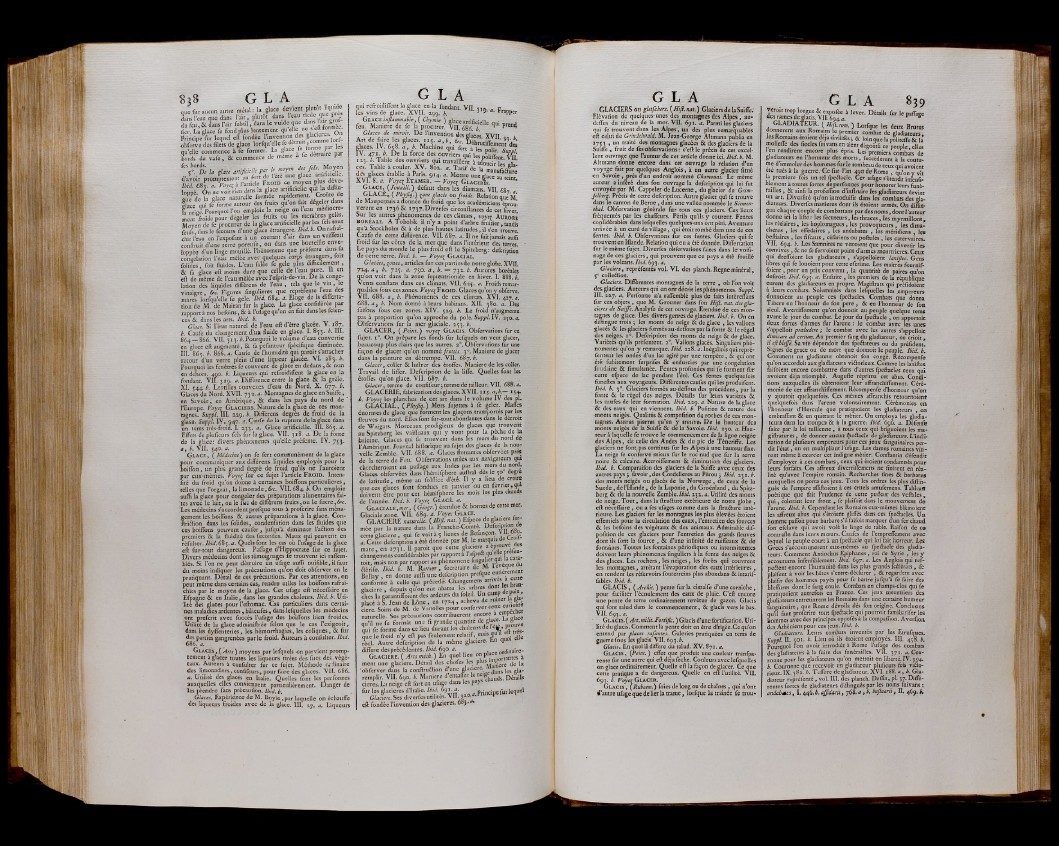
838 G L A
que fur aucun autre métal: la glace J e y j ^ t t ô t g ^
dans l'eau que dans l’air, p«tôt d an s il.e a u t fd ç que' . g
du feu, & dans l’air fubttl, d an s le v u id e que dans; 1 air gr
fier. La glace fe fond plus lentement quelle ne: ! e l l t ° .
Principe fur lequel erf fondée 1 invention des
olifcrve des filets de glace lorfqu'elle
a % » 0^ f , V c t t u c e r-de m ^ eC a fe détruire par
! i * « « r <1 avoir Dromntcmenr aæu tor ror=n »î é- r Ï Ï n e g S c f .a r t S "
eue do la glace naturelle formée rapidement. Croûte de
elace nui fe forme autour des fruits quon fait dégeler dans
fa neige. Pourquoi l’on emploie la neige ou 1 eau médiocrement
froide pour dégeler les fruits ou les membres gelés.
Moyen de fe procurer de la glace artificielle par les fels tout
fenls, faus le fecours d’une glace étrangère. Ibid. t . On rafraîchir
l’eau en l’cxpofant à un courant d air dans un vailleau
conftruit d’une terre poreufe, ou dans une bouteille enveloppée
d’un linge mouillé. Phénomène que prélente dans la
congélation l’eau mêlée avec quelques corps étrangers, loit
folides, foit fluides. L’eau folée fe gele p us difficilement,
8c fa glace eft moins dure que celle de 1 eau pure. 11 en
eft de même de l’eau mêlée avec l’efprit-de-vin. De la congélation
des liquides différens de l’e a u , tels que le v in , le
vinaigre, &c. Figures .fmgulieres que repréfente leau des
mares lorfqu’elle fe gele. Ibid. 684. a. Eloge de la diflerta-
tion de M. de Mairan fur la glace. La glace confidéree par
rapport à nos befoins, & à l’ufrge qu’on en fait dans les icien-
ces & dans les arts. Ibid. b.
Glace. Si l’état naturel de l’eau eft dêtre glacée. Y . 187.
b. Caufe du changement d’u a fluide en glace. I. 853. b. III.
864 — 866. VII. 313. ¿.Pourquoi le volume d’eau convertie
en glace eft augmenté, & fa pefanteur fpécifique diminuée.
III. 863. b. 866. a. Caufe de l’humidité qui paroît s’attacher
autour d’un verre plein d’une liàueur glacée. V I. 283. b.
Pourquoi les fenêtres fe couvrent de glace en dedans, oc non
en dehors. 490. b. Liqueurs qui refroidiffent la glace en la
fondant. VIL 319. a. Différence entre la glace & la grêle.
XI. 544. b. Lentilles convexes d’eau du Nord. X . 677. b.
Glaces du Nord. XVII. 73 a. a. Montagnes de glace en Suiffe,
en Savoie, en Amérique, & dans les pays du nord de *
l’Europe. Voyez G l a c i e r s . Nature de la glace de ces montagnes.
Suppl. IIL 229. b. Différens degrés de froid de la
glace. Suppl. IV . 940. a. Caufe de la rupture de la glace dans
un tems très-froid. I. 233. a. Glace artificielle. III. 863. a.
Effets dèpluficurs fels fur la glace. VII. 318. a. D e la fonte
de la glace: divers phénomènes qu’elle préfente. IV . 733.
a , b. VII. 340. a.
G la c e , ( Médecine') on fe fert communément de la glace
lour communiquer aux différens liquides employés pour la
jo iflon , un plus grand degré de froid qu’ils ne l’auroient
par eux-mêmes. Voye| fur ce fujet l ’article F r o id , lnten-
fité du froid qu’on donne à certaines boiffons particulières,
telles que l’orgeat, la limonade, Grc. VII. 684. b. On emploie
aufli la glace pour congeler des préparations alimentaires faites
avec le lait, ou le lue de différens fruits, ou le fucre,6*c.
Les médecins s’accordent prefque tous à profcrire fans ménagement
les boiffons & autres préparations à la glace. Con-
ftriétion dans les folides, conaenfrtion dans les fluides que
ces boiffons peuvent caufer, jufqu’à diminuer l’aélion des
premiers 8c la fluidité des fécondés. Maux qui peuvent en
réfulter. Ib id.683. a. Quels font les cas où Image de la glace
eft fur-tout dangereux. Paflage d’Hippocrate fur ce lujet.
Divers médecins dont les témoignages fe trouvent ici raffem-
blés. Si l’on ne peut détruire un ufage aufli nuifible,ilfaut
du moins indiquer les précautions qu’on doit obferver en le
pratiquant. Détail de ces précautions. Par ces attentions, on
peut même dans certains cas, rendre utiles les boiffons rafraîchies
par le moyen de la glace. Cet ufage eft'néceflaire en
“ Italie, dans les grandes chaleurs. Ibid. b. Uti-
pour l’eftomac. Cas particuliers dans certai-
E
Efpagne 8c en Uti
:è des glaces p< " ^
nés maladies ardentes ,bilieufes, dans lefquelles les médecins
lltl
ont preferit avec fuccès l’ufage des boiffons bien froides,
Utilité de la glace adminiftrée félon que le cas l’exigeoit,
dans les dyffenteries, les hémorrhagies, les coliques, 8c fur
des parties gangrenées parle froid. Auteurs à confulter. Ibid.
686. a.
G laces, ( J im ) moyens par lefqnels on parvient promptement
à glacer toutes les liqueurs tirées des fucs des végétaux.
Auteurs à confulter fur ce fujet. Méthode cvdinaire
G L A qui refroidiffent la glace en la fondant. VII o ,A * r
les vins de glace. XVII. 299. b. 3 9* ‘ FraPPer
G lace inflammable, ( Chymie ) glace â r fi& u iu
feu. Maniéré de fe la procurer. V l ï 686 ï ¡ P prCnd
g la ce , IV 6 ,8 . a t . Machine ,„ 1 fe „ i t o " ' 4W
des limonadiers »confifeurs, pour faire des glaces. V II. 686.
a. Utilité d,es glaces en Italie. Quelles font les perfonnes
auxquelles elles conviennent particulièrement. Danger de
les p'rendre fans précaution. Ibid. b.
.Glaces. Expérience deM . Boyle ,par laquelle on échauffe
des liqueurs froides avec de la glace. 111. 27. a. Liqueurs
4/ t ki ? « f° r -e h lespollffec W
' i 3. L Table des ouvriers qui travaillent àaifoucir les ela-
ces. Table à couler. X V . 802. a. T arif de la man«Sa»
des glaces établie à Paris. 914. a. Mettre une elace I I S L t
X V I . 8. p Voye[ E tam e r . - Voye^ G la c e r I e tCUlt*
G l a c e , (J o u aU l.) défaut dans les diamans. VII. 687 a
I G LA C É * ( Phyfiq. ) [O n e glacée ou f r o i d e . Relation que M*
de Maupentuis a donnée du froid que les académiciens éprou^
verent en 1736 8c i737.Diverfes circonftances de cet hiver.
Sur les autresphénomenes de ces climats, voye^ A u ro r e
b o r é a le . A T o b o ls k il n’y a point d’arbre fruitier, tandis
Ïu’à Stockholm 8c à de plus hautes latitudes, il s’en trouve
:»ufe de cette différence. VII. 687. a. Il ne frit jamais aufli
froid fur les côtes de la mer que dans l’intérieur des terres.
Le pays du monde le plus froid eft le Spitzberg : defeription
de cette terre. Ibid. b. — Voye^ G la c ia l .
GlacéeSy {(ones, articles fur ces parties de notre globe. XVII.
724. a y b. 723. a. 730. a y b. — 73 a. b. Aurores boréales
qu’on voit dans la zoue feptentrionale en hiver. I. 888. b.
Vents conftans dans ces climats. V II. 623. a. Froids remarÏuables
foiis ces zones. Voye{ F r o id . Glaces qu’on y obferve.
rll. 688. a y b. Phénomènes de ces climats. XVI. 427. a.
188. a y b. Nom donné à leurs habitans. XII. 380. a. Des
faifons fous ces zones. X IV . 329. b. Le froid n’augmente
pas à proportion qu’on approche du pôle. Suppl. IV. 230. a.
Obfervations fur la mer glaciale. 233.b .
G L A C E R , ( P e in t . ) voye\ G la cis . Obfervations fur ce
fujet. i°. On prépare les fonds fur lcfquels on veut glacer,
beaucoup plus clairs que les autres. 20. Obfervations fur une
façon de glacer qu’on nommé frottis. 30. Maniéré de glacer
dans la peinture en détrempe. V II. 687. b.
Glacer, coller 8c luftrer des étoffes. Maniéré de les coller.
Travail de liffer. Defeription de la iiffe. Quelles font les
étoffes qu’on glace. V II. 687. b.
Glacer, terme de confifeur; terme de tailleur. V II. 688. a.
G LACER IE, fabrication des glaces. XVII. 113./*, b.— 134.
b. Voyez les planches de cet art dans le volume IV des pl.
G L A C IA L , ( Phyfiq. ) Mers fujettes à fe geler. Maffes
énormes de glace que forment les glaçons tranfportés par les
fleuves du nord. Elles font fur-tout abondantes dans le détroit
de Waigats. Morceaux prodigieux de glaces que trouvent
au Spitzberg les vaiffeaux qui y vont pour la pêche de la
baleine. Glaces qui fe trouvent dans les mers du nord de
l’Amérique. Journal hiftoirique au fujet des glaces de la nouvelle
Zemble. V II. 688. a. Glaces flottantes obfervées près
de la terre de Feu. Obfervations utiles aux navigateurs qui
chercheroient un paflage aux Indes par les mers du nord.
Glaces obfervées dans l’hémifphere auftral dès le 30 degré
de latitude, même au folftice d’été. Il y a lieu de croire
que ces glaces font fondues en janvier’ ou en février, qui
doivent être pour cet hémifphere les mois les plus chauds
de l’année. Ibid. b. V rye^ G la c é . a-
G l a c ia l e , mer, ( Géogr.) étendue 8c bornes d| cette mer.
Glaciale zone. V II. 689. a. Voyez G lace. -
GLACIER E naturelle. (H ift . n a t.) Efpece de glâciere for
m 6c par la nature dans la Franche-Corati. OefcninKmde
cette glacière, qui fe Toit à , lieues de Befançon. V U . 6 *
a. Cette defeription a été donnée par M, le marquis de Croit
mare, en .7 3 1 . 11 parolt que cette P ^ I B i g S g
cltangemensconfidérables par rapport à 1 afpe& qu P
toit, mais non par rapport au phénomène fmguh .3 .
aérife. Ibid. b . M. R a vie r , fecréta.re de M. le v èqw u u
Bellay , en donne aufli une defeription prefque ®n, ‘ [ CÊtte
conforme à celle qui précédé: Changemens arri .
glaciere , depuis qu’on eut abattu les arbres d . ¡x
éiies la garantiffoient des ardeurs du folcil. Un c p P
placé à S. Jean de Lône , en 1 7 2 4 , acheva
ciere. Soins de M. de Vanolles pour conferver cette: cur
naturelle. Ses précautions contribuèrent encore à cmp
qu’il ne fe formât une fi grande quantité: de g la e j L^glace
qui fe forme dans ce lieu durant íes chaleurs de 1
que le froid n’y eft pas feulement relatif, mais qu :j^
réel. Autre defeription de la même glaciere. En q
différé des précédentes. Ibid. 690. a. „«tinaire-
G la CIERE. ( A n s méch. ) En quel lieu on pía antcs ¿
ment une glaciere. Détail des chofes les p lu s^ ^ ja
'obferver dans la conftruftion d’une glaciere. \ ns jes _
remplir. V II. 690. b. Maniéré d’entaffer la | | | , . Détails
cieres. La neige eft fort en ufage daers les pay
fur les glacières d’Italie. .^.„.Prin cipe fur lequel
Glaciere. Ses diverfesutilités. V il. 3*°
eft fondée l’invention des glacières. o “3*
G L A
GLACIERS ou gletfchers. (H ifi. nat. ) Glaciers de la Suifle.
Élévation de quelques-unes des montagnes des Alpes, au-
deffus du niveau de la mer. VU. 691. a. Parmi les glaciers
qui fe trouvent dans les Alpes, un des plus remarquables
eft celui de GrindelwaLf. M. Jean-George Altmann publia en
1733 , un traité des montagnes glacées 8c des glaciers de la
Suiffe , fruit de fes obfervations : c’eft le précis de cet excellent
ouvrage que l’auteur de cet article donne ici. Ibid. b. M.
Altmann donne encore dans cet ouvrage la relation d’un
voyage frit par quelques Anglois, à un autre glacier fitué
en Savoie »près d’un endroit nommé Chamouni. Le même
auteur a inféré dans fon ouvrage la defeription qui lui fut
envoyée par M. Cappeler de Lucerne, du glacier du Grim-
felberg. Précis de cette defeription. Autre glacier qui fe trouve
dans le canton de B erne, dans une vallée nommee le Siemen-
thal. Obfervation générale fur tous ces glaciers. Ces lieux
fréquentés par les chafleurs. Périls qu’ils y courent. Fentes
conftdérables dans lefquelles quelques-uns ont péri. Aventure
arrivée à un curé de village, qui étoit tombé dans une de ces
fentes. Ibid. b. Obfervations lur ces fentes. Glaciers qui fe
trouvent en Ifiande. Relation qui en a été donnée. Diflertation
fur le même fujet. Diverfes obfervations frites dans le voifi-
nage de ces glaciers, qui prouvent que ce pays a été fouillé
par les volcans.Ibid.693.a .
Glaciers y repréfentés vol. V I. des planch. Regne minéral,
3e colleâion.
Glaciers. Différentes montagnes de la terre , où l’on voit
fies glaciers. Auteurs qui en onr décrit les phénomènes. Suppl.
III. 227. a. Perfonne n’a raflemblé plus de faits intérelfrns
fur ces objets , que M. Grouner dans fon Hift. nat. des glacières
de Suifle. Analyfe de cet ouvrage. Etendue de ces’ montagnes
de glace. Des divers genres de glaciers. Ibid. b. On en
diuingue trois ; les monts de neige 8c de glace , les vallons
-glacés 8c les glaciers formés au-deflous parla fonte 8c le régel
des neiges. i° . Defeription des monts de neige 8c de glace.
Variétés qu’ils préfentent. z°. Vallons glacés. Singuliers phénomènes
qu’on y remarque. Ibid. 228. a. Inégalités qui repré-
fentent les ondes d’un lac agité par une tempête, oc qui ont
été fubitement furprifes 8c endurcies par une congélation
foudaine 8c flmultanée. Fentes profondes qui fe forment fur
cette efpece de lac pendant 1 été. Ces fentes quelquefois
funeftes aux voyageurs. Différentes caufes qui les prodiiifent.
Ibid. b. 30. Glaciers formés au-deffous des précédens, par la
fonte 8c le régel des neiges. Détails fur leurs variétés 8c
les caufes de leur formation. Ibid. 229. a. Nature de la glace
8c des eaux qui en viennent. Ibid. b. Pofition 8c nature des
-monts neiges. Qualités 8c compoiition de roches de ces montagnes.
Autres pierres qu’on y trouve. D e la hauteur des
monts neigés de la Suifle 8c de la Savoie. Ibid. 230. a. Hauteur
à laquelle fe trouve le commencement de la ligne neigée
des Alpes, de celle des Andes 8c du pic de Téneriffe. Les
glaciers ne font.pas continus fur les Alpes à une hauteur fixe.
La neige fe conlerve mieux fur le roc nud que fur la terre
noire 8c calcaire. Accroiffemens 8c diminution des glaciers.
Ibid. b. Comparaifon des glaciers de la Suifle avec ceux des
autres pays ; favoir ,des Cordclieres au Pérou j Ibid. 23 r. b.
des monts neigés ou glacés de la Norwege, de ceux de la
S^ede, de l’Ifiande, de la Laponie, du Groenland, du Spitzberg
8c de la nouvelle Zemble. Ibid. 232. a. Utilité des monts
de neige. T o u t , dans la ftrufture extérieure de notre globe,
eft néceflaire, ou a fes ufages comme dans la ftruâure intérieure.
Les glaciers fur les montagnes les plus élevées étoient
effentiels pour la circulation des eaux, l’entretien des fources
8c les befoins des végétaux 8c des animaux. Admirable dif-
pofition de ces glaciers pour l’entretien des grands fleuves
dont ils font la fource, oc d’une infinité de ruiffeaux 8c de
fontaines. Toutes les fontaines périodiques ou intermittentes
doivent leurs phénomènes fmguliers à la fonte des neiges 8c
des glaces. Les rochers, les neiges, les forêts qui couvrent
les montagnes, arrêtant l’évaporation des eaux intérieures,
en rendent les réfervoirs fouterreins plus abondans 8c intarif-
fables. Ibid. b.
G LA C IS , ( Archit. ) pente fur la cimaife d’une corniche,
pour faciliter l’écoulement des eaux de pluie. C ’eft encore
une pente de terre ordinairement revêtue de gazon. Glacis
qui (ont talud dans le commencement, 8c glacis vers le bas.
VII. 693. a.
G lacis. ( Art. miltt. Fortifie. ) Glacis d’une fortification. Utilité
du glacis. Comment la pente doit en être dfrigée. Ce qu’on
entend par places raflantes. Galeries pratiquées en tems de
guerre fous les glacis. VII. 603. b.
Glacis. En quoi il différé du talud. X V . 871. a.
G lacis , (Peint. ) effet que produit une couleur tranfpa-
rente fur une autre qui eft déjà feche. Couleurs avec lefauelles
on glace ordinairement. Quelle eft la façon de glacer. Ce que
cette pratique a de dangereux. Quelle en eft l’utilité. VII.
693. b. Voyez GLACER.
G lacis , (Rubann.) foies de long ou de chaînes, qui n’ont
«Tautrc ufage que de lier la trame, lorfque la traînée fe trou-
G L A 839
lcvcn Déuas
^ ^ Lori1ue <>«»* BrUtllS
oonnerent aux Romains le premier combat de gladiateurs,
¿ M m m & poiiteirc et la
mollefle des fiecles fiuvans en aient dégoûté ce peuple, elles
1 etl rendirent encore plus épris. Les premiers combats de
gladiateurs en l’honneur des morts, fitccéderent à la coutu-
me d’immoler des hommes fur le tombeau de ceux qui avoient
été tués à la guerre.1 C e fut l’an 400 de Rome , qu’on y vit
ja première fois un tel fpefracle. Cet ufage s’étendit infenfi-
blemcnt à toutes fortes de perfonnes pour honorer leurs fiwê-
railles, 8c ainfi la profeflion d’inftruire les gladiateurs devint
un art. Divcrflté qu’on ijitroduifit dans les combats des gladiateurs.
Diverfes maniérés dont ils étoient armés. On diftin-
gua chaque couple decombattans par des noms, dont l’auteur
donne ici la lifte: les fécuteurs, les thraces, les niyrmillons,
les rétiaires, les hoplomagues, les provoqueurs, les diina-
cheres , les effedaires , les andabates , les méridiens les
beftiaires, les fifeaux, céfariens ou poftulés, les catervaires.
VII. 694. b. Les Samnites ne venoient que pour divertir les
convives , 8c ne fe fervoient point d’armes meurtrières. Ceux
qui dreffoient les gladiateurs , s’appelloient laniftes. Gens
libres qui fe louoient pour cette eferime. Les maîtres fournif-
foient, pour un prix convenu , la quantité de paires qu’on
defiroit. Ibid. 693. a. Enfuite, les premiers de la république
eurent des gladiateurs en propre. Magiftrats qui préfidoient
à leurs combats. Solemnités dans lefquelles les .empereurs
donnolent au peuple ces fpcâacles. Combats que donna
Tibere en l’honneur de fon pere , 8c en l’honneur de fon
aïeul. Avertiffement qu’on donnoit au peuple quelque tems
avant le jour du combat. Le jour du fpeftacle, on apportoit
deux fortes d’armes fur l’arene : le combat avec les unes
s’appelloit praludere ; le combat avec les autres s’appelloit
dimicare ad certum. Au premier fang du gladiateur, on crioit,
i l eft bleflé. Sa v ie dépendoit des fpeftateurs ou du préfident.
Signes de grâce ou de mort que donnoit le peuple. Ibid. b.
Comment un gladiateur obtenoit fon congé. Kécompenfe
qu’on accordoit aux gladiateurs vifrorieux. Comme les laniftes
faifoient encore combattre dans d’autres fpefracles ceux qui
avoient déjà triomphé. Augufte réprima cet abus. Conditions
auxquelles ils obtenoient leur affranchiffement. Cérémonie
de cet affranchiffement. Récompenfe d’honneur qu’on
y ajoutoit quelquefois. Ces mêmes affranchis retoumoiene
quelquefois dans l’arene volontairement. Cérémonies en
l’honneur d’Hercule que pratiquoient les gladiateurs , en
embraffant 8c en quittant le métier. On employa les gladiateurs
dans les troupes 8c à la guerre. Ibid. 696. a. Défcnfe
frite par la loi tullienne, à tous ceux qui briguoient les ma-
giftratures, de donner aucun fliefrade de gladiateurs. L ’inclination
de plufieurs empereurs pour ces jeux frnguinaires perdit
l’état, en en multipliant l'ufage. Les dames romaines v inrent
même à exercer cet indigne métier. Conftantin défendit
d’employer à ces combats y ceux qui étoient condamnés pour
leurs forfaits. Ces affreux divertiflemens ne finirent en réalité
qu’avec l’empire romain. Recherches fines 8c barbares
auxquelles on porta ces jeux. Tous les ordres les plus diftiii-
gués de l’empire affiftoient à ces crüels amufemens. Tableafl
poétique que frit Prudence de cette pudeur des v efh le s,
q u i, colorant leur fro n t , fe plaifoit dans le mouvement de
l’arene. Ibid. b. Cependant les Romains-eux-mêmes blâmoient
les affreux abus qui s’êtoient gliffés dans ces fpeétacle's. Un
homme paffoit pour barbare s’il faifoit marquer d’un fer chaud
fon efclave qui avoit volé le linge de table. Raifon de ç»
contrafte dans leurs moeurs. Caufes de l’emprefTement avec
lequel le peuple court à un fpeâacle qui lui fait horreur. Les
Grecs s’accoutumèrent eux-mêmes au fpeâacle des gladiateurs.
Comment Antiochus Epiphanes, roi de Syrie , les y
accoutuma infenfiblement. Ibid. 697. a. Les Anglois qui ref-
peftent encore l’humanité dans les plus grands lcélérats, fe
platfent à voir les bêtes s’entre-déchirer , 8c regardent avec
piaifir des hommes payés pour fc battre jufqu’à fe frire des
bleflùres dont le fang coule. Combats en champs-clos qui fe
pratiquoient autrefois en France. Ces jeux meurtriers des
gladiateurs entretinrent les Romains dans une certaine humeur
fanguinaire, que Rome dévoila dès fon origine.. Concluons
qu’n faut profcrire tout fpeôacle qui pourroit frmiliarifer les
hommes avec des principes oppofés à la compafllon. Averfion
des Athéniens pour ces jeux. Ibid. b.
Gladiateurs. Leurs combats inventés par les Etrufqnes.
Suppl. II. 901. b. Lieu où ils étoient employés. III. 438. b.
Pourquoi l’on avoit introduit à Rome l’ufage des combats
des gladiateurs à la fuite des funérailles. VH. 371. a. Coudiateur
repréfenté, vol. III. des planch. Deffin, pl. 37. D ifférentes
fortes de gladiateurs diftingués par les noms fuivans :
andabates y I. 446. b. aflidarii, 760. a , b. bufiuarii, Q. 469. b»