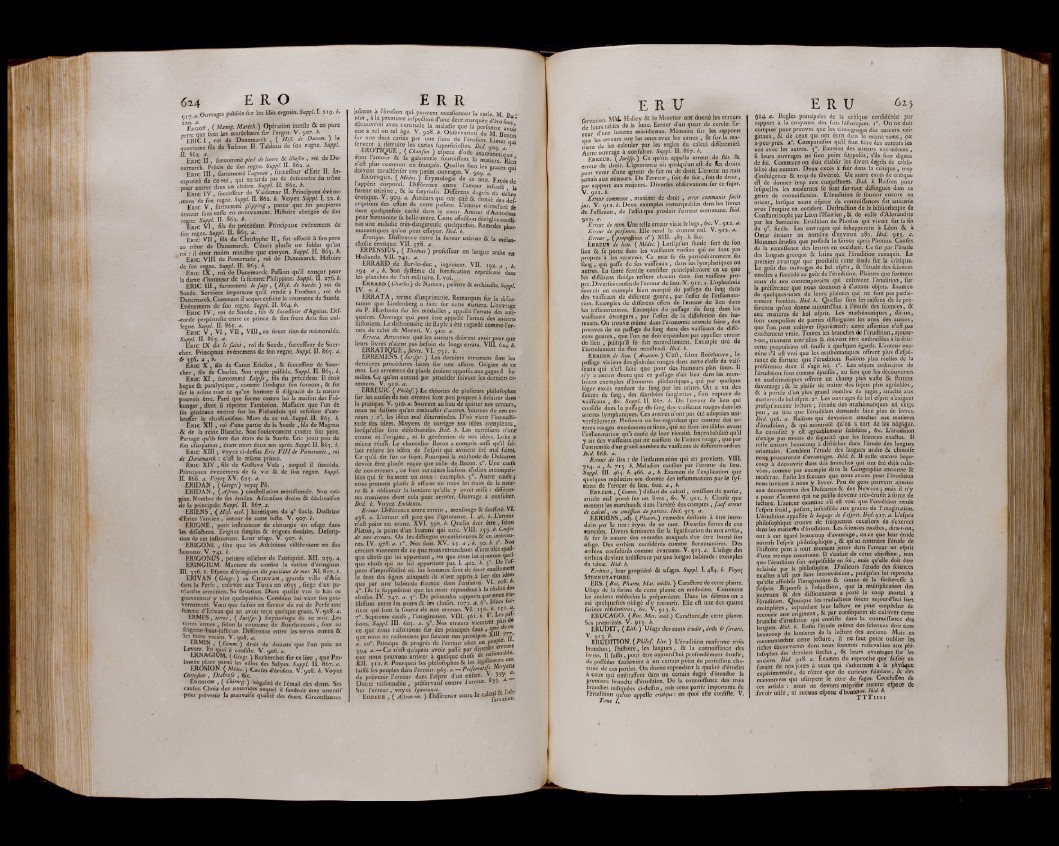
6 2 4 E R O
Ouvrages publies fur les blés ctgotés.Suppl. L 219. | i
2ÎEbGOT, (Maneg. Marée h.) Opération inutile & en pure
aerte que font les maréchaux fur l’ergot. V. 907. b.
ERIC I roi de Danemarck , ( Hijt. de Danem. ) le
quatrième fils de Suénon II. Tableau de fon règne. Suppl.
Eric I I , furnommé pied de lievre 8cilluffre, roi de Danemarck.
Précis de fon règne. Suppl. IL 96%. a.
Eaïc IU , furnommé l'agneau , fucceffeur d Enc II. Incapacité
de ce roi, qui ne tarda pas de dcfccndrc du trône
pour entrer dans un cloitrc. Suppl. II. 062. b.
Fmc IV (ucccffcur de VaJdcmar II. Principaux événe-
.mens de fon règne. Suppl. IL 86z. b. Voyez Suppl L ta. b.
Eric V , furnommé güpping, parce que fes paupières
étoient fans ccffe en mouvement. Hiftoire abrégée de fon
règne. Suppl» II. 862. b.
E r ic v l , fils du précédent. Principaux évenemens de
fon reine. Suppl. II. 863. a.
Eric V I I , fils de Cnriftophc I I , fut aflocié a fon pere
au trône de Danemarck. Cétoit plutôt un foldat au’un
roi ; il étoit moins miniftre que citoyen. Suppl. II. 802. b.
Eric VIII de Poméranie, roi de Danemarck. Hiftoire
Ai> Cnn rttanc. Suppl. II. 863. b.
, roi de Danemarck. E r i c 1 PaiUon qu’il conçut pour
la dame d’honneur de fa femme Philippine. Suppl. u. 470. u.
ERIC 111, furnommé le fa i t , {nifi, de Suede. ) roi de
Suede. Services importans qu’il rendit à Frothon , roi de
Danemarck. Comment il acquit enfuite la couronne de Suede.
Evénemens de fon regne. Suppl. II. 864. b.
Er ic I V , rpi de Suede , fils & fticefleur d’Agnius. Dif-
-corde perpétuelle entre ce prince & fon (rere Ane fon collègue.
Suppl. IL 865* a'
E r i c V , V I , V I I , VIII,ne firent rien de mémorable.
Suppl. IL 86 <. u.
Eric IX dit le faini, roi de Suede, fucccflcur de Sucr-
chcr. Principaux événemens de fon règne. Suppl. II. 8$5. a.
d» 356» tf , b.
Er ic X , fils de Canut Ericfon, 6c fuccefleur de Sucr-
cher , fils de Charles. Son regne paifible. Suppl. II. 86c. b.
Er ic XI , furnommé Leipfe, fils du précédent. Il croit
begue & paralytique , comme l’indique fon furnom, & fut
fur le trône tout ce qu’un homme h diigracié de la nature
pouvoit être. Parti que forme contre lui la maifon des Fol- •
kunger, dont il réprime l’ambition. Maftacre que l’un de
fes généraux exerce fur les Fintando» qui refufent d’em-
braifcr le chriftbnifmc. Mort de ce roi. Suppl. II. 865. b.
E r i c X I I , roi d’une partie de la Suede , fils de Magnus
& de la reine Blanche, son foulevement contre fon pere.
Partage qu’ils font des états de la Suede. Eric jouit peu de
fon ufurparion, étant mort deux ans après. Suppl. IL 863. b.
Er ic XIII ; voyez ci-dcftiis Eric y ¡11 de Poméranie , roi
de Danemarck : c*cft le même prince.
Eric X IV , fils de Guftave Vafii , auquel il fuccéda.
■Principaux évenemens de fit vie & de fon regne. Suppl.
IL 860. a. t'oyez XV. 62c. a.
ERIDAN ERIDAN,, (Géogr.) voye^voyez Pô.
Pi
EH IDA N , ( Aflron, ) conftcllation méridionale. Son ori-
«innee.. Nombre : de de
les étoiles. Afccnfion droite & déclinaifon
de la
la principale. Suppl. II. 867. a.
ERlENS , -( Hijï. eccl. ) hérétiques du 4* ftecle. Doârine
d’Erius l’ancien, auteur de cette fcéle. V. 907. b.
ER1GNE, petit inftrumcnt de chirurgie en ufage dans
les diffeâions. Erignes Amples & érienes doubles. Defcrip-
tion de cet inftrumcnt. Leur ufage. V. 907. é.
ERIGONE , fête que les Athéniens célébroient en fon
honneur. V. 741, b.
FR1GONUS , peintre célébré de l’antiquité. XII. 25p. a.
ER1NGIUM. Maniéré de confire la racine d’éringtum.
RI. 336. b. Efoece d’éringium dit panicaut de mer. XL 817. b.
ERIVAN ( Géoer. ) ou C h ir v a n , grande ville d’Afie
dans la Perfc, enlevée aux Turcs en 163c , fiege d’un patriarche
arménien. Sa ftruation. Dans quelle vue le kan ou
gouverneur y vint quelquefois. Combien lui vaut fon gouvernement.
Voeu que faifoit en faveur du roi de Pcrfe une
femme d’Erivan qui en avoir reçu quelque grâce. V. 908. a.
ERMES , terret, ( Jurifpr.) Etymologie de ce mot. jLés
terres ermes, félon la coutume de Bourbonnois, font au
fetgncur-haut-jufticier. Différence entre les terres ermes 6c
les biens vacans. V. 908, a.
ERMIN , ( Comm. ) droit de douane que l’on paie au
l § I | f l W d confifte. V. 908. *.
LRNAGIUM, l Géogr.) Recherches fur ce lieu , que Pto-
i n/-Cci/vvf*/"l*. s v," c* des Salyes. Suppl. IL 867. a.
EROSION. ( MU«. ) Gaiïfés 4’èraTton. V. 908. b. Voyez
Ccrrofion, Diubrolt, Oie.
Erosiok , (Cbirurg.) iuijal-.té de l'émail des dents. Ses
caufes. Choix des nourrice« auquel il faudrait être attentif
pour prévenir la mauvaife qualité des dents. Cireonllanccs
ERR
jointes à 1 érofton qui peuvent occalionner la catle, M Bu -* •
non , a la première Infpeflion d'une dent marquée d’éro'flnn *
découvrait avec certitude la maladie que la perfonne arai
eue a tel ou tel âge. V. 908. b. Obfervarion de M Bunnn
fur une dent cariée par une fuite de l'étofton. Limes «M
Ici “ ries fuperficielles. Ibid. 000 „
EROTIQUE, ( Ç/tanfm ) cljicce d'ode anacréontlque
dont 1 amour & la galanterie fournliTent la matière Rien
*? . Plui “ françols. Quelles font les grâces nu!
doivent caraélérifer ces petits ouvrages. V. 909. „ q
Ero tiq ue, ( Mitlcc.) Etymologie de ce mot. Excès de
lappeut corporel. Différence entre l’amour Infcnfé I.
fureur utérine, & le fatyriafts. Différons degrés du délire
érotique. V. 909. a. Auteurs qui ont ciré & donné des def
copiions des effets de cette paffton; L’amour démefuré fe
tient quelquefois caché dans le coeur. Amour d'Amlochua
pour Straïonice fa belle-mere. Cette affcRion dérégléeconfli.
tue une maladie irès-dangereufe quelquefois. Remets ¡fe»,
maceutiques qu’on peut effayer. ibid. b.
Erotique. Différence entre b fureur utérine 8c b mélaa-
cholic érotique. VIL 378. a.
ERPENSIUS, ( Thomas ) profeffeur en langue arabe en
Hollande. VIL 741. a.
ERRARD de Bar-le-duc , ingénieur. VIL 192. a b;
194. a , b. Son fyftéme de fortification représenté dans
les planches de l’art militaire. I. vol.,
E r r a r d ( Charles) de Nantes, peintre 8c architeâe. Suppl
IV. 7. b. * '
ERRATA, terme d’imprimerie. Remarques fur b diffçr-
tation que Lindenberg a faite fur cette matière. L’ouvrage
du P. Hardouin fur les médailles , appellé l’errata des antiquaires.
Ouvrage qui peut être appellé l’crrata des anciens
hiftoriens. Le didionnaire de Bayle a été regardé comme l’cr-
rata de celui de Moreri, V, 910, a.
Errata. Attention qué les auteurs doivent avoir pour que
leurs livres n’aient pas befoin de longs errata. VIII. Cia. b.
ERRATIQUE, fievre. VI. 731. b
ERREMENS, ( Junfpr. ) Les derniers erremens font les
■ dernières procédures faites fur une affaire. Origine de ce
mot. Les erremens du plaids étoient oppofés aux gages d batailles.
Ce qu’on entend par procéder luivant les derniers erremens.
V. 910. a.
ERREUR, f Philof. ) Le théories de pluficurs philosophes
fur les caufes de nos erreurs font peu propres à éclairer dans ■
b pratique. V. 910. a. Souvent au lieu de quitter nos erreurs,
nous ne faifons qu’en embraffer d’autres. Sources de nos erreurs
; i°. les idées mal déterminées. D’où vient l’inexadi-
tude des idées. Moyens de corriger nos idées complexes,
lorfqu’ellcs font defcûueufes. Ibid. b. Les carréfiens n’onr
connu ni l'origine , ni 1a génération de nos idées. Loke a
mieux réufti. Le chancelier Bacon a compris auffi qu’il falloir
refaire les idées de l’efprit qui avoient été mal faites«
Ce qu’il dit fur ce fujer. Pourquoi b méthode de Defcartes
devoir être plutôt reçue que celle de Bacon, Une caufè
de nos erreurs , ce font certaines liaifons d’idées incompatibles
qui fe forment en nous : exemples, 30. Autre caufc j
nous prenons pbifir & effacer en nous les traits de b nature
6c à obfcurcir la lumière qu’elle y avoir mife : différentes
manières dont'cela peut arriver. Ouvrage à confulter.
Ibid. b. "Voyez Evidence.
Erreur. Différence entre erreur, menfonge 6c fauffeté. VL
438. a. L’erreur cft pire que l’ignorance. 1. 46. b. L’erreur
n eff point un crime. XVI. 390. b. Quelle doit être , félon
Platon, b peine d’un homme qui erre. VIII. 159. b- Caufes
de nos erreurs. On les diftingue en extérieures 6c en intérieures.
IV. 978. a. 1". Nos fens. XV. 23. a , b. 30. b. Nos
erreurs viennent de ce que nous retranchons d’une idée quelque
choie qui lui appartient, ou que nous lui ajoutons quelque
ebofe qui ne lui appartient pas, I. 402. b. 3®. De 1 ci-
pecc d’impoffibilité où les hommes (ont de fixer exactement
le fens des lignes auxquels ils n’ont appris à lier des idées
que par une habitude formée dans l’enfance. VL
4". De b fuppofition que les mots répondent à la réalité des
chofes. IV. 747. a. 50. De prétendus rapports que nous êta-
bl iffons entre les noms 6c les chofos, 1072. a. 6°. Idées facn
c c s qu i ïont ia io u r te « c no» erreur», t». l i w' n ' r
7®. Septième caufc, l’imagination. VIII. 561.A. o .Lespa-
ftons. Suppl. III. 603. a. cf. Nos erreurs viennent P*H*
ce que -nous raifonnons fur des principes faux, que de
que nous ne raifonnons pas fuivant nos principes. ^
a. io°. Principe 6c progrès de l’erreur chez un
304. a.r— Ce n’eft qu’après avoir paffé par diverfe* ert’
que nous pouvons arriver à quelque cnofe n'
XII. c i l . b. Pourquoi les philofopncs 6c les
biffé les peuples dans l’erreur. 963. u. — Préfervatifi. y ,1
de prévenir l’erreur dans l'ciprit d’un enfant, v. 399- ^
Doute raisonnable, préfervatif contre l’erreur. «>33'
Sur l’erreur, voyez Ignorance. . g . y0h.
E rreur , ( Ajlronom. ) Différence entre le C3Ïcfe^ lll0n.
E R U E R U 6 2 5
f v a t io n . jvirvi. Halley 6c le Monnier ont donné les erreurs
de leurs tables de la lune. Erreur d’un quart de cercle. Erreur
d’une lunette méridienne. Mémoire fur les rapports
«me les erreurs ont les unes avec les autres , & fur b maniéré
de les calculer par les règles du calcul différentiel.
Autre ouvrage à confulter. Suppl. IL 867. b.
Erreur. ( Jurifp.) Ce qu’on appelle erreur de fait &
erreur de droit.- L'ignorance où quelqu’un eft de fcs droits
peut venir d’une yrcur de bit ou de droit. L’erreur ne nuit
jamais aux mineurs. De ferreur, foit de fait, foit de droit,
par rapport aux majeurs. Diverfcs obfcrvations fur ce fujet.
V .9 1 1 .b. . . . • r •
Erreur commune, maxime de droit , error communie jacit
jus. V. 911 .b. Deux exemples remarquables dans les livres
de Juftinien, de l’effet que produit l’erreur commune. Ibid.
912. a.
Erreur de nom. Une telle erreur vicie le legs, vc. V . 912. a.
Erreur de perfonne. Elle rend le contrat nul. V. 9 1 a‘
Erreur , ( proportion <T ) XIII. 483. b. Sec.
E rreur de lieu. ( Médec. ) Lorfqu’un fluide fort de fon
lieu & fe' porte dans les vailfcaux voifins qui ne font pas
propres à les recevoir. Ce mot fe dit particulièrement du
fang,’ qui paffe de fes vaiffeaux , dans les lymphatiques ou
autres. La fanté fcmble confiftcr principalement en ce que
les différens fluides reftent chacun dans fon vaiffeau propre.
Diverfcs caufes de l’erreur de lieu. V. 912 .a. L’ophtalmie
fournit un exemple bien marqué du partage du fang dan*
des vaiffeaux dé différent genre, par l’effet de l'inflammation.
Exemples de différens effets de l’erreur de lieu dans
les inflammations. Exemples du paffage du fang dans les
vaiffeaux étrangers , par l’effet de b diffolution des humeurs.
On trouve même dans l’économie animale faine, des
preuves de ce paffage du fang dans des vaiffeaux de différons
genres, que l’on ne doit cependant pas appellcr erreur
de lieu , puifqu’i! fe fait naturellement. Exemple tiré de
l’écoulement du flux mcnftrucl. Ibid. b.
Erreur de lieu. ( Anaiom. ) C’cft, félon Boërhaavc, je
paffage vicieux des globules rouges dans cette claffe de vaif-
ieaux qui n'eft faite que pour des. humeurs plus fines. Il
n’y a aucun doute que ce paffage n’ait lieu dans les nombreux
exemples d’hommes pléthoriques, qui par quelque
léger excès rendent du fané par les urines. On a vu tics
lueurs de fang, des diarrhées fanglantes, fans rupture de
vaiffeaux , dre. Suppl. II. 867« b. De l'erreur de lièu qui
confifte dans le paffage du fang des vaiffeaux rouges dans les
ancres lymphatiques. Ces artères n’ont pas été adoptées uni-
vcrfellcment. Plufieurs ne les regardent que comme des artères
rouges extrêmement fines, qui ne font invifibles avant
l'inflammation qu’à caufc de leur ténuité. Improbabilité qu’il
y ait des vaiffeaux qui ne naiffent de l'artere rouge, que par
f’entremifo d’un grand nombre de vaiffeaux de différens ordres.
Ibid. 868. «*. .
Erreur de lieu : de l’inflammation qui en provient. VIII.
714. a , b. 713. b. Maladies caufées par l’erreur du lieu.
Suppl. 111. 463. b. 466. a t b. Examen de l’explication que
quelques médecins ont donnée des inflammations par le fyf-
tente de l’erreur de lieu. 600. a t b.
Erreur , ( Comm. ) défaut de calcul, omiffion de partie,
article mal porté fur un livre, Grc. V. 912. b. Claufe que
mettent les marchands dans l’arrêté des comptes, f iu f erreur
de calcul y ou omiffion de parties. Ibid. 913. a.
ERRHINS,ad;. ( Phann.) remedes deftinés à être introduits
par le nez : étym. de ce mot. Diverfcs fortes de ces
vemcucs. Divers fentimens fur b figiiification du mot trrhin,
6c fur la nature des remedes auxquels doit être borné fon
ufage. Des errhins confédérés comme ftcrnutatoircs. Des
errhins confidérés comme évacuans. V. 913.4. L’ufage des
errhins devient indifférent par une longue habitude : exemples
du tabac. Ibid. b.
Errhins t leur propriété 6c ufages. Suppl. 1. 484. b. Voyc{
Sternutatoire.
ERS. ( Bot. Pharm: Mat. midto. ) Caraftere de cette plante.
Ufage de b farine de cette plante en médecine. Comment
les anciens médecins la préparaient. Dans les difettes on a
été quelquefois obligé d y recourir. Elle eft une des quatre
farines refolutives, &c. V. 913. b.
F.RUCAGO. (Bot. Mat. mid.) Cara6lcre.de cette plante.
Ses propriétés. V. 913. b.
ERUDIT, ( Litt. ) Ufage des mots érudit, doéte & favant.
V. 913. b.
ERUDITION.{Philof. Litt.) L’érudition renferme trois
branches; l’hiftoirc, les langues, 6c la connoiffnncc des
livres. Il fuffit, pour être aujourd’hui profondément érudit,
do pofféder feulement à un certain point de perfeélion chacune
de ces parties. On donne cependant la qualité d’érudits
à ceux qui embraffent dans un certain degré d’étendue la
première brandie d’érudition. De 1a connoiffancc des trois
branches indiquées ci-dcflVis, naît cette partie importante de
Vérudition qùfon appelle critique: en quoi elle confifte. V.
Tome f.
914- a- Règles principales de la critique confidéréc par
rapport à 1a croyance des faits hifloriques. i°. On ne doit
compter nour preuves que les témoignages des auteurs ori*
ginaux, oc de ceux qui ont écrit dans le même rems, ou
à-peu-prés. 2°. Comparaifon qu’il faut faire des auteurs les
uns avec les autres. 3°- Examen des auteurs eux-mêmes,
fi leurs ouvrages no font point fuppofês, s’ils font dignes
de foi. Comment on doit établir les divers degrés de crédibilité
des auteurs. Deux excès à fuir dans la critique, trop
d’indulgence 6c trop de févèrité. Un autre excès de critique
eft de donner 'trop aux conjeétures. Ibid. b. liaifons pour
lesquelles les moclerncS fe font fur-tout diftingués dans ce
genre de connoiffancês. L’érudition fe foutint encore en
orient, lorfque toute cfpece de connoiffancês fut anéantie
avec l’empire en occident. DeftruéHon de b bibliothèque de
Conftantinoplc par Léon l’Ifaurien, 6c de celle d’Alexandrie
par les Sarrazins. Erudition de Photius qui vivoit fur b fin
du 9*. fiecle. Les ouvrages qui échappèrent à Léon 8c à
Omar étoient au nombre d'environ 280. Ibid. 913. a.
Hommes érudits que pofféda b Grèce après Photius. Caufes
de là rcnaiffance des lettres en occident. Ce fut par l’étude
des langues grecque & latine que l’érudition renaquit. Le
premier avantage que produific cette étude fut b critique.
Le goût des ouvrages de bel cfptit, & l’étude des fcicnces
exactes a fuccédé au goût de l’érudition. Plaintes que forment
ceux de nos contemporains qui cultivent l’érudition, fur
b préférence que nous donnons à d’autres objets. Examen
de quelques-unes de leurs plaintes qui ne font pas parfaitement
fondées. Ibid. b. Quelles font les raifons. de la préférence
qu’on donne aujourd’hui à l’étude des fcicnces, &
aux matières de bel efprit. Les mathématiques, dit-on,
font compofées de parties diftinguées les unes des autres,
que l’on peut cultiver féparémenf : cette affertion n’eft pas
cxaélcmcnt vraie. Toutes les branches de l’érudition, ajoute-
t-on, tiennent entr’cllcs 6c doivent être embraffées à la fois:
cette propofition eft fauffe à quelques égards. L’auteur examine
s’il eft vrai que les mathématiques offrent plus d’efpé-
rancc de fortune que l’érudition. Raifons plus réelles de la
préférence dont il s’agit ici. i°. Les objets ordinaires de
l’érudition font comme épuifés, au lieu que les découvertes
en mathématiques offrent un champ plus vafte 6c flattent
davantage ; 8c le pbifir de traiter des fujets plus agréables,
8c à portée d’un plus grand nombre de juges, attache aux
matières de bel efprit. 2°. Les ouvrages de bel efprit n’exigent
prefqu’aucunc lecture ; l’étude des mathématiques eii exige
peu , au lieu que l’érudition demande bien plus de livres.
Ibid. 916. a. Raifons qui devraient attacher aux matières
d’érudition, & qui montrent qu’on a tort de les négliger.
La curiofité y cft agréablement fatisfaitc, Grc. L’érudition
n’exige pas moins de fagacité que les fcicnces exaéles. II
refte encore beaucoup à défricher dans l’étude des langues
orientales. Combien l’étude des langues arabe 8c chinoife
nous procurerait d’avantages. Ibid. b. 11 refte encore beaucoup
à découvrir dans des branches qui ont été déjà cultivées,
comme par exemple dans la Géographie ancienne 8c
moderne. Enfin les fccours que nous avons pour l’érudition
nous invitent à nous V livrer. Peu de gens peuvent ajouter
aux découvertes des Dcfcartcs 8c des Newton; mais il n’y
a point d’homme qui ne puiffe devenir très-érudit à force tfe
le&ure. L’auteur examine s’il eft vrai que l’érudition rende
î’cfprit froid, pefant, infenfiblc aux grâces de l’imagination.
L’érudition appcllée U bagage de L’efprit. Ibid. ^ ij. a. L’efprit
philofophiquc trouve de fréquentes occafions de s’exercer
dans les matietf s d’érudition. Les fcicnces exaétes, dira-t-on,
ont à cet égard beaucoup d’avantage, en ce que leur étude
nourrit l’cfprit philofophiquc, 8c qu’au contraire l’étude de
l’hiftoire peut à tout moment jetter dans l’erreur un efprit
d’une trempe commune. Il s’enfuit de cette objeéfion , non
que l’érudition foit méprifable en foi, mais qu’elle doit être
éclairée par la philofophie. D’ailleurs l’étude des fciences
exaétes n’eft pas fans inconvénient, puifqu’on lui reproche
qu’elle affoiblft l’imagination 8c donne de la féchereffe à
refont. Réponfc à l’objcéHon, que b multiplication des
journaux 8c des diélionnaires a porté le coup mortel à
l’érudition. Quoique les traduirions foient aujourd’hui fort
multipliées, cependant leur leéhire ne peut empêcher de
recourir aux originaux, 8c par conféquent de cultiver cette
branche d’érudition qui confifte dans b connoiffancc des
langues. Ibid. b. Enfin l’étude même des fciences doit tirer
beaucoup de lumières de 1a leélure des anciens. Mais en
recommandant cette leétore, il ne faut point oublier les
riches découvertes dont nous fommes redevables aux phi-
lofophes des derniers fiecles , 8c leurs avantages fur les
anciens. Ibid. 018. a. Examen du reproche que faifoir un
favant de nos jours à ceux qui s’adonnent à b phyfique
expérimentale, de n’être que de curieux fiiinéans, & des
manoeuvres qui ufurpent le titre de fages. Conclufton <te
cet article : nous ne devons méprijfer aucune cfpece de
.favoir utile, ni aucune cfpece d’homoics^Ibid. b.