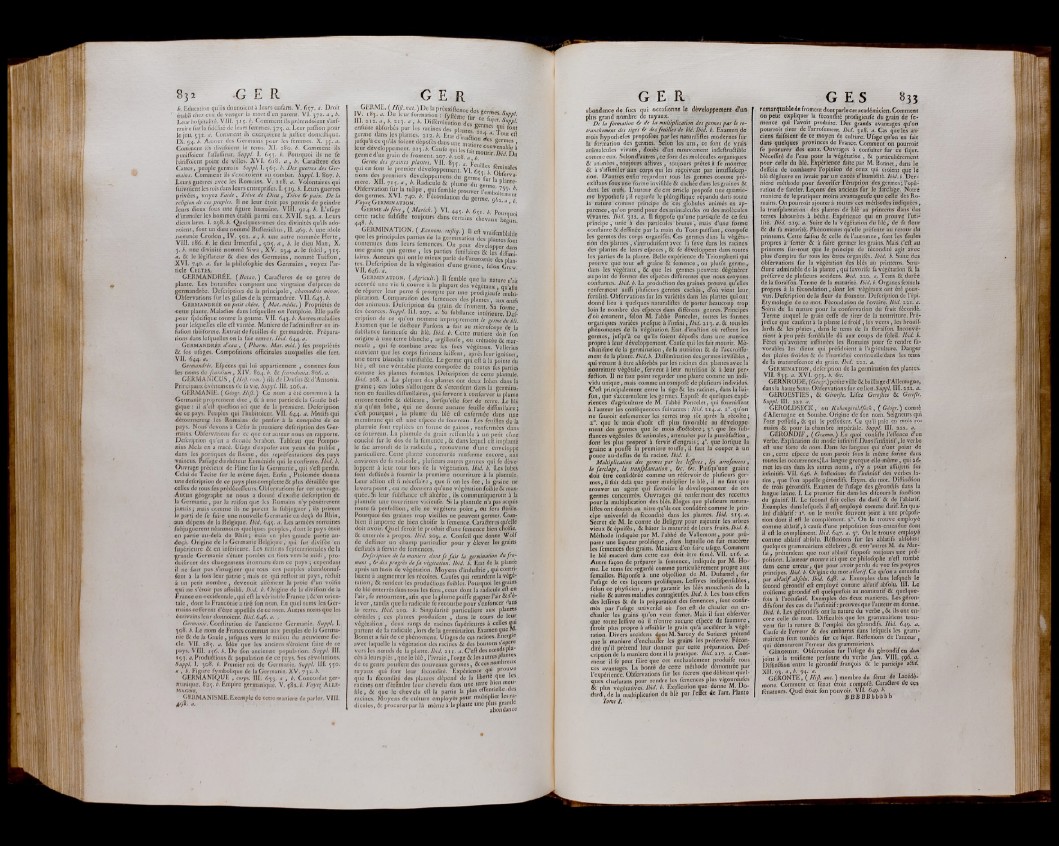
G E R G E R
b. Education qu'ils âonnoieni à leurs en fans. V . 6ey . a. Droit
établi citez eux de venger la mort d'un {tarent. VI. 37a. <*, b.
teur liofoUÀUè. V I II. j i f . b. Comment il» prérendoient s’inf-
iruirc fur la fidélité de leurs femmes. 375, a. Leur pnflion pour
le jeu. 53a. //. Comment ils exerçoient la jufiiee domcfiiquc.
IX. 94. b. Am ou r des Germains pour les femmes, X, 35, n.
Comment ils divifoient le tems. X I. 280. b. Comment ils
puniffoient l’affaflinat, Suppl. I. 6 53. b. Pourquoi ils ne fc
nntifibient point de villes. XVI. 618. <1, b. Caraélere des
Canes, peuple germain Suppl. I. 565. b. D e s guerres des Germains.
Comment ils s'excitoicnt au combat. Suppl. I. 807. b.
Leurs guerres avec les Romains. V . 118. a. Volontaires qui
fuivoient les rois dans leurs cntrcprtfcs. I. ç 19. b. Leurs guerres
privées, voyez F a id c , Trêve de D ie u , 7Vfve & pa ix . D e la
religion de ces peuples. Il ne leur étoit pas permis de peindre
Jeurs dieux fous une figure humaine, V IiI. 014, b. L ’ufiige
d'immoler les hommes établi parmi eux. X V II. 242. a. Leurs
dieux lares. I. 298, b. Quelques-unes des divinités qu’ils a doraient,
font un dieu nommé Bufierichus, II. 460. b. une idole
.nommée Crod on, IV, 502. a , b. une autre nommée K c r te ,
VIII, 186. b. le dieu Irmcnful, 905. a t b. le dieu Man, X.
3. b. une divinité nommé Siwa , XV . 234. a. le foleil, 3 x ç.
a. S i le légifiateur 8c dieu des Germains, nommé Tuifion ,
X V I , 740. a. fur la philofophie des Germains, voyez l'article
C eltes.
GERMANDRÉE. (B o ta n .) Caraélcres de c e genre de
plante. Les botanifies comptent une vingtaine d’elpcces de
germandrée. Defcription de la principale, cliamadris rninor.
Obfervations furies galles de la germandrée. V II. 64 3. b.
G ermandrée ou petit chêne. ( Mat. mèdic. ) Propriétés de
cette plante. Maladies dans lefquelles on l’emploie. Elle parte
pour fpécifique contre la goutte. VII. 643. b. Antres maladies
pour lefquelles elle efi vantée. Manière de l’adminifirer en in-
rufion théi forme. Extrait de feuilles de germandrée. Préparations
dans lefquelles on la fait entrer, Ibid. 644. a.
G ermandrée d 'e a u , ( Pharm. Mat. méd.) fes propriétés
& fes ufages. Compofitions officinales auxquelles elle fert.
VII. 644« a
Germandrée. Efpeces qui lui appartiennent , connues fous
les noms de feordium, XIV, 804. b. S i feorodonia. 8ofi. a.
G E R M A N IC U S , ( l i i f l . rom. ) filt, de Drufits & d’Amonia.
Principaux événemens de fa vie, ouppl. 111, 206. a.
GERMANIE. ( Géogr. / l i f t . ) Ce nom a été commun à la
Germanie proprement dite , ©c à une partie de la Gaule bel-
gique : il n’eu queftion ici que de la première. Defcription
de ce pays. Peuples qui l'hanitoient. V il, 644. a. Mo tifs qui
détournereiv les Romains de penfer h la conquête de ce
pays. Nous devons à Céfar la première defcription des Germains.
O b fe rv iü on s fur ce que cet auteur nous en rapporte.
Defcrwtton qu'en a donnée Strabon. Tableau que Pompo-
nius Mêla en a tracé, l/fagc d’expofer aux yeux du public ,
dans les portiques de Rome, des repréfeutations des pays
vaincus. Partage du rhéteur Euménide qui le confirme. Jbtd. b.
Ouvrage précieux de Pline fur la Germanie, qui s’eft perdu.
Celui de Tacite fur le même fujet. Enfin , Ptolomée donna
une defcription de ce payspluscomplette S i plus détaillée que
celles de tou s fes prédéccfieurs. Observations fur cet ouvrage.
■Aucun géographe ne nous a donné d’exaéte defcription de
la Germanie, par la raifon que Us Romains n'y pénétrèrent
jamais ; mais comme ils ne purent la fubjiigucr , ils prirent
Je parti de fe faire une nouvelle Germanie en deçh du Rhin,
aux dépens de la Belgique, fbid. 645. a. Les armées romaines
fubjuguerent néanmoins quelques peuples, dont le pays étoit
en partie au-delà du Rhin ; mais en plus grande partie au-
deçà. Origine de la Germanie Belgique , qui fut clivifée en
fupérieure S i en inférieure. Les nations fcptentrionalcs de la
grande Germanie s'étant portées eu fiots vers le midi, pro-
duifirent des changemens étonnans dans ce pays ; cependant
il ne faut pas ¿'imaginer que tous ces peuples abandonnaf-
fent â la fins leur patrie ; mais ce qui refioitau pays, réduit
à un petit nombre, devenoit aifément la proie tfun voifin
nui ne s'étoit pas affaibli. Ibid. b. Origine de la divifion de la
France en occidentale, qui cft la véritable France ; 8c‘en orientale
, dont la FrancOnie a tiré fon nom. En quel tems les Germains
cefferent d'être appellés de ce nom. Autres noms que les
écrivains leur donnaient. Ibid. 646. a. ,.
Germanie. Confiitution de l’ancienne Germanie. Suppl. I.
398, b. L e nom de Francs commun aux peuples de la Germanie
St de la Gaule, jufques vers le milieu du neuvième fie-
cle. VII. 283, a. Idée que les anciens s'éroient faite de ce
pays, VIII, i c 6. b. D e (on ancienne population. Suppl. III.
»93". a. Productions S i population de ce pays. Ses révolutions,
Suppl. I, 308. b. Premier roi de Germanie. Suppl. III. 530.
a , b. Figure fymbolique de la Germanie. X V . 732. b.
GERMANIQUE , corps. III, ¿»33. a , b. Concordat germanique.
825.b . Empire germanique. V. 582.b. Foyeç A llemagne,
GERMANISME. Exemple de cette maniéré de parler. VIII.
¿98. a.
GERME. ( H ill. nat. ) De la précxifteiw. ,i„. „
IV. 183. a. De leur formation ; f y f l & i S
III. « * . « .* . i l ) , a-; t .
enlime abfcrbi-s par les racines des p i- ,,... *L . SI" ‘ °m
germe dans les plantes, m . h. Etat d'ii afli„„ î " 0l"
|ufqu’4 ce qu'ils l'oient dépofis dans nne i ” Ü * cn" f ‘ >
leur développement, n i . b . Caufe (luilesf.,!, eûnvenalile i
germe d'un‘grain de froment. a07 Du
twfrm* /Germe dteuse grrrra. ines plantes. 1V/I(1Í . O8 3 c, a,FJLe n' ill cl •
qui en font le premier développement. VI Cf
nous des premiers dévcloppcmens.dti geíme V , ' i , , ‘
mere. XII. 7 1 5 .» , b. Radicule & plume Ju à Z . l' ,m c r
Olrfervation fur la tulipe , qui femlile prouver® cmhn'u99'
de. germes. XVI. 740. 1 f o n d a , J du”
Voye[ G e rm in a t io n . j
G erm e de fè v e f ( Maréch.) VI. aa», a ri t . j, p .,
en te rache M i l l e toujours dans certains cl,¿vaux bég¡K.
G ERMINATION. ( E c tm m . m j l i f c j II ¿ft vraifemblable
que les principales parties de la germination des plantes fom
contenues dans leurs femences. On peut dévclonncr dan.
une graine qui germe , les parties fimilaircs & 1« diflim
latres. Auteurs qui ont le mieux parlé ded’anatomie des nlan-
tcs. Oefcnpnon de la végétation d’une graine-, félon Grcw
VII, 646. a.
G erm inatio n, ( Àgricult. ) Il Tembleque la nature n’ait
accordé une vie fi .courre h la plupart des végétaux, qu’afin
de réparer leur perte Ti prompte par une prodigieufe multiplication.
Comparaifon des femences des plantes, aux oeufs
des animaux. Defcription du grain de froment. Sa forme
fes écorces. Suppl. I ll, 207. a. Sa fubftancc intérieure. D c¿
cription de ce qu’on nomme improprement te germe du blé.
Examen que le doélcur Parions a fait au microfcope de la
fubltance farineufe du blé. Ibid. b. Cette matière doit fon
origine h une terre blanche, argilleufc, ou crétacée S i ma r-
neufe , qui fc combine avec les fncs végétaux. Vallerius
convient que les corps farineux laiflcnt, après leur ignición 9
une terre blanche vitrifiable. Le germe qui cft à la pointe du
b lé , cft une véritable plante compofée de toutos les parties
comme les plantes formées, Defcription de cette plantule.
Ibid. 208. a. La plupart des plantes ont deux lobes dans la
graine ; ces lobes s’allongent S i s’étendent dans la germination
en feuilles diflîmilaires , qui fervent à confervcr la plume
encore tendre S i délicate, lorfqu’eile fort de terre. Le blé
n’a qu’un lo b e, qui ne donne aucune feuille diftimüaire j
c’cft pourquoi, la plume du blé eft enfermée dans une
membrane qui eft une cfpece de fourreau. Les feuilles de la
plantule font repliées en forme de gaines, renfermées dans
ce fourreau. La plmmile du grain rertemblc à un petit cône
couché fur le dos de la fcmcnce , S i dans lequel eft implanté
le fac arrondi de la radicule , recouverte aune enveloppé
particulière. Cette plante concentrée renferme encore, aux
environs de fa radicule, pliificurs autres germes qui fe développent
& leur tour lors de la végétation. Ibid. b. Les lobes
font deftiués à fournir la première nourriture à la plantule.
Leur aéliou cft fi néceftairc, que fi on les ô t e , la graine ne
lèvera point, ou ne donnera qu’une végétation foible&man-
quée. Si leur fubftance eft ahéfée, ils communiqueront la
plantule une nourriture vicicufe. Si la plantule n a pas acquis
route fa nerfcélion, elle ne végétera point, ou fera ftérile.
Pourquoi des graines trop vieilles ne peuvent germer. Combien
il importe de bien cnoifir la fcmence, Caraéleres qu'elle
doit avoir. Quel feroit le nroduit d’une femence bien cnoifie,
S i enterrée it propos. Ibid. 209. a. Confeti que donne Wolf
de deftincr un champ particulier pour y elever les grains
deftiués ¿1 fervir de femences.
Defcription de la maniere dont f c fa i t la germination du froment
t & des progris de fa végétation. Ibid. b. Etat de la plante
après un ftiois tle végétation. Moyens d'induftric, qui contribuent
:t augmenter les récoltes, Caufcs qui retardent la végétation,
S i rendent les productions foiblcs. Pourquoi les grains
de blé enterrés dans tous les fens, ceux dont la radicule eft en
l’a i r ,fc retournent, afin que la plume puifie gagner l’air 8c s’élever
, tandis que la radicule fe recourbe pour s enfoncer dans
la terre. Ibid. 210. b. Singularité particulière aux niantes
céréales j ces plantes produifent , dans le cours tle leur
végétation , deux rangs de racines fupérieures à celles qui
partent de la radicule ,Tors de la germination. Examen que M*
Bonnet a fait de ce phénomène. Ufages de ces racines. Energie
avec laquelle la végétation des racines S i des boutons s’opère
vers les noeuds de la plante. Ibid. n i . a. C ’cft des noeud* p»®"
cés li leurs piés, que le b lé , l’ivraie, l’orge Si les autre* plantes
de ce genre pourtent des nouveaux germes, Si ces nombreux
tuyaux qui font leur fécondité. Expérience qm prouve
que la fécondité des plantes dépend de la liberté que les,
racines ont il’éténdre leur chevelu dans une terre bien meub
le , S i que le chevelu eft la partie la plu* cflcnriellc-dc*
racines. M o y en s de culture employés pour multiplier le* radicules,
8c procurer par lit même h la plante une plus grano
1 abondance
G E R G E S 833
abondance de fucs qui occafionne le développement d’un
plus grand nombre oc tuyaux. '
De la formation 6* de la multiplication des germes par le retranchement
des tiges b des feuilles de blé. Ibid. b. Examen de
trois hyporlicies propofées par les naturaliftes modernes fur
la formation des germes. Selon les uns, ce font de vrais
animalcules vivans, doués d’un mouvement indcftruftible
comme eux. Selon d’autres, ce font des molécules organiques
S i animées, toujours aftives, toujours prêtes à fe montre r
S i à s’aftimilcr aux corps qui les reçoivent par intufiiifcep-
rion. D ’autres enfin regardent tous les germes comme pré-
exiftans fous une fOrmc invifiblc Si cachée dans les graines 8c
dans les oeufs, L’auteur de cet article propofe une quatrième
hypothefc 5 il regarde le plilogiftique répandu dans toute
la nature comme principe de ces globules animés en apparence
, qu’on prend pour des animalcules ou des molécules
vivantes. Ibid. 312. a. Il ftippofe qu’une partioulc de ce feu
principe, unie h des particules brutes, mais d’une forme
confiante S i deftinée par la main du Tout-puifiant, compofe
les germes des corps organifés. Ces germes dans la végétation
des plantes, s’introdtiifent avec la feve dans les racines
des plantes de leurs efpeces, 8c fe développent dans toutes
les parties de la plante. Belle expérience de Triomphctti qui
prouve que tout «ft graine S i lcmencc ,o u plutôt germe,
dans les végétaux, 8c que les germes peuvent dégénérer
au point de former des cfpcécs différentes que nous croyons
confiantes. Ibid. b. La production des graines prouve qu elles
renferment atiifi pluficurs germes cachés, d'où vient leur
fertilité. Obfervations fur les variétés dans les plantes qui ont
donné lieu à quelques naturaliftes de porter beaucoup trop
loin le nombre des efpeces dans difiéreos genres. Principes
d’où émanent, félon M. l’abbé Poncelct, toutes les formes
organiques variées prcfquc k l’infini, Ibid. 213. a. S i tous les
phénomènes de la végétation. Etat d'inaftion où relient les
germes, jufqu'à ce qu'ils foient dépofés dans une matrice
propre & leur développement. Chufé qui les fait mourir. Mé-
chanifme de la germination, de la nutrition 8c de l’accroifie-
ment de la plante. Ibid.b. Difiémination des germes invifiblcs,
qui venant à être abforbés par les racines des plantes avec la
nourriture végétale, fervent h leur nutrition 8c h leur per-
feélion. Il ne faut point regarder une plante comme un individu
unique, mais comme un compofe de pluficurs individus.
C e f t principalement entre la tige Si les racines, dans la liaison
, que s’accumulent les germes. Expofé de quelques expériences
d’agriculture de M. l'abbé Poncclet, qui rourniflcnt
à l’auteur les conféqucnccs fui vantes : Ibid. 214 .a . i ° . qu’on
ne fauroit enfemcncer les terres trop tôt après la,récolte;
2°. que le mois d’août eft plus favorable au développement
des germes que le mois d*o¿lobrc ; 30. que les ftib-
ftances végétales 8c animales, atténuées par la putréfaClion,
font les plus propret h fervir d’engrais ; 40. que lorfque la
graine a pouffé la première touffe, il faut la couper à un
pouce au-defius de fa racine. Ibid. b.
Multiplication des germes par les lefftves , les arrofemens,
le farclagey la tranfplantation , b c . &c. Puifqu’une graine
doit être confidéréc comme un réfervoir de pluficurs germes,
il fuit delà que pour multiplier lo blé, il ne faut que
trouver un agent qui favorife le développement de ces
germes concentrés. Ouvrages qui renferment des recettes
pour la multiplication des bïés. Eloges que pluficurs natura-
Jiftes ont dounés au nitre qu'ils ont conudére comme le principe
univerfel de fécondité dans les plantes. Ibid. 21 <. a.
Secret de M. le comte de Beligny pour rajeunir les arbres
vieux 8c épuifés, 8c hâter la maturité de leurs fruits. Ibid. b.
Méthode indiquée par M. l'abbé de Vallcmont, pour préparer
une liqueur prolifique, dans laquelle on fait macérer
les femences des grains. Maniere d’en faire ufage. Comment
le blé maceré dans cette eau doit être femé. VII. 216. a.
Autre façon de préparer la fcmence, indiquée par M. Home.
Le tems fcc regardé comme particulièrement propre aux
fcmaillcs. Réponfc à une objeftion de M. Duliamcl, fur
J’ufage de ce» liqueurs prolifiques. Lcffivcs indifpenfablc»,
félon ce phyficien , pour garantir les blés mouchetés de la
nielle 8c autres maladies contagicufcs. Ibid. b. Les bons effets
•des lcffivcs Si de la préparation des femences, font confirmés
par l’ufage univerfel où l’on cft de chauler ou cn-
chaulcr les grains qu’on veut femer. Mais il faut obfcrvcr
que toute lcffivc où il n'entre aucune cfpece de faumurc,
(croit plus propre h afioiblir le grain qu'à accélérer la végétation.
Divers accidcns dont M. Sarccy de Stitiercs prétend
que la maniere d’cnchauler les grains les préferve. Fécondité
qu’il prétend leur donner par cette préparation. Dcf-
■cription de la manière dont il la pratique. Ibid. 2 1 7 . a. C om ment
il fc peut faire que cet cnchaulemcnt nroduife tous
ces avantages, La bonté de cette méthode démontrée par
l’expérience. Obfervations fur les fccrcts que débitent quelques
charlatans pour rendre les femences plus v ¡go tac ufe s
S i plus végétatives. Ibid. b. Explication duc-donne M. Do-
dard, de la iRiUtiplication du blé par l’effet de lart. Plante
rcmarquablede froment dont parle cet académicien. Comment
on peut expliquer la fécondité prodigieufe du grain de fc mcnce
qui l'avoit produite. Des grands avantages qu’on
pourroit tirer de l’arrofcmcnt. Ibid. 318. a. Cas que les anciens
faifoient de ce moyen de culture. Ufagc qu’on en fait
dans quelques provinces de France. Comment on pourroit
fc procurer des eaux. Ouvrages à confultcr fur ce fujer.
Néccffité de l’eau pour la végétation, 8c particulièrement
pour celle du blé. Expérience faite par M. Bonnet, dans le
deffein de combattre l’opinion de ceux qui croient que le
blé dégénère en ivraie par un excès d'humidité. Ibid.b. Dernière
méthode pour favorifer l’éruption des ecrmes; l’opération
de farcler. Leçons des anciens fur le farclagc. Notre
manière de le pratiquer moins avantageufe que celle des Romains.
On pourroit ajouter à toutes ces méthodes indiquées,
la tranfplantation des plantes de blé au printems dans des
terre s labourées à béchc. Expérience qui en prouve l’ utilité.
Ibid. 219. a. Suite do la végétation du blé, de fa fleur
S i de fa maturité. Phénomènes qu’elle préfente au retoilr du
printems. Cette faifou S i celle de l’automne, font les feules
propres à' femer S i à faire germer les grains. Mais c’cft: au
printems fur-tout que le principe de fécondité agit avec
plus d'empire fur tous les êtres organifés. Ibid. b. Suite des
obfervations fur la végétation des blés au printems. Structure
admirable de la plante, qui favorife fa végétation 8c la
préferve de plufieurs accidcns. Ihid. 220. a. Tems 8c durée
de lafioraifon.Terme de la maturité. Ibid.b. Organesfexucls
propres à la fécondation, dont les végétaux ont été pourvus.
Defcription delà fleur du froment. Defcription de l’épi.
Etymologie de ce mot. Fécondation de l’ovaire, Ibid. 221. a.
Soins de la nature pour la confcrvation çln fruit fécondé.
Terme auquel le grain ccffe de tirer de la nourriture. Préjudice
que caufent à la plante le froid, les vents, les brouillards
Si les pluies, dans le tems de la floraifon. Inconvénient
à peu près fcmblablc dû aux coups de foleil. Ibid. b.
Fêtes qu’avoient inftituées les Romains pour fe rendre favorables
les dieux qui préfidoient à l’agriculture. Danger
. des pluies froides S i de l'humidité confmuellc'dans les tems
de la maturcfccnce du grain. Ibid. 222. a.
G ermination, defcription de la germination des plantes.
VII. 83«. *. XVI. 953. b. &c.
GERNRODE, (Géogr.) petite ville Si bailliage d'Allemagne,
dans la haute Saxe. Obfervations fur ce lieu, .$'«/;/;/, III. 222. a.
GEROESTIES, S i Giroefle. Life/. Gerojlics S i Gcrefle.
Suppl. III. 222. a.
GEROLDSECK, ou liohengtroldfcck, (G éo g r .) comté
d’Allemagne en Sotiabc. Origine de fon nom. Seigneurs qui
l'ont poffedé, 8c qui le poffedent. Ce qu'il paie en mois romains
S i pour la chambre impériale. Suppl. III. 222. a.
GÉRON DIF , ( Gramm. ) En quoi confifte l’cffence d’un
verbe. Explication du mode infinitif. Dans l’infinitif, le verbe
eft une forte de nom. Dans les langues qui n’ont point de
ca s, cette cfpece de nom paroît fous la même forme dans
toutes les occurrences,!La langue grecque elle-même, qui adr
met les cas dans les autres noms, n’y a point affujcttl fes
infinitifs. VII. 646. b. Inflexions de nnflnitif des verbes latins
, que l’on appelle gérondifs. Etym. du mot. Diftinéllon
de trois gérondifs. Examen de l’ufage des gérondifs dans la
langue latine. I. Le premier fait dans les dilcours la fonélion
du génitif. II. Le fécond fait celles du datif 8c de l'ablatif.
Exemples danslefqucls il eft employé comme datif. En qua^
lité d’ablatif: i°. on le trouve louvcnt joint à une prépofi-
tion dont il eft le complément. 2". On le trouve employé
comme ablatif, à caufe d'une prépofition fous-entendue dont
il cft le complément. Ibid. 647. a. 30. On le trouve employé
comme ablatif abfolu. Réflexions fur les ablatifs abfoltis;
quelques grammairiens célèbres, 8c cntr’aiitrcs M. du Mariai
, prétendent que tout ablatif fuppofe toujours une prépofition.
L'auteur montre ici que c e philofophe n'eft tombé
dans cette erreur, que pour avoir perdu de vue fes propres
principes. Ibid. b. Origine du mot ablatij. C e qu'on a entendu
par aolatif abfolu. Ibid. 648. a. Exemples dans Icfquels le
fécond gérondif cft employé comme ablatif abfolu- III. Le
troificmc gérondif eft quelquefois au nominatif S i quelquefois
à l’accufatif. Exemples des deux manières. Les gérondifs
font des cas de l’infinitif: preuves que l’auteur en donne.
Ibid. b. Les gérondifs ont la nature du verbe , S i ils ont en-'
corc celle du nom. Difficultés que les grammairiens trouvent
fur la nature 8c l’cwploi des gérondifs. Ibid. 649. a.
Caufe de l’erreur 8c des embarras dans Icfquels les grammairiens
font tombés fur ce fujet. Réflexions de l’atueur,
qui démontrent l’erreur des grammairiens.
Gérondif. Obfcrvation îur l’ufage du gérondif en dum
joint à la troificmc perfonne du verbe fum. VIII. jçd. a.
Difiinélion entre le gérondif françois 8c le participe aftif.
XII. 93• dy b. 94. a. 1 i , - ' , . . . .
GeKONTE , ( Hifl. anc. ") membre du fénat de Lacédé-
monc. Comment ce fénat etoit compofé. Caraûcrc de ces
fénateurs. Quel étoit fon pouvoir. V il. 649- ®
B B B B B b b b b b