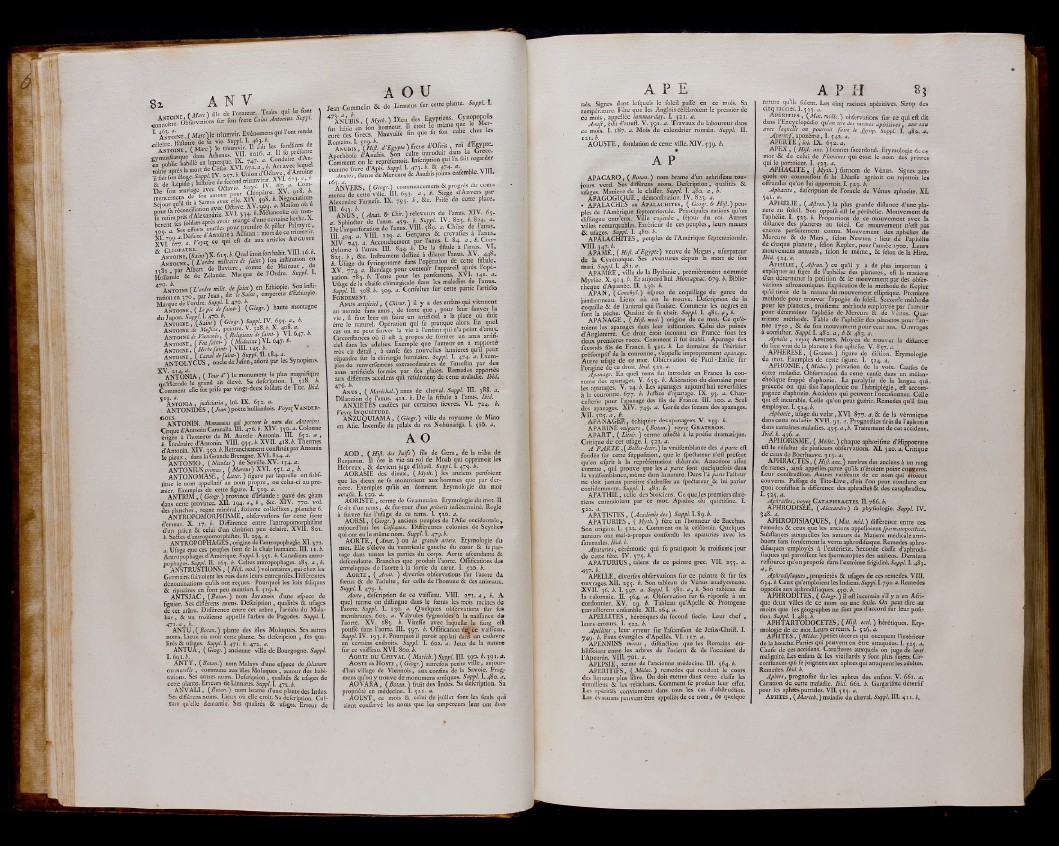
i
Sa A N V
■H
, • «r f Marc} fils de l’orateur..Traits qui le font
J S f d b k m d o n s fur fon frere CamsAmomus. Suffi.
1 ANTOINE, f Mure)le triumvir. Evénemens qui l’ont rendu
lu g r ^ b Æ 1tis toine après la mort de Cela . TTnion d’O&a vc, d'Antoine ntasîsSjêiartç.ç S
Séjour qu’il fit à S^ “ aJ o a „ e XV. 909. *. Mfifou où il
pourfareconciluiMn^ V ¿„^llancolie où tom-
? redraf F ? i d ^ Î ^ ' o ù W certaine herbe, X.
t e S e t è S n u t i l e s pour prendre & piller Palmyre,
309. a. Ses ® à Aftium : mort de ce tnumvir.
x v f ^ 77- '4 r °y‘ i ce i ui eft dit aux e- AUGUSTE
& i^nmr'fsâmt'lX. 61t. h. Quel étoitfon habit. VIII. rfi.J.
A ntoine, (L'ordre militairidc [ami) fon mffitutton en
„ 8 1 oar Albert de Bavière, comte de Hainaut , de
hollande & de Zélande. Marque de l’Ordre. Suffi. I.
4 7 A n t o i n e (XWrr milit. de frint) en Ethiopie. Son inffi-
turionen 370, par Jean, dit le Sain, , empereur dEfiuopte.
T l Ï Ï & Ï Ï G l o r . ) haute montagne
i = E fmÊÊKÊÊBÊi Antoine, ^ 1 647- b-
Antoine, (Ærii/uint- j VIU. 145-*•
Antoine, X Canal de [ami-) Suppl. U. 184. a. .
ANTOLYCUS , oncle de Jafon, adoré par les Synopiens.
ÂNTONIA ( Tour d’ ) le monument le plus magnifique
mi’Hèrode lé grand ait élevé. Sa defcription. L 518. A
Comment elle fut prife par vingt-deux foldats de lite. lbicL
* i^NTONIA , judidaria, loi.. IX. 652. a.
ANTONIDES, {Jean) poëteliollandois. Voye^ Vànder-
GCANTONIN. Monumens qui. portent le nom des Antomns.
Grque d’Antonin Caracalla. III. 476. b. XIV. 3 30. a. Colonne
érigée à l’honneur de M. Aurele - Antonrn. ffl. 6 <2. a ,
h. Itinéraire d’Antonin. VIII. 925. ¿.XVII. 418. b. Thermes
d’Antonin. XTV. 350. ¿.Retranchement confirait par Antonin
le pieux , dans la Grande Bretagne. XVI. 824. a.
ANTONIO, ( Nicolas) de Seville.XV. 134.a.
ANTONIUSprimus, {Marcus) XVI. 551. a , ¿.
ANTONOMASE, ( Littér. ) figure par laquelle on fubf-
titue le nom appellatif au nom propre, ou celui-ci au premier.
Exemples de cette figure. I. $19. a.
ANTRIM , ( Géogr.) province d’Irlande : pavé des géans
dans cette province. XIl. 194. <*, ¿ , 8cc. XIV. 770. vol.
des planches , regne minéral, fixieme collection , planche 6.
ANTROPOMORPHISME, obfervations fur cette forte
d’erreur. X. 17. b. Différence entre l’antropomorphifme
d’un païen & celui d’un chrétien peu éclairé. XVII. 801.
b. Seftes d’antropomorphiftes. II. 294. a.
ANTROPOPHAGLS, origine de l’antropophagte.XI. 372.
a. Ufage que ces peuples font de la chair humaine. III. 11. b.
Ântropophages d’Amérique. Suppl.1.351. b. Canadiens antro-
pophages. Suppl. II. 165. ¿. Celtes antropophages. 285. a , ¿.
ANSTRUSTIONS, {Hift. mod.) volontaires, qui chez les
Germains fuivoient les rois dans leurs entreprifes. Différentes
dénominations qu’ils ont reçues. Pourquoi les loix faliques
& ripuaires en font peu mention. I. 519. b.
ANTSJAC, {Botan.) nom Javanois d’une efpece de
figuier. Ses différens noms. Defcription , qualités oc ufages
de cet arbre. Différence entre cet arbre, l’aréalu du Malabar
, & un troifieme appellé l’arbre de Pagodes. Suppl. I.
471. a , b.
ANTU, ( Botan.) plante des i/les Mohxques. Ses autres
noms. Deux où croit cette plante. Sa defcription , fes qualités
& ufages. Suppl. I. 471. b. 472. a.
ANTU A , {Géogr.) ancienne ville de Bourgogne. Suppl.
1 .691. ¿.
AN T Y , {Botan.) nom Malays d’une efpece de folanum
ou morelle , commune aux ifles Moluques, autour des habitations.
Ses autres noms. Defcription, qualités & ufages de
cette plante. Erreurs de Linnæus. Suppl. I. 472. ¿.
AN V A U , {Botan.') nom brame d’une plante des Indes.
Ses différens noms. Deux où elle croit. Sa defcription. Culture
qu’elle demande. Ses qualités & ufages. Erreur de
A O U
JeanCemmelin & de Lmnatus fur cette plante. SuppL l
473Xnùbk, ÉÉjjÉ Dieu ics EFptif s- fut bâtie e n fon honneur. Il étoit Te même que le Mer-
cure des Grecs. Mauvaife fin que fit fon culte chez les
WÊËÊÊÊË d’E p f le ) WÊ d'OfirB roi d 'a p t e .
Aoothéofe d’Anubis. Son culte introduit dans la Grece.
Comment on le repréfentoit. Infcripnon qui 1 a fait regarder
comme frere d’Apis. Suppl. 1- 473- . 474- n.^ ylTT ■
Aauiis, flauie deMercure & Annbis joints enfemble. Vlll.
’ E n v e r s , (Gcogr.) coiiür.cntx'niens & progrès (h: commerce
de cette ville. III. 693. * , 4 Slege d’Anvers par
Alexandre Farnefe. IX. 795. 4 , &c. Prife de cette place.
À î$ S , ’ (Anat. S- Chir. ) releveurs de l’anus. XIV. 65.
m Sphinôer de l’anus. b. Suppl. IV. 823. 4. 824. u.
Delimperforation de l’anus. V lll. 589. a. Chute de lanus.
III. 404. u. VIII. 129. u. Gerçures & crevalTes a l amis.
XIV. 442. a. Accouchement par l’anus. 1. 84. a , b. Conr
Morne4! l’anus, ffl. 844. i. De la fiflu e à l’anus. VI.
8ae. 4 , &c. Infiniment defiinè à dilater lanus. X V . 448.
4. Ufage du fyrbigotome dans l’opération de cette tutule.
XV. 774-a. Bandage pour contenir l’appared après 1 opération.
783. 4. Tente pour les panfemens. XVI. 141.
Ufage delà chaife chirurgicale dans les maladies de lanus.
Suppl. II. 308. 4. 309. a. Confultez fur cette partie lartido
Fondement. .
A nus artificiel, ( Chirur. ) il y a des enfansqui vitnnene
au monde fans anus, de forte que, pour leur fauyer la
v ie , il faut leur en faire un artificiel à la place ou doit
être le naturel. Opération qui fe pratique alors. En ^ quel
cas on ne peut fauver la vie à l’enfant qui n a point d anus.
Circonftances où il eft à, propos de former un anus artificiel
dins les adultes. Exemple que l’auteur en a rapporté
très en détail , h caufe des nouvelles lumières qu’il peut
répandfe fur la chirurgie herniaire. Suppl. I. 474. a. Exemples
de renverfemens extraordinaires de l’inteftin par des
I anus artificiels formés par des plaies. Remedes apportés
I aux différens accidens qui rèfultoient de cette maladie. Ibid.
47 A n u s , (Maréchal.) anus de cheval. Suppl. HI. 388. if
Dilatation de l’anus. 4x1. ¿. De la fiftule à l’anus. Ibid.
ANXIÉTÉS caufées par certaines fievres. VI. 724. b.
Voyez Inquiétude.
ANZUQUIAMA, ( Gcogr. ) ville du royaume de Mino
en Aiie. Incendie du palais du roi Nobunanga. L 320. a.
A O
AO D , (Hift. ¿es Juifs) fils de Géra, de la tribu de
Benjamin. Il ote la vie au roi de Moab qui opprimoit les
Hébreux, & devient juge d’Ifraël. Suppl. 1.479. b.
AORASIE des dieux, {Myth.) les anciens penfoient
que les dieux ne fe montraient aux hommes que par derrière.
Exemples qu’ils en donnent. Etymologie du mot
aorafie. I. 520. a.
AORISiE , terme de Grammaire. Etymologie du mot. Il
fe dit d’un tems, & fur-tout d’un prétérit indéterminé. Rcgle
à fuivre fur l’ufage de ce tems. I. 520. a.
AORSI, {Géogr.) anciens peuples de l’Afie occidentale^
aujourd’hui les Coféques. Différentes colonies de Scythe»
qui ont eu le même nom. Suppl. 1. 479. b.
AORTE, {Anat.) ou la grande artere. Etymologie du
mot. Elle s’élève du ventricule gauche du coeur & fe par- '
tage dans toutes les parties du corps. Aorte afeendante &
defeendante. Branches que produit l’aorte. Ofiifications des
enveloppes de l’aorte à la fortie du coeur. I. 520. b.
A orte , ( Anat. ) djverfes obfervations fur l’aorte du
foetus & de l’adulte, fur celle de l’homme & des animaux.
Suppl. I. 479- A
Aorte, defcription de ce vaiffeau. VHI. 271. 4 , b. A
quel terme on diftingue dans le foetus les trois racines de
l’aorte. Suppl. I. 130. a. Quelques obfervations fur fes
membranes. 603. a. Valvules fygmoïdes-'’à la naiffance do
l’aorte. XV. 183. b. Vîteffe avec laquelle le fang eft
pouffé dans l’aorte. III. 597. b. Ofiification dej ce vaiffeau.
Suppl. IV. 193. b. Pourquoi il paraît applati dans un cadavre
en certains endroits. Suppl. I. 602. a. Jeux de la nature
fur ce vaiffeau. XVI. 800. b.
A orte du C h e v al . ( Maréch. ) Suppl. HI. 590- b- 321-&
A oste ou Hoste , ( Géogr.) autrefois petite ville, aujourd’hui
village de Viennois, aux confins delà Savoie. Frag-
mens qu’on y trouve de monumens antiques. Suppl. 1. 480. a,
AOVARA, ( Botan. ) fruit des Indes. Sa defcription. Sa
propriété en médecine. I. 521. a.
AOUST, ce mois & celui de juillet font les feuls qui
aient conferYé les noms que les empereurs leur ont dou*-
A P E
nés. Signes dans lefquels le foleil paffe en ce mois. Sa
température. Fête que les Anglois célébraient le premier de
ce mois, appellée laminas-day. L 521. a.
Aoufi, édit d’aouft. V. 391. a. Travaux du laboureur dans
ce mois. I. 187. a. Mois du calendrier romain. Suppl\ II.
X2I. b.
AOUSTE, fondation de cette ville. XIV. 539. ¿.
A P*
APACARO, ( Botan. ) nom brame d’un arbriffeau toujours
verd. Ses différens noms. Defcription, qualités &
ufages. Maniéré de le claffer. Suppl. I. 480. a , b.
APAGOGIQUE , démonftration. IV. 823. a.
• APALACHES ou A p a l a ch it e s , { Géo*r. & Hift.) peuples
de l’Amérique feptentrionale. Principales nations qu’on
diftingue entr’eux. Ville capitale , féjour du roi. Autres
villes remarquables. Extérieur de ces peuples, leurs moeurs
& ufages. Suppl. I. 480. b. . . . . ^ . .
APALACHiTES, peuples de l’Amenque feptentrionale.
•Vin. 347^- N
APAMÉ, ( Hift. d'Egypte) veuve de Maeus , ufurpateur
de la Cyrénaïque. Ses aventures depuis la mort de fon
mari. Suppl. I. 40!. a.
APAMÉE , ville de la Bythime , premièrement nommée
Myrlée. X. 914. b. Et aujourd’hui Montagnac. 679. b. Bibliothèque
d’Apamée. II. 230. b.
APAN, ( Conchyl. ) efpece de coquillage du genre du
jambonneau. Deux où on le trouve. Defcription de la
coquille & de l’animal qui l’habite. Comment les negres en
font la pèche. Qualité de fa chair. Suppl. I. 481. <*, b.
APANAGE, ( Hift. mod. ) origine de ce mot. Ce qu’é-
toient les apanages dans leur inititution. Celui des puînés
d’Angleterre. Ce, droit étoit inconnu en France fous les
deux premières races. Comment il fut établi. Apanage des
féconds fils de France. I. 521. b. Le domaine de l’héritier
préfomptif de la couronné, s’appelle improprement apanage.
Autre ufage de ce mot. Obfervation de Paul-Emile fur
l’origine de ce droit. Ibid. 322. a. .
Apanage. En quel tems fut introduit en France la coutume
des apanages. V. 655. b. Aliénation du domaine pour
les apanages. V . 24. b. Les apanages aujourd’hui reverubles
à la couronne. 677. ¿. Juftice d’apanage. IX. 93. a. Chancellerie
pour l’apanage des fils de France. III. 100. a. Scel
des apanages. AlV . 749. a. Garde des fceaux des apanages.
,V1I. 505. ay b. :
APANAGER, échiquier dés apanagers. V . 239. ¿.
APARINE vulgaire, ( Botan.) voyeç G ra te r on .
APAR T, {Littér.) terme affeôé à lapoéfie dramatique.
Critique der cet ufage. I. 322. a.
A PARTE , ( Belles-lettr. ) la vraifemblanCe des à parte eft
fondée fur cette fuppofition, que le fpeâateur n’eft prélent
qu’en efprit à la repréfentation théâtrale. Anecdote affez
connue, qui prouve que les à parte font quelquefois dans
la vraifemblance, même dans la nature. Dans l’à parte l’aéleur
ne doit jamais paraître s’adreffer au fpe&ateur & lui parler
confidemment. Suppl. I. 481. b.
APATHIE, celle des Stoïciens. Ce que.les premiers chrétiens
entendoient par ce mot. Apathie du quiétifine. I.
522. a. n
APATISTES , {Académie des) Suppl. 1. 89. b.
APATURIES , ( Myth. ) fête en l’honneur de Bacchus.
Son origine. I. 3 22. a. Comment on la célébrait. Quelques
auteurs ont mal-à-propos confondu les apaturies avec les
faturnales. Ibid. b. ,
Apaturies, cérémonie qui fe pratiquoit le troifiemè jour
de cette fête. IV. 573. b.
APATURIUS, talens de ce peintre grec. VII. 233. a.
1437. b.
APELLE, diverfes obfervations fur ce peintre & fur fès
ouvrages. XII. 23 3. b. Son tableau de Vénus anadyomene.
XVII. 36. b. I. 397. a. Suppl. I. 381. a, b. Son tableau de
la calomnie, ü . 364. a. Obfervation fur fa réponfe à un
cordonnier. XV. 19. b. Tableau qu’Apelle & Protogene
travaillèrent enfemble. XII. 264. a.
APELLITES , hérétiques du fécond fieéle. Leur chef ,
leurs erreurs. I. 322. b.
Apellites , leur erreur fur Pafcenfion de Jefus-Chrift. I.
749. b. Faux évangiles d’Apellès. VI. 117. a.
APENNINS monts , diitinétion que les Romains éfa-
bliffoient entre les arbres de l’orient & de l’occident de
l’Apennin. V lll. 701. a.
APEPSIË, terme de l’ancienne médecine. III. 364. ¿.
APÉRITIFS, ( Médec. ) remedes qui rendent le cours
des liqueurs plus libre. On doit mettre dâns cette claffe les
émolliens & les relâchans. Comment fe produit leur effet.
Les apéritifs conviennent dans tous les cas dobftraétion.
Les évacuans peuvent être appetiéâ de ce nom, de quelque
A P H 83
ftature qu'ils foient. Les cinq racines apéritives. Siröp des
cinq racines. I. 323. a.
j ^ PdcITIFSi ’ m^ lc-) obfervatiôns fur ce qui eft dit
dans 1 Encyclopédie qu’o/z tire des racines apéritives. une eau
avec laquelle on pourroit faire le fyrop. Suppl. I. 482. a.
Apéritif, apozême, I. 342. a.
A rE R T E , loi. IX. 632. a.
APEX, I Hift. anc. )'bonnet facerdotal. Étymologie de ce
mot -& de celui de Flamines qui étoit le nom des prêtres
qui le portoient. I. 323. a.
APHACITE, ( Myth. ) furnom de Vénus. Signes aux-,
quels on connoifioit fi la Déeffe agréoit ou rejettoit les
offrandes qu’on lui apportoit.I. 323. b.
Aphacite, defcription de l’oracle de Vénus aphacite. XL
APHÉLIE , {Aftron.) la plus grande diftance d’une planète
au foleil. Son oppofé eft le périhélie. Mouvement de
1 aphélie. I. 323. b. Proportions de ce mouvement avec la
diftance des planètes au foleil. Ce mouvement n’eft pas
encore parfaitement connu. Mouvement des aphélies de
Mercure & de Mars , félon Newton : lieu de l’aphélie
de chaque planete , félon Kepler, pour l’année 1700. Leurs
mouvemens annuels, félon le même, & félon de la Hire.
Ibid. 324.0.
A ph é l ie , { Aftron.) ce qu’il y a de plus important à
èxpliquer au fujet de 1 aphélie des planetes, eft la maniéré
d’en déterminer la pofition & le mouvement par des .obfervations
aftronomiques. Explication de la méthode de Kepler
qu’il tirait de la nature du mouvement elliptique. Premiere
méthode pour trouver l’apogée du foleil. Seconde méthode
pour lw planetes, troifieme méthode employée par l’auteur
pour déterminer l’aphélie de Mercure & de Vénus. Quatrième
méthode. Table de l’aphélie des planetes pour l’année
1750, & de fon mouvement pour cent ans. Ouvrages
à confuiter. Suppl. I. 482. a , b & 483. a.
Aphélie, voyei A psides. Moyen de trouver la diftance
du lieu vrai de la planete à fon aphélie. V. 837. a. '
APHERESE, {Gramm.) figure de di&iom Étymologie
du mot. Exemples de cette figure. I. 324. a.
APHONIE, {Médec.) privation de la voix. Caufes de
cette maladie. Obfervation de cette caufe dans un mélan-*
cholique frappé d’aphonie. La paralyfie de la langue qui*
précédé ou qui fuit l’apoplexie ou l’hémiplégie, eft accom->
pagnée d’aphonie. Accidens qui peuvent l’occafionner. Celle
qui eft incurable. Celle qu’on peut guérir. Remedes qu’il faut
employer. I. 324. b.
_ Aphonie, ufage du velar,XVL 877, a. & de la véronique
dans cette maladie. XVII. 91. a. Prognoftics tirés de l’aphonie
dans certaines maladies. 43 3. a, b. Traitement de cet accident*
Ibid. b. 436. a.
APHORISME, {Médec.) chaque aphorifme d’Hippocrate
èft le réfultat deplufieurs obfervations. XL 320. a. Critique
de ceux de Boerhaave. 3 i 3. ai
APHRACTES, ( Hift. anc. ) navires des anciens à un rang
de'rames, ainfi àppellésparce qu’ils n’étoientpoint couverts.
Leur conftraôion. Autres vaiffeaux de ce nom qui étoient
couverts. Paffage de Tite-Dve, d’où l’on peut conclure en
quoi confiftoit la différence des aphraéteS & des cataphraétes*
Apkraues, voyez CATAPHRACTES. H. 766. ¿1
APHRODISÉEi {Alexandre) fa phyfiologie. Suppl. IV*
548. a.
APHRODISIAQUES, {Mat. méd.) différence entre ces
femedes 8c ceux que les anciens appelloient fpcrmatopoitlica.
Subftances auxquelles les auteurs de Matière médicale attribuent
fans fondement la vertu aphrodifiaque. Remedes aphro-
difiaques employés à l’extérieur. Seconde claffe d’aphrodi-
fiaques qui paroiffent les fpermatopées des afiéièns. Derniere
raflource qu’on propofe dans l’extrême frigidité. Suppl. L 483*
d, b.
Aphrodifiaques, propriétés 8c ufages de ces remedes. VIII.
634. b. Ceux qu’emploient les Indiens. Suppl. 1.792. a. Remedes
ôppofés aux aphrodifiaques. 430. b.
APHROD1TES, ( Ge'ogr. ) il eft incertain s’il y a en Afrique
deux villes de ce nom ou une feule. On peut dire au
moins que les géographes ne font pas d’accord fur leur pofition.
Suppl. 1.483. b.
APHtARTODOCETES, {Hift. eccl.) hérétiques. Etymologie
de ce mot. Leurs erreurs. 1. 326. a.
APHTES, {Médec. ) petits ulcérés qüi occupent l’intérieut1
de la bouche. Parties qui peuvent en être attaquées. I. 323. a*.
Caufe de ces accidens. Carafteres auxquels on juge de leur
malignité. Les enfàns 8c les vieillards y font plus lujets. Cir-
conltances qui fe joignent aux aphtes qui attaquent les adultes*
Remedes. Ibid. b.
Aphtes ,■ prognoftic fur les aphtes des enfàns. V. 661. ai
Curation de cette maladie. Ibid. 662. b. Gargariûnc déterfif
pour les aphtes putrides. VIL 313. a.
A p h te s , ( Maréch. ) maladie du çheyal. Suppl, IIL 4 1 1. ¿,