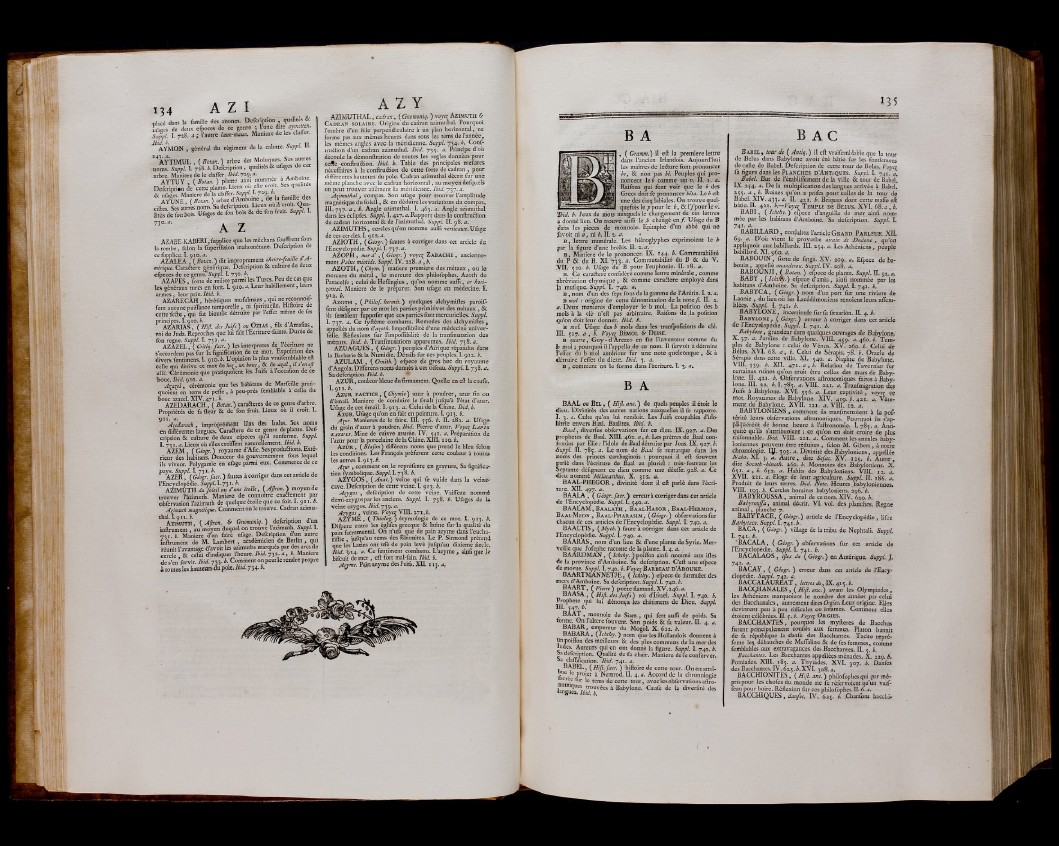
1 3 4 A Z I
«lacé dans la famille des ahones. Defcriprion , qualités &
ifages de deux efpeces de ce genre ; l’une dite
Suppl. L 728. a ; l’autre laun-maun. Maniéré de les clalier.
^AYMON , général du régiment de la calotte. Suppl. II.
I4AYTIMUL , ( Botan. ) arbre des Moluques. Ses autres
noms. Suppl. I. 728. i. Defcriprion, qualités St. ufages de cet
arbre. Maniéré de le daller, Ibid. 7 2 9 . <*• ,
AYTUY ( Botan. ) plante ainfi nommee à Amboine.
Defcriptien de cette plante. Lieux où eUe croit. Ses quab
& ufaees. Maniéré de la claffer. Suppl. 1.729. 0.
AyIjNE , ( Botan. ) arbre d’Ambome , de la ftmille des
73°“' A Z
AZABE-KABERI, fupplice que les méchans fouffrent fous
•la tombe, félon la fuperffîdon mahométane. Defcription de
cefupplice. 1 .910. a. ... .
AZALEA , (Botàn.) dit improprement chevre-feuiUe d A-
mérique. Caraétere générique. Delcription 8c culture de deux .
efpeces de ce genre. Suppl. 1. 730. h « 1
AZAPES, forte de milice parmi les Turcs. Peu de cas que
les généraux turcs en font. ï. 910. a. Leur habillement, leurs
armes, leur paie. Ibid. b. . ..
AZARECÀH, hérétiques mufulmans, qui ne reconnoil-
fent aucune puiffance temporelle, ni fpirituelle. Hiftoire de
cette feéle, qui fut bientôt détruite par l’effet même defes
principes. 1 .910. b. r
AZARIÂS, (Hifl. des Juifs) ou O zias , fils dAmafias,
. roi de Juda. Reproches que lui fait l’Ecriture-fainte. Durée de
fon regne. Suppl. I. 731. u.
AZAZEL, (-Critiq. facr.) lés interprètes de 1 écriture ne
s’accordent pas fur la lignification dé ce mot. Expourion des
divers lentimens. 1 . 910. b. L’opinion la plus vraifemblable eft
celle qni dérive ce mot dehezy un bouc , 8c àe açal , il s en efi
allé. Cérémonie que prariquoient les Juifs à 1 occafion de ce
Loue. Ibid. q'xo. a. , ■
Araiel, cérémonie que les habitans dfe Marfeüle prati-
quoient en tems de pefte, à peu-près femblable à celle du
‘bouc azazel. XIV. 471. b.
AZEDARACH, ( Botan.) caraéleres de ce genre d arbre.
Propriétés de fa fleür & de fon fruit. lieux où il croit. L
'OII. "a. . t « o
Azedarach, improprement lilas des Indes, bes noms
en différentes langues. Caraftere de ce genre déplanté. Defcriprion
8c culture de deux efpeces qu’il renferme. Suppl.
1. 731. a. lieux où elles croiffent naturellement. Ibid. b.
AZEM, (Géogr.) royaume d’Afie. Ses produâions. Extérieur
des habitans. Douceur du gouvernement fous lequel
ils vivent. Polygamie en ufage parmi eux. Commerce de ce
pays. Suppl. 1. 731 .b.
AZER, (Géogr. facr. ) fautes à corriger dans cet arade de
l ’Encyclopédie. Suppl.l. 731- b.
AZIMUTH du foleil ou d'une ¿toile , ( Aflron. ) moyen de
trouver l ’azimuth. Maniéré de connoître exactement par
obfervation l’azimuth de quelque étoile que ceToit. 1. 911 .b.
Azimuth magnétique. Comment on le trouve. Cadran azimuthal.
1.911. b. . . „
Azimuth , f Aftron. S* Gnomomq. ) defcription d un
infiniment, au moyen duquel on trouve l’azimuth. Suppl. I.
731. b. Maniéré d’en faire ufage. Defcription dun autre
infiniment de M. Lambert , académicien de Berlin, qui
réunit l’avantage d’avoir les aximuths marqués par des arcs de
cercle 8c celui d’indiquer l’heure. Ibid. 73a. a , b. Mamere
de s’enfervir. Ibid. 733. ¿.Comment on peut le rendre propre
à toutesles hauteurs dupole. Ibid.^4. b.
A Z Y
AZIM U TH A L , cadran, ( Gnomoniq. ) voyez AZIMUTH &
C adran solaire. Origine du cadran azimuthal. Pourquoi
l’ombre d’un flile perpendiculaire à un plan horizontal, ne
forme pas aux mêmes heures dans tous les tems de l’année,
les mêmes angles avec la méridienne. Suppl. 734. b. Conf-
truélion d’un cadran azimuthal. Ibid. 733. a. Principe d’où
découle la démonflration de toutes les regles données P°ur
ceffe conflruétion. Ibid. b. Table des principales melùres
néceffaires à la coriflruftion de cette forte de cadran , pour
différentes hauteurs du pôle. Cadran azimuthal décrit fur une
même planche avec le cadran horizontal, au moyen defquels
on peut trouver aifément la méridienne. Ibid. 737. a.
Azimuthal, compas. Son ufage pour trouver l’amplitude
magnétique du foleil, 8c en déduire les variations du compas.
III.737. a , b. Angle azimuthal. I. 463. a. Angle azimuthal
dans les éclipfes. Suppl. 1. 427. a. Rapport dans la conflruélion
du cadran horizontal 8c de l’azimuthal. Suppl. II. 98. a.
AZIMUTHS, cercles qu’on nomme auffi verticaux. Ufage
de ces cercles. 1 .912. a.
AZIOTH, ( Géogr. ) fautes à corriger dans cet article de
l’Encyclopédie. Suppl. 1. 737. a.
AZOPrl, mer d’ , ( Géogr. ) voyez Z a b a c h e , anciennement
Palus mèotide. Suppl. IV. 228. a , b.
AZOTH, ( Chym. ) matière première des métaux, ou le
mercure du métal, le mercure des philofophes. Azoth de
Paracelfe ; celui de Heflingius, qu’on nomme auffi, or horizontal.
Maniere de le préparer. Son ufage en médecine. I.
912. b.
A zoth , ( Philof. hermét. ) quelques alchymifles paroif-
fent défigner par ce mot les parties primitives des métaux, 8c
ils femblent iuppofer que cesparties fontmercurielles. Suppl.
I. 737. a. Ce fyflême combattu. Remedes dès alchymifles ,
ippellés du nom à'azpth. Impofïibilité d’une médecine univer-
.eùe. Réflexions fur l’impoflibilité de la tranfmutation des
métaux. Ibid. b. Tranfmutations apparentes. Ibid. 738. a.
AZUAGUES, ( Géogr.) peuples d’Afrique répandus dans
la Barbarie 8c la Numidie. Détails fur ces peuples. 1. 912. b.
AZULAM , '( Omith. ) efpece de gros bec du royaume
d’Angola. Différens noms donnés à cet oifeau. Suppl. 1. 738. a.
Sa defcriprion. Ibid. b.
AZUR, couleur bleue du firmament. Quelle en efl la caufc.
‘I.912. b.
ÀZUR factice , ( Chymie) azur à poudrer, azur fin ou
d’émail. Maniere de conduire le fmalt jufqu’à l’état d'azur.
Ufage de cet émail. L'913. u. Celui de la Chine, Ibid. b.
A zur. Ufage qu’on en fait en peinture. I. 913, b.
Azur. Manieres de le faire. III. 556. b. II. 282. a. Ufage
du grain d’azur à poudrer-. Ibid. Pierre d’azur. Voyez L a p i s
l a z v l i . Mine de cuivre azurée. IV. <41. a. Préparation de
l’azur pour la porcelaine de la Chine. XIII. 110. b.
A z u r , (Blafon) différens noms que prend le bleu feloij
les conditions. Les François préfèrent cette couleur à toutes
les autres. I.913. é.
Azur, comment on le repréfente en gravure. Sa lignification
lymbolique. Suppl. 1.738. b.
AZYGOS, ( Anat. ) veine qui fe vuide dans la veine-
cave. Defcription de cette veine. L 913. b.
Azygos , defcription de cette veine. Vaiffeau nommé
demi-azygospar les anciens. Suppl. I. 738. b. Ufages de la
veine azygos. Ibid. 739. a.
Azygos , veine. Voyez VIII. 271.é.
A Z ïM E , ( Théolog.) étymologie de ce mot. I. 913. b.
Difpute entre les églues grecque 8c latine fur la qualité do
pain facramental. On n’ufa que de pain azyme dans l’eucha-
riflie , iufqu’au tems des Ébionites. Le P. Sirmond prétend ?ue les Latins ont ufé de pain levé jufqu’au dixième fieçle.
bid. £14. a. Ce fentiment combattu. L’azyme, aijjfi quç je
bifçuit de mer, efl fort mal-fain. Ibid. b.
Azyme. Pain azyme des Juifs, XU. 113. a.
b a c
, ( Gramm. ) il eft la première lettre
dans l’ancien Irlandois. Aujourd’hui
les maîtres de leéhire font prononcer
be, 8c non pas bé. Peuples qui prononcent
le b comme un v. H. 1. a.
Raifons qui font voir que le b des
Grecs doit fe prononcer bêta. Le b eft
une des cinq labiales. On trouve quelquefois
le p pour le é, 8c l’/pour le v.
‘Jbid. b. Jeux de mots auxquels le changement de ces lettres
a donné lieu. On trouve auffi le .b changé en f. Ufage du B
¡dans les pièces de monnoie. Epitaphe d’un abbé qui ne
Jàvoit ni a , ni b. H. 2. a. *
b , lettre numérale. Les hiéroglyphes exprimoient le b
par la figure d’une brebis. II. 2.a.
B , Maniéré de le prononcer. IX. *44* ^ Commutabilité
du P 8c du B. XI. '733. a. Commutabilité du B 8c du V.
.VII. 520. b. Ufage du B pour l’euphonie. II. 18. a.
b. Ce caraâere confidérécomme lettre minérale, comme
abréviation chymique, 8c comme caraétere employé dans
ja mufique. Suppl. I. 740. a.
B , nom d’un des fept fons de la gamme de l’Arétin. I. 2. a.
B mol : origine de cette dénomination de la note fi. II. 2.
a. Deux maniérés d’employer le b mol. La pofition des b
mois à la clé n’eft pas arbitraire. Raifons de ,1a pofition
qu’on doit leur donner. Ibid. b.
B mol. Ufage des b mois dans les tranfpofirions de clé.
m . Ç17. a , b. Voyez BÉMOL & DlESE.
b quarre, G uy -d ’Arezzo en fut l’inventeur comme du
b mol j pourquoi il fappella.de ce nom. Il fervoit à détruire
l’effet du b mol antérieur fur une note quelconque, 8c à
détruire l’effet du dieze. Ibid. 3. a.
b , comment on le forme dans récriture. I. 3. a.
B A
BAAL ou BëL, ( Hifl. anc.) de quels peuples il ¿toit le
dieu. Divinités des autres nations auxquelles il fe rapporte.
1. 3. a. Culte qu’on lui rendoit. Les Juifs coupables d’idolâtrie
envers Baal. Baalites. Ibid. b.
Baal, diverfes obfervarions fur ce dieu. IX. 927. a. Des
prophètes de Baal. XIII. 462. a , b. Les prêtres de Baal confondus
par Elie: l’idole de Baal détruite par Joas. IX. 927. b.
Suppl. U. 785. a. Le nom de Baal fe remarque dans les
noms des princes carthaginois : pourquoi il eft fouvent
arlé dans l’écriture de Baal au pluriel : très-fouvent les
optante défignent ce dieu comme une déeffe. 928. a. .Ce
dieu nommé Mélacarthus. X. 312. a.
BAAL-PHEGOR, divinité dont il eft parlé dans l’écriture.
XII. 497. a.
BAALA , ( Géogr. facr.) erreur à corriger dans cet article
de l’Encyclopédie. Suppl. I. 540. a.
BAALAM, B a a la th , Baa l-Hasor, Baal-Hermon,
Baal-Meon , Baal-Pharasim, (Géogr.) obfervarionsfur
chacun de ces articles de l’Encyclopédie. Suppl. I: 740. a.
BAALTIS, (Myth.) faute à corriger dans cet article de
l’Encyclopédie. Suppl. 1. 740. a.
BAARAS, nom d’un lieu & d’une plante de Syrie. Merveille
que Jofephe raconte de la plante. 1. 4. a.
BAARDMAN, ( Ichthy.) poiffon ainfi nommé aux ifles
de la province d’Amboine. Sa -defcriprion. C’eft une efpece
de morue. Suppl. 1. 740. b. Voyez Barbeau d’Arouke.
BAARTMANNETJE, ( Ichthy. ) efpece de furmulet des
mers d’Amboine, Sa defcriprion. Suppl. 1. 740. b.
BAART, (Pierre) poète flamand. XV. 246. a.
BAASA, ( Hifl. des Juifs) roi d’Ifraël. Suppl. I. 740. b.
Prophète qui lux dénonça les châtimens de Dieu. Suppl.
ll l. <47. b.
B A A T , monnoie de Siam, qui fert auffi de poids. Sa
forme. -On 1 altéré fouvent. Son poids & fa -valeur. U. 4. a.
BABAR, empereur du Mogol. X. 612. b.
BABARA, (Ichthy.) nom que lesHollandois donnent à
un poiffon des meilleurs 8c des plus communs de la mer des
Indes. Auteurs qui en ont donné la figure. Suppl. 1. 740. b.
e d?f™Ptio"- Qualité de fa chair. Maniéré de le conferver.
^a claflification. Ibid. 741. a.
BABEL, (Hifl. facr. ) hiftoire de cette tour. On en attri-
f Ue , Proiet à Nemroa. II. 4. a. Accord de la chronologie
^rc.e ‘ur le tems de cette tour, avec les obfervations aftro-
1 " 1,(îHes tr°uvèes à Babylone. Caufe de la diverfité des
langues. Jbid. b.
B a b e l , tout Je ( Antiq. ) il eft vraifemblable que la tour
de Belus dans Babylone avoit été bâtie fur les fondemens
de celle de Babel. Defcription de cette tour de Belus. Voyez
fa figure, dans les P la n c h e s d ’A n t iq u e s . Suppl. I. 741. a.
Babel. But de l’établiiTement de la ville 8c tour de Babel.
IX. 254. a. De la multiplication des langues arrivée à Babel.
235. a , b. Ruines qu’on a prifes pour celles de la tour de
Babel. XIV. 433.. a. II. 421. b. Briques dont cette maffe efi
bâtie, n . 42*. b.—Voyez T EM P L E d e BE LU S . XVI. 68. a , b.
BABI, ( Ichthy. ) efpece d’anguille de mer ainfi nom*
mée par les habitans d’Àmboine. Sa defcriprion. Suppl. I.
74‘ - à.
BABILLARD, confultez l’article Gr an d Pa r leu r . YTT.
69* fi- D ou vient le proverbe airain de Dodone , qu’en
appliquoit aux babillards. III. 234 .a. Les Athéniens , peuple
babillard. XI. 960. a. " '
BABOUIN, forte de finge. XV. 200. a. Efpece .de babouin
, appelle ouanderou. Suppl. IV. 208. a.
BABOUNJI, ( Botan. ) efpece de plante. Suppl. II. 92. a.
BABY , ( Ichtfy.) efpece a’amia, ainfi nommée par les
habitans d’Amboine. Sa defcriprion. Suppl I. 741. b.
BABYCA, ( Géogr.) nom d’un port fur une riviere de
Laonie , du lieu où les Lacédémoniens tenoient leurs affem-
blées. Suppl. I. 741, b.
BABYLONE, incertitude fur fa fituation. H. 4. b.
B a bylo ne , ( Géogr. ) erreur à corriger dans cet article
de l’Encyelopédie. Suppl. I. 741. b.
Babylone, grandeur dans quelques ouvrages de Babylone/
X. 37. a. Jardins de Babylone. VIII. 459, a. 460. b. TemÈles
de Babylone : celui de Vénus. XV. 260. b. Celui de
'élus. XVI. 68. a 9 b. Celui de Sérapis. 78.' b. Oracle <lé
Sérapis dans cette ville. XI. 340. a. Naphte de Babylone.
VIII. 339. b. XII. 471. a y b. Relation de Tavernier fur
certaines ruines qu’on croit être céUes des murs de Babyr-
lone. II. 421. b. Obferyarions aftronpmiques faites à Babylone.
HI. 22. b. I. 78?. u. VIII. 221. a, Tranfniigration de^
Juifs à Babylone. XVl. « 6 . a. Leur captivité , voyez cç
mor. Royaumes de Babylone- XIV. 419. é. 421. a. Vêtement
de Babylone. XVII. 221. a. VIII. 12. a.
y BABYLONIENS, comment ils tranfmettoient à la pof-
térité leurs obfervations aftronomiques. Pourquoi ils s’appliquèrent
de bonne heure à l’aftronomie. I. 785. a. Antiquité
qu’ils s’attribuoient : ce qu’on en doit croire de plus
raifonnable. Ibid. VIH. 221. a,. Comment les annales babyloniennes
peuvent être réduites , félon M. Gibert, à notre
chronologie. m- 393- a. Divinité des Babyloniens, appellee
Nabo. XL 3. a. Autre, dite Sefac. XV. 125. b. Autre,
dite Socoth-bénoth. 260. b. Monnoies des Babyloniens. X.
651- a , b. 6<¡ 2. a. Habits des Babyloniens. VIH. 12. a.
XVII. 221. a. Eloge de leur agriculture. Suppl. II. 186. a.
Produit de leurs terres. Ibid. Note. Heures babyloniennes.
Vin. 103. b. Çercles horaires babyloniens. 296. b.
BABYROUSSA, animal de ce nom. X IV. 620. b.
Baby ronfia y animal décrit. VI. vol. des planches. Regne
animal, planche 7.
BABYTACE, ( Géogr.) article de l’Encyclopédie , lifez
Burbytace. Suppl. 1. 741. b.
BACA, (Géogr.) yiÙage de la tribu de Nephtali. SuppL
L 741. b.
"BACALA, ( Géogr. ) .obfervations fur cet article de
l’Encyclopédie. Suppl. I. 741. b.
BACALAOS , ifles -de f Géogr. ) en Amérique. Suppl. J.
742. «•
BACA Y , ( Géogr. ) erreur dans cet article Je l ’Encyclopédie.
Suppl. 742. a.
BACCALAUREAT, lettres de, IX. 413. b.
BACQHANALES, ( Hifl. anc. ) avant les Olympiades,
les Athéniens marquoient le nombre des années par celuji
des Bacchanales, autrement dites Orgies. Leur origine. Elles
devinrent peu à peu ridicules ou infames. Comment elles
étoient célébrées. H . q. b. Voyez Orgie s.
BACCHANTES, pourquoi les myfteres de Bacchus
forent principalement confiés aux femmes. Platon bannit
de fa république la danfe des Bacchantes. Tacite repréfente
le$ débauches de Meffaline 8c de fes femmes, comme
fcmblables aux extravagances des Bacchantes. II. 5. b.
Bacchantes. Les Bacchantes appellées ménades. A. 229. b.
Pomiades. XIII. 185. a. Thyiades. XVL 307. b. Danfes
des Bacchantes. IV. 625. b. XvI. 308. a.
BACCHIONITES, ( Hifl. anc. ) philofophes qui par mépris
pour les chofes du monde ne fe réfervoient qu’un vaif*
feau pour boire. Réflexion fur ces philofophes. H. 6. a.
BACCHIQUES, danfes. IV. 625. b. .Chanfons bacchi*