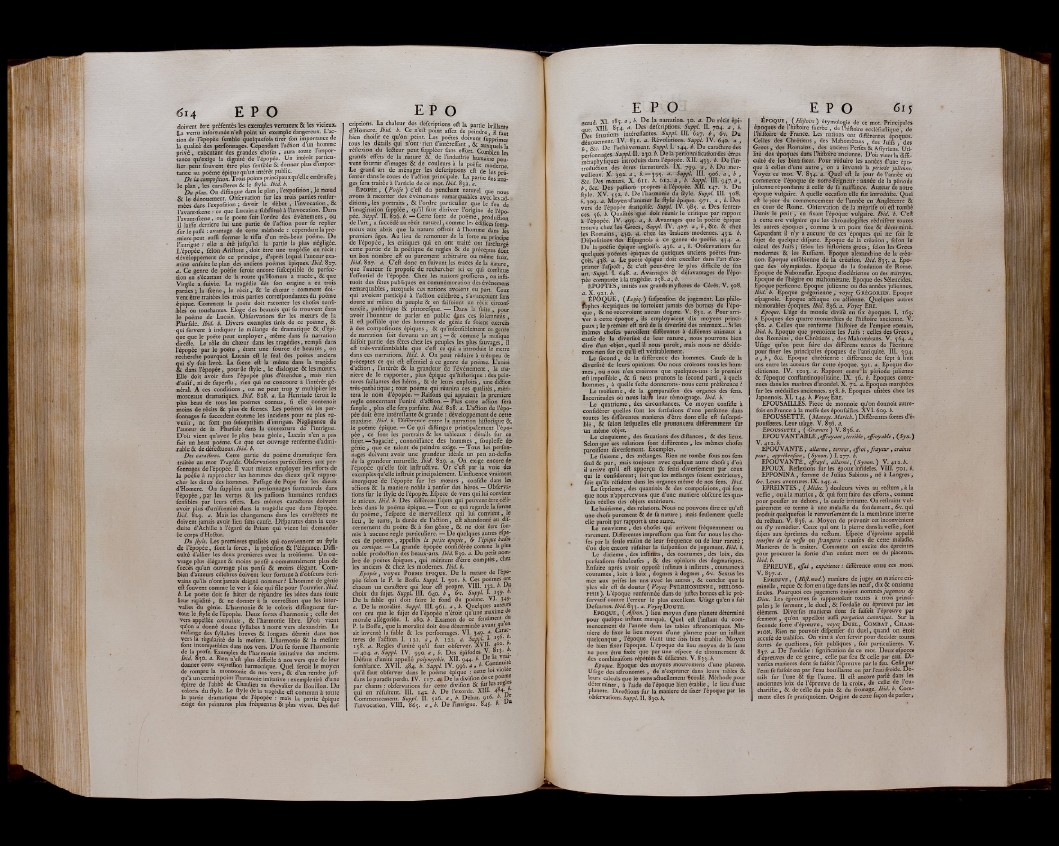
ó i 4 E P O
doivent être préfentès les exemples vertueux 8c les vicieux.
La vertu infortunée n’eft point un exemple dangereux. L’action
de l’épopée femble -quelquefois tirer fon importance de
la qualité des perfonnages. Cependant l’attion d’un homme !
privé, exécutant des grandes chofes, aura toute 1 impor- ;
tance qu’exige la dignité de l’épopée. Un intérêt parucu- ,
lier.peut-fouvent être plus fenfible Sc donner plus dimpor- |
tance au poëme épique qu’un intérêt public.
De Ut composition. Trois points principaux qu elle embrafle ;
le plan, les caratteres & le ftyle.Ibid.b. f l j j
Du plan. On -diftingue dans le plan, 1 expofmon, Je noeud
& le dénouement. Obfervation fur les trois parties renfermées
-dans Texpofition ; -favoir le début, l’invocation,.8c
l’avantdcene : ce que Lucain a fubftitué à l’invocation. Dans
,1’avantifcene, ou le poète fuit l ’ordre des événemens, ou
il laiffe derrière lui une partie de Tattkm pour fe replier
fur le paffé : avantage de cette méthode : cependant la première
peut aufli former le tiflù d’un très-beau poème. De
l’intrigue : elle a été jufqu’ici la partie la plus négligée.
L’épopée, félon Ariftoce , doit être une tragédie en récit :
•dévéloppement de ce principe, d’après lequel l’auteur examine
enfuite le plan des anciens poèmes épiques. Jbid. 827.
41. Ce genre de poéiie feroit encore fufceptible de perfection
en s’écartant de la route qu’Homere a tracée, 8cque
Virgile a fuivie. La tragédie dès fon origine a eu trois
parties ; la fcene, le récit, 8c le choeur : comment doivent
être traitées lés trois parties correfpondantes du poème
épique. Gomment le poète doit raconter les chofes terri-
.bles ou touchantes. Eloge des beautés qui fe trouvent dans
le poëme de Lucain. Obfervations fur les moeurs de la
Pharfale. Ibid. b. Divers exemples tirés de ce poëme, &
qui fervent à indiquer le mélange de dramatique 8c d’épi-
3ue que le poète peut employer, même dans fa narration
ireâe. Le rôle du choeur dans les tragédies, rempli dans
l’épopée par le poète , étant une fource de beautés, on
recherche pourquoi Lucain eft le feul des poètes anciens
qui s’y foit livré. Xa fcene eft la même dans la tragédie
& dans l’épopée, pour le ftyle, le dialogue 8c les moeurs.
Elle doit avoir dans l’épopée plus d’étendue , mais rien
d’oifif, ni de fuperflu, rien qui ne concoure à l’intérêt général.
A ces conditions , on ne peut trop y multiplier les
morceaux dramatiques. Ibid. 828. a. La Henriade feroit le
plus beau de tous les poèmes connus, fi elle contenoit
moins de récits & plus de fcenes. Les poèmes où les personnages
fe fuccedent comme les incidens pour ne plus revenir
, ne font pas fufceptibles d’intrigue. Négligence de
l’auteur de la Pharfale dans la contexture de rintrigue.
D’où vient qu’avec le plus beau génie, Lucain n’en a pas
fait un beau poème. Ce que cet ouvrage renferme d’admirable
8c de défcéhieux. Ibid. b.
Des caraHeres. Cette partie du poëme dramatique fera
traitée au mot Tragédie. Obfervations particulières aux perfonnages
de l’épopée. U vaut mieux employer les efforts de
la poéiie à rapprocher les hommes des dieux qu’à rapprocher
les dieux des hommes. Paifage de Pope fur les dieux
‘d’Homere. On fuppléra aux perfonnages furnaturels dans
l’épopée, par les vertus 8c les paillons humaines rendues
fenfibles par leurs effets. Les mêmes caratteres doivent
avoir plus -d’uniformité dans la tragédie que dans l’épopée.
Ibid. 029. a. Mais les changemens dans les caratteres rie
doivent jamais avoir lieu fans caufe. Difparates dans la conduite
d’Achille à l’égard de Priam qui vient lui demander
le corps d’Hettor.
Du flyle. Les premières qualités qui conviennent au ftyle
de l’épopée, font la force, la préciilon 8c l’élégance. Difficulté
d’allier les deux premières avec la troifieme. Un ouvrage
plus élégant 8c moins penfé a communément plus de
fuccès qu’un ouvrage plus penfé 8c moins élégant. Combien
d’auteurs célébrés doivent leur fortune à d’obfcurs écrivains
qu’ils n’ont jamais daigné nommer ? L’homme de génie
eft fouvent comme le ver à foie qui file pour l'ouvrier. j/é/V.
b. Le poète doit fe hâter de répandre fes idées dans t'oute
leur rapidité , 8c ne donner à la correction que les intervalles
du génie. L’harmonie 8c le coloris dimnguent fur-
tout le ,ftyle de l’épopée. Deux fortes d’harmonie ; celle des
vers appellée contrainte, 8c l’harmonie libre. D’où vient
qu’on a donné douze fyllabes à notre vers alexandrin. Le
mélange des fyllabes brèves 8c longues détruit dans nos
vers la régularité de la mefure. L’harmonie 8c la mefure
font incompatibles dans nos vers. D’où fe forme l’harmonie
de la orofe. Exemples de l’harmonie imitative des anciens.
Ibid. 830. a. Rien n’eft plus difficile à nos vers que de leur
donner cette expreflion narmonique. Quel feroit le moyen
de rompre la monotonie de nos vers, 8c d’en rendre juf-
qu’à un certain pomt 1 harmonie imitative : exemple tiré d’une
épitre de l’abbé de Chàulieu au chevalier de Bouillon. Du
coloris du ftyle. Le ftyle de la tragédie eft commun à toute
la partie dramatique de l’épopée : mais la partie épique
exige des peintures plus fréquentes 8c plus vives. Desdcf-
EP O
criptions. La chaleur des deferiptions eft la partie brillante
d’Homere. Ibid. b. Ce n’eft point affez de peindre H faut
bien choifir ce qu’on peint. Les poètes doivent fupprimer
tous lçs .détails qui n’ont'rien d’intéreffant, & auxquels la
réflexion du letteur peutfuppléer fans effort. Combien les
grands' effets de la nature oc de l’induftrie humaine peuvent
fournir d’images 8c de couleurs à la poéfie moderne"
Le grand art de ménager les deferiptions eft de les pré-
fenter dans le cours de rattion principale. La partie des unà-
ges fera traitée à l’article de ce mot .Ibid. 831. a.
Épopée, {Poéfif ) c’eft du penchant naturel que nous
avons à raconter des événemens remarquables avec les ad-
dirions, les portraits, 8c l’ordre particulier que le feu de
l’imagination fimplée, qu’il faut dériver l’origine de l’épopée.
Suppl. II. 826. b. — Cette forte de poëme, production
de l’art, a fuccédé au récit naturel, comme les édifices fomp-
tuèux aux abris que la nature offroit à l’homme dans les
premiers âges. Au lieu de remonter de la forte au principe
de l’épopée, les critiques qui en ont traité ont furchargé
cette partie de la poétique de réglés 8c de préceptes dont
un bon nombre eft ou purement arbitraire ou même faux.
Ibid. 827. a. C’eft donc en fuivant les traces de la nature
que l’auteur fe propofe de rechercher ici ce qui conftitue
Teffentiel de l’épopée. Chez les nations groffieres, on infti-
tuoit des fêtes publiques en commémoration des événemens
remarquables, auxquels ces nations avoient eu part. Ceux
qui avoient participé à l’attion célébrée, s’avançoient fans
doute au milieu du peuple 8c en faifoierit un récit circonf-
tancié, pathétique 8c pittorefque. — Dans la fuite , pour
avoir l’honneur de parler en public (Uns ces folemnités ,
il eft poffible que des hommes de génie fe foient exercés
à des compofitions épiques , 8c qu’infenfiblement ce genfe
de narration foit devenu un a r t ;— 8c comme la mufique
faifoit partie des fêtes chez les peuples les plus fauvages, il
eft très-vraifemblable que c’eft ce qui a introduit le metre
dans ces narrations. Ibid. b. On peut réduire à très-peu de
préceptes ce qui eft effentiel à ce genre de poëme. L’unité
d’attion , l’intérêt 8c la grandeur de l’événement, la maniéré
de le rapporter, plus épique qu’hiftorique : des peintures
faillantes des héros, 8c de leurs exploits, une diétion
très-pathétique ; tout poëme qui réunira ces qualités, méritera
le nom d’épopée. — Rations qui appuient la première
réglé concernant l’unité, d’a&ion. — Plus cette attion fera
funple, plus elle fera parfaite. Ibid. 828. a. L’aétion de l’épopée
doit être intéreffante 8c grande : développement de cette
maxime. Ibid. b. Différence entre la narration hiftorique 8c
le poëme épique. — Ce qui diftingue principalement l ’épopée
, ce font les portraits 8c les tableaux : détails fur ce
fujet.— Sagacité, connoiffance des hommes , foupleffe de
génie, que ce talent de peindre exige. — Tous les perfonnages
doivent avoir une grandeur idéale un peu au-deffus
de la grandeur naturelle. Ibid. 829. a. On exige encore de
l’épopée qu’elle foit inftruttive. Or c’eft par la voie des
exemples qu’elle inftruit principalement. L’influence vraiment
énergique de l’épopée fur les moeurs , confifte dans les
aélions 8c la maniéré noble à penfer des héros. — Obfervations
fur le ftyle de l’épopée. Efpece de vers qui lui convient
le mieux. Ibid. b. Des différens fujets qui peuvent être célébrés
dans le poëmp épique. — Tout ce qui regarde la forme
du poème, l ’efpece de merveilleux qui lui convient, le
lieu, le tems, la durée de l’aélion, eft abandonné au discernement
du poète 8c à fon génie, 8c ne doit être fournis
à aucune réglé particulière. — De quelques autres efpe-
ces de poèmes, appellés la petite épopée, & l'épique badin ?
ou comique. — La grande épopée coniidérée comme la plus
noble produélion des beaux-arts. Ibid. 830. a. Du petit nombre
de poètes épiques, qui méritent d être comptés, chez
les anciens 8c chez les modernes. Ibid. b.
Epopée, voyez P o e m e é p i q u e . De la nature de l’épopée
félon le r . le Boflù. Suppl. I. 301. b. Ces poèmes ont
chacun un carattere qui leur eft propre. VIII. 132. b. De
choix du fujet. Suppl. III. 640. b , bc. Suppl. L 159*
De la fable qui doit faire le fond du poème. VI. 349*
a. De la moralité. Suppl. III. 961. a , b. Quelques auteurs
ont cru que le fujet de l’épopée n’étoit qu’une maxime de
morale allégoriée. I. 280. b. Examen de ce fentiment du
P. le Boflù, que la moralité doit être d é te rm in é e avant qu on
ait inventé la fable 8c les perfonnages. VI. 349* ¿"y
teres de l’aétion. I. 121. a , b. 122. a. Suppl. L *5®* f
138. a. Réglés d’unité qu’il faut obferver. XVII* 402,b.
vrai-
I U U11IIW UU II 1UUL VUIMTVII ¿ f Q
— 404. a. Suppl. IV. 990. a y b. Des épifodes. V. qMj
Défaut d’unité appellé polymythie. XII. 944. b. De la V
femblance. XVlf. 484. b. Suppl. IV. 996. a , b. Conunui
qu’il faut obferver dans le poëme épique : cette lot
dans le paradis perdu. IV. i iy .a u De la divifion de ce poe
par chants : obfervations fur cette divifion 8c furies regi
qui en réfultent. III. 142. b. De l’exorde. XIU. 4°4- *
Commencement. Suppl. II. 526. a , b. Début. 9 • wl’invocation.
VIII. 863. a , b. De l’intrigue. 845. b.
E P O E P O
noeud. XL 183. a , b. De la narration. 30. a. Du récit épique
XIIL 834. a. Des deferiptions. Suppl. II. 704. a , b.
Des fituations intéreflantes. Suppl. III. 627. b , &c. Du
dénouement. IV. 831. a. Révolutions. Suppl IV. 640. a ,
b &c. De l’achèvement. Suppl. I. 144. Du carattere des
perfonnages. Suppl. II. 230. b. De la pe'iibnnification des êtres
métaphyuques introduits dans l’épopée. XII. 43 3. b. De l?ih-
troduttion des êtres furnaturels.; IX. 799. a , b. Du merveilleux.
X. 392. a i é. — 395. a. Suppl. III. 906. a , b ,
8cc. Des moeurs. X. 611. b. 612. a , b. Suppl. III. 947. a ,
é , 8cc. Des paflioris propres' à l’épopée. XII. 147. b. Du
ftyle. XV. 532. b. De l’harmonie du ftyle. Suppl. III. 308.
b. 309. à. ftfoyèn d’animer de ftyle épique. 971. a , b. Des
vers de l’épopée françoîfè. SuppL IV. 983. a. Des ïenten-
ces. 36. b. Qualités'^que doit réunir le critique par rapport
à l’épopée. IV. 495. <*., b. Avantages que la poéfie épique
trouva che£ les Grecs, Suppl. ÏV. 427. a , b, 8cc. 8c chez
les Romains , ^30. dt. chez les Italiens modernes. 432. b.
Difpofitions 'des Efpagnols à ce genre de poéfie. 434. a.
De la poéfie épique angloife. 436. a , b. Obfervations fur
quelques poèmes -épiques de quelques anciens poètes fran-
çois. 438. a. Lepoëte -épique doit exceller dans l’art d’exprimer
l’afpOtt, oc c’eft peut-être le plus difficile de fon
art. Suppl. I. '648. -a. Avantages 8c désavantages de l’épopée
comparée àia tragédie. 130. a,b.
EPOPTËS, initiés aux grands myfteres de Cérès. V. 308.
a. X, ozi. b.
.É PO Q U E , I^Logiq.) fufpenfion de jugement. Les philo-
iophes Sceptiques ne fortoient jamais des bornes de l’époque,
8c ne recevoient aucun dogme. V. 831. a. Pour arriver
à cette époque , ils employaient dix moyens princi-
paux ; le premier eft tiré de la diverfité des animaux.... Si les
mêmes chofes paroiffent différentes à différens animaux à
■caufe de la diverfité de leur nature, nous pourrons bien '
dire d’un -objet, -quel il nous paroît, mais nous ne déciderons
rien fur ce qu’il eft véritablement.
Le fécond, de la différence des hommes. Caufe de la
diverfité de leurs opinions. Ou nous croirons tous les hommes
, ou nous n’en croirons que quelques-uns : le premier
eft impoffible , 8c fi nous prenons le fécond parti, à quels
■hommes , à quelle fette donnerons - nous cette préférence ?
Le troifieme, de la comparaifon des organes des fens.
Incertitudes où nous laiire leur témoignage. Ibid. b.
Le quatrième, des circonftances. Ce moyen confifte à
confidérer quelles font les fenfations d’une perfonne dans
toutes les différentes maniérés d’être dont elle eft fufceptible
, 8c félon lefquelles elle prononcera différemment fur
un même objet.
Le cinquième, des fituations des diftances, 8c des lieux.
Selon que ces relations font différentes, les mêmes chofes
paroiffent diverfement. Exemples.
Le fixieme , des mélanges. Rien ne tombe fous nos fens
feul 8c pur, mais toujours avec quelque autre chofe ; d’où
il arrive qu’il eft apperçu 8c fenti diverfement par ceux
Îui le confiderent ; foit que les mélanges foient extérieurs,
bit qu’ils réfident dans les organes même de nos fens. Ibid.
Le feptieme, des quantités 8c des compofitions, qui font
que nous n’appercevons que d’une maniere obfcure les qualités
réelles des objets extérieurs.
Le huitième, des relations. Nous ne pouvons dire ce qu’eft
une chofe purement 6c de fit nature ; mais feulement quelle
elle paroît par rapport à une autre.
Le neuvième, des chofes qui arrivent fréquemment ou
rarement. Différentes impreffions que font fur nous les chofes
par la feule raifon de leur fréquence ou de leur rareté ;
d’où doit encore réfulter la fufpenfion de jugement. Ibid. b.
Le dixième , des inftiffits, des coutumes, des loix, des
perfuafions fàbuleufes , 8c des opinions des dogmatiques.
Enfuite après avoir oppofé inftituts à inftituts , coutumes à
coutumes, loix à loix , dogmes à dogmes , &c. Sextus les
met aux prifes les uns avec les autres, 8c conclut que le
plus sûr eft de douter ( Voye1 P yîIRHONIENNE , p h i l o s o p
h i e ) . L’époque renfermée dans de juftes bornes eft le préfer
vatif contre l’erreur le plus excellent. Ufage qu’en a fait
Defcartes. Ibid. 833. a. VÜyefë.D o u t e . .
E p o q u e , ( Âftron. ) lieu moyen d’une planete déterminé
pour quelque inftant marqué. Quel eft l’inftant du commencement
de l’année dans les tables aftronomiques. Maniere
de fixer le lieu moyen d’une planete pour un inftant
uelconque, l’époque étant une fois bien établie. Moyen
e bien fixer l’époque. L’époque du lieu moyen, de la lune
ne peut être fixée que par une efpece de tâtonnement 8c
des combinaifons répétées 8c délicates. V. 833. b.
Epoque. Epoque des moyens mouvemens d’une planete.
Ufage des aftronomes , de n’exprimer dans leurs tables 8c
leurs calculs que le teins actuellement écoulé. Méthode pour
déterminer, à l’aide de l’époque bien établie, le lieu d’une
planete. Directions fur la maniere de fixer l’époque par les
obfervations. Suppl. II. 830. b.
É p o q u e f (Hijloire) étymologie de ce mot. Principales
époques de Ihtftotre facrée , de Vhiftoire eedéfiaftique, de
Phiftotre de France. Les nattons ont différentes époques.
Celles dès Chrétiens , des Màhométans , des Juifs des
Grecs, 'des Romains, des anciensPerfes8cAffyrièns! Utilité
des époques dahs l’hiftofre ancienne. D’où vient la difficulté
de les bien fixer. Pour déduire les aimées d’une époque,
à celles d’une autre, on a inventé la période julienne.
Voyez ce mot. V. 834. a. Quel eft le jour de Tannée où
commence l ’époque de nori*e-feigncur : année de la période
julienne répondante à celle de fa naiflarièe. Auteur de notre
époque vulgaire. A quelle occafiori elle fut introdûite. Quel
eft le jour du commencement de Tannée en Angleterre 8c
en cour de Rome. Obfervation de la méprife où eft tombé
Denis le petit , en fixant l’époque vulgaire. Ibid. b. C’eft
à cette ere vulgaire que les chronologiftes réduifent toutes
les autres époques, comme à un point fixe 8c déterminé.
Cependant il n’y a aucune 'de ces époques qui ne foit le
fujet de quelque difpute. Epoque de la création , félon le
calcul des Juifs ; félon les hiftoriens grecs ; félon les Grecs
modernes 8c les Ruffiens. Epoque alexandrine de la création.
Epoque eufôbienne dé la création. Ibid. 83 3. a. Epoque
des olympiades. Epoque de la fondation de Rome.
Epoque de Nabonaffar. Epoque dioclétienne ou des martyrs.
Epoque de l’hégire ou mahométane. Epoque des'Séleucidès.
Epoque perfienne. Epoque julienne ou des années juliennes.
Ibid. b. Epoque grégorienne, voye^ G r é g o r i e n . Epoque
efpagnole. Epoque aftiaque ou attienne. Quelques autres
mémorables époques. Ibid. 836. a.- Voyer E r e .
Epoque. L’âge du monde divifé en fix époqués. I. 169.'
b. Epoques des quatre monarchies de l’hiftoire ancienne. V.
382. a. Celles que renferme l’hiftoire de l’empire romaiir.
Ibid. b. Epoque que prenoiènt les Juifs : celles des Grecs ,
des Romains, des Chrétiens , des Mahométans. V. 364. a.
Ufage qu’on peut faire des différens textes de l’écriture
pour fixer les principales époques de l’antiquité. III. 394.
a , .b , 8cc. Epoque chrétienne : différence de fept à huit
ans entre les auteurs fur cette époque. 391. a. Epoque dioe
détienne. IV. 1013. a. Rapport entre* la période julienne
8c l’époque conftantinopolitaine. IX. 36. b. Epoques contenues
dans les marbres d’arondel. X. 72. a. Epoques marqriées
fur les médailles anciennes. 238. b. Époques uutées chez les
Japonnois. XI. 144. b. Voyeç E r e .
EPOUSAILLES. Piece de monnoie qu’on donnoit autrefois
en France à la meffe des époufailles. XVI. 609. b.
EPOUSSETTE. ( Manege. Maréch. ) Différentes fortes d’é-,
pouffettes. Leur ufage. V. 836. a.
E p o u s s e t t e , ( Gravure ) V. 836. a.
EPOUVANTABLE , effrayant, terrible, effroyable , (5y/z. )
V. 412. b.
EPOUVANTE , allàrme , terreur, effroi, frayeur , crainte
peur , appréhenfion , ( Synon. ) 1. 277. b.
ÉPOUVANTÉ, effrayé, allarméy ( Synon. j V. 412.b.
EPOUX. Réflexions fur les époux inndeles. VIII. 701. b.
EPPONINA , 'femme de Julius Sabinus, né à Langres,
&c. Leurs aventures. IX. 243. a.
EPREINTES, ( Médec. ) douleurs vives au reôum, à la
veflie, ou à la matrice, 8c qui font faire des efforts, comme
pour pouffer au dehors , la caufe irritante. On reftraint vulgairement
ce terme à une maladie du fondement, &c. qui
produit quelquefois le renverfement de la membrane interne
du rettum. V. 836. a. Moyen de prévenir cet inconvénient
ou d’y remédier. Ceux qui ont la pierre dans la veflie, font
fujets aux épreintes du rettum. Efpece d’épreinte appellé
tenefme de la veffie ou ßrangurie : caufes de cette maladie.
Maniérés de la traiter. Comment on excite des épreintes
pour procurer la fortie d’un enfant mort ou du placenta.
Ibid. b.
ÉPREUVE, effai, expérience : différence entre ces mots.
V- 837.4.
E p r e u v e , ( Hijl.mod.) maniéré de juger en matière criminelle
, reçue 8c fort en ufage dans les neuf, dix 8c onzième
fiecles. Pourquoi ces iugemens étoient nommés jugemens de
Dieu. Les épreuves fe rapportoient toutes à trois principales;
le ferment, le duel, 8c l’ordalie ou épreuve par les
élémens. Diverfes manières dont fe faifoit l’épreuve par
ferment, qu’on appelloit aufli purgation canonique. Sur la
fécondé forte d’épreuve, voyez D u e l , C o m b a t , C h a m p
i o n . Rien ne pouvoit difpenfer du duel, quand on ¿toit
aceufé de trahifon. On vint à s’en fervir pour décider toutes
fortes de queftions, foit publiques , foit particulières. V.
837. a. De l’ordalie : fignifleation de ce mot. Deux efpeces
d'épreuves de ce genre, celle par feu 8c celle par eau. Diverfes
maniérés dont fe faifoit l’epreuve par le feu. Celle par
l’eau fe faifoit ou par l’eau bouillante ou par l’eau froide. Détails
fur l’une 8c fur l’autre. Il eft encore parlé dans^les
anciennes loix de l’épreuve de la croix, de celle de Peu-
Ichariftie, 8c de celle du pain 8c du fromage. Ibid. b. Comment
elles fe pratiquoient. Origine de cette façon de parler,