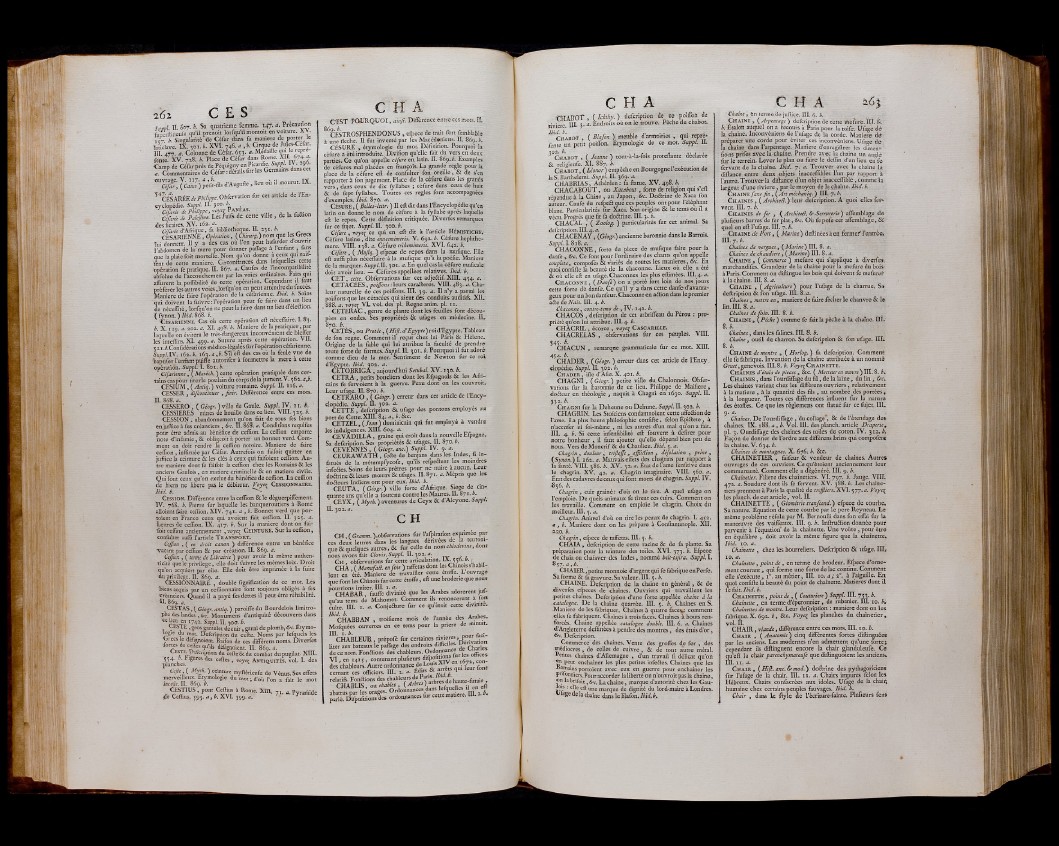
a 62 CES Sawl. ïï 807. £. Sa quatrième femme. 147. e. Précaution
fiioerilirieufe qu’il prenoit lorfqu’il montoit en voiture. XV.
u t b. Singularité de Cèfar dans fa mamere de porter le
laticlave. IX. lo t. i. XVI. 746. a , i. Cirque de Jules-Cefar.
III. 477. a. CilonnedeCéfar.éj3. i .MédaiUemu le rcpréfente.
XV. 718. b. Place de Célar dans Rome XO-674-
Camp de « fa r près de Péquigny e ^ ’Î
a. Commentaires de Céfar: détails fur les Germains dans cet
j t ^ ( 2 2 $ penVflsd’Angnfle, lieu où il mourut. IX.
^ 4CÉSARÉE </* Philippe. Obfervation fur cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. II. 3°°- %
- iie’ d= i &aion
des ficaires. XV. 162. *• - ■' „ ,
Céfarée d’Afrique, fa bibliothèque. 11.131. b.
CESARIENNE, Opération, ( Chtrurg.) nom que les Crrecs
lui donnent. Il y a des cas où l’on peut hafarder d’ouvrir
1 abdomen de la mere pour donner paffage a 1 enfant, fans
que la plaie foit mortelle. Nom qu’on donne à ceux qui nail-
■fent de cette maniéré. Circonffances dans lefquelles cette
opération fe pratique. H. 867. a. Caufes de 1 incompatibilité
abfolue de l’accouchement par les voies ordinaires. Faits qui
affurent la poflibilité de cette opération. Cependant il faut
préférer les autres voies,lorfqu’on en peut attendre du fucces.
Maniéré de faire l’opération de la céfarienne. Ibid. b. Soins
qui doivent la fuivrc : l’opération peut fe faire dans un lieu
de néceflité, lorfqu’on ne peut la faire dans un heu d éleétion.
( fynon. ) Ibid. 868. b. .
Césarienne. Cas où cette opération eft néceffaire. 1. 03.
b. X. 110. a. 202. a. XI. 498. 'b. Maniéré de la pratiquer, par
laquelle on évitera le très-dangereux inconvénient de bleffer
les inteilins. XI. 499. *. Suture après cette opération. VII.
r 21.¿.Confidérations médico-légales fur l’opérauon céfarienne.
Suppl.IV. 162. b. 163. a,b. S’il eft des cas où la feule vue de
'bapüfer l’enfant pqiue autorifer à foumettre la mere à cette
opération. Suppl. I. 801. b. .
Céfarienne, ( Maréch. ) cette opération pratiquée dans certains
cas pour tirerle poulain du corpsdela jument. V. •¡6z.atb.
CESIUM, ( Antiq. ) voiture romaine. Suppl. II. i 16. a.
CESSER , difcontinuer , finir. Différence entre ces mots,
n . 868. tf.
CESSERO , ( Géogr. ) ville de Gaule. Suppl. IV. 11. b. 1
CESS1ERES mines de houille dans ce lieu. VIII. 325. b.
CESSION, abandonnement qu’on fait de tous fes biens
enjuftice à fes créanciers , 6*c. 11.868. a. Conditions requifes
pour être admis au bénéfice de ceflion. La ceffion emporte
note d’infamie, & obligeoit à porter un bonnet verd. Comment
on doit rendre la ceflion notoire. Maniéré de faire
ceflion , inftituée par Céfar. Autrefois on faifoit quitter en
jufiice la ceinture & les clés à ceux qui faifoient ceflion. Autre
maniéré dont fe faifoit la ceflion chez les Romains & les
anciens Gaulois, en madere criminelle & en madere civile.
Qui font ceux qu’on exclut du bénéfice de ceflion. La ceflion
de biens ne libéré pas le débiteur. Voyeç C essionnaire.
Ibid. b. |É ï
C ession. Différence entre la ceflion & le déguerpiffement.
IV. 768. b. Pierre fur laquelle les banqueroutiers à Rome
alloient faire ceflion. XIV. 74t. a , b. Bonnet verd que por-
toient en France ceux qui avoient fait ceflion. II. 325. a.
Lettres de ceflion. IX. 417. b. Sur la maniéré dont on faifoit
ceflion anciennement , voye^ C einture. Sur la ceflion,
confulter aufli l’article T ransport.
Ceffion , ( en droit canon ) différence entre un bénéfice
•vacant par ceflion & par création. IL 869. a.
Ceffion , ( terme de Librairie ) pour avoir la meme authenticité
que le privilège, elle doit fuivre les mêmes loix. Droit
qu’on acquiert par elle. Elle doit être imprimée à la fuite
•du privilège. H. 869. a. ,
CESSIONNAIRE , double lignification de ce mot. Les
'biens acquis par un ccflionnaire font toujours obligés à fes
créanciers. Quand il a payé fes dettes il peut être réhabilité.
"II. 869. a.
CESTAS, ( Géogr. antiq. ) paroiffe du Bourdelois limitrophe
des landes ,6*c. Monumens d’antiquité découverts dans
CC rcc-rc SuPPl- H. 300. b. .
vJATE, groseantelet de cuir, garni de plomb, 6"c. Etymologie'
du mot. Defeription du celle. Noms par lefquels les
v»recs le défignoient. Raifon de ces différens noms. Diverfes
fortes de ceftes qu’ils défignoient. II. 869. n.
t r- ‘P.“on ceRe& du combat du pugilat. XIII.
penchés ce^es » voye{ A n t iq u ité s , vol. I. des
WÊÊ - ^ 3 ' I cfinÎurc myftèrieufe de Vénus. Ses effets
merveilleux. Etymologie du mot I d’où l’on a fait le mot
incefie. II. 869. b.
CESTIUS, pont Ceftius à Rome. X1U. j j a. Pyramide
fie Ceihu$, 395. af b. XVI. 399. a. *
CHA C’EST POURQUOI > ainfi. Différence entre ces mots. II.
86£ESTROSPHENDONUS , efpece de trait fort femblable
à une fleche. Il fut inventé par les Macédoniens» II. 869. b.
CÉSURE , étymologie au mot. Définition. Pourquoi la
céfure a été introduite. Divifion qu’elle fait du vers en deux
parties. Ce qu’on appelle céfure en. latin. II. 869. b. Exemples
de céfures mal placées en françoîs. La grande regle pour la
place de la céfure eft de confulter fon oreille, & de s’en
rapporter à fon jugement. Place de la céfure dans les grands
vers, dans ceux de dix fyllabes ; céfure dans ceux de huit
& de fept fyllabes. Toutes ces regles font accompagnées
d’exemples. Ibid. 870. a.
C é sure , ( Belles-lettr. ) II eft dit dans l’Encyclopédie qu’en
latin on donne le nom de céfure à la fyllabe après laquelle
eft le repos. Cette définition critiquée. Diverfes remarques
fur ce fujet. Suppl. II. 300. b.
Céfure , voye{ ce qui en eft dit à l’article HÉMISTICHE.
Céfure latine, dite enneemimeris. V. 692.b. Céfure hephthe-
mere. VIII. 138. a. Céfure trihemimeris. XVI. 642. b.
Céfure, ( Mufiq.) efpeoe de repos dans la mufique. Elle
eft aufli plus néceflaire à la mufique qu’à la poéfie. Maniere
de la marquer. Suppl.ll. 301. a. En quel cas la céfure muficale
doit avoir lieu. — Céfures appellées relatives. Ibid. b.
C E T , cette. Obfervations iur cet adjeftif. XIII. 434. a.
CÉTACÉES, poiffons : leurs carafteres. VIII. 483. a. Chaleur
naturelle de ces poiffons. III. 39. a. Il n’y a parmi les
poiffons que les cétacées qui aient des conduits auditifs. XIL
. 888. a. voyeç VL voL des pl. Regne anim. pl. 11.
CETERAC, genre de plante dont les feuilles font découpées
en ondes. Ses propriétés ufages en médecine. IL
870. b.
CETÈS, ou Protée, (Hifl. d’Egypte) roi d'Egypte. Tableau
de fon regne. Comment il reçut chez lui Pâris & Hélene.
Origine de la fable qui lui attribue la faculté de prendre
toute forte de formes. Suppl. II. 301. b. Pourquoi il fut adoré
comme dieu de la mer. Sentiment de Newton fur ce roi
d’Egypte. Ibid. 302. a.
CETOBRIGA , aujourd’hui Setubal. XV. 130. b.
CETRA, petits boucliers dont les Efpagnols & les Africains
fe fervoient à la guerre. Peau dont on les couvroit.
Leur ufage. II. 870. b. - .
CETRARO , (Géogr. ) erreur dans cet article de 1 Encyclopédie.
Suppl. H. 302. a.
CETTE , defeription & ufage des pontons employés au
port de Cette. XIII. 84. <*, b. &c. . . . •
CETZEL, (J^ n ) dominicain qui fut employé à vendre
les indulgences. X l lt 604. ai „
CEVADILLA, graine qui croit dans la nouvelle Elpagne.
Sa defeription. Ses propriétés & ufages. II. 870. b.
CEVENNES, ( Géogr. anc.) Suppl. IV. 9. a.
CEURAWATH , feéte de benjans dans les Indes, fi infatués
de la métempfycofe, qu’ils refpeftent les moindres
infeéles. Soins de leurs prêtres pour ne nuire à aucun. Leut
doétrine & leurs moeurs & ufages. II. 871. a. Mépris que les
do&eurs Indiens ont pour eux. Ibid. b.
CEUTA, (Géogr.) ville forte d’Afrique. Siege de cin-
7 > .. ° e* TT Q-r A quante ans au’elle a foutenu contre les Maures. II. 871. b.
C E Y x I a v e n t u r e s de Ceyx & d’Alcyone.Suppll
H. 302. a.
C H
CH , ! Gramm. Vobiervations fur l’afpiration exprimée par
ces deux lettres dans les langues dérivées de la teutom-
que & quelques autres, & fur celle du nom chkicvins, dont
nous avons fait Chvis. Suppl. II. 301. a. .
Ch , obfervations fur cette articulauon. IX, 3 56. b. 1
CHA, ( p s p f e tn filt ) taffetas dont les Chinois s habillent
en été. Maniéré de travailler cette étoffe. L ouvrage
que font les Chinois fur cette étoffe, eft une broderie que nous
pourrions imiter. III. l -a- , . ■ r
CHABAR fauffe divinité que les Arabes adorèrent ml-
ou’au tems de Mahomet. Comment Ils renoncèrent à fois
culte. III. 1. a. Conjefture fur ce qu’étoit cette divinité*
^ CHABBAN , troifieme mois de l’année des Arabes.
Mofquées ouvertes en ce tems pour la prière de minuit.
H CHABLEUB., prépofé fur certaines rivières •
liter aux bateaux le paffage des endroits difficiles. ,
decenom-FonSions deT chableurs. Ordonnance de Charics
V I , en .4.5 , contenant pluf.eurs difpor.uons fur ies <llhces
des chableurs. Autre ordonnance de Loms^.^ . fol]C
cernant ces officiers. III. 2. a. £-<uts
relatifs. Fonélions des chableurs de ‘ ", * iiaute_f\ltaie ,
CHABLIS,
fa tTD P[fpofiüôns des ordonnances fur ceue madere. IU. a.
CHA CHABOT , ( Ichthy.f^ defeription de te poiffoh de
riviere. IH- 3- a- Endroits où on le trouve. Pèche du chabotv
^ C habot , ( Blafon ) meuble d’armoiries , qui repré*
■fente un petit poiffon. Étymologie de ce mot. Suppl. II»
^^HABOT , ( Jeanne ) tout-à-la-fois proteftante déclarée
& religieufe. XI» 887. b. #
C h a b o t , { Léonor ) empêche en Bourgogne 1 exécution de
la S. Barthelemi. Suppl. II. 369. a,
CHABRIAS, Athénien : la ftatue. XV. 498. A
CHACABOUT, ou Xacabout, forte de religion qui s’eft
répandue à la Chine, au Japon, 6>c. Doftrine de Xaca fon
•auteur. Caufe du refpeét que ces peuples ont poùr l’éléçhant
blanc. Particularités lùr Xaca. Son origine & le tems ou il a
vécu. Progrès que fit fa doftrine. III. y. b.
CHACAL , ( Zoolog. ) particularités fur cet animal. Sa
defeription» III. 4. a.
CHACENAY, (Géogr.) ancienne baronnie dans le Barrois.
Suppl. 1.818. a.
CHACONNE, forte de piece de mufique faite pour la
danfe, &c. Ce font pour l’ordinaire des chants qu’on appelle
couplets9 compofés & Variés de toutes les maniérés, &c. En
quoi confifte la beauté de la chaconne. Lieux ou elle a été
& où elle eft en ufage. Chaconnes les plus eftimées. III. 4. a.
C haconne , (Danfe) on a porté fort loin de nos jours
cette forte dé danfe. Ce qu’il y a dans cette danfe-d’avantageux
pour nn bon danfour» Chaconne en aftion dans le premier
afte de Naïs. III. 4. b.
Chaconne, contre-tems de, IV. 142. b.
CHACOS , defeription de cet arbriffeau du Pérou : pro^
priété qu’on lui attribue. III. 4. b.
CHACRIL, écorce , voye^ Cascarille»
CHACRELAS , obfervations fur ces peuples. VIII.
^CHACUN , remarqne grammaticale fur ce mot. XIII.
454. b.
CHADER, (Géogr.) erreur dans cet article de l’Ency,
clopédic. Suppl. II. 302. b.
Chader ,■ ifle d’Afie. X. 401. b.
CHAGNI, (Géogr.) petite ville du Chalonnois. Obfervations
fur la baronnie de ce lieu. Philippe de Maifiere »
dofteur en théologie , naquit à Chagni en 1630. Suppl. II.
332. b.
Chagni fur la Deheune pu Dehune. Suppl. II. 302 .b*
CHAGRIN; Les Stoïciens condamnoient cette affeftion de
l’ame. La plus haute philofophie confifte, félon Épiftete, à
n’accufer ni foi-même , ni les autres d’un mal qu’on a fait.
III. 4. b. Si cette infenfibilité eft fouvent à defirer pour
notre bonheur , il faut ajouter qu’elle dépend bien peu de
nous. Vers de Moncrif & de Chamieu. Ibid. 5. a.
Chagrin , douleurtrifieffe , ajjliflion , défolation , peine ,
(Synon.) I» 162. a. Mauvais effets des chagrins par rapport à
la fanté. VIII. 386. b.. XV. 32. a. État de l’ame fenfirive dans
le chagrin. XV. 42» a. Cnagrin imaginaire. VIII. ç6o. a.
État des cadavres de ceux qui font morts de chagrin. Suppl. IV.
856. b.
Chagrin, cuir grainé : d’où on le tire. A quel ufage on
l’emploie. De quels animaux fe tirent ces cuirs. Comment on
les travaille. Comment on emploie le chagrin. Choix du
meilleur. HI. 5. a.
. Chagrin. Animal d’où on tire les peaux de chagrin. I. 432.
a y b. Maniéré dont , on les prépare à Conftantinople. XII.
220. b.
Chagrin, efpece de taffetas. III. 5. b.
CHAIA, defeription de cette racine 8c de fa plante. Sa
préparation pour la teinture des toiles. XVI. 373. b. Efpece
de chaïa ou chaïaver des Indes, nommé belt-tsjira. Suppl. I.
857. a , b.
CH AIER, petite monnoie d’argent qui fe fabrique enPerfe.
Sa forme & fa gravure. Sa valeur. III. 5. b.
CHAINE. Defeription de la chaîne en général, & de
diverfes efpeces de chaînes. Ouvriers qui travaillent les
petites chaînes. Defeription d’une forte appellée chaîne à la
.catalogne. De la chaîne quarrée. III. 5. b. Chaînes en S.
•Maniéré de les fabriquer. Chaînes à quatre facev comment
.elles fe fabriquent. Chaînes à trois faces. Chaînes à bouts renforcés.
Chaîne appellée catalogne double. III. 6. a. Chaînes
d’Angleterre defunées à pendre des montres, des étuis d’or,
d>c. Defeription.
Commerce des chaînes. Vente des groffes de fer , des
médiocres, de cçlles de cuivre, & de tout autre métal.
Petites chaînes d’Allemagne , d’un travail fi délicat qu’on
en peut enchaîner les plus petites infeftes. Chaînes que les
Romains portoient avec eux en guerre pour enchaîner les
Pr|fonnier,p ° ur accorder la liberté on n’ouvroit pas la chaîne,
on la brifoit, &c. La chaîne, marque d’autorité chez les Gau-
ois ; elle eft une marque de dignité du lord-maire à Londres.
8e H k chaîne dans le blafon. Ibid, b.
CHA §g| Chaîne , fen terme âe jüftiçe. III. 6. b.
C haîne , (Arpentage ) defeription dè cette mèfiiré. IIÍ. &
b. Étalon auquel on a fecours à Paris pour la toife. Ufage dé
la chaîne. Inconyéniens de l’ufage de la corde. Maniere dé
préparer une corde pour éviter ces inçonvéniens. Ufage de
la chaîne dans l’arpentage. Maniere d’enregiftrer les dimen-¿
fions prifes avec la chaîne. Prendre avec la chaîne, un anglè
fur le terrein. Lever le plan ou faire le defiïn d’un lieu en fo
fervant de la chaîne» Ibid. 7. a. Trouver avec la chaîne là
diftance entre deux objets inaccefliblës l’un par rapport à
l’autre. Trouver la diftance d’un objet inaçceffible, comme la
largeur d’une riviere, par le moyen de la chaîne» Ibid. b.
CHAINE fans fin, (Art méchaniq. ) III. 7. b.
C haînes, (Architefl.) leur defeription. A quoi elles fer*
vent. III. 7. b.
C haînes de fer y ( Architefl. &.Serrurerie ) affemblage dé
plufieurs barres de fer plat, &c. Où fe pofe cet affemblage, le quel
en eft l’ufage. III. 7. b.
Chaîne de Port 9 ( Marine) deftinéesàen fermeti l’entréei
III. 7.b.
Chaînes de vergues t ( Marine) III. 8. a.
Chaînes de chaudière j ( Marine) III. 8. a.
Chaîne , ( Commerce ) mefure qui s’applique à diverfes,
marchandifes. Grandeur de la chaîne pour la mefure du bois-
à Paris. Comment on diftingue les bois qui dcwvent fe mefureé
à la chaîne. IU. 8. a.
Chaîne , (Agriculture) pour l’ufage dè la charrue. Sa
deibription & l'on ufage. Ul. 8. a.
Chaînes, mettre en y maniere de faire fécher le chanvre 8c lé
lin. IU. 8. a.
Chaînes de foin. IÏÎ. 8. b.
Chaîne , (Pêche ) comme fe fait là pêche à la chaîne. IU.
8.A
Chaînes, dans íes fidines. ni. 8. b.
Chaîne, outil de charron. Sa defeription & fon ufage. nL.
8. b.
Chaîne de montre , ( Horlog. ) fa defeription» Comment
elle fe fabrique. Invention de la chaîne attribuée à un nommé
Gruet j genevois. IU» 8. b. Voyez Chaînette.
CHAINES d’étuis de pièces , 8cc. ( Metteur en oeuvre) III. 8. b¿
Chaînes , dans l’ourdiffage du fil, de la laine, du lin, &c.
Les chaînes varient chez les différens ouvriers, relativement
à la matière , à la quantité des fils , au nombré des portées *
à la longueur. Toutes ces différences influent fur la.nature
des étoffes. Ce que les réglemens ont ftatué fur ce fujet. IIL
9. a.
Chaînes. De l’ourdiffage , du collage, & de l’étendage deschaînes.
IX. 188. a , b. Vol. IU. des planch. article Draperie *
pl. 3. Ourdiffage des chaînes des toiles de coton. IV. 312. b.
Façon de'donner de l’ordre aux différens brins qui compofent
la chaîne. V. 634. b.
Chaînes de montagnes. X» 676; b, & c.
CHAINETIER , faifeur & vendeur de chaînes. Autre»
ouvrages de ces ouvriers. Ce qu’étoient anciennement leur
communauté. Comment elle a dégénéré. III. 9. b.
Chaînetier» Filiere des chaînetiers. VI. 797. b. Jauge. VIIL
47a. a. Soudure dont ils fe fervent. XV. 388. b. Les chaîne-
tiers prennent à Paris la qualité de trefiliers. XVL 377» a. Voye£
les planch. de cet article, vol. II.
CHAINETTE , ( Géométrie tranfeend. ) efpece de courbe*
Sa nature. Équation de cette courbe par le pere Reyneau. Le
même problème réfolu par M. Bcrnoulli dans fon effai fur la
manoeuvre des yaiffeaux. III. 9. b. Inftruftion donnée pour
parvenir à l’équation de la chaînette. Une voûte, pour être
en équilibre , doit avoir la même figure que la chaînette*
Ibid. 10. a.
Chaînette , chez les bourreliers. Defeription & ufage. IH*
Chaînette, point de, en terme de brodeur. Efpece d’orne-*-
ment courant, qui forme une forte de lac continu.^Comment
elle s’exécute, i°. au métier, III. 10» a ; 20. à l’aiguille. En
quoi confifte la beauté du point de chaînette. Matières'dont il
fe fait. Ibid. bk _
Chaînette , point de, ( Couturière) Suppl. IU. 733. b.
Chaînette , en terme d’éperonnier, de rubanier. III. 10. b.
Chaînettes de montre. Leur defeription : maniere dont on les
fabrique.X. 692. b, &c. Voye^ les planches du chaînetier >
vol. H.
CHAIR, viande, différence entre ces mots. III. 10. b.
Chair , (Anatomie) cinq différentes fortes diftinguées
par les anciens. Les modernes n’en admettent qu’une forte;
cependant ils diftinguent encore la chair glanduleufe. Ce
au eft la chair parenchymateufe que diftinguoient les anciens*
3.1 1 . q. . B H H H H
Ch a ir , ( Hifi. anc.6*mod.) doftrine des pythagoriciens
fur l’ufage de la chair. III. 11. a. Chairs impures félon1 le»
Hébreux. Chairs confacrées aux idoles. Ufage de la chaiti
humaine chez certains peuples fauvages. Ibid. b.
Chair , dans le ftyle de l’écfiture-faintc. Plufieurs fens