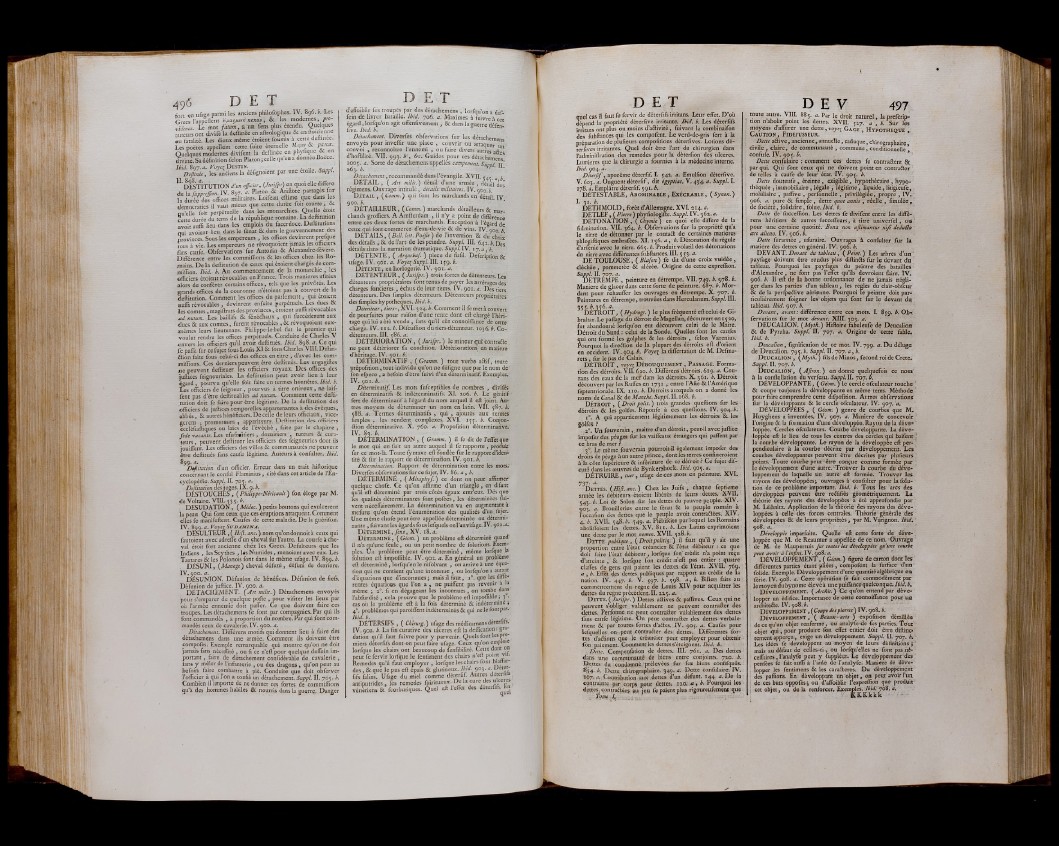
§Ü D E T
fort en uftee parmi les anciens philofophes. IV. 896. i. Les
Grecs rappellent •¡Mag&Èj n t x u i, & les modernes, providence.
Le mot fa tum , a un fens plus étendu. Quelques
auteurs ont divifé la deftinée en aftrologique & cnftoicicnne
•u fatalité. Les dieux même étoient fournis à cette deitince.
Les poètes appellent cette fuite éternelle Mtp« oc parc*.
Quelques modem« divifent la dellinée en phyfique 6c en
divine. Sa définition félon Platon; celle qu en a donnée Bocce.
léid. 807. u. p'ityer D e s t in . ,
B c / in ic , les anciens la défignoiént par une étoile. S u ffi.
^ DESTITUTION d ’un officier, ( Jurifpr) en quoi elle différé
de la fuppreffion. IV. 897- *■ Platon & Anflote partagés fur
la durée des offices militaires. Loifeau efome que dans les
démocraties il vaut mieux que cette durée <ditcoiine, 6c
nu’elle foit perpétuelle dans les monarchies. Quelle étoit
cette durée du tems de la république, romaine. La deitmmon
avoir àiiffi lieu dans les emplois du facerdoce. Defliturions
oui avoient lieu dans le fénat & dans le gouvernement des
provinces. Sous les empereurs , les offices devinrent prefque
tous à vie. Les empereurs ne révoquoient jamais les officiers
fans caufe. Obfervations fur Antortin & Alexandre-févere.
Différence entre les commiffions 8c les offices chez les Romains.
De la deflitution de ceux qui étoient chargés de com-
miffion. lbid. b. Au commencement de la monarchie, les
officiers étoient révocables en France. Trois maniérés ufitées
alors de conférer certains offices, tels que les prévôtés. Les
grands offices de la couronne n’étoient pas à couvert de la
deflitution. Comment les offices du parlement, qui étoient
auffi révocables, devinrent enfuite perpétuels. Les ducs &
les comtes, magiflrats des provinces, étoient auffi révocables
ad nutum. Les baillifs & fénéchaux , qui fuccédcrent aux
ducs & aux comtes, furent révocables , & révoquoient eux-
anèmes leurs lieutenans. Philippe-le-bel fut le premier qui
voulut rendre les offices perpétuels. Conduite de Charles V
envers les officiers qu’il avoit deflitués. lbid. 898. a. Ce qui
fe parta fur ce fujet fous Louis XI & fous Charles VIII. Diflin-
âion faite fous celui-ci des offices en titre , d’avec les commiffions.
Ces derniers peuvent être deflitués. Les engagiftes
ne peuvent deftituer les officiers royaux. Des offices des
îuflices feigneuriales. La defiiturion peut avoir lieu à leur
égard , pourvu qu’elle foit faite en termes honnêtes, lbid. b.
Les officiers de feigneur, pourvus à titre onéreux, ne laif-
fent pas d’être deftituables ad nutum. Comment cette defli-
tution doit fe faire pour être légitime. De la deflitution des
officiers de juftices temporelles appartenantes à des évêques,
abbés, & autres bénéficiers. De celle de leurs officiaux, vice-
gerens , promoteurs , appariteurs. Deflitution des officiers
ecdéfiafliques ou laïcs de l’évêché , faite par le chapitre ,
fede vacante. Les ufufmitiers , douaniers , tuteurs & curateurs
, peuvent deflituer les officiers des féigneuries dont ils
jouiflent. Les officiers des villes & communautés ne peuvent
être deflitués fans caufe légidme. Auteurs à confulter. lbid.
899. a.
Deflitution d’un officier. Erreur dans un trait hiflorique
concernant le conful Flaminius, cité dans cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. IL 705. a.
Deflitution des juges. IX. 9. b. '
DÉSTOUCHES, ( Philippc-Néricault) fon éloge par M.
de Voltaire. VIII. 333. b.
DESUDATION, ( Médec. ) petits boutons qui exulcerent
la peau Qui font ceux que ces éruptions attaquent. Comment
elles fe manifcflent. Caufes de cette maladie. De la guérifon.
IV. 8oq./z. Voyez Sudamina.
anct) nom qu’ondonnoità ceux qui
DËSULTEUR AHijl.i
fautoient avec adreffe a un cheval fur l’autre. La courfe à çfief.
val étoit fort ancienne chez les Grecs. Defulteurs que les
Indiens , les Scythes , les Numides, menoient avec eux. Les
Tartares 8c les Polonois font dans le même ufaee. IV. 899. b.
DÉSUNI, (Manège) cheval défuni, défunt de derrière.
IV. 900. a.
DÉSUNION. Défunion de bénéfices. Défunion de fiefs.
Défunion de juflice. IV. 900. a.
DÉTACHEMENT. {Art milit.) Détachcmens envoyés
pour s’emparer de quelque pofle , pour vifiter les lieux par
oit l’armée ennemie doit paifer. Ce que doivent faire ces
troupes. Les détachemcns le font par compagnies. Par qui ils
font commandés , à proportion du nombre. Par qui font commandés
ceux de cavalerie. IV. 900. a.
Détachement. Différens motifs qui donnent lieu à faire des
détachemens dans une armée. Comment ils doivent être
compofès. Exemple remarquable qui montre qu’on ne doit
jamais fans nèceffité , ou fi ce n’efl pour quelque deffein important
, faire de détachement confidérable de cavalerie ,
laits y mêler de l’infanterie, ou des dragons, qu’on peut au
befoin faire combattre à pié. Conduite que doit obferver
l’officier à qui l’on a confié un détachement. Suppl. II. 705* b.
Combien il importe de ne donner ces fortes de commiffions
¡qu’à des hommes habiles & nourris dans la guerre. Danger
d’affoiblir fes troupes par des détachemens , lorfqu’on a déf-
fein de livrer bataille. lbid. 706. a. Maximes à fuivre à cet
égard, lorfqu’on agit offenftvement, & dans la guerre défen-
ftve. lbid. b.
Détachement. Diverfes obfervations fur les détachemens
envoyés pour invertir une place , couvrir ou attaquer un
convoi , reconnoitre l’ennemi , ou faire divers autres aêles
d’hoflilité. VII. 991. b y 6*c. Guides pour ces détachemens
1005. a. Sorte de détachemens appelles campement. Suppl II*
16}. b. '
Détachement y recommandé dans l’évangile. XVII. a b
DÉTAIL , ( Art milit.') détail d’une armée, détail des
régimens. Ouvrage intitulé, détails militaires. IV. 900. b.
D é t a i l , ( Comm. ) qui font les marchands en détail IV
900. b.
DÉTAILLEUR, {Comm.) marchands dctailleurs 8c marchands
groffiers. A Amflerdam , il n’y a point de différence
entre ces deux fortes de marchands. Exccpdon ¡à l’égard de
ceux qui font commerce d’eau-de-vie & de vins. IV. 900. a
DÉTAILS, ( Bell.lett.Poéfie) de l’invention & du choix
des détails ,.& de l’art de les peindre. Suppl. III. 642. b. Des
détails .dans. la narration dramatique. Suppl. IV. 1 7.0,'é.
DÉTENTE, | Arquebuf. ) piece de fufil. Description 8c
ufage. IV. 901. a. Voye[ Suppl.III. 139. b.
D é t e n t e , en horlogerie. IV. 901. a.
DÉTENTEUR, ( Jurifpr. ) trois fortes de détenteurs. Les
détenteurs propriétaires font tenus de payer les arrérages des
charges foncières, échus de leur tems. IV. 901.4. Des tiers
détenteurs. Des fimplcs détenteurs. Détenteurs propriétaires
des fimples hypothéqués. lbid. b.
Détenteur, tiers- , XVI. 3 24 .b. Comment il fe met à couvert
de pourfuites pour raifon d’une rente dont efl chargé l’héritage
qui lui a été vendu, fans qu’il eût connoiiTance de cette
charge. IV. 112. b. Difcuffion du tiers-détenteur. 1036. b. Co-
détenteurs. III. 586. a.
DÉTÉRIORATION, ( Jurifpr. ) le mineur qui contraêle
ne peut détériorer fa condition. Détériorations, en matière
d’héritage. IV. 901. b.
DÉTERMINATIF , ( Gramm. ) tout verbe aêlif, toute
prépofition, tout individu qu’on ne défigne que par le nom de
fon efpece, a befoin d’être fuivi d’un déterminatif. Exemples.
IV. 901. b.
Déterminatif. Les mots fufceptibles de nombres , divïfés
en déterminatifs & indé termina tifs. XI. 206. b. Le génitif
fert de déterminatif à l’égard du nom auquel il efl joint. Autres
moyens de déterminer un nom en latin. Vil. 587. b.
588. a. Termes déterminatifs , qui , ajoutés aux termes
umples , les rendent complexes. XVI. 155. b. Conjon-
âion déterminative. X. 760. a. Propofition dé termi native.
IV. 83. b.
DÉTERMINATION , ( Gramm. ) il fe dit de l’effet que
le mot qui en fuit un autre auquel il fe rapporte, produit
fur ce mot-là. Toute fyntaxe efl fondée furie rapport d’identité
& fur le rapport de détermination. IV. 901.0.
Détermination. Rapport de détermination entre les mots.’
Diverfes obfervations fur ce fujet. IV. 86. a , b.
DÉTERMINÉ , ( Métaphyf. ) ce dont on peut affirmer
quelque chofe. Ce qu’on affirme d’un triangle, en difant
qu’il efl déterminé par trois côtés égaux entr’eux. Dés que
les qualités déterminantes font pofées, les déterminées lui-
vent néceffairemenr. La détermination va en augmentant à
mefure qu’on étend l’énumération des qualités d’un, fujet.
Une même chofe peut être appellée déterminée ou déterminante
, fuivant les égards fous lefqucls on l’anvifage. IV. 902.4.'
D é t e rm in é , fens, XV. 18. a.
D é t e rm in é , ( Géom. ) un problème efl déterminé quand
il n’a qu’une feule, ou un petit nombre de folurions. Exemples.
Un problème peut être déterminé, même lorfque la
folution efl impoffible. IV. 902. a. En général un problème
efl déterminé, lorfqu’en le réfolvant, on arrive à une équation
qui ne contient qu’une inconnue, ou lorfqu’on a autant
d’équations que d’inconnues ; mais il faut, i°. que les diffé-
rentes équations que l’on a , ne puifTent pas revenir à la
même ; 20. fi en dégageant les inconnues, on tombe dans
l’abfurdité , cela prouve que le problème efl impoffible ; 3 -
cas où le problème efl à la fois déterminé 8c indéterminé ;
4°. problèmes qui paroiffent indéterminés & qui ne le font pas.
lbid. b. i
DÉTERSIFS , ( Chirurg. ) ufage des médicamens deterfifs.
IV. 90a. b. L a fin curative des ulcères efl la déification : gr*1"
dation qu’il faut fuivre pour y parvenir. Quels font les prelorfque
les chairs ont beaucoup de ienfibilité. Ceux dont on
peut fe fervir lorfque le fentiment des chairs n’eft point vu.
Remèdes qu’il faut employer , lorfque les chairs font bjaftar-
des, 8c que le pus efl épais & glutineux. lbid. 903. a.Uetcr-
fifs falins. Ufage du miel comme déterfif. Autres déterli
antiputrides, les remedes ffiiritueux. De la cure des ulcer
vénériens 8c feorbutiques. Quel efl 1 effet des déterfifs^
D E T
quel cas il faut fe fervir de déterfifs irritans. Leur effet. D’où
dépend la' propriété déterfive irritante. lbid. b. Les déterfifs
irritans ont plus ou moins d’aêlivité, fuivant la combinaifon
des fubflances qui les compofcnt. Le verd-de-gris fert à la
préparation de .plufieurs compofitions déterfives. Lotions dé-
ternves irritantes. Quel doit être l’art du chirurgien dans
l’adminiflration des remedes pour la déterfion des ulcérés.
Lumières que la chirurgie a fournies à la médecine interne.
lbid. 904. a.
Déterfif, apozême déterfif. I. 342. a. Emulfion déterfive.
V.603. a. Onguent déterfif, dit égyptiac. V.43’4. a. Suppl. I.
178. a. Emplâtre déterfif. 391. b.
DÉTESTABLE, A b om in a b le , E x é c r a b l e , ( Synon.)
I. 31. b.
DETHMOLD, forêt d’Allemagne. XVI. 214. a.
DETLEFy (Pierre) phyfiologilte.Suppl.IV .362.a.
DÉTONATION, ( Chymie ) en quoi elle différé de la
fulmination. VII. 364. b. Obfervations fur la propriété qu’a
le nitre de détonner par le contaêl de certaines matières
phlogifliques embrafées. XI. 136. a , b. Détonation du régule
(Tarfenic avec le . nitre. 663. b. Produit volatil des détonadons
du nitre avec différentes fubflances.HL 333.a.
DE TOULOUSE, ( Blafon ) fe dit d’une croix vuidée ,
cléchée, pommetée 8c alézée. Origine de cette expreffion.
Suppl. II. 707. a.
DETREMPE , peinture en détrempe. VIL 749. b. 978. b.
Maniéré de glacer dans cette forte de peinture. 687. b. Mordant
pour rehauffer les ouvrages en détrempe. X. 707. b.
Peintures en détrempe, trouvées dans Herculanum.Suppl.III.
35t ô i f e , ( Hydrogr. ) le plus fréquenté efl celui de Gibraltar.
Le partage du détroit de Magellan, découvert en 1320,
fut abandonné lorfqu’on eut découvert celui de le Maire.
Détroit du Sund : celui de la Sonde. Quelles font les caufes
Îui ont formé les golphes 8c les détroits , félon Varenius.
ourquoi la direftion de la plupart des détroits efl d’orient
en occident. IV. 904. b. Voye1 la difTertation de M. Defma-
rets, fur le pas de Calais.
DÉTROiT , voyez D é b o u q u em e n t , P a s s a g e . Formation
des détroits. VIL 620. b. Différens détroits. 619. a. Cou-
rans des eaux de la mer dans les détroits. X. 361. b. Dém>it
découvert par les Rufles en 1731, entre l’Afie 8c l’Amérique
feptentrionale. IX. 110. b. Détroits auxquels on a donné les
noms de Canal 8c de Manche. Suppl. II. 168. b.
D é t r o i t , ( Droit polit. ) trois grandes queflions fur les
détroits 8c les golfes. Réponfe à ces queflions. IV. 904.^.
i°. A qui appartiennent légitimement les détroits 8c les
golfes l , . _ t -
2°. Un fouverain, maître d’un détroit, peut-il avec juflice
inipofer des péages fyr les vaifleaux étrangers qui partent par
ce bras de mer F .. , - .
30. Le même fouverain pourroiwl également împofer des
droits de péage à un autreprince, dont les terres confineroient
à:la côte fupérieure 8c intérieure de ce détroit? Ce fujet dif-
cuti dans les oeuvres de Bynkershoek. lbid. 903. a. ___ _
' DÉTRUIRE, tuer, ufage de ces mots en peinture. XVL
737. a. • . . . .
D e t t e s . {Hifl. anc.) Chez les Juifs , chaque feptieme
année les débiteurs étoient libérés de leurs dettes. XVII.
343. b. Loi de Solon fur les dettes du pauvre peuple. XIV.
903. a. Brouilleries entre le fénat 8c le peuple romain à
Voccafion des dettes que le peuple avoit contraélées. XIV.
4. b. XVII. 34B.b. 349. a. Plêbifcite par lequel les Romains
abolifloient les dettes. XV. S u . b. Les Latins exprimoient
une dette par le mot nomen. XVII. 3 28. b.
D e t t e publique , ( Droitpolitiq. ) il faut qu’il y ait une
proportion entre l’état créancier 8c l’état débiteur : ce que ■
doit faire l’état débiteur, lorfque fon'crédit n’a point reçu
d’atteinte , 8c .lorfque fon crédit n’efl pas entier : quatre
clartés de gens qui paient les dettes de l’état. XVII. 769.
a , b. Effet des dettes publiques par rapport au crédit de la
nation. IV. 447. b. V. 39y. b. 398. a, h. Billets faits au
commencement du règne ae Louis XIV pour acquitter les
dettes du regne précédent. II. 223. a.
D e t t e . Çlunfpr. ) Dettes aâives 8c paflives. Ceux qui ne
peuvent s’obljgcr. valablement ne peuvent contraftcr des
dettes. Perfonne ne peut contraêler valablement des dettes
fans caufe légitime. On peut contraêler des dettes-verbalement
8c par toutes fortes d’aéles. IV. 903. a. Caufes pour
lcfquellçs on-peut.contraêler des dettes.. Différentes fortes
d’aâions que le créancier peut employer pour obtenir
ion paiement. Comment les dettes s’éteignent. Ibidt b.
Dette. Compeijfation de dettes. III. 761. a. Des dettes
dans une çomnum?uté' de biens entre conjoints. 720. b.
Dettes du condaip^ 'prélevées fur fes biens confifqués.
#54. b. Dette chirographaire. 349. a. Dette confulaire. IV.
107. 4, Contribution nux dettes a’un défunt. 144, a. De la
contrainte par , corps ppur dettes. 120. a , b. Pourquoi les
dettes^ contraélées au jeu fe paient plus rigoureuferaent que
Tqmç -lf . _.j. , b __
D E Y 497
toute autre. VIII. 883. a. Par le droit naturel, la preferip-
tion n abolit point les dettes. XVII. 327. a , b. Sur les
moyens d’aflùrer une dette, voye{ G a g e , H y p o th é q u é
C a u t i o n , F id e / u s s e u r .
Dette aêlive, ancienne, annuelle, caduque, chirographaire,
civile, claire, de communauté, commune, conditionnelle *
confùfe. IV. 903. b.
Dette confulaire : comment ces dettes fe contraêlent 8c
par qui. Qui font ceux qui ne doivent point en contraêler
de telles à caufe de leur état. IV. 903. b.
Dette douteufe, éteinte, exigible, hypothécaire , hypothéquée
, immobiliaire, légale , légidme, liquide, litigieufe,
mobiliaire , paflive , perfonnelle , privilégiée, propre , IV.
906. a. pure 8c fimple , dette quoi annis, réelle , fimulée ,
de fociétc, folidaire, folue. lbid. b.
Dette de fuccertion. Les dettes fe divifent entre les diffé-
rens héritiers 8c autres fuccerteurs, à titre univerfel, ou '
pour une certaine quotité. Bona non aflimantUr nifi deduéta
cere alieno. IV. 906. b.
Dette furannée , ufuraire. Ouvrages à confulter fur la
maticre des dettes en général. IV. 900. b.
DEVANT. Devant du tableau, {Peint.) Les arbres d’un*
payfage doivent être rendus plus diflinêls fur le devant du
tableau. Pourquoi les payfages du peintre des batailles
d’Alexandre, ne font pas l’effet qu’ils devroient faire. IV.
906. b. Il efl de la bonne ordonnance de ne jamais négliger
dans les parries d’un tableau, les réglés du clair-oblcur
& de la perfpcêlive aérienne. Pourquoi le peintre doit particulièrement
foigner les' objets qui font fur le devant du
tableau. lbid. 907. b. '
Devant, avant: différence entre ces mots. I. 839. b. Obfervations
fur le mot devant. XIII. 303. a.
DEUCALION. {Myth.) Hifloire fabulcufc de Deucalion
8c de Pyrrha. Suppl. ¡H. 707. a. Origine de cette fable.
lbid. b.
: Deucalion, lignification de ce mot. IV. 799. a. Du déluge
de Deucalion. 793. b. Suppl. II. 707. a, b.
D e u c a l i o n , ( Myth. ) fils de Minos, fécond roi de Crete.
Suppl. II. 707. b.
D e u c a l i o n , (AJlron; ) on donne quelquefois ce nom'
à la conflellation du verfeau. Suppl. II. 707. b.
DÉVELOPPANTE, ( Géom.) le cercle ofculateur touche
8c coupe toujours la développante en même tems. Méthode
pour faire comprendre cette difpofmon. Autres obfervations
fur la développante 8c le cercle ofculateur. IV. 907. a.
DÉVELOPPÉES, ( Géom: ) genre de coufbes que M.
Huyghens a inventées. IV. 907. a. Maniéré de concevoir
l’origme 8c la formation d’une développée. Rayon de la développée.
Cercles ofculateurs. Courbe développante. La déve-
■ loppée efl le lieu de tous les centres des cercles qui baifent
la courbe développante. Le rayon de la développée efl perpendiculaire
à la courbe décrite par développement. Les
courbes développantes peuvent être décrites par plufieurs
points. Toute courbe peut ‘être conçue comme formée par
le développement d’une autre. ^Trouver la courbe du développement
de laquelle un autre efl formée. Trouver les
rayons des développées; ouvrages à confulter pour la folution
de ce problème important, lbid. b. Tous les arcs des
: développées peuvent être reêlifiés géométriquement. La
théorie des rayons des développées-a été approfondie par
M. Léibnitz. Application de la théorie des rayons des développées
à celle des forces centrales. Théorie1 générale des
développées 8c de leurs propriétés, par M. Varignon. lbid.
908. a .,
Développée imparfaite. Quelle efl cette forte de déve-.
loppée que M. de Reaumur a appellée de ce nom.'Ouvrage
‘ de M. de Maupertuis fur toutes les développées qu’une courbe
peut avoir à l'infini. IV. 908.-0.
DÉVELOPPEMENT, ( Géom. ) figure de carton dont les
différentes parties étant pliées, compofént la furfàce d’un'
folide. Exemple. Développement d’une quantité algébrique en
férié. IV. 908. 0. Cette opération fe fait commodément par
lemoyendubynome élevé à une puiffancequelconque. Ibid.b.
D é v e l o p p e m e n t . ( Archit. ) Ce qu’on entend par développer
un édifice. Importance de cette connoiiTance pour un
arcniteêle. IV. 908. b. o ’
D é v e l o p p e m e n t , ( Coupe des pierres) IV. 908. b.
D é v e l o p p e m e n t , ( Beaux-arts ) expofition détaillée
j de ce qu’un objet renferme, ou analyfe-de fes parries. Tout
. objet qui, pour produire fon effet -entier doit être diilmc*
tementapperçu, exige un développement. Suppl. IL 707. b.
Les idées fe développent au moyen de leurs définitions ;
mais au défaut de celles-ci, ou lorfqu’elles ne font pas né-
ceffaires, i’analyfe peut y fuppléer. Le développement des
Îienfées fe fait aurti à l’aide de l’analyfe. Manière de déveopper
les fentimens 8c les caraéleres; Du développement
■ des partions. En: développant un objet, on peur avoir l’un
: de ces buts oppofés ; ou d’affoiblir l’expreffion que produit
i cet objet .o u de la renforcer, Exemples, lbid: 708, a.
1 K K K k k k