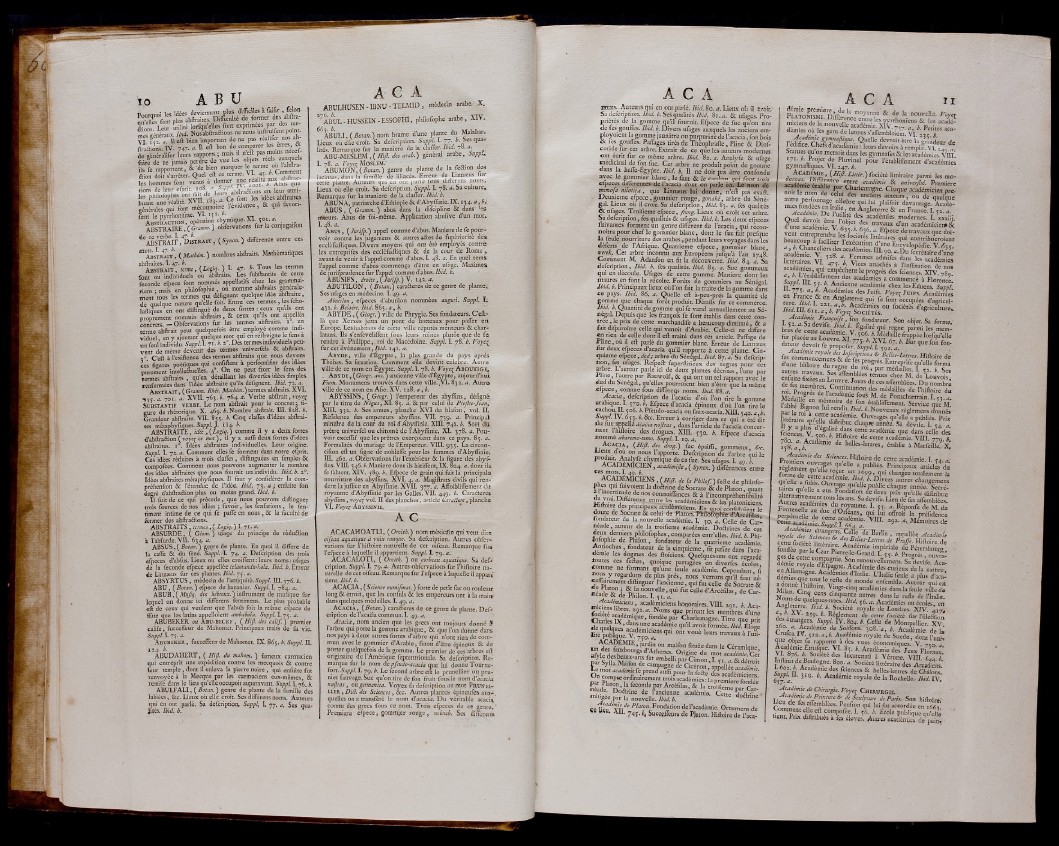
I O ABU h S ipc hlées deviennent plus diIfficifleosr mà efar ifiir“ ,» lfbe}oa q i ï u r Stilité lorfqu’elles font exprimées par des terr.
Ibid. Nosabftraélions ne nous mftruifent point. Il■mr»e ffAnéraux. i',U5aDurtl'-tlu“ 3 , .r; 1 u
VI f r a . i lie ft bien Important de ne pas réahfer nos ab-
ftraétions. IV. 747. a. f i eft bon de comparer les êtres, &
de eènèraUfer ?eurs rapports; mais il n’eft pas moins nécef-
M t! de ne jamais petite-de vue les objets réels. auxquels
ils le rapportent, & ’de bien marquer le terme ou labflra-
iai5io ine droapitp su’arricriêit e,r . Quel eit ce tteerrmmee , VvLi. 445f. b. Combmn enc.t
les hommes font venus à donner une ^ / é / 'V u s qUe
rions de leur efprir. r°8; '¿Mkaffions en leur attrik
s font les idées abftraites
l'évidence, 6c qui favori-
1 ) obfervations fur laconjugatfon
• A B S T R A I R E , ( G o-»»i . ABSTRAIT,4Dis t b a it , (Synon.) différence entre ces
“ a bmÆ t '.(M altón.) nombresabftraits. Mathémariques
^ A b s t r a it^ urne, (Logii/. ) I. 47- J - .I? “ 5. . 1“ , “ ™.!î
font ou individuels ou abftraits, Les fubftannfs de cette
fécondé efpece font nommés appeUatifs chez les grammairiens
; ma£ en philofophie, on nomme abftraits généralement
tous les termes qui défignent quelque idée abftraite,
de quelque nature qu’elle foir. Entre ces termes, les fcho-
laftiques en ont diftingué de deux fortes : ceux quils ont
proprement nommés abftraits, & ceux quils ont appelles
concrets. — Obfervations fur les termes abftraits. i . un
terme abftrait peut quelquefois être employé comme individuel
, en y ajoutant quelque mot qui en reftreigne le feus à
unfeulindividu. Suffi. 1. 7<- *• ñ Des termesmdmduels peu-
vent de même devenir des termes umverfels 6c abifraits.
,o à l’exiftence des termes abftraits que nous devons
¿es heures poétiques qui confiftent à perfonnifier des idées
purement intelleâueUes. 4°- On ne peut fixer le fens des
termes abftraits , qu’en détaillant les diverfes idees Amples
renfermées dans l’idée abítente qu’ils défignent.Ibid. 7 L,a.
A b s t r a i t , ( Gramm. Rhét. Mathém.) termes abftraits. XVI.
vee. a. 70i. È XVII. 763. b. 764. a. Verbe abftrait, voye^
S u b s t a n t i f v e r b e . Le nom abftrait pour le concret; figure
de rhétorique. X. 469- b. Nombre abftrait. IH. 828. b.
Grandeur abftraite. VII. 8 « . b. Cinq claffes d’idées abftraites
métaphyfiques. Suppl. 1. 114. b.
ABSTRAITE, idée y(Logiq.) comme il y a deux fortes
d’abftra&ion ( voye^ « moi), il y a auffi deiix fortes d’idées
abftraites. i°. Idées abftraites individuelles. Leur origine.
Suppl. I. 72. a. Comment elles fe forment dans notre elprit.
Ces idées réduites à trois claffes, diitinguées en fimples &
compofées. Comment nous pouvons augmenter le nombre
des idées abftraites que nous fournit un individu. Ibid. b. 20.
Idées abftraites métaphyfiques. Il faut y confidérer la com-
préhenfion & l’étendue ae l’idée. Ibid. 73. a ; enfuite fon
degré d!abftraétion plus ou moins grand. Ibid. b.
Il fuit de ce <
trois fources de
riment intime de ce qiii fe paffe en nous, & la faculté de
former des abftraftions.
ABSTRAITS , tenues, ( Logiq. ) 1. 71. tf.
ABSURDE, § Géom. ) ufage du principe de réduction
à l’abfurde. VII. 634. a.
ABSUS, ( Botan.) geijre de plante. En quoi il différé de
la cafte & du féné. Suppl. • I. 74. a. Defcription des trois
efpeces d’abfus. Lieux ou elles croiftent : leurs noms : ufages
de la fécondé efpece appellée telamandu-kola. Ibid. ¿.Erreur
de Linnæus fur ces plantes. Ibid. 75. a.
ABSYRTUS, médecin de l’antiquité. Suppl. III. 376. b.
ABU I ( Botan. ) efpece de bananier. Suppl. I. 784. a.
ABUB, ( Mufiq. des hébreux.") inftrument de mufique fur
lequel on donne ici différens fentimens. Le plus probable
eft de ceux qui veülent que l’abub foit la même efpece de
flûte que les latins appelloient ambabiiia. Suppl. 1.75. a.
ABUBEKER ou à b u -b e c r e , ( Hiß. des calif. ) premier
calife, fucceffeur de Mahomet. Principaux traits de fa vie.
I Suppl. 1.75.0.
A b u b e k e r , fucceffeur de Mahomet. IX. 865. b. Suppl. II.
124. b.
ABUDAHERT, ( Hiß. du mahom. ) fameux carmacien
qui entreprit une expédition contre les mecquois & contre
leur temple, dont il enleva la pierre noire , qui enfuite fût
renvoyée à la Mecque par les carmaciens eux-mêmes, &
remife dans le lieu qu’elle occupoit auparavant. Suppl. 1.76. b.
ABULFALI, ( Botan. ) genre de plante de la famille des
labiées, &c. Lieux où elle croit. Ses différens noms. Auteurs
qui en ont parlé. Sa deferiprion« Suppl, I, 77, a, Sçs qualités.
Ibid. b.
qui précédé, que nous pouvons diftinguer
e nos idées; favoir, les îenfations , le fen-'
A G A
ABULHUSEN-IBNU-TELMID, médecin arabe. ,X.
*7ABUL-HUSSEIN-ESSOPHI, philofophe arabe, XIV.
^ Ï b ü L I ( Botan. ) nom brame d’une plante du Malabar.
Lieux où elle croît. Sa defcription. Suppl I. 77.. ?• Ses qttar
lités. Remarque fur la maniéré delà claffer.Ibid. 78.a.
ABU-MESLEM,( Hijl. des arab.) général arabe, SuppU
I. 78. a. Voyer MOSLEM.“ , . - -
ABUMON, ( Botan. ) genre de plante de la feétion des
iacintes, dans là famille de liliacés. Erreur de Linnæus ur
cette plante. Auteurs qui en ouc parlé lous. dînerons noms.
Lieux ou elle croît. Sa defcription. Suppl. I. 78. a. Sa culture.
Remarque fur la maniéré de la claffer. Ibid. b.
ABUNA, patriarche d’Ethiopie & d’Abyflinie. IX. 124.4, b:
ABUS, ( Gramm. ) abus dans la difeipline & dans ’es
jnceurs. Abus de foi-même. AppÜcation abufive d’un mot.
1 .48. a.
A bus , ( Jurifp.) appel comme d’abus. Maniéré de fe pourvoir
contre les juge mens & autres aétes de fuperiorite des.
eccléfiaftiques. Divers moyens qui ont été employés contré
les entreprifes des eccléfiaftiques & de la cour de Rome ,
avant de venir à l’appel comme d’abus. I. 48. a. En quel tems
l’appel comme d’abus commença d’être en ufage. Maxime*
de juriiprudence fur l’appel comme d’abus. Ibid. b.
ABUSIFS, droits, ( Jurifp.) V. 142. a.
ABUTILON, (Botan.) caraéleres de ce genre de plante.
Ses ufages en médecine. 1. 49. a.
A but don, efpeces d’abutilon nommées auguri. Suppl. I.'
432. b. Beloére. Ibid. 863. a , b.
A B YD E , ( Géogr.) ville de Phrygie. Ses fondateurs. C’eft-
là que Xerxès jetta un pont de batteaux pour paffer en
Europe. Les habitans de cette ville réputés menteurs & charlatans.
Ils s’enfeveliffent fous leurs ruines plutôt que de fe
rendre à Philippe, , roi de Macédoine. Suppl. I. 78. b. Voye%_
fur cefèvénement, Ibid. 141. a.
A b y d e , ville d’Égypte, la plus grande du pays après
Thébes. Sa fituation. Comment elle devint célébré. Autre
ville de ce nom en Égypte. Suppl. 1.7 8 . b. Voyeç A b o u t ig e ,
. A byd e , (Géogr. anc.) ancienne ville d’Égypte, aujourd’hui
Fium. Monumens trouvés dans cette ville. ¡Vl. 832. a. Autre
ville de ce nom en Afie. XV. 128. a , b.
ABYSSINS, ( Géogr.) l’empereur des abyflins, défigné
par le titre de Négus, Xl. 8r. a. & par celui ae Preftre-Jean.
XIII. 332. b. Ses armes, planche XVI du blafon, vol. II.
Réfidence des empereurs abyffins. VII. 739. a. Principal
miniftre de la cour du roi d’Abyffinie. XIIÎ. 742. b. Sort du
prêtrç univerfel ou chitomé de l’AbylTmie. XI. 378. a. Pouvoir
exceffif que les prêtres exerçoient dans ce pays. 85. a.
Formalités du mariage de l’Empereur. VUl. 933. Lacircon-
cifion eft un figne de noblefle pour les femmes d’Abyffinie.
III. 462. a. Obfervations fur l’extérieur & la figure des abyffins.
Vin. 346.¿.Maniéré dont ils bâtiifent, IX. 804. a. dont ils]
fe faluent. X IV. 589. b. Efpece de grain qui fait la principale
nourriture des abyffins. X.VI. 4. a. Magiftrats civils qui rendent
la juftice en Abyffinie. XVII. 377. a. AfFoibliflement du
royaume d’Abyffinie par les Galles. VII. 449. b. Cara&eres
abyflins, voye^ vol. H des planches, article CaraStre, planché
VI. Voyex Abyssinie,
A c
ACACAHOATLI, ( Omitk.) nom méxicâin qui veut dire
oifeau aquatique à voix rauque. Sa defcription. Autres obfervations
fur l’hiftoire naturelle de cet oifeau. Remarque fu*
l’efpece à laquelle il appartient. Suppl. I. 79. a.
ACACALOTI, ( Ornith. ) ou corbeau aquatique. S i defr
cription. Suppl. I. 79. a. Autres obfervations fur l’hiftoire naturelle
de cet oifeau. Remarque fur l’efpece à laquelle il appart
tient. Ibid. b.
A CACIA, (Science numifnutt.) forte de petit fac ou rouleatf
long & étroit, que les confuls & les empereurs ont à la maii»
dans quelques médailles. 1 .49. a.
A c a c i a , (Botan.) carafteres de ce genre de plante. DefJ
cription de l’acaéia commun. I. 49. a.
' Acacia, nom ancien que les grecs ont toujours donné S
l’arbre qui porte la gomme arabique, & que l’on donne dans
nos pays à deux autres fortes d’arbre qui n’ont rien de coin- '
mun avec le gommier d’Arabie, finon d’être épineux & de
porter quelquefois de la gomme. Le premier de ces arbres eft:
originaire de l’Amérique feptentrionale. Sa defcription. Remarque
fur le nom de pfeudo-acacia que lui donne Tournerait.
Suppl. I. 79. b. Le lecond arbre eft le prunellier ou pru-*
nier fauvage. Suc qu’on tire de fon fruit fous le nom d'acacia
nojlras , ou germanica. Voyez fa defcription au mot Prunellier
, Difl. des Sciences y occ. Autres plantes épineufes aux-,
quelles 011 a transféré le nom $ acacia. Du véritable acacia
connu des grecs fous ce nom. Trois efpeces de ce genre."
Première efpece, gommier rouge, nebneb. Ses difterens.
ACA ACA ir noms-. Auteurs qui-en ont-p’arlé. Ibid. So. a. Lieux où il 'croît.’
Sa defcription. Ibid. b. Sesqualités Ibid. St. a. & ufages. Propriétés
de la gomme qu’il fournit. Efpece de fuc qu’on tire
de fes goufles. Ibid. b. Divers ufages auxquels les anciens em-
ployoient la gomme jaunâtrê ou purpurine de l’acacia, ion bois
& fes goufles. PafTages tirés de Théophrafte, Pline & Diof-
condef ur cet arbre. Extrait de ce que les auteurs modernes
ont: écm fur ce même arbre. Ibid. 82. a. Analyfe & ufage
médicinal de fon fuc. Cet arbre ne produit point de gomme
dans la bafle-Égypte. Ibid. b. Il ne doit pas être confondu
avec le gommier blanc, le fant & le cnrdem <pû font trois...
efpeces différentes'de l’acacia dont on parle ici. Le nom de
mimo fa nilòtica , • que Linnæus lui donne,- ri’eft pas éxaft.
x Deuxième efpece, gommier rouge, gonaké, arbre du Sénétal.
Lieux où il croît. Sa defcription, Ibid. S1}, a. fes qualités
c ufages. Troifieme efpece, fiung. Lieux où croît cet arbre.
Sa defcription, fes qualités & ufages. Ibid. b. Les deux efpeces
iùivantes forment un genre différent de l’acacia, qui recon-
noîtra pour chef le gommier blanc, dont le fuc fait prefque
la feule nourriture des arabes, pendant leurs voyages dans les
déferts de l’Afrique. Quatrième efpece, gommier blanc,
verek. Cet arbre inconnu aux Européens jufqu’à l’an 1748!
Comment M. Adanfon en fit la découverte. Ibid. 84. a. Sa
defcription, Ibid. b. fes qualités.Ibid. 85. a. Suc gommeux
qui en découle. Ufages de cette gomme. Maniere dont les
maures en font la récolte. Forêts de gommiers au Sénégal.
Ibid. b. Principaux lieux ou l’on foit la traite de la gomme dans
ce pays. Ibid. 86. a. Quelle eft à-peu-près la quantité de Ì
gomme que chaque forêt produit. Détails fur ce commerce.
/¿«/¿.Quantité de gomme qui fe vend annuellement au Sé-
négal. Depuis que les françois fe font établis dans cette con-
*r?e ’ J.e Pr*x de cette marchandife a beaucoup diminué, & a
iait difparoître celle qui venoit d’Arabie. Celle-ci ne différé
r*en ^ cefie dont il eft traité dans cet article. Paffage de
Pline, ou il eft parlé du gommier blanc. Erreur de Linnæus
lur deux efpeces d’acacia qu’il rapporte à cette plante. Cinquième
efpece, ded; arbre du Sénégal. Ibid. 87. a. Sa deferip-
tion, f« ufages. Refpeft fuperftitieux des' negres oour-cet
m- S' « auteur Parle ici de deux plantes décrites, f’une par
j j j* Rauwolf, & qui ont un tel rapport avec le
ded du Sénégal, qu’elles pourroient bien n’être que la même
■efpece, connue fous differeqs noms. Ibid. SS.a.
Acacia y defcription de l’acacia d’où l’on tire la gomme
arabique. I. 370. ¿.Efpece d’acacia épineux d’où l’on tire le
cachou. II. 506. b. Pfeudo-acacia ou faux-acacia.XIII. <40. a.b.
Suppl. IV. 6ç2. b. & c. Erreur à corriger dans ce qui a été dit
* . é acf c'la nojlras , dans l’article de l’acacia concernant
lbiftoire des drogues. XIII. 330. b. Efpece d’acacia
nommé abaremo-temo. Suppl. I. 10. a.
, . A c a S^> (Hift des drog.) fuc épaiffi, gommeux, f 'f.
Lieux dou on nous lappone. Defcription de l’arbre qui le
a r a r ^ ? » aj j Î er c Ï 7 m i ‘i u e d e c s f u c - S e s u & g e s . 1 . 4 9 . b.
ACADÉMICIEN, académijtc, (Synon.) diferencà entre
ces mots. 1.49. b. t
nh^CA^ É- ■CIEîÎS,’ ic i de plùlofoî
n l r Cm/ r m la do« rine de Socrate & de Platon, quant
du v S l î f f î ° S conn°idànces & à l’htcompréhenfibilité
1 » æ & les platoniciens.
Hiftoire des pnncipaux académiciens. En quoi confiftoient le
doute de Socrate & celui de 1*tïïISir1Îitoftipttte-d’Arcéfdas,
fondateur de la nouvelle académie. I. 50. a. Celle de Car-
néade, auteur de la troifieme académie. Doctrines de ces
rieux derniers philofophcs, comparées entr’elles. Ibid. b. Phi-
lofophie de Philon, fondateur de la quatrième académie.
Anuochus, fondateur de la cinquième, fit paffer dans l’aca-
tiémie les dogmes des ftoïciens. Quelques-uns ont regardé
toutes ces feéles, quoique partagées en diverfes écoles,
comme ne formant qu’une feule académie. Cependant fi
nous y regardons de plus près, nous verrons qu’il faut ’né-
ceiiairement diftinguer l’ancienne, qui fin ceUe de Socrate &
académiciens honoraires. VHI. 291. b. Aca-
fociété and? " ^ "c i i ” S SueJ?r!rent Ies membres d’une
Charles lX (T iqi,e ’ ,u P-ar H ^ a g n e . Titre que prit
de quelques’ S g » .a«dém,e qu’d avoir formée. Ibid. Éloge
f e OE t . qiu ° " ' voué leurs travam à m
. » Jardin ou maifon fituée dans le Céraminm» gïïiiaïiîiï-ssia
aae. Doctrine de fancienne académie. Cette doflri’n» •
jP ar nouvelle. Ibid. b. dotinne
te u é ù f S * , f T i F0"m riOnÌ elò f adéraie.- Ornemeosde
• 745» Sucçsffeurs de P^ton, Hiftoire de l’aça-
iP-luartûonrnissmMe. DDiifffTéreeknc em e°nyterne nlelîs &py rrdheo nlai ennso u&ve lleles. aPcaidwémiciens
de a nouvelle académie. ¡ § § 7,™WM Petites académies
ou les gens de lettres s’a f fem b lÆ H K p
àjË S pS S b ê 'M ÿ M i - Quelle devrait être la grandeur de
1 édifice. Chefs d académie : leurs devoirs à remplir. "VI. .
Statues qu on mettoit dans les gymnafes & les académies. Vlll"
171. ¿.Projet de Pluvinel pour l’établiflêment d’académies
gymnaihques. VI. 247. b.
A c a d ^ îie , (Hijl. Littèr. ) fociété littéraire parmi les mo-
entre académie & univerfité. Première
11“ - V I 5; 78; ÎÆ Ê r .& • Vices attachés à Khffitution de nos
e emPêahent te progrès des feiences. XIV. 789.
i W ITT z” î nt eS académies a commencé à Florence,
i i y ï y - 1 Antaenne académie chez lesEduens. Suppl.
en i l f l | S Ê S Ê Ahé ¥ 0 JüIFS- Académie,
“ " S , Angleterre qui fe font occupées d’agricul-
Coüé,és d’agricult“ re-
1. Son o i '« - Sa
W m s m Ê m
d f f n membres Corn'' ^ f « s affemblées. Du nombre
rai p < j \ Continuation des médaillés de l’hiftoire du
M é d f c . a uûe fous M. de Pontcha rtrtS S? . |
Ï Ïh h éR i. mémoire de fon établiflement. Service aucM.
par le rrJ i *Ç C u v eau x réglemens Sonnés
littéraire ou’d ifc r f t ' ° uvra8es Su’elle I pubüés. Prix
Il v a nl,?f ? Î 'â bue « P Î année- s a devife. I. , 4.
feiences V r o l ’ ï Hift"5 académie T e dans ceüe. des
780 M R n H P P W de cette académie. VIII. 77o. t.
158'u ' i heftes-lettres, éfabbe à MarfeiUe?X,
Académie des Sciences. Hiftoire <!e cette académie I es -
M W Ê I W Ê 0 q"’elle a PubUés’ Principaux amdls dn
forme de cette a c a d S tie^ iL 9f r ? “ chimê'a''oralement la
au’elle a iiïfi” acaaenue. Jbsd b. Divers autres changemens
i ® a f è S: Ouvrage,1,’dle publie chaque année.^Secré-
aitern^ Fondation de deux prix qu’elle diftribue
aAuut tr™e s aa c acd témdieês md u V r oMy Sa u- mS ae .d eIrV. i tf ei -. L ai e. uR déen Èo n f ea f fdeem Mb lé eAs.. =3i5
fondée Par1e c t ï L r a iaedG r „d '7 é; : é t
dèmle r a v a lT Î f ^ P re"°uveilement. S a & e ° A c Î
-S 1 cinquante autres dans le refte de l’Italie.
i f * caÎ é" i s « ¿'Oies, en
7 f , l - S ° clété royale de Londres. XIV. 4i 7,
j ’ e i 219• b. Règlement de cette fociété fur l’éleétion
des étrangers f v . 8o4. b. Celle de Montpellier. X V
C ra 'fca 'îi lde1S°iz0n•S• 1°*-'“ ’ h- Académie de la
Crafca IV Sa2 .u,i. Académie royale de Suede, dont l’nnr,
Acadé I rapporte à des vues économiques. .V. g f g g
V p T e< ? T ; T 1’ ? 5’ l - Aeadémie des Jeux Floraux
VI. Sy6. b. Société des Incatenad à Vérone VTTT c i
nftitut de Boulogne. 800. ». 'Société li t z é S e f e ï c a t i& i s
Sw p fn A«d=m,e des fciences & belles-lettres de Chiions.
Suppl H. 310. b. Acadénue royale de la Rochelle.. Ibid. IV.
Académie de Chirurgie. Voye^ C h i r u r g i e .
T . j di P“ Mure b de Sculpture de Pans. Son hiftoire’
eu de fes affemblées. Penfion qui lui fur.accordée en 166.
Comment elle eft compofée. 1. 5d. b. École publique qu’elle
tient. Prix diftnbués à fes éleves. Autres académies de pein,