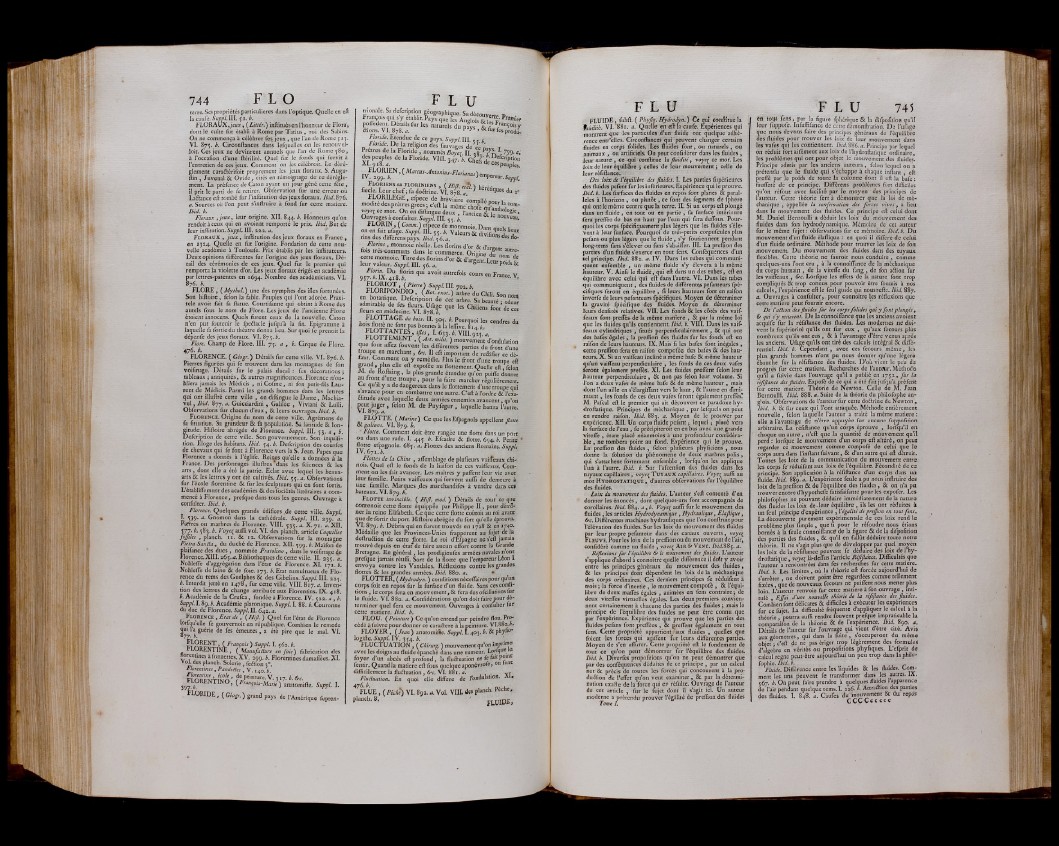
744 F L O
terre. Ses propriétés particulières dans l ’optique. Quelle en cil
la caufe. Suppl. 111, 52. b.
FLORAUX ,je u x , (Littér.) inftitués en l’honneur de Flora',
dont le culte fut établi a Rome par Tatius , roi des Sabins.
On ne commença à célébrer fes jeu x , que l’an de Rome 3 1
VI. 875. b. Circonftances dans lefquellcs on les renouve
loit. Ces jeux ne devinrent annuels que l’an de Rome 580
à l'occafion d’une ftérilité. Quel fut le fonds qui fervit i
l’entretien de ces jeux. Comment on les célébrait. Le déré1
glanent caraftérifoit proprement les jeux floraux. S. Augii-
ftin, Juvenal & Ovide, cités en témoignage de ce dérèglement.
La préfence de Caton ayant un jour gêné cette fête ..
il prit le parti de fe retirer. Obfcrvation fur une erreur où
Laéiance eil tombé fur l’inftitution des jeux floraux. Ibid. 876.
a. Sources où l’on peut s’inilruire à fond fur cette matière.
Ibid. b. j • .
Floraux , j e u x , leur orìgine. XII. 844. b. Honneurs qu’on
rendoit à ceux qui en avoient remporté le prix. Ibid. But de
leur inflitution. Suppl. III. 222. a. '
Floraux | j e u x , inflitution desjeux floraux en France I
en 1324. Quelle en fut l’origine. Fondation de cette nouvelle
académie à Touloufe. Prix établis par les inflituteurs.
Deux opinions différentes fur l’origine des jeux floraux. Détail
des cérémonies de ces jeux. Quel fut le premier qui
remporta la violette d’or. Les jeux floraux érigés en académie
par lettres-patentes en 1694. Nombre des académiciens. VI.
876. b.
F LO R E , ( Mythol. ) une des nymphes des ifles fortunées.
Son hifloire, félon la fable. Peuples qui l’ont adorée. Praxitèle
avoit fait fa flatuc. Courtifanne qui obtint à Rome des
autels fous le nom de Flore. Les jeux de l’ancienne Flore
étoient innocens. Quels furent ceux de la nouvelle. Caton
n’en put foutenir le fpeélacle jufqu’à la fin. Epigramme à
laquelle fa fortie du théâtre donna lieu. Sur quoi le prenoit la
dépenfc des jeux floraux. VI. 87c. b.
Flore. Champ de Flore. III. 73. a , b. Cirque de Flore.
4 76. b.
FLORENCE. ( Gêogr. ) Détails fur cette ville. VI. 876. b.
Pierres figurées qui fe trouvent dans les montagnes de fon
voifinage. Détails fur le palais ducal : fes décorations;
tableaux ; antiquités, 8c autres magnificences. Florence n’oubliera
jamais les Médicis , ni Cofme, ni fon petit-fils Laurent
de Médicis. Parmi les grands hommes dans les lettres
qui ont illuftré cette ville , on diflingue le Dante, Machiavel
, Ibid. 877. a. Guicciardini , Galilée , Viviani 8c Lulli.
Obfervations fur chacun d’e u x, 8c leurs ouvrages. Ibid. b.
F lorence. Origine du nom de cette ville. Agrémens de
fa fituation. Sa grandeur 8c fa population. Sa latitude & longitude.
Hifloire abrégée de Florence. Suppl. III. 53. a , b.
Defcription de cette ville. Son gouvernement. Son inquifi-
tion. Eloge des habitans. Ibid. 34. b. Defcription des courfes
de chevaux qui fe font à Florence vers la S. Jean. Papes que
Florence a donnés à l’églife. Reiqes qu’elle a données à la
France. Des perfonnaees illuilres dans les feiences & les
arts, dont elle a été la patrie. Eclat avec lequel les beaux-
arts 8c les lettres y ont été cultivés. Ibid. 33. a. Obfervations
fur l’école florentine 8c fur les fculpteurs qui en font fortis.
L’établiffement des académies ôcdcsfociétés littéraires a commencé
à Florence, prefque dans tous fes genres. Ouvrage à
confulter. Ibid. b.
Florence. Quelques grands édifices .de cette ville. Suppl.
L 09* a. Gnomon dans la cathédrale. Suppl. III. 239. a.
Pierres ou marbres de Florence. VIII. 333. a . X .7 1 . a . XII.
377- b‘ 582. b. FOyrç aufli vol. V I. des planch. article Coquilles
fojfiles , planch. 11. & 12. Obfervations fur la montagne
Pietra Sanila y du duché de Florence. XII. 399. b. Maifon de
plaifance des ducs , nommée Pratolino , dans le voifinage 4e
Florence.XIII. 263.4. Bibliothèques de cette ville. II. 233. a.
Nobleffe d’aggrégation dans l’état de Florence. XI. 1 7 1 . b.
Nobleffe de laine & de foie. 173. b. Etat tumultueux de Florence
du tems des Guelphes & des Gibelins. Suppl. III. 223.
b. Interdit jetté en 1478, fur cette ville. VIII. 817. a. Invention
des lettres de change attribuée aux Florentins. IX. 418.
b. Académie de la Crufca, fondée à Florence. IV . 322. a , b.
Suppl. 1. 89. b. Académie platonique. Suppl. 1. 88. b. Couronne
du duc de Florence. Suppl. II. 642. a.
1 » Etat de , ( Hijl. ) Quel fut l’état de Florence
loifqu’elle fe gouvernoit en république. Combien le remede
cjui 1 a guérie de fes émeutes , a été pire que le mal. VI.
C I R E N T , (F ra n ç o is ) Suppl. I. 362. b.
URENTINE , ( Manufacture en fo ie ) fabrication des
florentines à formelles. X V . 299. b. Florentines damaffées. X I.
vol. des planch. Soierie, feétion 3*.
Florentines, Pan de (tes, V . 140 b
,d' P ' ,ntur“ - V . 3 17-i . Ü
Marie) anatomifle. Suppl. I.
397 4 ’ anatomiii
FLORIDE, ( G i o p . ) grand pays de l’Amérique fepicnt
F L U
fi,r ks na,urcl! du m . i p s
Prêtres de la Floride , nommés Boyer. II t8o /, n : 7?9- a.
des peuples de la Floride. VIII. 147. i C h . lL cfcnP‘™i
XI.918.rn “ î ctille « s peuples
’ ( cmpcrtn^ | g |
FLORIENS OU FLORIN1ENS , ( H ifl eccl \ hA.A •
fieclc. Leur ch ef ; fa doârinc. VI. 878. a ^Ues B a°
FLO RILEGE, efpece de bréviaire 'compilépour 1,
modtté des prin-es grecs ; e’eft la mêméeh™e ou’Ï Ï „ , °m'
voytç ce mot. On en diflingue deux , l’ancien ^ k Î „ 8'e ■
Ouvrages à confulter. Suppl. III. qé0 c nouveau.
F LO R IN , ( Comm.) efpece de monnnoie. Dans rinitè \i
on en fatt.ufage. S u f f i lit . b. Valeurs & divifiom i e ‘fl"*
ruts des dtfltércns pays. Ib id . j 6. a. m fe-
F lor in s , monnoie réelle. Les florins d’or & d’arcenr
fois très-communs dans le commerce. Orieine du „ „ f '
cette monnoie. Titre des florins d’or & d’argfm L cm Z Z t
leur valeur. Suppl. III. 5«. a. S cnr poids &
9 s Î /A Î x .4 Ï 8 fli°rin qUi avoit iuIrcfols cours en France. V .
F L O R IO T , ( Pierre) Suppl. III. 702 b.
F LO R IPON D IO , (B o t . ex o t.) arbre du Chili Çnn
en botanique. Defcription de Cet arbre. Sa beauté ; odcÜe
admirable de f o fleurs. Ufage que les Chiliens font de c «
fleurs en médecine. V I. 878. b.
u / Jn ° 1 7 A Ç E du IL î ° 5- *• Pourquoi les cendres du
nt Pas bonnes i la lefllve. 814. i ,
F LO T T A N T E S , iJUs. I. 6 ,3 . b. V I I I . i .a
i mouvcmcn< d’ondulation
que font allez fouvent les différentes parties du front d’une
troupe en marchant, II eft Important de reûifier ce détour.
Comment on y remédie. Plus le front d’une troupe eil
grand, plus elle efl expofée au flottement. Quelle eft, félon
M . de Koftamg, la plus grande étendue qu’on puiffe donner
au front d une troupe, pour la faire marcher régulièrement.
V e qu A y a de dangereux dans le flottemerit d’une troupe qui
savancc pour en combattre une autre. C ’efl à l’ordre 8c l’exactitude
avec laquelle deux armées ennemies avancent | qu’on
peut ju g er, félon M. de Puyfegur, laquelle battra l’autre.
V l. 079. a.
F LO T TE . ( Marine) C e que les Efpagnols appellent flotte
8C galions. VI. 879. b.
• Flotte. Comment doit être rangée une flotte dans un port
ou dans une rade. I. 443 b. Efcadre & flotte. 694. b. Petite •
flotte efpagnole. 683. «t. Flottes des anciens Romains. SuppL
IV . 671. b.
Flottes de la Chine , affemblage de plufieurs vailîeaux chinois.
Quel cil le fonds de la liaifon de ces vaiffeaux. Comment
on les fait avancer. Les maîtres y paffent leur vie avec
leur famille. Petits vaiffeaux qui fervent auffl de demeure i
une famille. Marques .des marchandifcs à vendre dans ces
bateaux. VI. 879. b.
F l o t t e invi "
contenoit cette
ner la reine Elifabeth. Ce que cette notte coucou au roi avant
que de fortir du port. Hifloire abrégée du fort qu’elle éprouva.
V I. 879. b. Débris qui en furent trouvés en 1728 8c en 174°*
Médaille que les Provinces-Unies frappèrent au fujet ae la
deflruâion de cette flotte. Le roi d’Élpagne ne s’eflJamais
trouvé depuis en état de faire aucun effort contre la Grande
Bretagne. En général, les prodigieufes armées navales n’ont
prefque jamais réufli. Sort ae la flotte que l’empereur Léon I
envoya^ contre les Vandales. Réflexions contre les grandes
prefqui
envoya 1«™*«,«, «
flottes 8c les grandes armées. Ibid. 880. a. •
F LO T TE R , ( Hydrodyn. ) conditions néceffaires pour qu’un
corps foit en repos fur ia furfacc d’un fluide. Sans ces conditions
, le corps fera en mouvement, & fera des ofcillations fur
le fluide. V L 880. a. Confidérations qu’on doit faire pour déterminer
quel fera ce mouvement. Ouvrages à confulter fur
cette matière. Ibid. b.
FLOU. ( Peinture ) Ce qu’on entend par peindre flou. Procédé
à fui vre pour donner c e caraélere à la peinture. Vl.88q.r-
FLOYER , ( Jean) anatomifle. Suppl. f. 403. b. 8cphyuo*
logiflc. Suppl. IV . 3 34. b. \
F LU C T U A T IO N , ( Chirurg.) mouvement qu’on injprltnc
avec les doigts au fluide épanché dans une tumeur. lonque, ®
foyer d’un abcès efl profond, la fluftuation ne fe fa»‘ f i g l
fentir. Quand la matière efl fous quelque aponévrofe» on c
difficilement la fluéluation, &c. VI. 801. a. . YT,
Fluctuation. Én quoi elle différé de l'ondulation. •
F LÙ E , ( P i d ! ) V L 891. a. V ol. VIIL de* p lan * -p4cbc'
planch. 8, ’ n v I V £ ,
F L U F L U 745
FLUIDE, fubfl. ( Phyfiq. Hydrodyn.) Ce qui conflituela
fluidité. VI. *881. a. Quelle en eft fa caufe. Expériences qui
montrent que les particules ,d?un fluide ont quelque adhérence
entr’elles. Circonftances qui peuvent changer certains
fluides en corps folides. Les fluides font, ou naturels, où
animaux , ou artificiels. On peut confidérer dans les fluides,
leur nature., ce qui conflitue la fluidité, voyeç_ ce mot'. Les
joix de leur équilibre ; celles de leur mouvement ; celle de
leur réfiftance. -
Des lo ix de l ’équilibre des fluides. I. Les parties fupérieurcs
des fluides pefenr fur les inférieures. Expérience qui leprouve.
Ibid. b. Les furfàces des fluides en repos font planes oC parallèles
à l’horizon , ou plutôt, ce font des fegmens de fphcrc
ni ont le même centre que la terre. II. Si un corps eft plongé
ans un fluide, en tout ou en partie , fa furface intérieure
fera prefféc de bas en haut par l’eau qui fera deffous. Pourquoi
les corps fpécifiquement plus légers que les fluides s’élèvent
à leur furface. Pourquoi de très-petits corpufcules plus
pefans ou plus légers que le fluide, s’y foutiennent pendant
long-tems fans s’élever ou fans s’abaiffer. III. La preflion des
parties d’un fluide s’exerce en tout fens. Conféquences d’un
tel principe. Ibid. 882. a. IV. Dans les tübes qui communiquent
enfemble , un même fluide s’y élevera à la même
hauteur. V . Ainfi le fluide, qui eft dans un des tubes, eft en
équilibre avec celui qui eft dans l’autre. VI. Dans les tubes
qui communiquent, des fluides de différentes pefanteurs fpé*
cifiques feront en équilibre, ft leurs hauteurs font en raifon
inverfe de leurs pefanteurs fpéciflques. Moyen de déterminer
la gravité fpécifique des fluides. Moyen de déterminer
Ictus denfité« relatives. VII. Les fonds 8c les côtés des vaiffeaux
font preffés- de la même maniéré , & par la même loi
que les fluides qu’ils contiennent. Ibid. b. VIII. Dans les vaiffeaux
cylindriques , fltués perpendiculairement, & qui ont
des baies égales , la preifion des fluides fur les fonds eft en
raifon de leurs hauteurs. IX. Mais fi les bafes font inégales,
cette preffion fera en- raifon compofée des bafes & des hauteurs.
X. Si un vaiffeau incliné a même bafe & même hauteur
qu’un vaiffeau perpendiculaire , les fonds de ces deux vafes
feront également preffés. XI. Les fluides preffent félon leur
hauteur perpendiculaire, & non pas félon leur volume. Si
l’on a deux vafes de même bafe & de même hauteur , mais
dont l’un aille en s’élargiffant vers le haut, & l’autre en diminuant
, les fonds de ces deux vafes feront également preffés?
M. Pafcal eft le premier qui ait découvert ce paradoxe hy-
droftatique. Principes de méchanique , par leiqucls on peut
en rendre raifon. Ibid. 883. a. Moyen de le prouver par
expérience. XII. Un corps fluide pefant, lequel, placé vers
la furface de l’eau, fe précipiterait en en bas avec une grande
viteffe , étant placé néanmoins à une profondeur confidéra-
b le , ne tombera point au fond. Expérience qui le prouve.
La- preffion des fluides, félon plufieurs phyficiens , nous
donne la folution du phénomène de deux marbres polis,
qui s’attachent fortement enfemble , lorfqu’on les applique
1 un à l’autre. Ibid. b. Sur l’afcenfion des fluides dans les
tuyaux capillaires, voyt{ TUYAUX capillaires. Foyer aufli au
mot H y d r o s t a t iq u e , d’autres obfervations fur l’équilibre
des fluides.
L o ix du mouvement des fluides. L’auteur s’eft contenté d’en
donner les énoncés, dont quelques-uns font accompagnés de
corollaires. Ibid. 884. a , b. Voyeç aufli fur le mouvement des
fluides ; les articles Hydrodynamique , Hydraulique, Elaflique,
6>c. Différentes machines hydrauliques que l’on conftruit pour
l ’élévation des fluides. Sur les loix du mouvement des fluides
ar leur propre pefanteur dans des canaux ouverts, voye[
leuve. Pour les loix de la preffion ou du mouvement de l’air,
confidéré comme un fluide, vove^ A ir 6* V ent. Ibid.883. a.
Réflexions fur l'équilibre & le mouvement des fluides. L’auteur
s’applique d’abord à connoitre quelle différence il doit y avoir
entre les principes généraux du mouvement des fluides, 8c les principes dont dépendent les loix de la méchanique
des corps ordinaires. Ces derniers principes fe réduifent à
trois ; la force d’inertie, le mouvément compofé , & l’équilibre
de deux maffes égales , animées en fens contraire ; de
deux viteffes virtuelles égales. Les deux premiers conviennent
certainement à chacune des parties des fluides ; mais le
principe de l’équilibre des fluides ne peut être connu , que
par l’expérience. Expérience qui prouve que les parties des
fluides pefans font preffées , & preffent également en tout
fens. Cette propriété appartient/aux fluides , quelles que
foient les forces qui agiffcnt lur leurs différentes parues.
Moyen de s’en aflurcr. Cette propriété eft le fondement de
tout ce qu’on peut démontrer fur l’équilibre des fluides.
Ibid. b. Divcrfes propofitions qu’on ne peut démontrer que
par des conféquences déduites de ce principe , par un calcul
net & précis de toutes les forces qui concourent S la production
de l’effet qu’on veut examiner, & par la détermination
exaOe de la force qui en réfulte. Ouvrage de l’auteur
de cet article , fur le fujet dont il s’agit ici. Un auteur
moderne a prétendu prouver l’égâlité de preffion des fluides
Tome I,
en toift fens, par la figure fphérique & la difpofition qu’il
leur fuppofe. Infuffifance de cette dimonftration. De l’ufagc
que nous devons faire des principes généraux de l’équilibre
des fluides pour trouver les loix de leur mouvement dans
les vafes qui les contiennent. Ibid. 886. a. Principe par lequel
on réduit fort ai fément aux loix de l’hydroftatique ordinaire,
les problèmes qui ont pour objet le mouvement des fluides.
Principe admis par les anciens auteurs, félon lequel on a
prétendu que le fluide qui s’échappe à chaque inftant , eft
preffé par le poids de toute la colonne dont il cil la bafe :
fauffeté de ce principe. Différons problèmes fort difficiles
qu’on réfout avec facilité par Je moyen des principes de
1 auteur. Cette théorie fert à démontrer que la loi ae méchanique
, appellée la confervation des forces v iv e s , a lieu
dans le mouvement des fluides. Ce principe eft celui dont
M. Daniel Bcrnoulli a déduit les loix du mouvement des
fluides dans fon hydrodynamique. Mémoire de cet auteur
fur le même fujet : obfervations fur ce mémoire. Ibid. b. Du
mouvement d’un fluide élaftique : en quoi il différé de celui
d’un fluide ordinaire. Méthode pour trouver les loix de fon
mouvement. Du mouvement des fluides dans des tuyaux
flexibles. Cette théorie ne fauroit nous conduire, comme
uclques-uns l’ont cru , à la connoiffance de la méchanique
u corps humain , de la viteffe du fang , de fon aélion fur
les vaiffeaux , b c . Lorfque les effets de la nature font trop
compliqués 8c trop connus pour pouvoir être fournis à nos
calculs, l’expérience eft le feul guide qui nousrefte. Ibid. 887.
a. Ouvrages à confulter, pour connoitre les réflexions que
cette matière peut fournir encore.
D e laCtion des fluides fur les corps folides qui y font plongés ,
6* qui s ’y meuvent. De la connoiffance que les anciens avoient
acquife fur la réfiftance des fluides. Les modernes ne doivent
la fupériorité qu’ils ont fur eux , qu’aux fccours plus
nombreux qu’ils ont eu s, & à l’avantage d’être venus après
les anciens. Ufage qu’ils ont tiré des calculs intégral & différentiel.
Ibid. b. Cependant , avec ces fecours même, les
plus grands hommes n’ont pu nous donner qu’une légero
ébauche fur la réfiftance des fluides. D ’où vient le peu de
progrès fur cette maticre. Recherches de l’auttAir. Méthode
qu’il a fuivie dans l’ouvrage qu’il a publié en 173 2 , fur la
réfiflance des fluides. Expofé de ce qui a été fait jufqu’à préfeht
fur cette maticre. Théorie de Newton. Celle ae M. Jean
Bcrnoulli. Ibid. 888. a. Suite de la théorie du philofophe an-
glois. Obfervations de l’auteur fur cette doélrine de Newton,
Ibid. b. 8c fur ceux qui l’ont attaquée. Méthode entièrement
nouvelle, félon laquelle l’auteur a traité la même matière :
elle a l’avantage de n’être appuyée fur aucune fuppofition
arbitraire. La réfiftance qu’un corps éprouve , lorfqu’il en
choque un autre, n’eft que la quantité de mouvement qu’il
perd : lorfque le mouvement aun corps eft altéré, on peut
regarder ce mouvement comme compofé de celui que le
corps aura dans Huilant fuivant, & d’un autre qui eft détruit.
Toutes les loix de la communication du mouvement entre
les corps fe’ réduifent aux loix de l’équilibre. Fécondité de ce
principe. Son application à la réfiftance d’un corps dans un
fluide. Ibid. 889. a. L’expérience feule a pu nous inftruire des
loix de la preffion & de l’équilibre des fluides, 8c on n’a pu
trouver encore dhypothefi fatisfaifante pour les expofer. Les
philofophes ne pouvant déduire immédiatement de la nature
des fluides les loix de-leur équilibre , ils les ont réduites à
un feul principe d’expérience, Y égalité de preffion en tout fens.
La découverte Durement expérimentflle de ces loix rend le
problème plus fimple , que fi pour le réfoudre nous étions
bornés à la feule connoiffance de la figure & de la difpofition
des parties des fluides, 8c qu’il en fallût déduire toute notre
théorie. Il ne s’agit plus que de développer par quel moyen
les loix de la réfiftance peuvent fe déduire des loix de 1 hy-
droftatique, voyeç là-deffus l’article Réfiflance. Difficultés que
l’auteur a rencontrées dans fes recherches fur cette matiero.
Ibid. b. Les limites , où la théorie eft forcée aujourd’hui de
s’arrêter ne doivent point être regardées comme tellement
fixées, que de nouveaux fecours ne puiffent nous mener plus
loin. L’auteur renvoie fur cette mauere à fon ouvrage , intitulé
Elfa i d’une nouvelle théorie de la réfiflance des fluides.
Combien font délicates 8c difficiles à exécuter les expériences
fur ce fujet. La difficulté fréquente d’appliquer le calcul à la
théorie, pourra aufli rendre fouvent prefque impraticable la
comparaifon de la théorie 8c de l’expérience. Ibid. 890. a.
Détails de l’auteur fur l’ouvraee qui vient d’être cité. Avis
aux géomètres, qui dans la luite , s’occuperont du même
objet ; c’eft de ne pas ériger trop légèrement des formulej
d’algcbre en vérités ou propofitions phyfiques. L’efprit de
calcul rogne peut-être aujourd’hui un peu trop dans la philo-
fophie. Ibid. b.
Fluide. Différence entre les liquides 8c les fluides. Comment
les uns peuvent fe transformer dans les autres. IX.
367. b. On peut faire prendre à quelques fluides l’apparence
de l’air pendant quelque tems.L 226. % Attraaion des parties
des fluides. I. 848. *. Caufcs d u mouvement 8t du repos
C C C C c c c c c