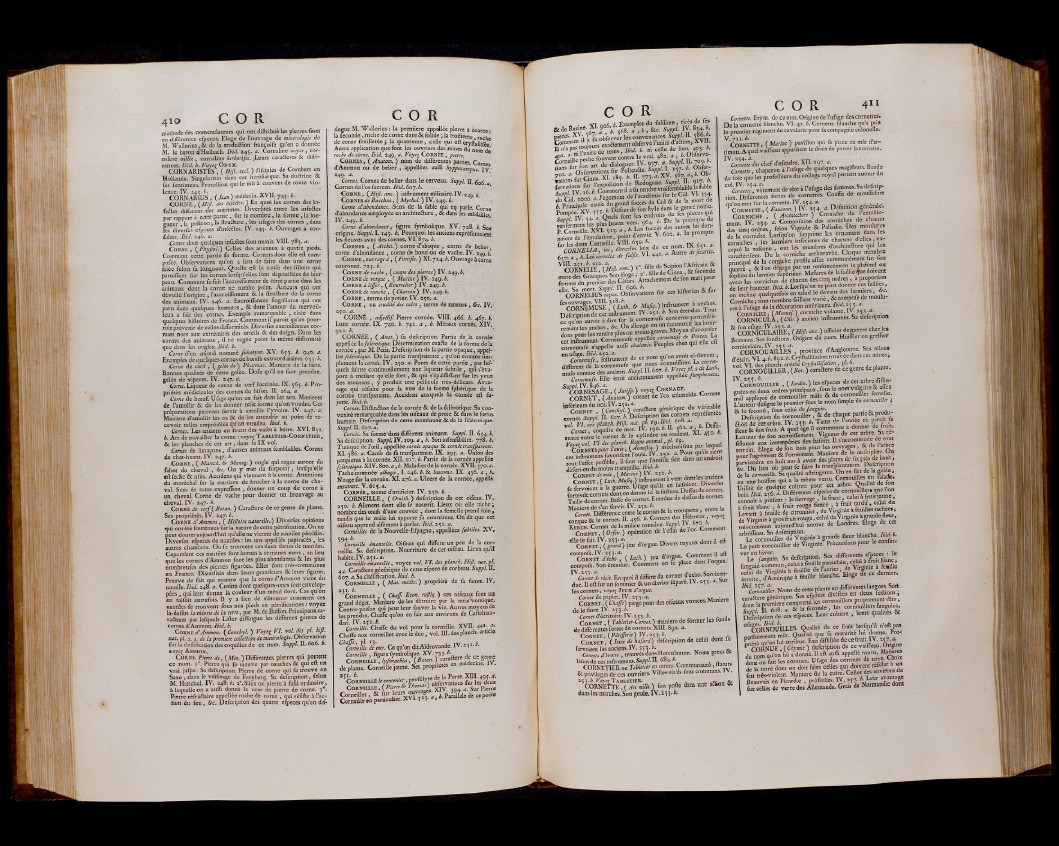
4 i o COR méthode des nomenclateurs qui ont diftribué les pierres fines
en différentes efpeces. Eloge de l’ouvrage de minéralogie de
M. Wallerius, & de la traduâion françoife qu’en a donnée
M. le baron ¿’Holbach, Ibid. 245. a. Cornaline onyce, cornaline
aillée , cornaline herbprifée. [Leurs caraéleres & difiè-
rences. Ibid, b. Voyez O n y x .
CORNARISTES, ( Hift. eccl. ) difciples de Cornhert en
Hollande. Singularités dans cet héréfiarque. Sa dottnne Sc
fes fentimens. Proteftion qui le mit à couvert de toute violence.
IV. 245. b. ¿-r- -, VTm ,
CORNARIUS 1 ( Jean ) médedin. XVII. 745. b.
CORNE ( Hift• d es infiéles.YEn quoi les cornes des în-
feéles different des antennes. Diverfités entre les infe&es
par rapport à cette partie , fur le nombre, la forme , là longueur
, la pofition, la ftrufrure , les ufages des cornes, dans
les diverfes efpeces d’infeftes. IV. 245. b. Ouvrages à con-
fulter. Ibid. 246. a. . o
Cornes dont quelques infectes font munis. VIII. 783. a.
C o r n e , ( Phyfiol. ) Celles des animaux à quatre pieds.
Comment cette partie fe forme. Cornets dont elle eft com-
pofée. Obfervations qu’on a lieu de faire dans une corne
fciée félon fa longueur. Quelle eft la caufe des filions qui
paroiffent fur les cornes lorfqu’elles font dépouillées de leur
peau. Comment fe fait l’accroiffement de cette partie dans les
animaux dont la corne ne tombe point. Auteurs qui ont
dévoilé l’origine, l’accroiffement & la firufture de la corne
des animaux. IV. 246. a. Excroiffances fingùlieres qui ont
paru dans quelques hommes , & dont l’amour du merveilleux
a fait des cornes. Exemple remarquable , citée dans
quelques hiftoires de France. Comment il paroît qu’on pour-
roit prévenir de telles difformités. Diverfes excroiffances cornues
nées aux extrémités des orteils & des doigts. Dans les
cornes des animaux , il ne regne point la même difformité
que dans les ongles. Ibid. b.
Corne d’un animal nommé fukotyro. XV. 653. b. 940. a.
Exemples de quelques cornes de boeufs extraordinaires. 653. A.
Corne de cerf , ( gelée de ) Pharmac. Maniéré de la faire.
Bonnes qualités de cette gelée. Dofe qu’il en faut prendre,
gelée de viperes. IV. 247. a.
Corne. Liqueur de corne de cerf fuccinée. IX. 365. b. Propriétés
médicinales des cornes du bifon. II. 264. a.
Corne de boeuf. Ufage qu’on en fait dans les arts. Maniérés
de l’amollir & de lui donner telle forme qu’on voudra. Ces
Séparations peuvent Îèrvir à amollir l’yvoire. IV. 247. a.
aniere d’amollir les os & de les attendrir au point de recevoir
telles empreintes qu’on voudra. Ibid. b.
Cornes. Les anciens en firent des vafesà boire. XVI. 832.
b; Art de travailler la corne :yoye{ T a b l e t i e r - C o r n e t i e r ,
8c les planches de cet art, dans le IX vol.
Çomes de limaçons, d’autres animauxfemblables-Cornes
de chat-huant. IV. 247. b.
C o r n e , ( Maréch. & Maneg. ) ongle qui regne autour du
fabot du cheval , &c. On y met du furpoint, lorfqu’elle
«ftfeche & ufée. Accidens qui viennent à la corne. Attentions
du maréchal fur la maniéré de brocher à la corne du cheval.
Sens de cette expreflion, donner un coup de corne à
un cheval. Corne de vache pour donner un breuvage au
cheval. IV. 247. b.
C o r n e de cerf (Bot an. ) Caraftere de ce genre de plante.
Ses propriétés. IV. 247. b. x . /■ • •
C o r n e d'Ammon, ( Hiftoire naturelle.) Diverfes opinions
qui ont été foutenues fur la nature de cette pétrification. On ne
Eeut douter aujourd’hui qu’elle ne vienne de nautiles pétrifiés,
ïiverfes efpeces de nautiles : les uns appellés papiracés , les
autres chambrés. Où fe trouvent ces deux fortes de nautiles.
Cependant ces nautiles font bornés à certaines mers , au lieu
que. les cornes d’Ammon font les plus abondantes & les plus
nombreufes des pierres figurées. Elles font très-communes
en France. Diverfités dans leurs grandeurs & leurs figures.
Preuve de fait qui montre que la corne d’Ammon vient du
nautile. Ibid. 248. a. Croûte dont quelques-unes fontenvclop-
pées, qui leur donne la couleur d’un métal doré. Cas quon
en fidfoit autrefois. Il y a lieu de s’étonner comment ces
nautiles fe trouvent fous nos pieds en pétrifications: voyez
là-deffus la théorie de la terre, par M. de Buffon. Principaux ca-
raâeres par lefquels Lifter diftingue les différens genres de
cornes d’Ammon. Ibid. b.
C o r n F. d’Ammon. ( Conchyl. ) Voye^ VI. vol. des pl. hiß.
nat. pl. 2. 3. de la première eolleflion de minéralogie. Qbfervation
fur la clamfication des coquilles de ce nom. Suppl. H. 606. b.
voye^ Am m o n .
C o r n e . Pierre de y (Min. ) Différentes pierres qui portent
ce nom. i°. Pierre qui fe trouve par couches & qui eft un
vrai jafpe. Sa description. Pierre de corne qui fe trouve en
Saxe , dans le voifinage de Freyberg. Sa defeription, félon
M. Henckel. IV. 248. b. 20.Silex ou pierre à fuül ordinaire,
à laquelle on a auffi donné le nom de pierre de corne. 30.
Pierre réfraôaire appellée roche de corne , qui réfifte à l’action
du fou, &c. Defeription des quatre eipeces qu’en dif-
COR ringue M.'Wallerius: la première appellée pierre à écorce*
la fecortde, roche de corne dure &fblide j la rroifieme roche
de corne feuilletée ; la quatrième, celle qui eft crytfàl|jfée
Autre application que font les ouvriers des mines du nom dé
roche de corne. Ibid. 249. a. Voye[ CORNÉE , pierre.
C o r n e s , ( Anatom. ) nom de différentes parties. Cornes
d’Ammon ou de belier , appellées auffi hyppocampus. IV *
249. a. ,
Cornes. Cornes de belier dans le cerveau. Suppl. n. 606 a
Cornes de l’os facrum. Ibid. 607. b.
C o r n e , (Hift. anc. ) infiniment militaire. IV. 249. b.
C o r n e s de Bacchus, ( Mythol. ) IV. 249. b.
Corne .d'abondance. Sens de la. fable qui en parle. Corno
d’abondance employée en architedure , & dans les médailles
IV. 249. b.
Come d'abondance y figure fymbolique. XV. 728. b. Son
origine. Suppl. 1. 143. b. Pourquoi les anciens repréfentoient
les fleuves avec des cornes* VI. 874. b.
C o r n e s , ( Archit.) corne d’abaque , corne de belier
corne d’abondance, corne de boeuf ou de vache. -IV. 249. b.
. C o r n e , ouvrage à , ( Fortifie. ) XI. 724. b. Ouvrage à corne
couronné. 723. b.
C o r n e de vache, (coupe des-pierres) IV. 249.b.
CORNE de vergue y ( Marine ) IV. 249. b.
C o r n e à lijfer, ( Bourrelier ) IV. 249. b.
CORNE de ranche y ( Charron ) IV. 249. b.
C o r n e , terme de potier. IV. 230 .a.
C o r n e , ou crudité des cuirs, terme de taneurs, &c. IV.
230. a.
CORNÉ , adjeflif. Pierre cornée. VIII. 466. b. 467. b.
Lune cornée. IX. 740. b. 741. a , b. Métaux cornés. XIV.
922.. b.
CORNÉE, ( Anat. ) fa defeription. Partie de la cornée
appellée la felérotique. Détermination exaile de la forme delà
cornée , par M.Petit. Defeription de la partie opaque, appellée
felérotique. De la partie tranfparente , qu’on nomme Amplement
la cornée. IV. 230. a: Pores de cette partie , par lef-’
quels fuinte continuellement une ligueur fubtile, qui s’évapore
à mefure quelle fort, & qui s’épaiffiffant fur ies yeux-
des mourans, y produit une pellicule très-délicate. Avantage
qui -réfulte pour la vue de là forme fphérique de la
cornée tranfparente. Accidens auxquels la cornée eft fu-
jette. Ibid. b.
Cornée. Diftinâion de la cornée & de la felérotique. Sa convexité
remarquable dans les oifeaux de proie & dans le foetus
humain. Defeription de cette membrane & de la felérotique.
Suppl. II. 607. a.
Cornée. Sa forme'dans différens animaux. Suppl. II. 654. b.
Sa deferiptiom Suppl. IV. 109. a , b. Son infenfibilité. 778. b.
Tunique de l’oeil, appellée cornée opaque & cornée tranfparente.
XI. 306. a. Caufe de fa tranfparence. IX. 293. a. Union des
paupières à la cornée. XII. 207. b. Partie de la cornée appellée
felérotique. XIV. 800. a, b. Maladies de la cornée. XVII. 370. a.
Tache nommée albugo , I. 246. b. & leucoma. IX. 436. a , b.
Nuage fur la cornée. XI. 276. æ Ulcere de la cornée, appêllé
encavure. V . 613. a.
C o r n é e , terme d’artificier. IV. 230. b.
CORNEILLE, ( Omith. ) defeription de cet oifeau. IV.
230. b. Alimens dont elle fe nourrit. Lieux où elle niche ;
nombre des oeufs d’une couvée , dont la femelle prend foin,
tandis que le mâle lui apporte fa nourriture. On dit que cet
oifeau apprend aifément à parler. Ibid. 231. a.
Corneilles de la Nouvelle-Efpagne, appellées fubtiles. XV.
Corneille émantelée. Oifeau qui différé un peu de la corneille.
Sa defeription. Nourriture de cet oifeau. Lieux qu’il
113CorneiUeVmanteUe, voyez vol. VI. des planch. Hift. nat.pt.
44. CaraÔere générique de cette efpece de corbeau. Suppl. II.
607. a. Sa clamfication. Ibid. b.
C o r n e i l l e , ( Mat. médic. ) propriété de fa fiente. IV .
a3CoRNEiLLE , ( Chaff. Econ. ruftiq. ) ces oifeaux font un
erand dégât. Maniéré de les détruire par la noixVomique.
Contre-poifon qui peut leur fauver la vie. Autres moyens de
les prendre. Chaffe qu’on en fait aux environs de Caltelnau-
Corneille,Î Chaffe du vol pour la corneille. XVII. 44»^
Chaffe aux corneilles avec le duc, vol. III. des planch. article
ChaCorneïlù de mer. Ce qu’en dit Aldrovande. IV. 2Ç »•
Comeille, figure , a afymb|oliquie. XVp. 733- fdMe ce iv-
’ ’ c o r n e i l l e o b f e m S
Corn.ilîcVo particulier. XVI. 51 S' Parallele de ce poëté
COR COR 411
„ . V I 0 0 6 t. Exemples du fublime,
& de ¡ B l { , r i. ,68. a , b , & c. Suppl. IV- 834- ;
pieces. XV. i 7 bf ver convenances. SuppiII- Çi-*- isrSiSate^pw<g?! ;
S/ PPr - } a J u w m e n , deVacadèmie fur le Cid. VI. 334-
Pompée XV 535.» u e e J rolts de fes pieces qm ¡PlisiÜ isSl!v- &6oî-I,"prompM fu r le s d e u x C o rn e i lle . VHI. 630. IX.631.tf.
T .)
U m “& fur
rm m f l^ r r lr C é f / A u a c h em e n td e fo nm a n p o u r
Defeription de cf , , ^ ” e1",^omenîufe concerne particuliè-
c e qu'on * » « . . . a t b r e : ' ^ r W c r u r è i f lès bouren
ufage. lbii. d nom qu’on avoir ci-devant t
a iÆ f i à :
^ ^ . “ ï S i i n e m e n 7; ap p ê flé e
Corners 1
''“ ' « ^ " T c S T é a r a a e r e génériipre du véritable
c o r n e S - II- 6o7y i/Defcriorion des cornets rcpréfentés
vol VI. oc. planch. H if. n o .p l 6^ !b‘d 608. . ^ D;ff, _
défert ou du moins tranqudle. Ibid. b.
fe fcrv^ent a la guerrÎMfage. qu'Us en
eUC0EunW( 'g ” ,/) jeu d'orgue. Divers ruyaux don. il eft Ævï: éÉÉ ê compofé. Son étendue. Comment ôn le place dans org
1VComt<* rtc il. En quoi il différé du cornet d'écho. Sonéten-
due. Il eft fur un fommier & un davier féparé. V. 33* I
les cornets, voyt\ J e u x d'orgue.
Cornet de papier. IV. 233. a, w 1
C o r n e t , ( Chaffe) piegepour des oifeaux voraces. Maniéré
de le faire. IV. 233. b.
Cornet d’écritoire.IV. 233. b. , fnori.
C o r n e t , ( Tabletier-Cornet.) mamefe de former les tonos
de différentes fortes de cornets. XIII. 892. a.
C o rn e t. (PdtiiTerie') IV .233.b. . . . S
‘ C o rn e t, (Jeux de hafard) defeription de celui dont fe
fervoient les anciens.IV. 23^. b.
Cornets d'ivoire y trouvés dans Herculanum. Noms grecs ec
latins de ces inftrumens. Suppl- H. 684. b. «
CORNETIER ou Tabletier en cornes. Communauté, rams
& privilèges de ces ouvriers. Villes ou ils font communs. IV.
« if iO fon Pofte dans une aâion &
dans les marches. Son grade. IV. ¿53-^
Cornette. Etym. de ce mot. Origine de l’ufage des cornettes.
De la cornette blanche. VI. 42. b. Cornette blanche qu’a pris
le premier régiment de cavalerie pour fa compagnie colonelle.
^ CORNETTE, ( Marine ) pavillon qui fe place au mât d’artimon.
Aquel vaiffeau appartient le droit de porter la cornette.
^Cornette du chef d’efeadre. XII. 197- a- _ ,
Cornette y chaperon à l’ufage de quelques magiftrats. Bande
de foie que les profeffeurs du collège royal portent autour du
COlc Z J J ’ vêtement de tête à l'ufage des femmes. Sa deferip-
tion^Différent« fortes de coreettes. Coëffe de mouffelme
au’on met fur la cornette. IV. 234. a. , .
C o r n e t t e , ( Faucon*. ) IV. « ¡R M Défini,'°n # “ él 1e-
C o r n i c h e , ( Architecture ) Corniche de 1 enn.bfo
ment IV 134. a. Compofition des corniches de chacun
T s cinq ordret, félon ÆgnOle & Palladio. Dcs mo.ilures
de la corniche. Lorfqu’on fuppnme les ornemens dans les
corniches , les larmiers inférieurs de chacune d elles, ex
cepté la tofeane , ont les membres d architeilure qui les
caraftérifent. De la corniche architravée. Chaque membre
urSciual de la corniche profile affea communément fur fon
ouarré & l’on dégage par un renfoncement le plafond ou
E t é du larmier Æplriüur. Mefures de la fatll.e ^ue dwveint
avoir les corniches de chacun des cinq ordres , à Pr08“f.?0B
de leur hauteur Ibid. i.Lorfqu'on ne peut donner ces faillies,
on S H « =" «î“ d le d?™ t des S f ’„ u t :
Corniche; tout membre faillant vane, moulu
res à l'ufage de la décoration intérieure.Ibid. a y . «•
C o r n i c h e , (Mcnuif.) corniche volante.IV. es3.«,
CORNICULA, ( Chir. ) ancien inflrument. Sa deicnption
& S S rS E S u S S K S ) officier de mierre cher le,
Romains. Ses fonffions. Origine du nom. Huiffierou greffier
” C 0 w Î 0 U A l i i5É s ', province d’Angleterre. Ses mine,
d’ètain. VI. 4. b. 89a. i.Cryftallifauon trouvée dans ces mines,
vol VI des planch. article Cryftallifation, pl. 6.
CORNOUILLER, (Bot. ) caraftere de ce genre de plante.
IVCornoÙilliR , ( Jardin.) les efpeces de cet arbre diffin.
euèes en deux o rdre s principaux, fous le nom^vulgaire
md appliqué de cornouiller mâle & de cornouJler femelle.
L’auteur défigne le premier fous le nom fimple de cornouiller ,
& le fécond, fous celui de fangum. . „ j.,.
Defcriprioii du cornouiüer j & de chaque partie & p
A îîl «tTrbre IV. 2 « . b. Tems de l’année ou paro»t fa
fleur & fon fruit. À quel âge il commence à donner du fruit.
Un eur de fon accroiffcment. Vigueur de cet «b «. Sa ^
Mance aux intempéries desfaifons. Il
Îc'la o rL aTsa qualirè aflringente. On en for de la gelée,
ou une boiffon qu. a la même vertuCornoumsm
Utilité de quelque culture pour cet arbre. y “a“ lc “j-
I bois. IJbhiidA. -îTlej 6. aa. Dviitftfeérreenmte s effp ece^s de co¿r nouille^rs q ueu 1n oen,
mSp awfe ce “p caraélere génénqu . ,P. cornouillers proprement dits,
d%onEt la premièrer comp n îcomdku,,ürlse r«s fanguin&s. Ufa|;ORNOUnXES. Qualité de ce fruit lirfqu’il n’eft pa»
mûr Ouaüté que fa maturité lui donne. Pro«
SriSè au’on lui attribue. Eau diftillée de ce friüt.]LV. u<7. o.
CONNUE ( Chymie ) defeription de ce vatffeau. Ôrigine
d u nW o n lu iaT o n n é .I le ft auffi appellèr««.. Ma«t«
S i ® 1« cornues. Ufage de,
de k terre dont on doit faire ceUes qui doivent rélifter a un
ÿutrès-v'olent. Maniéré de la cuire. Celles de, cny.fensdc
B é a n ts « Picardie , préférées. W M f l g f c g g »
l fur celles de yerre des Allemands, Grais de N