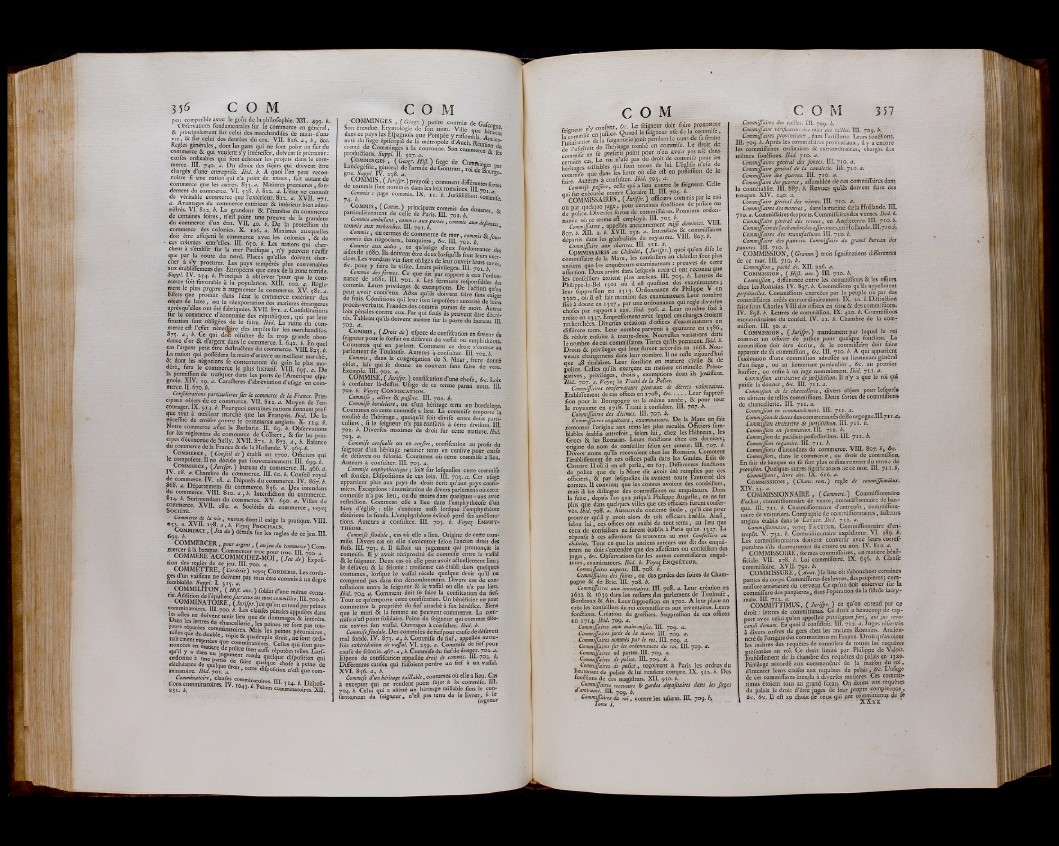
3 j 6 COM peu compatible avec le goût de la plnlofophie. XÏI. 409. b.
Obfervations fondamentales fur le commerce en général,
& principalement fur celui des marchandifes de main-d’oeuvre,
6c fur celui des denrées du cru. VII. 826. a , b, &c.
Réglés générales, -dont les gens qui ne font point au fait du
commerce & qui veulent s’y intéreffer, doivent fe prémunir:
caufes ordinaires qui font échouer les projets dans le commerce.
III. 740.. a. Du choix des fujets qui doivent être
chargés d’une entreprife. Ibid. b. A quoi l’on peut recon-
noître fi une nation qui n’a point de mines, fait autant de
commerce que les autres. 833. a. Matières premières , fondement
du commerce. VI. 538. b. 812. a. L’état ne connoit
de véritable commerce que l’extérieur. 812. a. XVII. 771.
a. Avantages du commerce extérieur & intérieur bien admi-
niftrés. VI. 812. b. La grandeur & l’étendue du commerce
de certaines foires, n’eft point une preuve de la grandeur
du commerce d’un état. VIL 40. b. De la proteélion du
commerce des colonies. X. 126. a. Maximes auxquelles
doit être affujetti le commerce avec les colonies , & de
• ces colonies entr elles. III. 630. b. Les nations qui cherchent
à s établir fur la mer Pacifique , n’y peuvent réufiir
que par ^la route du nord. Places qu’elles doivent chercher
à s’y procurer. Les pays tempérés plus convenables
aux etablifTemens des Européens que ceux de la zone torride.
Suppl. IV. 234. b. Principes à obferver *pour que le commerce
foit favorable à la population. XIII. 100. 4. Règlement
le pins prgpre à augmenter le commerce. XV. <81. a.
Effets- que produit dans l’état le commerce extérieur des
objets de luxe, ou la réexportation des matières étrangères
après quelles ont été fabriquées. XVII. 871. a. Confidéranons
fiir le commerce d’économie des républiques, qui par leur
fituanon font obligées de le faire. Ibid. La ruine du commerce
eft J’effet néeef&jre des impôts fur les marchandifes.
y 5- a > *- doit réfulter de la trop grande abondance
d or 8c d argent dans le commerce. I. 642. b. En quel
cas 1 argent peut être deftruôeur du commerce. VIII. 823. b.
La nation qui poffédera la main-d’oeuvre au meilleur marché,
& dont les négocians fe contenteront du gain le plus modéré,
fera le commerce le plus lucratif. VIII. 693. a. De
la permiffion de trafiquer dans les ports de l’Amérique efpa-
gnole. XIV. 19. a. Caraéleres d’abréviation d’ufage en commerce.
II. 670. b. -
Confidératïons particulières fur le commerce de la France. Principaux
objets de ce commerce. VII. 812. a. Moyen de l’encourager.
IX. 914. b. Pourquoi certaines nations donnent pref-
tout à meilleur marché que les François. Ibid. De la
necefiite de croifer contre le commerce anglois. X. 124. b.
Notre commerce avec la Barbarie. II. 69. b. Obfervations
lur les réglemens de commerce de Colbert, & fur les principes
d économie de Sully. XVII. 871. b. 872. a , b. Balance
du commerce de la France & de la Hollande. V . 069. b.
Commerce , ( Confeil de ) établi en 1700. Officiers qui
le compofent. Il né décide pas fouverainement. III. 699. b.
Commerce, (Jurifpr. ) bureau du commerce. II. 466.a.
IV. 18. a. Chambre de commerce. HI. 60. b. Confeil royal
de commerce. IV. 18. a. Députés du commerce. IV. 867. b.
»68. a. Départemens du commerce. 836. a. Des intendans
du commerce. VIII. 810. a ,b . Interdiction du commerce.
014. b. Surintendant du commerce. XV. 690. a. Villes de
— e. XVII. 280. a. Sociétés de commerce, voye^
Commmtdt L iv i,, vertus dont a esige la pratique. Vili.
«53. a. XVII. 178 a , i. Prochain.
^Commerce, (/ru du) diudls fur ies regies ge ce g | | m
COMMERCER , pour argent, ( au jeu du -commerce j Corn-
meicf r ? «banque. Commercer troc pour troc III -700 a
COMMERE ACCOMMODEZ-mS ; W u Je ) ^ p o fi.
non des réglés de ce jeu. III. 700. a.
COMMETTRE, ( Corderie') voye^ Corderie. Les corda-
ses d un vaiffeau ne doivent pas tons être commis k un degré
tembiable. Suppl. L 313. a.
rieCAddri d Vi*' I ^ “nC‘ Ì foklat d’une même centu'
C O m S a t S m V mo“ ommili'°- «>■ 7°°- *■
comm^W TTT ? y ? rt/Pr- ) ce qu’on entend par peines
leTaft« 7°°- b. Les claufes pénales appofées dans
Da„, “ 5 léu™sVde' Îf"‘r n'“ ’ “ î de Lnmages 8c intérêts,
¡ours ohancellerie, les peines ne font pas tou-
Mf peines pécuniaires,
nairement réputées true'ci™ ne font ordìnoncées
en matière _ omminatoires. Celles qui font pro-
qu’il y a dans un iuaeme*? * au^"1 réputées telles. Lorf-
ordonne à ime panie de "/• -r u tpelque difpofition qui
déchéance de quelque droit choi? Ì Peine de
minatoire. Ibid. 701. a. 9 difpofition n eft que com-
Commnatoire, claufes commino«-
fions comminatoires. IV. 1042 b pifnS‘ ^4- b. Diipôfi-
j j i . b% emes comminatoires. XII.
C O M
.-COMMINGES , (G éo g r .) petite contrée de Gafcrw»
Son étendue. Etymologie de fon nom. Ville que ¿ gne'
dans ce pays les Efpagnols que Pompée y raffembla An^
neté du fiege épifcopal de la métropole d’Auch. Ré..«^ .
comté de Comminges à la couronne. Son comme™ & 1
produirons. Suppl. II. 327. a. K fes
Laudi
gne.
COMMIS, (Jurifpr.) prépofoj comment différentes fort^
de comtnts font nommés dans les loix romaines. RI.
' “8e commis- " • i- Jnrifdiâion
C o m m i s , ( Cotttm.) principaux commis des douanes ftr
particulièrement de celle de Paris. III 70X é
Commuambulant commis auxpanes .cammiiauxdefeenut
commis aux recherches. III. 701. b. J^tts ,
Commis, en termes de commerce de mer, commis & fous,
commis des négocians, banquiers , &c. III. 701. b.
, ce qu’exige d’eux l’ordonnance des
aides de 1680. Us doivent être deux lorfqu’ils font leurs excr?
cices.Les vendais vin font obligés de leur ouvrir leurs caves
&e. pour y faire la vifite. Leurs privtieges. IU. 7oi. b.
e V ” ™ ' Ce que vdit Par rapport à eux l’ordonnance
de 1681. III. 701. b. Les fermiers refponfables des
commis. Leurs privilèges & exemptions. De l’aftion qu’on
peut avoir contr eux. Aôes qu’ils doivent faire fans eriger
de frais. Conditions qui leur font impofées : autorité de leurs
proces-verbaux. Fraudes des commis punies de mort. Autres
‘^Pénales contre eux. Par qui feuls Us peuvent être décrétés.
1 ableau qu Us doivent mettre fur la porte du bureau Ùl
702. a.
C o m m i s , (Droit de) efpece deconfifcation en faveur du
leigneur pour le forfait ou défaveu duvaffal ou emphithéote.
Coutumes qui en parlent. Comment ce droit s’exerce au
parlement de Touloufe. Auteurs ^confulter. III. 702. b.
Commis t dans la congrégation de S. Maur, frere donné
oblat, laïc qui fe donne au couvent fans foire de voeu.
Exemple. III. 702. a.
COMMISE j ( Jurifpr. ) confifcation d’une chofe, <S*c. Loix
a confulter là-deffus. Uiage de ce terme parmi nous. III.
702. b. Voye{ C o n f i s c a t i o n .
Commife , aflivc 8c pajjivc. III. 702. b.
Commife bordeliere, ou d’un héritage tenu en bordel âge»
Coutumes ou cette commife a lieu. La commiie emporte la
totalité de l’héritage, quoiqu’il foit -divifé entre deux particuliers
, fi le feigneur n’a pas confenti à cette divifion. III.
702. b. Diverfes maximes de droit fur cette matière. Ibid.
703. a.
Commife cenfuelle ou en cenfive, confifcation au profit dü
feigneur d’un héritage roturier tenu en cenfive pour caufe
de défaveu ou félonie. Coutumes où cette commife a lieu.
Auteurs à confulter. III. 703. a.
Commife emphythéotique ; loix fur lefquelles cette commife
eft fondée. Difpofitions de ces loix. lll. 703. a. Cet ufage
appartient plus aux pays de droit écrit qu’aux pays coutu-
miers. Exceptions : énumération de divers parlemens où cette
commife n’a pas lieu, ou du moins dans quelques - uns avec
reftriétion. Comment elle a lieu dans l’emphythéofe d’un
bien d’églife : elle s’exécute aufli lorfque l’emphythéote
détériore le fonds. L’emphythéote évincé perd fes améliorations.
Auteurs à confulter. III. 703. b. Voye[ E m p h y -
THÉOSE.
Commife féodale, cas où elle a lieu. Origine de cette commife.
Divers cas où elle s’exécutoit félon l’ancien droit des
fiefs. III. 703. b. Il falloit un jugement qui prononçât la
commife. Il y avoit réciprocité de commife entre le vaffal
& le feigneur. Deux cas où elle peut avoir aôuellement lieu ;
le défaveu & la’ félonie : troifieme cas établi dans quelques
coutumes, lorfque le vaffal récele quelque droit qu’il ne
comprend pas dans fon dénombrement. Divers cas de con-
teftations entre le feigneur le vaffal où elle n’a pas lieu.
Ibid. 704. a. Comment doit fe foire la confifcation du fief.
Tout ce qu’emporte cette confifcation. Un bénéficier ne peut
commettre la propriété du fief attaché à fon bénéfice. Biens
que le mari & la femme ne peuvent commettre. La commife
n’eft point folidaire. Peine du feigneur qui commet félonie
envers fon vaffal. Ouvrages à confulter. Ibid. b.
Commife féodale. Des commifes de fief pour caufe de défaveu
mal fondé. IV. 873. a, b. Commife de fief, appellée autrefois
exhérédation de vaffal. VI. 239. a. Commiie de fief pour
caufe de félonie. 467. a , ¿..Commife du fief de danger. 702. a.
Efpece de confifcation appellée droit de commis. III. 702^ b.
Différentes caufes qui foifoient perdre un fief à un vaffal.
XVI. 856 .a ,b . .
Commife d'un héritage taillable, coutumes ou elle a heu. Cas
à excepter <ïui ne rendent point fujer à la commife. 111.
704. ¿. Celiu qui a aliéné un héritage taillable fans le con-
fente/neot du feigneur, n’eft pas tenu de le hvrer,_fi^e
C O M C O M
. . | „V eonfent, &c. Le feigneur doit foire prononcer
feigneu Y juftice. Quand le feigneur ufe de la commife,
r rfiuitier de la feigneurie-jouit pendant le tems de fa ferme
îï l’ufufruit de l'héritage tombé en commife. Le droit de
!Lnmife ne fe preferit point pour n’en avoir pas ufô dans
certains cas. I ™ n’ulf pas Su droit de cotumtfc pour les
héritages taillable» qui fout tenus de lut. f e g h p § g | de
commue que dans les lieux où elle eft en poffeffion de le
Aire. Auteurs à confulter. ibtd. 705. a.
Commife paßve, celle <¡111 a lieu contre le feigneur. Celle
oui fut exécutée contre Clotatre IL 111. 705. b.
COMMISSAIRES, (Jurifpr.) officiers commis par le rot
ou par quelque juge, pour certaines fonaions de O B H I
de police. Diverfes fortes de commiffaires. Premiere ordonnance
où ce terme eft employé. III. 7°S- . . . VTTT
Commiffaires , appelles anciennement miffi dominicu V Ui.
807. b. XII. 2. ¿. XVII. 232. a Intendans & commiffaires
départis dans les généralités du royaume. VIII. 807. b.
Commiffaire aux chartres. III. 221. p. g
C ommissaires" au .Châtelct, {Jurifpr.) quojquen d.fele
commiffaire de la Mare, les confeUlers au chatelet font plus
anciens que les enquèteurs-examinateurs : preuves de cette
affertion; Deux arrêts dans lefquels ceux-ci ont reconnu que
les confeillers étoient plus anciens. III. 703. b. Lettres de
Philippe-le-Bel 1301 où il eft queftion des exammateurs;
leur luppreffion en 1313. Ordonnance de Phihppe V en
X320 , ou il eft fait mention des examinateurs. Leur nombre
fixé à douze en 1327 , par une ordonnance qui regle diverfes
chofes par rapport à eux. Ibid. 706. a. Leur nombre fixe a
treize en i3j7.Empreifementavec lequel ces charges étoient
recherchées. Diverfes créations d’offices d’examinateurs en
différens tems. Leur nombre parvenu à quarante en 1586,
& réduit enfulte à trente-deux. Nouvelles vananons dans
le nombre de ces commiffaires. Titres qu’ils prennent./¿¿¿. ¿.
Droits & privilèges qui leur furent accordés en 1668. Nouveaux
changemens dans leur nombre. Il ne refte aujourd hui
que 48 titulaires. Leur fonâion en matière civile & de
police. Celles qu’ils exerçent en mariere criminelle. Prérogatives
, privilèges, droits, exemptions dont ils jouiffent.
Ibid. 707. a. Voyc{ le Traité de la Police.
Commiffaires confervateurs généraux de décrets volontaires.
Etabliffement de ces offices en 1708, &c. . . . . Leur fuppref-
fion pour la Bourgogne en la même année, & pour tout
le royaume en 1718. Traité à confulter. III. 707. b.
Commiffaires des décimes. IIL 707. b.
Commiffaires enquêteurs, examinateurs. De la Mare en foit
remonter l’origine aux tems les plus reculés. Officiers fem-
blables établis autrefois, félon lui, chez les Hébreux, les
Grecs & les Romains. Leurs fondions chez ces derniers;
origine du nom de confeiller félon cet auteur. III. 707. b.
Divers-noms qu’ils recevoient chez les Romains. Comment
l ’établiffement de ces offices paffa dans les Gaules. Edit de
Clotaire IIou il en eft parlé, en 613. Différentes fonctions
de police que de la Mare dit avoir été remplies par ces
officiers, & par lefquelles ils avoient toute l’autorité des
comtes. Il convient que les comtes avoient des confeillers ,
mais il les diflingue des commiffaires ou enquêteurs. Dans
la fuite, depuis Fan 922 jufqu’à Philippe Augufte, ce ne fut
plus que dans quelques villes que ces officiers furent confer-
vés. Ibid. 708. a. Auteurs du onzième fiede , qu’il cite pour
prouver qu’il y avoit alors de tels officiers.établis. Ainfi,
félon lui, ces offices ont exifté de tout tems au lieu que
ceux de confeillers ne. furent établis à Paris qu’en 1327. La
réponfe à ces affertions fe trouvera au mot Confeillers au
châtelet. Tout ce que les anciens auteurs ont dit des enquêteurs
ne doit s’entendre que des affeiTeurs ou confeillers des
juges, &c. Obfervations fur les autres commiffaires enquêteurs,
examinateurs. Ibid. b. Voyc^ E n q u ê teu r .
Commiffair.es experts. III. 708. b. j .
Commiffaires des foires, ou des gardes des foires de Champagne
& de Brie. IH. 708. b.
Commiffaires aux inventaires. HI; 708. a. Leur création en
162a & 1639 dans les refforts des parlemens de Touloufe,
Bordeaux & Aix. Leur fuppreffion en 1702. A leur place on
créa les confeillers du roi commiffaires aux inventaires. Leurs
fondions. Création de greffiers. Suppreffion de ces offices
en 1714. Ibid. 709. a.
Commiffaires aux main-mifes. HI. 709. a.
Commiffaires jurés de la marée. III. 709. a.
.Commiffaires nommés par le roi. IU. 709. a.
- Commiffaires fur les ordonnances du roi. HI. 709. a.
■ Commiffaires ad partes. IU. 709. a.
Commiffaires de police, III. 709. b.
Commiffaires de police, reçoivent à Paris les ordres du
Keutenant de police &lui rendent compte. IX. 312. b. Des
fondions de ces raagiftrats. XII. 910. b.
g Commiffaires receveurs & gardes dépofitaires dans les fieges
d amirauté. IU. 709. b.
Commiffaires du roi, contre les nfures. UI. 709. ¿4
Tome /, •
.Commiffaires des tailles. III. 709. b.
• Commiffaire vérificateur des rôles des tailles. UI. 7O9. b.
Commiffaires provinciaux , dans l’artillerie. Leurs fondions,
in. 709. b. Apres les commiffaires provinciaux, il y a encore
les commiffaires ordinaires & extraordinaires; chargés des
mêmes fondions. Ibid. 710. a.
Commiffaires général des fontes. III. 710. a.
Commiffaire général de la cavalerie. UI. 710. a.
Commiffaire des guerres. III. 710. a.
Commiffaire des guerres , affemblée de ces commiffaires dans
la connétablie. III. 887. b. Revues qu’ils doivent foire des
troupes. S XIV. 240. a ..
Commiffaire général des vivres. IU. 710. à.
Commiffaires des montres , dans la marine de la Hollande. Iü.
710. a. Commiffaires desports. Commiffaires des ventes .Ibid. b.
Commiffaire général des revues, en Angleterre. III. 710. ¿.
Commiffaire de la chambre des affurancesjjnn.c\lznùç. III.710.b,
Commiffaires des manufaElures. III. 710. b.
Commiffaire des pauvres. Commiffaire du grand bureau des
pauvres. IU. 710. b.
COMMISSION, ( Gramm.) trois fignifications différentes
de ce mot. III. 710. b.
Commijfion , péché de. XII. 226. a.
C ommission, (Hifi. anc.) III. 710. ¿.
Commijfion | différence entre les commiffions & les offices
chez les Romains. IV. 897. b. Commiffions qu’ils appelloient
perpétuelles. Commiffions exercées par le peuple ou par des
commiffaires créés extraordinairement. IX. 20. b. Diftindiort
faite fous Charles VIII des offices en titre & des commiffions.
IV. 898. b. Lettres de commiffion, IX. 420. b. Commiffions
extraordinaires du confeil. IV. 21. b. Chambre de la commiffion.
IU. 30. a.
C ommission , ( Jurifpr:) mandement par lequel le roi
commet un officier de jufuce pour quelque fondion. La
commiffion doit être écrite, & le commiffoire doit foire
apparoir de fa commiffion, &c. III. 710. ¿. A qui appartient
l’exécution d’une commiffion adreffée au lieutenant général
d’un fiege, ou au lieutenant particulier , &c. au premier
huiffièr, ou enfin à un juge nommément. Ibid. 711. a.
Commijfion attributive de jurifdiilion. Il n’y a que le roi qui
puiffe la donner, &c. ni. 711. a.
Commiffion de la chancellerie, divers objets pour lefquels
on obtient de telles commiffions. Deux fortes de commiffions
de chancellerie. UI. 711. a.
Commiffion en commandement. UI. 711. a.
Commiffion de dettes descommunauté9deBourgogne.ni.7i i .a.
Commijfion excitative de jurifdiilion. IU. 711. ¿.
Commijfion en fommation. III. 711. b.
Commiffion de pacificis pofleflbribus. III. 7 1X. b,
Commijfion rogatoire. lll. 711. b.
Commiffions d’intendans du commerce. Vin. 807. ¿, &c.
Commijfion, dans le commerce, ou droit de commiffion.
En fait de banque on fe fert plus ordinairement du terme de
provifion. Quelques autres fignifications de ce mot. III. 711. b.
Commiffions, livre des. IX. '616. a.
C ommissions, ( Chanc. rom.) réglé de commijfionibus.
XICvO-M23M-*I-S SIONNAIRE , ( Commerc. v) ^Çommiffionnaire
d’achat, commiffionnaire de vente, .commiffionnaire de banque.
III. 71 x. b. Commiffionnaire d’entrepôt, çommiffion-
naire de voituriers. Compagnie de commiffionnaircs, foéteurs
anglois établis dans le Levant. Ibid. 712. a.
Commiffionnaire, voye[ FACTEUR. Çopimiffionnàire d entrepôt.
V. 732. b. Commiffionnaire expéditeur. VI. 289. ¿.
Les commiffionnaires doivent convenir avec .leurs corref-
pondans s’ils demeureront du croire ou non. IV. 810. a.
COMMISSOIRE, formes commiffoires, en matière béné-
ficiale. VIL 178. b. Loi commiffoire. IX. 656. b. Claufe
commiffoire. XVU. 791. b. ‘. •
COMMISSURE, (Anat.) le lieu ou s’abouchent certaines
parties du corps. Commiffures des levres, des paupières ; conj-
miffurç antérieur^ du cerveay. Çe qu’on doit , .• r
commiffure des paupières, dans Î’ôpératipn de la fiftule lacrymale.
III. 712. a. •
COMMITTIMUS, ( Jurifpr. ) ce quon entend par ce
droit : lettres de committimus. Ce droit a beaucoup de rapport
avec celui qu’on appelloit privilegmm fort , aut j/tsrevo-
! candi domum. En quoi if confiftoit. îll. 712. a. Juges réfervés
; £ divers .ordres .de gens chez les anciens. Romains. Ancienneté
de l’origine des committinjus en France. Droit qu’avoieijt
i les maîtres des requêtes de connoître de toutes les requêtes
! présentées au roi. Ce droit limité par Philippe de "Valois.
Etabliffement de la chambre des requêtes du palais en 1320.
Privilège accordé aux comroenfaux de Ja mai fon du roi,
d’intenter leurs caufes aux requêtes du palus, fyc. L’ufage
de ces commiffions étendu à diverfes matières. Ces cpmmit-
timus étoient tous au grand fceaii.' O11 donna aux reqyêtçs
' du palais le droit d’être juges dé leur propre competeoçe,
£*c. &c. i l eft au choix de ceux qui fiP} çpmnnmniu# de fe
• ' - " ' ^C'X*x X