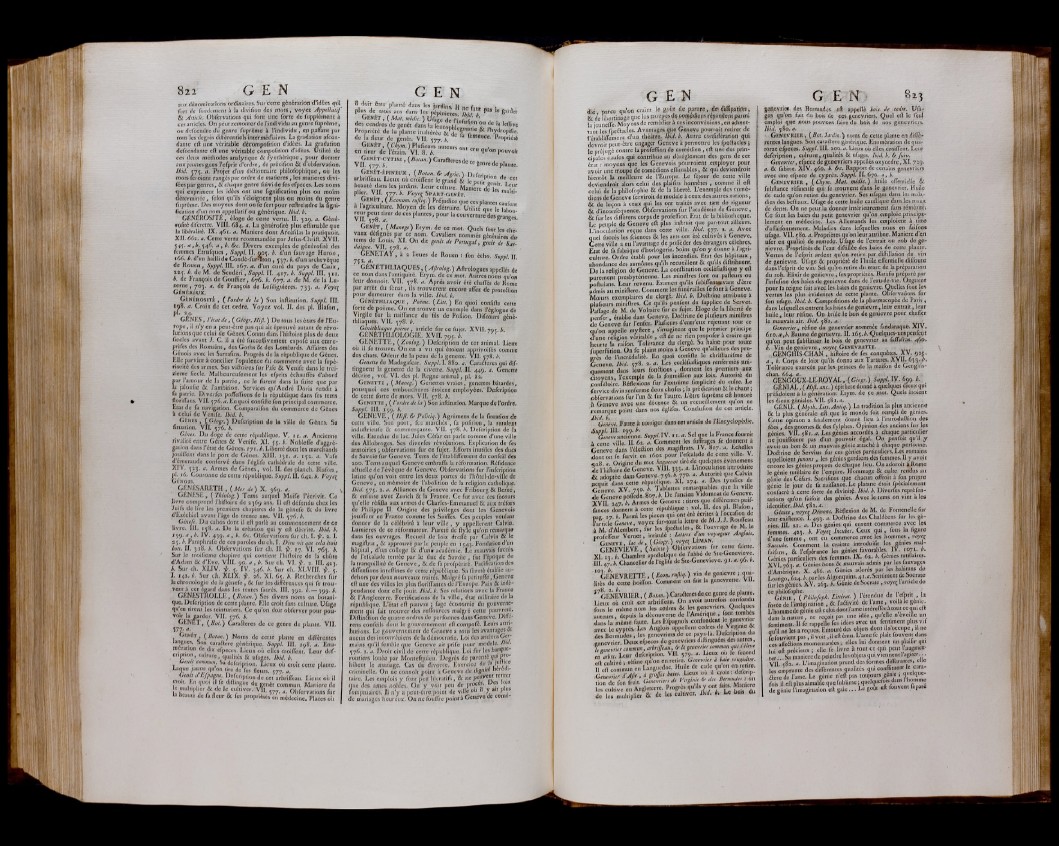
822 G E N
a u x dénominations ordimires.Sur cette génération d’idées qm
fort de fondement h la divifion de» mots, voyez A p p e lla tif
Si Article. Obf'ervation* qui font une forte de fiipplément à
ces art iclcs. On peur remonter de l'individu au genre fuprême ,
on defeendre du genre fuprême à l'individu, en panant par
tous les degré» différentiel# intermédiaires. La gradation afctm-
dante eA uni véritable décompofition d'idées. La gradation
dercendanrc eA une véritable compofitton d'idées. Utilité de
ces deux méthodes analytique 6c fynthérique, pour donner
aux jeunes gens l’eÎprit d'ordre, de préeifion 8c u'olffcrvation.
Ibid. <73. (t. Trojct d'un diélionnstre philosophique, où les
mots (ci oient rangés par ordre de matières, les matières divisées
par genres, 8c chaque genre iiiivi de Tes efpeces. Les noms
qui expriment les idées ont une lignification plus ou moins
déterminée, félon qu'ils s'éloignent plus ou moins du genre
fuprême. Des moyens dont on fe fert pour refireindre la lignification
d'un nom appellatif ou générique. Ibid. b.
GÉNÉROSITÉ, éloge de cette vertu. II. 329. a. G èn é -
fofttèdifcrette. V I lI , 684. a. La générofité plus euimable que
la libéralité. IX. 46 1 . a. Manière dont Afcéfilas la prariquoit.
XII, 662. a. Cette vertu rcommandéc par Jcfus-ChriA. XVII.
543. a ,b , 546. a , b . &e. Divers exemples de générofité des
femmes Etr 11 fij 11 e s , Suppl. II. 003. b. d'un fauvage Iluron ,
*66, b, d'un bailli de Condé-fur-lton, 537. b, d'un archevêque
de Rou en , Spppl, III, 167. a. d’un curé du pays de C a u x ,
123, b, de M, de Scudéri, Suppl. II. 417, b. Suppl. III. 311.
b. de François de Goufiicr, 0 16 . b, 6 7 7 , a. de M, de la Luze
rne, 703, a. de François de Lcfdiguieres, 733. a, Voyez
GÉNÎMf.VX,
G liN k n o sn ù , {Tordre de l a ) Son infiitution. Suppl, III,
108. a. Croix de cet,ordre. V o y e z vol. II. des pl. Blafon,
GENES, l'état d e , 1 Géogr, U ifl, ) De tous les états de l’Eu-
fop e , il n'y en a peut-être pas qui ait éprouvé autant de révo-
lutionsque celui de Gênes. Connu dans l'hiRoire plus de deux
ficelés avant S. G , il a été fuccelfivement expoté aux entre-
prifes des Romains, des Goths 6c des Lombards, Affaires des
Génois avec les Sarrafms. Progrès de la république de G èn es .
Elle parvint à concilier l'opulence du commerce avec la fupé-
riorité des armes. Ses viéloircs fur Pife & Venifc dans le treizième
ftccle. Malheurcufcment les efprits échauffés d’abord
par l'amour de la patrie, ne le furent dans la fuite que par
la jaloufie St. l'ambition. Services qu'André Doria rendit k
fa patrie. Diverfes po/Tefiions de la république dans fc# teins
fiorifians. VII. y/6, a. En quoi confifie fon principal commerce.
Etat de fa navigation. Comparaifon du commerce de Gênes
b celui de Vcnife. Ibid, b.
G tu u n , (G éo g r .) Defcription de là ville de Gênes. Sa
fimatiou, V IL 376. b.
Gènes. Du doge de cette république. V. 1 1 . a. Ancienne
rivalité entre Gênes 6c Venife. XI. M b. Noblcffe d'aggré-
gation dans l’état de Gênes. ¡ 7 1 . b, Liberté dont les marchands
/oument dans le port de Gênes. XIII, 131. a. 132, a. Va fe
ffémeraude coniervé dans l’églife cathédrale de cette ville.
11$ ' a' ‘I® Gênes, vol. II. des planch, lllafon ,
p l . 16. Couronne de cette république. Suppl, II, ¿4a, b. Poye?
G E N O IS . - ’ * %
G ÉN É SA R E TH , {M e r d e ) X . 369. d.
G E N E S E , (Théolog.) Tems auquel Moïfe l'écrivit. Ce
livre comprend l'biAotre de 2369 ans. Il eA défendu chez les
Juifs de lire les premiers chapitres de la génefe 6c du livre
d ’Ezéchiel avant l'âge de trente ans. VII. 376, b.
Génefe. Du cahos dont il eA parlé au commencement de ce
livre. III. j<8. a. De la création qui y eA décrite, Ibid. b.
1 59, a , b. IV . 439. a , b. 6>c. Obfervations fur ch. I. ffi. 2. I.
a y . b. Paraphrafe de ces paroles du ch. I, P ieu vit que cela étoit
bon. II, 3 18. b. Obfervations fur ch. II, ÿ , 17, VI, 762. b.
Sur le troifieme chapitre qui contient l'hiAoire de la chùte
d ’Adam 6c d 'E ve . VIII, 90, a , b. Sur ch. VI, $r. a, III, 4*3.
b. Sur ch. X LIV , ÿ . 3. IV. 346. b. Sur ch. XI.VIII, ÿ . 3.
J. 14». b. Sur ch, XLJX, ÿ , 26. XI. (><, b. Recherches fur
la chronologie de la génefe, 6c fur les différence# qui fe trouv
en th cet égard dans les textes facrés. III. 392, b, — 399, b.
GEN ESTROL LK , {Dotan,) Ses divers nom# en botanique.
Defcription de cette plante. Elle croît fans culture, Ufiige
qu'en tirent les teinturier s. C e qu'on doit ohferver pour pouvoir
la garder, VII, <76, b.
G EN ET, { B o t .) Caraéleres de ce genre de plante. VII.
M l ’ <ï>
. G i-n é t, {JJotan.) Noms de cette plante en différentes
i>.0n «»taélerc générique. Suppl. III, 108, a. Enu-
inératlon de dix efpeccs, Lieux où elles croiffent. Leur def-
crlprlon, culture, qualités 6c ufages. Ibid. b,
Genêt commun, Sadcfçrfpriqij, Lieux où croit cette plante.
Lauue tau; e qu’on tire de fon fleurs. «77. a.
r f f j m m M de c et arbriffeau. Lieux oh il
çtou, En qtto» il fe diA.ngue du «en4t commun. Maniéré de
L M M B « Y » - m . «■ O b f« » « io i» fur
" l a i , <*« r* ilcllr & M l>ropntt4* c i mWcciiic. Place, oli
G E N
d e , ccnilrc’. de L a S c S S i ” ï ‘ n k
« n t ÉTd’c® : )v !:,t T '4U,CUr,om 1 <!“’»" I-.VOH
’ {B Q ,a n ) Cara8crc" lc Pin..«.
G tN k T - fa iN w x , ( Boum, & A m e . 1 f e î & S i .
«rbriffeau. Lieux où croiffent le grand oc le petit ® a » cct
beauti B le. jardin.. Leur c u C c S ' Î Lî'.,r
plier. VII. , v . \ . Voy« S p a u t -o sn î t ! “ lc‘
G i y t o , {Econom. rnJlWA Préjudice que ce. plante, caufera
!i 1 agriculture. Moyen de le . détruire, ü tiliti q,,c |c lal ' .
v l i ' PC7 S ‘a " 1’li"UM' I’°" r j» couverture de» grange..
G*NéT, IM a n te c ) Ktyra. de ce mot. Qu el, fonde» die-
vau« défigné. par ce nom. Cavalier, nommé, génétalre. dir
rem» de Couil. XI. On dit g inii dt Portugal, gtnh d , Saf-
daigne. V II, 578. a.
G E N E T A ï , à a lieues de Rouen s fon écho. Suppl If
73 2. a. / J '
G ÉN É TH L IAQ U E S , ( Aflrolog.) AArologues nppellés de
c c nom dans 1 antiquité. Etym. de ce mot. Autres noms qu’on
leur donuott. VU . 378. a. Après avoir été chaffés de Rome
par arrêt du fénat, ils trouvèrent encore affez de protcAion
pour demeurer dans la ville. Ibid. b.
G/iNÎTHttaqviî , Poème. { L i t t . ) En quoi confiAc cette
forte de poèm e. O n en trouve un exemple dans l’églogue de
Virgile fur la nalffancc du fils de Pollion. Difcoitrs céné-
thliaques. V II. 378. b.
Généthliaaue poème, article fur ce fincr. XVII, 7 0 e , A.
G ÉN É TH U OLOG IE , XVII. 793. b.
G EN E T T E , (Z o o lo g .) Defcription de cet animal. Lieux
ou il fe trouve. On en a vu qui étoient apprivoifés comme
des chats. Odeur de la peau de la genette, VII, 378. b.
Genette de Madagafcar. Suppl, I. 880. 0. Caractère;» qui dlf-
tinguent la genette de la civette. Suppl,.11. 449. a. Genette
décrite, vol, V I . des pl. Rcgnc animai, pl. I2.
G e n e t t e , ( Maneg. ) Genettes vraies, genettes bâtardes,
pourquoi ces embouchures étoient employées,' Defcription
de cette forte de mors. V II. 378. b.
G e n e t t e , ( l'ordre de la ) Son InAitution. Marque de l'ordre.
Suppl. II(. 190. b.
G EN E V E , ( H ifl. £ P o litiq .) Agrémcns de la fituatlon de
cette ville. Son po r t, fes marchés, fa pofttion, la rendent
induAricufe 8c commerçante, VU, 378. b, Defcription de la
ville. Etendue du lac. Jules Céfar en parie comme d'une ville
des Allobroges. Ses diverfes révolutions. Explication de fes
armoiries ; oofervations fur ce fujet, Efforts inutiles des ducs
de Savoie fur Gcneve. Teins de 1 étahllffement du confeil des
200, Tems auquel Gcneve embraffa la réformatlou. Réfidence
aétuelie de l'évèque de Genevc. Obfervations fur l’infeription
latine qu'on voit entre les deux portes de l’Iibrel-de-ville de
G cn e v e , en mémoire de l'abolition de la religion catholique.
Ibid. 373, 2, a. Alliances de Geneve avec Fribotirg & Berne,
6c enfuire avec Zurich 6c la France. C e fut avec ces fecours
qu'elle réfiAa aux armes de Charlcs-Emmanuc! 8c aux trùfors
de Philippe II Origine des privilèges dont les Genevois
jouiffent en France comme les Suifles, Ces peuples voulant
donner de la célébrité â leur v ille , y appellcrent Calvin.
Lumières de ce réformateur. Pureté de Ayle qu'on remarque
dans fes ouvrages. Recueil de loix dreffé par Calvin 6c le
magiA/at, 6c approuvé par le peuple en 1343. Fondation d’un
hôpital, d'un collège 6c d'une académie, Le mauvais fttccés
de l'cfcalade rentée par le duc de Savriie, fut l’époque du
la tranquillité de G en ev e, 6c de fa profpérité, I^cificâtjott des
diffenfions InteAines de cette république, Sa fTircré établie au-
dehors par deux nouveaux traités. Malgré fa peiiteffè, Ç cn cv e
eA 11 ne des villes les plus fioriffaiites de l'Europe. Paix 6c indépendance
dont elle jouit. Ibid. b. Ses relations avec la France
6c l'Angleterre. Fortifications de la v ille , état militaire de la
république. L'état eA pauvre \ fage économie du gouvernement
qui fait trouver des reffoùrccs malgré cette pauvrczA»
DiAinètion de quatre ordres de perfonnes «ans Gcneve. Dinl*
rens confeils dont le gouvernement eAcompofé, Leurs attrE
butions. Le gouvernement de Geneve a tous les avantages 6c
aucun desiuconvéuiens de la démocratie. Loi des anciens Cet*
mains qu'il femble que Geneve ait prife pour modelé.
37<5. 2. a, Droit civil de cette république. Loi fur les hsoÇ11®"
routiers louée par Monreftjuicii. Degrés de parenté «m PJ'®*
hibenr le mariage. Cas dii divorce. Exercice
criminelle. On ne connoît point h G e n e v e do dignité iicrcat-
taire. Les emplois y font bpd lucratifs, 6t ne pciiycnr te _
que des ames nobles. On y vd jt peu de prof es-
lomptiiaires. Il 11'y a peut-être point de ville ou 11 v a |
de mariages heureux, Ou ne fo'uffre point à Geneve de om -
G E N
Aie, parce qu’on craint le gg® (|® parure > de- ^iffipxtjpn,
6c de libertinage que les troupe* dç cotpèqleps rêpa'ldept parmi
la icuncffc. Moyens de remédier â ces inconvénient, en admetta
it les fpcAaeics. Avantagea que Gcneve pourrqit retirer de
l'établiffcmciu d'un théâtre. Ipid- b. Autre confidération qui
devroit peut-être engager Geneve à permettre les fpcéUcle# ;
le préjugé contre la profefiion de comédien, eA une des principale*
caufcs qui contribue au dérèglement des gens de cet
état ; moyens que les Genevois pourroient employer pour
avoir une troupe de comédiens cAimablcs, 6c qui deviendroit
bientôt la meilleure de l'Europe. Le féiour de cette ville
deviendroit alors celui des plfufirs honnêtes, comme il cA
celui de la philofophle 6c de la liberté. L’exemple des çomè-
diens de Gcneve fervirolt de modèle k ceux des autres nations,
6c de leçon U ceu x qui les opt traités avec tant de rigueur
6c d'inconféquencc. Obfervations fur l’académie de G en ev e,
5 fur les différons corps de profefiion. Etat de la bibliothèque.
Le peuple de Geneve cA plus in/buit que par-tout ailleurs.
L'inoculation reçue dans cette ville. Ibid. 377. 1. g Avec
quel fuccés les fçiencc» 6c les arf* <)nt li» c«»»vés k Geneve,
Cette ville a eu l’avantage de pofféder des étrangers célèbres.
Etat de fa fabrique d'horlogerie. Soins qu’on y donne à 1 agriculture.
Ordre établi pour les incendies. Etat des hôpitaux ,
abondance des aumônes qu’ils recueillent 6c qu'ils diAribucnt.
D e la religion de Geneve. La conAitution cccléfiaAique y eA
purement presbytérienne. Les mtniArcs font ou paAcurs ou
poAulans. Leur revenu. Examen qu’ils fiibiffcntwvaiu d’être
admis au miniAcrc. Comment les funérailles fe font k Genev e.
Moeurs exemplaires du clergé. Ibid, b, DoArinc attribuée 4
pluficurs mini Are#. Ce qu'ils penfent du fupplicc de Servet.
Fafiagc de M. de Voltaire fur ce fujet. Eloge de la liberté de
«enfer établie dans Geneve. Doélrine de pluficurs miniAres
de Gcneve fur l'enfer. Pluficurs d'entr’citx rejettant tout ce
qu’on appelle myficre , s’imaginent que le premier principe
d’une religion véritable, cA de ne rien propofer k croire qui
heurte la raifon. Tolérance du clergé. Sa haine pour toute
fuperAition. On fe plaint moins à Geneve qu’ailleurs des progrès
de l’incrédulité. En quoi confiAe le cbrjAiarnfmc de
Geneve. Ibid. 378. 2. a. Le» ecclèfiaAiqucs renfermes uni-
fluetnent dans leurs f o u lo n s , donnent les premiers aux
citoyens, l’exemple de la foumiflion aux Jqix. Autorité du
ConfiAoirc. Réflexions fur l’extrême fimphcité du culte. Le
Zcrvicc divin renferme deuxehofes j la prédication et le chant ;
obfervations fur l’un & fur l'autre. L'être fuurême cA honoré
¿1 Gcneve avec une décence 6c un recueillement quon ne
remarque point dans nos églife». Conclufion de cet article.
Faute | corriger dan.cet article de l'Liicyclopidie.
S l‘Ü n ! a n c i e n n e . Suppl. IV. 11. a. Sel mie la France fournit
i cime ville. II. d i. a. Comment Ida ninragca fe donnent a
Gcneve dan» l'ileffion de» magiftrat». I V. 817. a. t e relie»
dont on fe fervit en tdo» pour Icfcalade de cette vdle. V.
* 18 a Origine du mot hugumut tiré de quelque, iytnemen»
Se l'iiiiloireae Geneve, VIII. m . a. L'inoculation introduite
& adoptée dan» G en e v e .,,« . *. 77«- “■ Autorué que Calvto
acquit dan» cette république. XL »74. a. O u lyodic» de
Gcneve XV, 7,0 . é, Tuolcite» remarqualile» que la ville
de Geneve poilede. 807. *. De l'ancien Vldomnat de Genève.
X VII. 247. b. Armes de Geneve : utres qnc différentes putff.
nce» donnent é cette république : vol. II. de. pl. Blafon ,
paa. 17. é. Parmi le» pièce, qui ont été écrite» à I ocçafum de
l'article Grnrv,, voyc» fur-tout la lettre de M. J. 1. Rouffeait
i M. d'Alembcrt, I le. fpcaaele., & l'ouvrage de M. le
profeifeur V ern et, intitulé 1 U tm t d m voyag.u, A u g k u .
G tN .v e , lac J e , (G lu g r .) n m LéMAN.
G EN EVIE VE. (S a in t .) Obforvation. fur cotte faime.
XI 11. é. Cliamlrre apoilolique de l'abbé de Stc-Genevievc.
¡ 11.47, b. Chancelier de i'églift de Stc-Gencv.cvo. 91 .a . pd. b.
' “ ciEN E VR E T TE , (P.cup. ruJHg.) vin de genievre, qiia-
Ilté» de cotte IroilTon. Comment on fait la genevrotte. VIL
, 7 GENEVRIER, ( P atau .) Caraflere» de ce genre de plante.
Lieux oh croit cet arbriffeau. On avoit autrefois confondu
fou. le même nom le. codre. 8c les genévrier». Quelque»
auteur», depui» la découverte de l'Amérique, B | M >
idana la mémo faute. L e . EfpagnoU confondca lc aonevnor
avec le evuré». Le» Angloi» appellent ccdrc» dè Virginie oc
de» Bcrmnde», le» genévrier» de cc paya-li: Defcription du
ccnevrier. Dciixefpcco» de genévrier» diAinguéoa de» autre»,
tcatncvricr commun, arbriffeau. Ch le geuev,ter commun o n t , lleve
où arbre. Leur defcription. VII. ,79, ». Deux ou le fécond
oft cultivé 1 réfuie qu’on en retire. Genévrier, à baie rougeâtre.
n oft commiin en Üngiiedoe. Huile de cade qu'on en,retire,
S i f d e ' f m l ' f e G r e w L ’ T V i r g b ! I fr des X r a W r r ! oPn
G E- N B23
gcncyxicf des Bcrmmlvs cA appcllé bois dt etdre. Vfiir
gcif qu’(>n fitit du hoi# de ces genévriers. Quel cA le feu)
emploi que nous ppuvons taire du bois de nos genévriers.
fbid. 380. a.
G e n e v r ie r , {B o t. Jardin.) noms de jccttc plante en différentes
langues. Saq çaraftete générique. Enumération de quatorze
cfpeces. Suppl. 111. 200.«. Lieux où elles croiffent. Leur
defcription, culture, qualités 6c ufages. Ibid. b. % fuiv .
Gtntvrier, elpcce de genévriers appcllês oxycedre, XI. 729.
a. 6c fabine. XIV. 460. b. fyc. Rapport de certain» genévriers
avec une efpccc de cyprès. Suppl. IL 670. a , b.
GENEVRIER , ( Chym. Mat. midic. ) huile efienticllc 6c
AifiAance réfineiife qui fe trouvent dans le genévrier. Huile
de cade qu'on retire du genévrier. Scs ufages dans les maladies
des beAiaux. Ufiige de cette huile çauAiquc dan» les maux
de dents. On ne peut la donner intérieurement fans témérité*
C e font les baies du petit genévrier qu’on emploie principalement
en médecine. Les Allemands les cmjdoicnt «t titre
d'affaifonnement. Maladies dans lcfquclles nous en faifon#
ufiige. VII. 380. a. Propriété» qu'on leur attribue. Manière d'en
ufer en qualité de remede. Ulagc de l’extrait ou rob de gc-
nievre. Propriété# de l’eau diAilIéc des baies de cette plante.
Vertus de l’cfitrit ardent qu’on retire par diAillation fin vin
de genievre. ufiige 6c propriété de l’huile cffcnticlle diflbute
dans l’efprit de vin/ Sel qu’on retire du marc de la préparation
du rob. Elixir de genievre, fe» propriété». Ratafia préparé par
i'infufion des baie# de genievre dans de l'cau-dc-viç. Onguent
pour la teigne fait avec les baies de genievre. Quelles font les
vertus les plus évidentes de cette plante. Obfervations fur
fon uiage. Ibid. b. Compofitions de fa pharmacopée de Pari# »
dans lciquellcs entrent les bajes de genievre, leur extrait. leur
huile, leur réfinc. On brûlé le bots de genievre pour chafler
le mauvais air. Ibid. 38t. a.:
Genévrier, réfute du genévrier nommée fandaraqUC. X IV .
6 \ o . a ,b . Baume de genievre. II. 163. é. Quclqucs-unspcnfcçt
qu’on pçut fiibfiituer, le bois de genevrier au faffafras., 49p.
b. Vin de genièvre,, voyez G en evue tte.
, GeMGHIS-CHAN , biAoire de fc# conquêtes. XV . 923.
a , b. Corps de Joix- qu’ils donna aux Tartarcs. XVIL 033./’.
Tolérance exercée par les princes de la maifon de Gcngliis-
chan. (6 4 . H. . ,
GEN COVX-LE-ROYA L, ( Géogr. ) Suppl. i y . 699. b.
GÉNI A L , f Hijl. anc. ) éplrhetc donné à quelques dteti^ qui
préfidoient k la génération'. Etym, de ce niot. Quels étoient
les dieux géniale». V IL 381. a.
GÉNIE . {Myrb- l 'u i .A n i iq .) La tradition la plus ancienne
8c la plus générale eA que le monde foit rempli de génies.
Cette opinion a finalement donné lieu .i l'introduction des
fé e s , des gnomes 6c des fy Iphcs. Opinion des anciens fur les
génies. VII. 381. a. L e s génies accordés k chaque particulier
ne [jotiiffoienr pas d’un pouvoir égal. O n penfoit qu'il y
avott un bon 6c un mauvais génie attaché à chaque pcrlonnc.
Poitrine de Servius fur ces génies particuliers. Les romains
appel loi en t junoru , les génies gardiens des femmes. Il y avoit
encore les génies propres de chaque lieu. Onadoroit ¿Rome
le génie tutélairc de l’empire. Hommage 6c culte rendu# au
génie des Céfar#. Sacrifices que chacun offroit k fon propre
génie le jour de fa naiflancc. Le platane étoit Spécialement
confacré a cette forte de divinité. Ibid. b. Diveries repréfen-
tafions qu’on faifoit des génies. A v ec le tems on vint à les
identifier. Ibid. 382.4. .
Génies, voyez Dénions. Réflexion de M. de Fontcncuc lut
leur cxiAencc. î. 493. a. Doftrinc des Chaldéens fur les génies.
III. a i. a. Des génies qui eurent commerce avec les
¡femmes. 423. b. Voycç Incubes. Ceux q u i, fous la figure
d’une femme , ont eu commerce avec les hommes, voyez
Succube. Comment la crainte introduifit les génie# maj-
faifans, 8c l’cfpàrancc les génies favorables. IV. ro y i. b.
Génie» particulier# des femmes, IX. 6 t . b. Gcmcs tutélairc#.
XVI. 761. a. Génie# bons 6c mauvais admis par les fauvages
d'Amorique. X. 48«- "• ü adori» |iar le» hablWM do
Lqango, «14. b„par le» Algonquin*. 41. a. Scmunem de Socratu
fur les ginic». XV . a« ,. *. Giiue deSocraïc, voyet 1 arnclc de
e e l ! t m Ph(PM o fip ir . IM r a r . ) lïrcndue de
force de l'imagination , 8i l’aSiviii de l'«me / vqil> le gime.
L'hommede ginic oft colin dontl'amein.ireffieàtout ce qut cil
dan. la naiurc , ne reçoit pa» une id ic , qu elle n éveille un
fcmlment. Il fe rappelle fe» idée» avec un feniment plu» v ,f
qu'il ne le» a reçue». Entouré de» objets dont il» occupe, il 11c
?c fouvient pa», il v o it , il cil ému. Dame fc plaît fouvem dan.
ce» affcillom momentanée» ; elle» lut donnent un platfir qui
lui oft précieux ; elle fe livre i tour cc qui peut 1 augmenter
. S» manière de peindre Ic.objel» qui vicnnentl agiter...
VII »8a. a. L’imagination prend des forme» différente., eue
le. emprunte de. différente» qualité, qui con(Utuéntle c .r .-
Ûcre de l'amc. Le génie n’efl pa» toiqour. génie,
foi» Il ert plu. aimable que fublimc ( qticlmicfôls danal homme
de génie fimag'.naf.on clt gaie. . . Le golli eft fouvent féparé