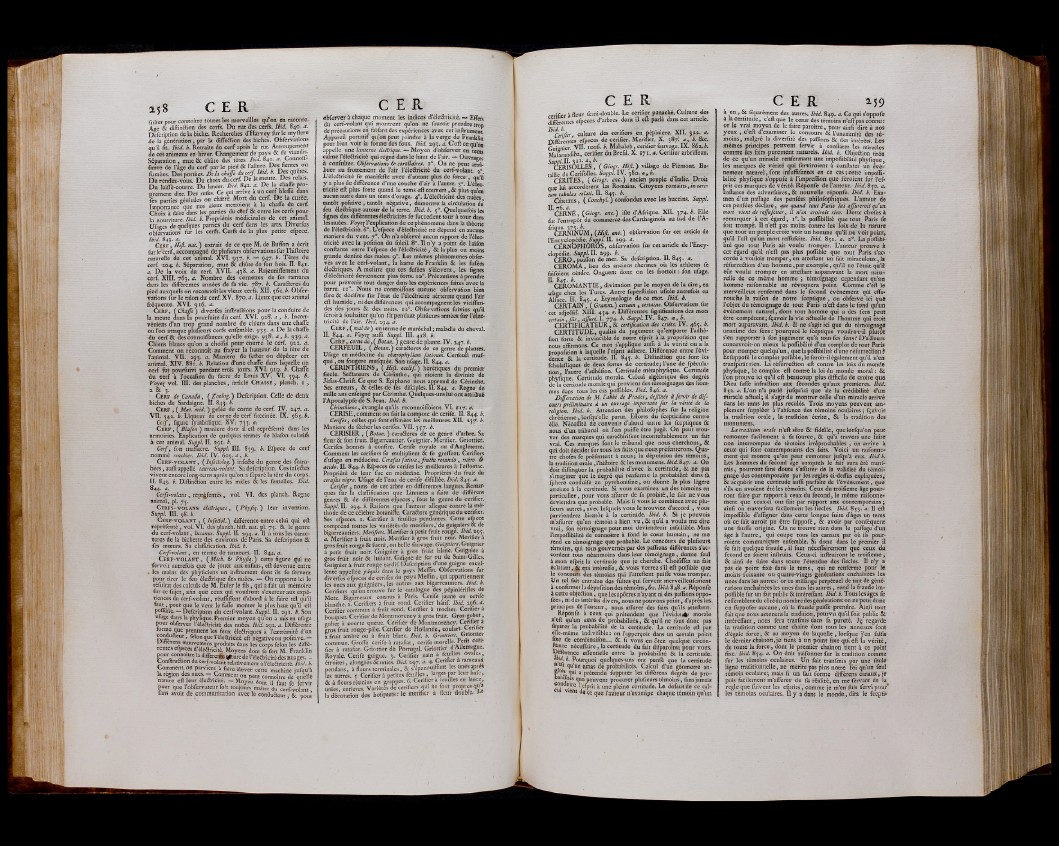
1 5 8 CER fulter pour connoître toutes les merveilles qu’on tfn raconte.
Age & diftinflion des cerfs. Du rut des cerfs. lbid. 840. a.
Defcription delà biche. Recherches d’Harvey fur Te myftere
de la génération, par la dîffeftion des biches. Obfervatîbns
qu’il nt. lbid. b. Retraite du cerf après le rut. Attroupement
de ces animaux en hiver. Changement de pays & de viandis.
Séparation, mue 8c chute des têtes, lbid. 041. a. Connoït-
fanee de l’âge du cerf par le pied & Des fientes^ ou
fumées. Des portées. Delà chaffe du cerf. lbid. b. Des quêtes.
Du rendez-vous. Du c h o ix d u ccri De h meute. Des rula.s.
Du hlffi-courre. Du lancer, lUd. U f t g De l îÆ S i g Ë t
prement dite. Des rufer. Ce qui arrive à un cerf bleffé dans
íes parties génitales ou charr*. Mort du çerf. De la curée.
r ■ - — aïeux Importance que nos _ mettoient a la chafle au cerf.
Choix à faire dans les parues du c€rf & entre les cerfs pour
la nourriture, lbid. b. Propriétés médicinales de cet animal.
Ufages de quelques parties du cerf dans les arts. Diverfes
obfervations fur les cerfs. Cerfs de la plus petite efpece.
Ibid. 843. a. . _
C e r f , Hiß. nat.) extrait de ce que M. de Buffon a écrit
furle cerf, accompagné de plufieurs obfervations fur l’hiftoire
jiaturelle de cet animal. XVI. 937. b. — 947. b. Têtes du
cerf. 204. b. Séparation, mue & chute de fon bois. II. 841.
a. De la voix du cerf XVII. 438. a. Rajeuniffement du
cêrf. Xin. 763. a. Nombre des cornettes de fes ramures
dans les différentes années de fa vie. 787. b. Carafteres du
pied auxquels on reconriôît' les vieux cerfs. XII. 561. b. Obfervations
fur le talon du cerf. XV. 870. a. Lieux que cet animal
fréquente. XVI. 916. a.
( J e r f , ( C baffe ) diverfes inftfu&ions pour là conduite de
là meine dans la pourfaite dü cerf. XVI. 928. a , b. Inconi-
véniens d’un trop grand nombre de chiens dans une chafle
ou l’on attaque plufieurs cerfs enièmble. 93 3. a. De lachaife
du cerf 8c descohnoiffarices qu’elle exige. 938. a, b. 939. à.
Chiens blancs qu’on a choifis pour courre le cerf. 92a. à.
Comment on feconnoîtau fraÿet la hauteur de la tête de
l’anirtial. VU. 173. a. Maniéré de feftér ou dépécer cét
animal. XlV. 881. b. Relation (fuiie chafle dans laquelle un
cerf fat pourfuîvi pendant tröis jouts. XVI. 919. p. Chafle
du cerf à l’ôccafidn du faefe de Louis XV. VI. 394. b.
Voyei vol. III. des planches, àrficlé Ch a s sé , planch. x ,
2 K 3. •
C e r f de Canadd, ( Zoolog. ) Defcription. Celle de deüx
biches de Sardaigne. II. 843. b.
C er f , ( Mat. méd. ) gelée de come de cerf. IV. 247. a.
VII. 542. b. Liqueur de corne de cérf fuccinée. IX.' 563. b.
Cerf, figure lyrtbolique. XV. 733. a.
C e r f , ( Blafon) maniéré dont ü eil repréfènté dans les
armoiries. Explication de quelques termes de blafdn relatifs
à cet animal. Suppl. ü. 291. b.
Cerf, fon inaflacre. Suppl. III. 839. b. Efpece de cerf
nommé rcnchicr. Ibid. IV. 003. a , b.
C erf-v o l a n t , ( lnfeilolog.) infeéte du genre des feara-
bées, aufli appelle taureau-volant. Sa defcription. Ces infeÎtes
vivent encore long-tems après qu’on a féparé la tête du corps.
II. 843. b. Diftinaion entre les mâles & les femelles, lbid.
844. a.
Cerft-volanS, repréfentés, vol. VI. des planch. Regne
animal, pl. 73. • •
C e r f s - v o la n s éleilriques, ( Pkyfq. ) leur invention.
Suppl. ni. 98. b.
C erf-v o l a n t , ( Infeflol. ) différence entre celui qui eft
repréfenté, vol. VI. des planch. hifl. nat. pl. 73. & le genre
du cerf-volant, lucartus. Suppl. II. 294. a. 11 a tous les caractères
de la bichette des environs de Paris. Sa defcription &
fes moeurs. Sa claflificatioii. Ibid. b.
Cerf-volant, en terme de tanneurs. II. 844. a.
C e r f - v o l a n t , (Mich. 6> Phyfiq.) cette figure qui ne
fervoit autrefois que de jouet auxenfans, eft devenue entre
. les mains dès phyficiens un infiniment dont ils fe fervent
pour tirer le feu éleftrique des liuêes. — On rapporte ici le
réfultat des calculs de M. Èuler le fils, qui à fait un mémoire
fur ce fujet, afin que ceux qui voudront s’exercer aux expériences
du cerf-volant, réufnflent d’abord à le faire tel qu’il
faut, pour que le vent le fafle monter le plus haut qu’il eft
poflible.— Defcription du cerf-volant. Suppl. II. 291. b. Son
ufage dans la phyiique. Premier moyen qu’on a mis en ufage
pour obferver 1 éleftricitè des nuées, lbid. 292. a. Différente
torme que prennent les feux éleélriques à l’extrémité d’un
TV«* CUr i ^on clue V¿leôricité eft négative ou pofitive. —
1 rem mouvemens produits dans les corps félon les différentes
efpeces déleftricité. Moyens dont fe fert M. Franklin
pour connoître la différent qffturc de l’élefaicité des nuages. -
Conftruction du cerf-volant relativement à l’êlearicité. lbid. b.
Comment, on parvient à fàltc élever cette machine jufqu’à
la région des nues. - Comment on peut connoître de quelle
nature eft leur éleancné. - Moyen dont il faut fe fetvir
pour que 1 obfervateur foit toujours maître du cerf-volant
fans avoir de communicadon avec le condu&cur, 8t pour
C E R
obferver à chaque moment les indices d’éle&ricitè. — Effets
du cerf-volant qui montrent qu’on- ne fauroit prendre trop
de précautions en faifantdes expériences avec cet infiniment
Appareil portatif qu’on peut joindre’ à la verge de Franklin
pour bien voir la forme' des feux. lbid. 293. a. C’eft ce qu’on
appelle une lanterne électrique. — Moyen d’obiérver en tems
calme l’éleftricité qui régné dans le haut de l’air. —- Ouvrages
à confulter. Obfervations & corôlldires. r°. On ne peut attribuer
au frottement de l’air l’éle&ricité du cerf-volant. 2“.
L’élcftricité fe manifefie avec d’autant plus de force , qu’il
y a plus de différence d’itne couche d’air à l’autre. 30. L’éleo-
tricité eft plus forte quand le tems eft couvert ,-& plus qu’en
aucun autre dans un tems d’orage. 40. L’éle&ricité aes nuées
tantôt pofitive , tantôt négative, démontre la circulation du
feu éleârique autour de la terre, lbid. b. 30. Quelquefois les
fignes des différentes éle&ricités fe fuccedent tour à tour dans
les nuées. Voye^ l’explication de ce phénomène dans la théorie
de l’éleâricité. 6°. L’efoece d’éle&ricité ne dépend en aucun»
maniéré du vent. 70. On n’a obfervé aucun rapport de l’électricité
avec la poiition du foleil. 8°. Il n’y a point de liaifon
confiante emre l’efpece de l’éleÔrieité, & la plus ou moins
grande denfité des nuées. o°. Les mêmes phénomènes obfer-
vés avec le cerf-volant, la barre de Franklin & les fufées
éleélriques. A mefure que ces fafées s’élèvent, les fignes
d’éleftricité deviennent plus forts. io°. Précautions à prendre
pour prévenir tout danger dans les expériences faites avec 1a
barre. ii° . Nous ne connoiffons aucune obfervation bien
iûre& décifive fur l’état de l’éle&ricité aérienne quand l’air
eft humide, ni des différences qui accompagnent les viciflitU-
des des jours & des nuits. 120. Obfervations futvies qu’il
feroità fouhaiter qu’on fît pendant plufieurs années far l’électricité
de l’air. lbid. 294. a.
Gerf , ( mal de ) en terme dé maréchal ; maladie du chevaL
H. 844. a. Voye{ aufli Suppl. III. 418. b.
Ge r f , corne de,(Botan. ) genre de plante. IV. 247. b.
CERFEUIL, ( Botan.) caraéteres de ce' genre de plantes.
Ufage eh médecine du chdtrpphyllutti fativum. Cerfeuil muf-
qué, ou fougere mufquée. Son ufage. II. 844. a.
CÉRINTHIENS, ( Hijl. tccléf.) hérétiques du premier
fiecle. Seélateurs de Cérinthe, qui nioient la divinité de
Jéfus-Chrift. Ge que S. Epiphane nous apprend de Cérinthe.
Ses erreurs, & celles de les difciples. II. 844. a. Regne de
mille ans ehfeigné par Cérinthe. Quelques-uns lui ont attribué
l’Apocàlypfe de S. Jean. lbid. b.
Cérinthiens, évangile qu’ils reconnoiffoient. VI. tiy. d<
CERISE, comment On fait la compote de cerife. II. 844. b.
Cerifes, celles qui font ôfiimées les meilleures. XII. 237. b.
Maniéré de fécher les cerifes. VII. 337. b.
CERISIER , (Botan.) caraéteres de ce gerire d’arbre. Sa
fleur & fon fruit. Bigarreautier. Guignier. Merifier. Griottiei*.
Cerifes bonnes à confire. Cerife royale ou d’Angleterre.
Comment les cerifiers fe multiplient & fe greffent. Ccrifiers
d’ufage Cn médecine. Cerafus fativa, fruElu rotundo, nibtô &
acido. II. 844. b. Efpeces de cerife9 les meilleures à l’eftoihac.
Propriété de leur fuc en médecine. Propriétés du fruit dü
cerafus nigra. Ufage dé l’eau de cerife difiillée. lbid, 843. a.
Cerifier, noms de cet ütbre en différentes langues. Remarques
fur la claflification que Linn&us a faite de différens
genres & de différentes efpeces, fous le genre du cerifier.
Suppl. IL 294. b. Raifons que l’auteur allégué contre la. mé*-
thode de ce célébré botaniite. Caraétere générique du cerifier.
Ses eipeces. 1. Cerifier à feuilles pendantes. Cette efpece
comprend toutes’les variétés de merifiers,’ de guigniers & de
bigarreautiers. Merifiers. Merifier à petit fruit rouge. lbid. 19 3.
a. Merifier à fruit noir. Merifier à gros fruit noir. Merifier à
gros fruit rouge & fucré, ou belle fauvage. Guigniers. Guignier
à petit fruit noir. Guignier à gros fruit blanc. Guignier à
gros fruit ndir & luifant. Guigne de fer ou de Saint-Gilles.
Guignier à fruit roüge tardif. Defcription d’une guigne excellente
appellée pâquïs dans le pays Meflïn. Obiervations fur
diverfes efpeces de-cerifes du pays Meflïn, qui appartiennent
les unes aux guigniers, les autres aux bigarreautiers. lbid. b.
Cerifiers qu’on trouve fur le catalogue des pépiniériftes de
Metz. Bigarreaux connus à Paris. Cerifé jaune oü cerife
blanche. 2. Cerifiers à fruit rond. Cerifier hâtif. lbid. 296. d.
Cerifier commun à fruit rond. Cerifier à trochet. Cerifier à
bouquet. Cerifier de Montmorency à gros fruit. GroS-gobet,
gobe; à courte queue. Cerifier aé Montmoreftçy. Cerifier â
gros fruit rouge-pâle. Cerifier dé Hollande, eôufart. Cerifier
à fruit ambré ou à fruit blanc. lbid. b. Grioltiers. Gtiottlet
commun. Grofle cerife à ratafiat, cerife morelle. Petit certifier
à ratafiat. Griottier de Portugal. Griottiei* a Allemagne.
Royale. Cerife guigne. 3. Cerifier nain à /euill« avales,
étroites, alongées 8c unies. lbid. 297. a. 4- Cerifier a rameaiut
pendans, à fleurs terminales, & s’épanouiflant les unes après
les autres. 5. Cerifier à petites feuilles , laWS par leur kafe,.
& à fleurs réunies en grappes; 6 Cenfier il tcu.lles elt lante.
unies, entières. Variétfs tfe cerifiers qui ne font M M M M
la décoration des bofquets: le menficr à fleür doitMe, »
C E R C E R *59
•fier à fleur femi-donble. Le cerifier panaché. Culture des
différentes efpeces d’arbres dont il eft parlé dans cet article.
^ Cerifier, culture des cerifiers en pépinière. XII. 322. a*
Différentes efpeces de cerifier. Merifier. X. 387Î * , b. 6cc.
Guignier. VII. 1006. b. Mahaleb * cerifier fauvage. IX. 862. b.
Mafarandiba, cerifier duBrefil. X. X71. a. Cerifier arbrifleau.
^^ERIsàLLES, ( Géogr. Hift. ) village de Piémont Bataille
de Cerifolles. Suppl. IV. 380. a , b.
CÉRITES » ( Géogr. anc. ) ancien peuple d Italie. Droit
que lui accordèrent Iss Romains. Gtoyens romains, ïn ctri-
tum tabulas relati. II. 845. b. .
Cér it e s , ( Conchyl. ) confondus avec les buccins. Suppl.
L&RN É , ( Giogr. anc. ) ifle d’Afrique. XII. 374. b. Elle
fut l’entrepôt du commerce des Carthaginois au fud de l’A -
anc. ) obfervation fur cet article de
l’Encyclopédie. Suppl. II. 299. a.
CERNOPHOROS, obfervauon fur cet article de 1 Encyclopédie.
Suppl. II. 299. b.
CERO,poiffon de mer. Sa defcription. 11. 843. a.
CEROMA, lieu des anciens thermes où les athletes fe
faifoient oindre. Onguent dont on les frottoit : fon ufage.
& C8E4R5-O MANTIE, divi. nan. on par ,l e moyen d. e l, a a.r e , en
ufage chez les Turcs. Autre fuperftition ufitée autrefois en
Alface. U. 843. a. Etymologie de ce mot. lbid. b.
CERTAIN, (Gramm.) certain , certaine. Obfervations fur
cet adjeélif. XIII. 434. a. Différentes lignifications des mots
certain, fur, ajjure. I. 774. b. Suppl. IV. 847. «*, b.
CERTIFICATEUR, & certification des criées. IV. 463. b.
CERTITUDE, qualité du jugement qu’emporte l’adhé-
fion forte & invincible de notre efprit à la propofition que
nous affirmons. Ce mot s’applique aufli à la vérité ou à la
propofition à laquelle l’eforit adhéré. Différence entre l’évidence
& la certitude. II. 843. b. Diftinfrion que font les
fcholafliques de deux fortes de certitude; l’une de fpécula*
tion, l’autre d’adhéfion. Certitude métaphyfique. Certitude
phyfique. Certitude morale. Calcul algébrique des degrés
de la certitude morale qui provient des témoignages des hommes
daps tous les cas poflibles. lbid. 846. a.
Dijfertation de M. l’abbé de Pradest defiinée à fervir de dïf-
cours préliminaire à un ouvrage important fur la vérité de la
religion, lbid. b. Attention des philofophes fur la religion
chrétienne, lorfqu’elle parut. Efforts du fcepdcifme contre
elle. Néceflité de convenir d’abord entre les feeptiques &
nous d’un tribunal où l’on puiffe être jugé. On peut trouver
des marques qui caraélérifent inconteuablement un fait
vrai. Ces marques font le tribunal que nous cherchons, &
qui doit décider fur tous les faits que nous préfenterons. Quatre
chofes fe présentent à nous; la dépolition des témoins,
la tradition orale ,1’hiftoire & les monumens. lbid. 847. a. On
doit diflitiguer la probabilité d’avec la Certitude , Ôc ne pas
s’imaginer que le degré qui renferme la probabilité dans fa
fphere conauife au pyrrhonifme, ou donne la plus légère
atteinte à la certitude. Si vous examinez un des témoins en
particulier, pour vous aflùrer de fa probité, le fait ne vous
deviendra que probable. Mais fi vous le combinez avec plufieurs
autres, avec lefquels vous le trouviez d’accord , vous
parviendrez bientôt à la certitude. lbid. b. Si je pouvois
m’aflurer qu’un témoin a bien v u , & qu’il a voulu me dire
vrai, fon témoignage pour moi deviendroit infaillible. Mais
l’impoflibilitè de connoître à fond le coeur humain, ne me
rend ce témoignage que probable. Le concours de plufieurs
témoins, qui tous gouvernés par des pallions différentes s’accordent
tous néanmoins dans leur témoignage, donne feul
à mon efprit la cettitude que je cherche. CnoifiiTez un fait
éclatant, & qui intérefle, & vous verrez s’il efl poflible que
le concours des témoins qui l’atteflent puiffe vous tromper.
Un tel fait entraîne des fuites qui fervent merveilleufcment
à confirmer la dépofition des témoins, lbid. 848. a. Réponfe
à cette objc&ion, que les apôtres n’ayant ni des pallions oppo-
fées, ni des intérêts divers, nous ne pouvons point, d’après les
principes de l'auteur, nous aflùrer des fûts qu’ils attellent.
Réponfe à ceux qui prétendent que l’évidei^ morale
n’eft qu’un amas de probabilités, & qu’il ne faut donc pas
féparer la probabilité de la certitude. La certitude eft par
elle-même indivifible : on l’apperçoit dans un certain point
™c dë combinaifon.... & fi vous en ôtez quelque dreon-
«swe nécelfaire, la certitude du fait dilparoitta pour vous.
Uroêrence eflentiellc entre la probabilité fie la certitude.
>Lab' ^our9uoi quelques-uns ont penfé que la certitude
> qu’un amas de probabilités. Calcul d’un géometre an-
f T*'1 a Pritcndu ^'PPuier ^es différens degrés de pro-
üaoiütés que peuvent procurer plufieurs témoins, fans jamais
~ Fciprit à une pleine certitude. Le défaut de ce cal-
vient de ce que l’auteur n’examijie chaque témoin qu’un
a un, & feparément des autres, lbid. 849. a. Ce qui s’oppofe
a la certitude, c’ell que le coeur des témoins n’eft pas connu :
or le vrai moyen de le faire paraître, pour ainli dire à nos
yeux , c eft d examiner le concours 8c l’unanimité des témoins
, malgré la diverfité des pallions 8c des intérêts. Les
mêmes principes peuvent fervir à conftater les miracles
comme les faits purement naturels, lbid. b. Objeftion tirée
de ce qu’un miracle renfermant une impoflibilité phyfique,
les marques de vérité qui lèrviroient à conftater un événement
naturel, font infuffifantes en ce cas;-cette impoffi-
bilité phyfique s’oppofe à l’impreflion que feraient fur l’ef*
f rit ces marques de vérité. Réponfe de l ’auteur. lbid. 830. a.
nftance des adverfaires, 8c nouvelle réponfe. lbid. b. Examen
d’un paflage des penfées philofophiques. L’auteur de
ces penfées déclare, que quand tout Paris lui affureroit qu’un
mort vient de reffufeiter, il n’en croiroit rien. Deux chofes à
remarquer à cet égard, i°. la poflibilité que tout Paris fe
foit trompé. Il n’eft pas moins contre les loix de la nature
que tout un peuple croie voir un homme qu’il ne vbit point,
qu’il l’eft qu’un mort reflùfcite. lbid. 851. a. 20. La poflibi-
lité que tout Paris ait voulu tromper. L’auteur prouve à
cet égard qu’il n’eft pas plus poflible que tout Paris s’accorde
à vouloir tromper, en atteflant un fait miraculeux, la
réfurreâion d’un- homme, par exemple, qu’il ne l’étoit qu’il
eut voulu tromper en atteflant auparavant la mort nam-*
relie de ce même homme ; témoignage cependant qa’nn
homme raifonnable ne révoquera point. Comme c’eft le
merveilleux renfermé dans le fécond événement qiii effarouche
la raiibii de notre feeptique, on obferve ici que
l’objet du témoignage de tout Paris n’eft dans le fond qu un
événement naturel, dont tout homme qui a des fens peut
être compétent ; fçavoir la' vie aéluelle de l’homme qui ¿toit
mort auparavant. Ibid.b. Il ne s’agit ici que du témoignage
unanime des fens : pourquoi le feeptique voudra-t-il plutôt
s’en rapporter à fon jugement qu’à tous fes ifens? D ’ailleurs
concevrait-on mieux la poflibilité d’un complot de tout Paris
pour tromper quelqu’un, que la poflibilité d’une réfurreélion ?
Et fuppofé le complot pollinie, le ferait-il également qu’il n’en
tranipirât rien. La réfurreélion eft contre les loix du monde
phyfique, le complot eft contre la loi du monde moral : 8c
l’on prouve ici qu’il eft beaucoup plus difficile de croire que
Dieu fafle infraction aux fécondés qu’aux premières. lbid.
832. a. L’on n’a parlé jufqu’ici que de la crédibilité d’un
miracle aéluel; il s’agit de nlontrer celle d’un miracle arrivé
dans les tems les plus reculés. Trois moyens peuvent amplement
fuppléer à l’abfence des témoins oculaires ; fçaVoir
la tradition orale, la tradition' écrite, & la tradition des
monumens.
La tradition orale n’eil sûre 8c fidelle, quelorfqu’on peut
remonter facilement à fa fource, & qu’à travers une fuite
non interrompue de témoins irréprochables , on arrive à
ceux qui font contemporains des faits. Voici un raifonne-
rnent qui montre qu’on peut remonter jufqu’à eux. lbid b.
Les hommes du fécond âge auxquels le fait aura été transmis
, pourront fans doute S’aflùrer de la validité du témoignage
des contemporains par les réglés ci-deflùs expliquées,
& acquérir une certitude aufli parfaite de l’événement, que
s’ils en- avoient été les témoins. Ceux du troifieme âge pourront
faire par rapport à ceux du fécond, le même raisonnement
que ceux-ci ont fait par rapport aux contemporains ;
ainfi 011 traverSera facilement les fiecles. lbid. 833. a. Il eft
impoffible d’affigner dans cette longue faite d’âges un tems
où ce fait aurait pu être fuppofé, oc avoir par conféquent
une fauffe origine. O11 ne trouve rien dans le paifage d’un
âge à l’autre, qui coupe tous les canaux par où ils pourraient
communiquer enfemble. Si donc dans le premier il
fe fût quelque fraude, il faut néceffûrement que ceux du
fécond en foient inftruits. Ceux-ci inftruiront le troifteme,
8c ainfi de fuite dans toute l’étendue des fiecles. Il n’y a
pas de point fixe dans le tems, qui ne renferme pour le
moins foixante ou quatre-vingts générations enchûnées les
unes dans les autres: or ce mélange perpétuel de tant de générations
enchûnées les unes dans les autres, rend la fraude im-
pofliblc fur un fait public 8c intéreflant. lbid. b. Tous les âges fe
reflemblentdu côté du nombre des générations: on ne peut donc
en fuppofer aucune, où la fraude puifle prendre. Ainfi tout
fait que nous amènera la tradition, pourvu qu’il foit public 8t
intéreflant, nous fera tranfmis dans fa pureté. Jç regarde
la tradition comme une chaîne dont tous les anneaux font
d’égale force, 8c au moyen de laquelle, lorfque j’en faifis
le dernier chûnon,je tiens à un point fixe qui eft la vérité,
de toute la force, dônt le premier chaînon tient à ce point
fixe. lbid. 834. a. On doit raifonner fur la tradition comme
fur les témoins oculûres. Un fût tranfmis par une feule'
ligne traditionnelle, ne mérite pas plus notre foi qu’un feul
témoin oculaire; mûs fi un fait forme différens canaux, je
puis facilement m’aflùrer de fa réûité,en meférvant de la
réglé que fuivent les eforits, comme je m’en fuis fervi pour*
les témoins oculûres. 11 y a dans le monde, dira le feepri**