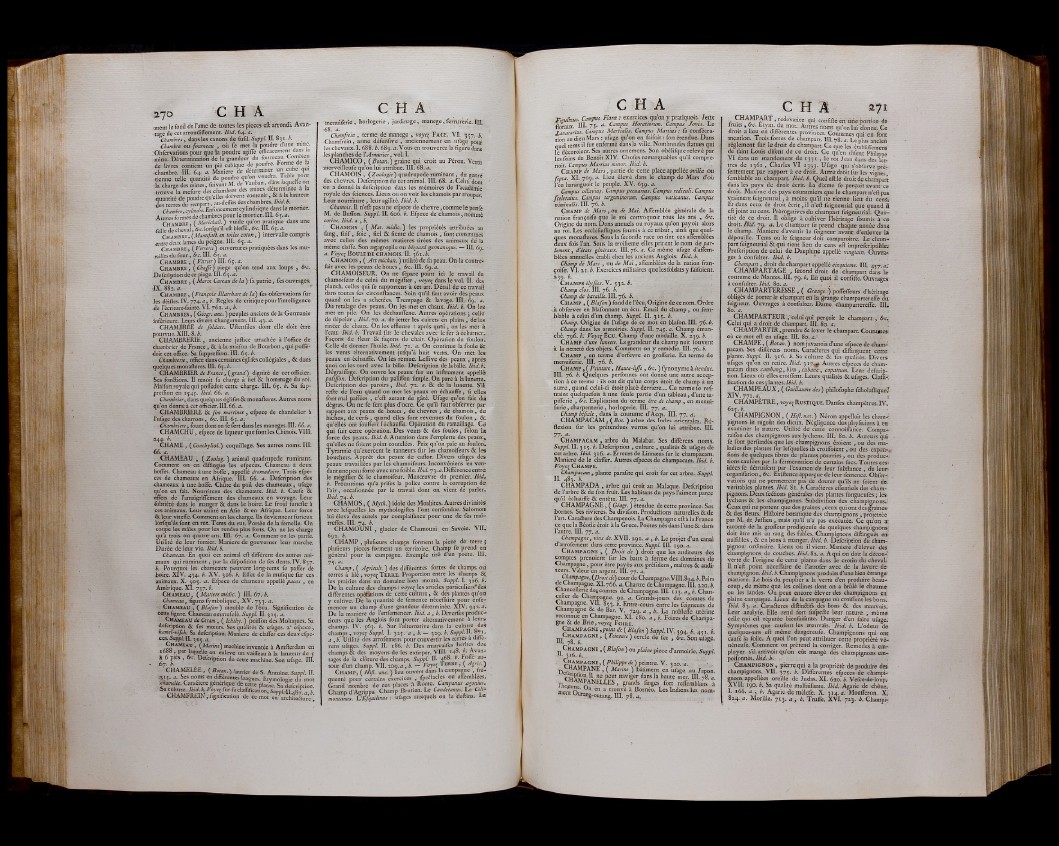
.2.7 o C H A
«ment le fond de l’ahiede toutes les pièces eft afrondi. Avantage
de cet arrondiffement. Ibid. 64. a.
Chambres, dans les canons de fuÎil. Suppl. II. 831 -b.
Chambre ou fourneau , -où fe met-la poudre d’une mine.
Obfervations pour que la poudre agifle efficacement dans ia
mine. Détermination de la grandeur du fourneau,■ t-oni jeu
de livres contient un pié cubique de poudre, Forme
chambre. III. 64. 1 Maniéré de déterminer un cube qm
tienne telle quantité de poudre qu<an,v»“
la charge des mines, fuivan. M. de Vanta., dans laquelle on
trouve la mefure des chambres des mines déterminée b la
quantité de poudre qu'elles doivent eontentr & a la hautetn
des terres du rempart, au-deffiis des chambres. g »
Chambre, cylindre. Enfoncement cylindrique dans le mortier.
Auirés formes de chambres pour le mortier. III. 6 5. a.
C h a m b r e , (Maréchall. ) vuide qu on pratique dans une
d'elle de cheval, &c. lorfqu’il eft bleffé, &c. III. 63. a.
C h a m b r e , (ManufaS.en toiles coton , ) intervalle compris
entre deux lames du peigne. III. 63. a.
C h a m b r e , ( Verrerie) ouvertures pratiquées dans les murailles
du four, &c. III. 6<. a.
C hambre , l Vitrier) III. 63. a.
C h ambre, ( Chajfe) piege qu’on tend aux loups , &c. ,
Defçription de ce piege. III. 65. a.
C hambre , ( Marin 'Cureau de la ) fa patrie , fes ouvrages:
IX. 88a. ;
CHAMBRE, ( François Illarrhart de la) fes obfervations fur
les déifies. IV. 774. «*, b. Réglés de critique pour l’intelligence
rie l’écriture-fainte. VI. 762. a,b.
C hambres , ( Geogr. anc. ) peuples anciens de la Germanie
inférieure. Leurs divers changemens. III, 43. a.
CHAMBRÉE de foldats. Uftenfdes dont elle doit être
pourvue. XIII. 8. b.
CHAMBRERIE , ancienne juftice attachée a l’office de
chambrier de France, & à-la maifon de Bourbon, qui poffé1
doit cet office. Sa fuppreffion. III. 65. b.
Chambrerie, office dans certaines églifes collégiales , & dans
quelques monafteres.lll. 65. b.
CHAMBRIER de France ; ( grand) dignité de cet officier.
Ses fondions. Il tenoit fa charge à fief & hommage du roi.
Mâifon royale qui pôffédoit cette charge. III. 65, b. Sa fuppreffion
en.1343. Ibid. 66. a.
Chambrier, dans quelques églifes & monafteres. Autres noms
qu’on donne à cet officier. III. 66. a. .
CHAMBRIERE & fon martinet, efpece de chandelier à
l’ufage des charrons, &c. III. 65. a.
Chambriere, fouet dont on fe fert dans les maneges.IIL 66. à.
CHAMCHU, efpece de liqueur que font les Chinois. VIII.
A44. b. '
CH AME , ( ConchylioU) coquillage. Ses autres noms. III.
46. a.
CHAMEAU , ( Zoolog. ) animal quadrupède, ruminant.
Comment on en diftingue les efpeces. Chameau à deux
boffes. Chameau à une bofTe, appelle dromadaire. Trois efpe-
ces1 de chameaux en Afrique. III. 66. a. Defçription des
chameaux à une boffe. Chute du poil des chameaux, ufage
qu’on en fait. Nourriture des chameaux. Ibid. b. Caufe &.
effets de l’amaigriffcment des chameaux en voyage. Leur
fobriété dans le manger & dans le boire. Le froid funefte à
ces animaux. Leur utilité en Afie & en Afrique. Leur force
ritleur vîteffe. Comment on les charge. Us deviennent furieux
lorfqu’ilsfont en rut. Tems du rut. Portée de la femelle. On
coupe les mâles pour les rendre plus forts. On ne les charge
qu’à trois ou quatre-ans. III. 67. a. Comment on les panlè.
Utilité de leur fumier. Maniéré de gouverner leur marche.
Durée de leur vie. Ibid. b.
Chameau. En quoi cet animal eft différent des autres animaux
qui ruminent, par la difpofition de fes dents. IV. 837.
b. Pourquoi les chameaux peuvent long-tems fe paffer de
boire. XIV. 434. b. XV. 300. b. Effet de la mufique fur ces
animaux. X. 903. a. Efpece.de chameau appellé pacos , en
Amérique. XI. 7.37. b.
C hameau , ( Matière midic. ) III. 67.'' b.
. Chameau, figurofymbolique, XV. 733. a.
C hameau., ( Blafon ) meuble de l’écu. Signification de
cette figure. Chameau emmufelé. Suppl. II. 315 .a.
C hameau de Ceram ? ( Ichihy. ) poilfon des Moluques. Sa
defçription 8c fes moeurs. Ses qualités & ufages. 2e efpece,
kamel-vifch.Sz defçription. Manière de claffer ces deux efpeces.
SuppkU. 3-1 «. a..
Chameau , (Marine) machine inventée à Amfterdam en
.16»», par laquelle on enleve un vaiffeau à la hauteur de 3
¿y J- ï DefcriPti°n de cette machine. Son ufage. III.
CHAMELÉE , ( Botan. | laurier de S. Antoine. Suppl. II.
M % no“ s en dtfférentes langues. Etymologie du mot
¡ p p Caraflerc genenque de c«re pUiie. Sa defcripiion.
i jcultiire. Ibid. b,Voyeç fur fa claffification, SupplA\ i b
CHAMFREIN ,iignification de ce mot en archfteaure
C H A
Wenuiferie , horlogerie, jardinage, manege, ferrurerie. IH;
'68. a.
Chamfrein , terme, de manege , voye^ F ace. VL 337. b.
•Chamfrein, arme défenfive', anciennement en .ufage pour
les chevaux. 1 .688. b. 689. a. Vous en trouverez la figure dan»
■les planches de Y Armurier, vol.I.
CHAMICO, (Botan.) graine qui croit au Pérou. Vertu
merveilleufe qu’on lui attribue. III. 68. a.
CHAMOIS , (Zoologie) quadrupède ruminant, du genre
des chevres. Defçription de cet animal. III. 68. a. Cèlui dont
on a donné la defçription dans les mémoires de l’académie
royale des fciences. Lieux où on voit les chamois par troupes.
Leur nourriture, leur agilité. Ibid. b.
Chamois. Il n’eft pas une efpece de chevre,comme le penfe
M. de Buffon. Suppl. II. 606. b. Efpece de chamois, nommé
corine. Ibid. a , b.
C hamois , (Mat. médic.) les propriétés attribuées au
fang, fuif, foie , fiel & fiente de chamois, font communes
avec celles des mêmes matières tirées dés animaux dé la
même claffe. Son ægagropile ou bé^oard germanique. — III. 69. •
a. Voye{ BOULE DE CHAMOIS. II. 361. b.
C hamois , ( Art méchan. ) utilité de fa peau. On la contrefait
avec les peaux de boucs, &c. III. 69. a.
CHAMOISEUR. On ne fépare point ici le travail du
chamoifeur de celui du mégiffier, voye^ dans le vol. II. des
planch. celles qui fe rapportent à cet art. Détail de ce travail
dans toutes fes circonftances. Soin qu’il faut avoir dès peaux
quand on les a achetées. Trempage & lavage. III.' 69. a.
Du retalage des peaux. On les met en chaux. Ibid. b. On les
met en pue. On les déchauffene. Autres opérations ; celle
de dépeler, Ibid. 70. a. de jetter les cuirets en plains, de les
rincer de chaux. On les effleure : après quoi, on'les met à
l’eau: Ibid. b. Travail fur le chevalet avec lefer àécharner.
Façons de fleur & façons de chair. Opératioh du foulon.
Celle de donner l’huile. Ibid. 71. a. On continue la foule &
les vents alternativement jufqu’à huit vents. On met les
peaux en échauffe. On les remue. Leffive des peaux, après
Îuoi on les tord avec la bille. Defçription de la bille. Ibid.b.
)égraifTage. On ouvre les peaux fur un infiniment appellé
Eali (fon. Defçription du paliffon fimple.On pare à la lunette.
)efcription des paroirs, Ibid. 72. a. & de la lunette. S’il
refte de l’eau quand on met les peaux en échauffe, fi elles
font mal paffées , c’cft autant .de gâté. Ufage qu’on fait du
dégras.- On ne fe fert plus d’ocre. Ce qu’il faut obfervèr par
rapport aux peaux de,boucs, de chevres, de chamois, rie
biches, de cerfs, quand elles font revenues du foulon, &
qu’elles ont fouffert l’échauffe. Opération du ramaillage. Ce
qui fuit cètte opération. Des vents & des foules, félon la
force des peaux. Ibid. b. Attention dans l’emplette des peaux,
Îu’elles ne foient point coutelées. Prix qu’on paie au foulon,
ÿrannie qu’exercent le tanneurs fur les chamoifeurs & les
bouchers. Apprêt des peaux de caftor. Divers ufages des
peaux travaillées par les chamoifeurs. Inconvéniens ’en ven*
dant une peau forte avec une foible. Ibid. 73. c.Différence entre
le mégiffier & le chamoifeur. Manoeuvre du premier. Ibid.
b. Précautions qu’a prifes la police contre la corruption de
l’air, occafionnee par le travail dont on vient de parler.
Ibid. 74. b.
CHAMOS, ( Myth.) idole des Moabites. Autres divinités
avec lefquelles les mythologiftes l’ont confondue. Salomon
lui éleva des autels par complaifance pour une de les mai-,
treffes. III. 74. b.
CHAMOUNI , glacier de Chamouni en Savoie. VII.’
‘ 692. b.
'CHAMP , plufieurs champs forment la piecé de -terre ;
plufieurs pièces forment un territoire, Champ fe prend en
général pour la campagne. Exemple tiré d’un poète. III.
75. a.
Champ, ( Agricult. ) des différentes fortes de champs ou
terres à blé, voye^ T erre. Proportion entre les champs &
les prairies dans un domaine bien monté. Suppl. I. 326. b.
De la culture des champs : voye^ les articles particuliers* des
différentes opérions de cette culture, & des plantes qu’ori
y cultive. De la quantité de femence néceffairè pour enfe-
mencer un champ d’une grandeur déterminée. XIV. 942. a'.
De la maniéré de l’enfemencer. Ibid. a, b. Diverfes productions
que les Anglois font porter alternativement à leurs
champs. IV. 563. bf Sur l’alternative dans la culture des
champs , yoye% Suppl. I. 325. a , b.— 329. b. Suppl.IL 871*
a , b'. Utilité des arrofemens pour convertir les terres à diffé-
rens ufages. Suppl. II. 186. b: Des mauvaifes herbes des
champs oc des moyens de les extirper. VIII. ||||||p " van"
tages de la clôture des champs. Suppl. II- H
tour d’un champ. VII. 209. a , b. — Voye{ T erre , ( Agnc. )
C h am p , ( Hift. anc. ) Heu ouvert dans la campagne ,fré-
quenté pour certains exercices , fpeflacles ou aflemblées.
Grand nombre de ces places M M W M M h
Champ d’Agrippa. Champ Brnrien. Le CcuJcunus. Le CcU-
montanus. Mfamünus : ufages auxquels on le delhna. M
C H A
Bitnilhuis. Campus Flores: exercices qu’on y pratiquoit.-Jeûx
floraux. III. 7Ç. a. Campus Horatiorum. Campus Jovis. Le
Lanatarius. Campus Martialis. Campus Martius : fa consécration
au dieu Mars : ufage qu’on en fàifoit : fon étendue. Dans
quel tems il fut enfermé dans la ville. Nombreufes ftatues qui
le décoroienr. Ses autres ornemens. Son obélifque relevé par
les foins de Benoît XIV. Chofes remarquables qu’il compre-
noit. Campus Martius minor. Ibid. b.
C hamp de Mars, partie de cette place appellée ovilia ou
fepta. XI. 709. a. Lieu élevé dans le champ de Mars d’où
l’on haranguoit le peuple. XV. 639. a.
Campus oflavius. Campus pecuarius. Campus rediculi. Campus
.feeleratus. Campus tergeminorum. Campus vaticanus. Campus
viminalis. III. 76. b.
C hamp de Mars, ou de Mai. AfTemblée générale de la
nation françoife gue le roi convoquoit tous les ans , &ç.
Origine du nom. Dons annuels ou royaux qu’on payoit alors
au roi. Les eccléfiaftiques fournis à ce tribut, ainfi que quelques
monafteres. Sous la fecônde race on tint ces aflemblées
deux fois l’an. Sous la troifieme elles prirent le nom de parlement
, d’états généraux. III. 76. a. Ce même ufage d’ailem-
blées annuelles étabU chez les anciens Anglois. Ibid. b.
Champ de Mars , oxi de Mai, afTemblées de la nation françoife.
VI. 21. b. Exercices militaires que les foldats y faifoient.
239- b-
C hamps élyfées. V . 532. b.
Champ clos. III. 76. b.
■Champ de bataille. III. 76. b.
Champ , ( Blafon) fond de l’écu. Origine de ce nom. Ordre
sà obferver en blafonnant un écu. Émail du champ, oufem-
blable à celui d’un, champ. Suppl. II. 315. b.
Champ. Origine de l’ufage de ce mot en blafon. III. 76. b.
Champ dans les armoiries. Suppl. II. 745. a. Champ éman-
ché. 796. Voyer Écu. Champ d’une médaille. X. 239. b.
C h amp d’une lunette. La grandeur du, champ nuit louvent
à la netteté des objets. Comment on y remédie. III. 76. b.
Champ , en terme d’orfevre en grofferie. En terme de
menuiferie. m . 76. b.
Champ , ( Peinture , Haute-lijfe , &c. ) fynonyme à étendue.
III. 76. b. Quelques perfonnes ont donné une autre acception
à ce terme : ils ont dit qü’un corps étoit de champ à un
autre, quand celui-ci étoit placé derrière.... Ce terme le refi-
traint quelquefois à une feule partie d’un tableau, d’une ta-
piflerie , &c. Explication du terme être de champ , en menuiferie,
charpenterie , horlogerie. III. 77. a.
Champ béftale, dans la coutume d’Acqs. III. 77. a.
CHAMPACAM, ( Bot. ) arbre des Indes orientales. Réflexion
fur les prétendues vertus qu’on lui attribue. III.
.77- a‘
Champacam , arbre du Malabar. Ses différens noms.
Suppl. II. 313. bi Defçription , culture , qualités & ufages de
cet arbre. Ibid. 316. a. Erreurs de Linnæus fur le champacam.
Maniéré de le claffer. Autres efpeces de champacam. Ibid. b.
Voyei Champe.
II ^ ^ né>a^am » plante parafite qui croît fur cet arbre, Suppl.
CHÂMPADA , arbre qui croît au Malaque. Defçription
de l’arbre & de fon fruit. Les habitans du pays l’aiment parce
qu’il échauffe & entête. III. 77. a.
CHAMPAGNE, (Géogr. ) étendue de cette province. Ses
bornes. Ses rivieres. Sa divifion. Produirions naturelles & de
l’art. Caraâere des Champenois. La Champagne eft à la France
ce que la Béotie étoit à la Grece. Poètes nés dans l’une & daifs
l’autre. III. 77. a.
Champagne, vins de. XVII. 291. a , b. Le projet d’un canal
d’arrofement dans cette province. Suppl. III. 190. a.
C hampagne , ( Droit de ), droit que les auditeurs des
comptes prenoient fur les baux à ferme des domaines dç
Champagne, pour être payés aux préfidens, maîtres & auditeurs.
Valeur en argent. III. 77. a.
Champagne, (Droit de) cour de Champagne. VIII.894. b. Pairs
/^L i|Pa5ne. 7^°-a- Chartre de Champagne. III. 220. b.
Chancellerie de* comtes de Champagne. III. 113 ,a , b. Chancelier
de Champagne. 92. a. Grands-jours des comtes de
Champagne. VII 853. b. Entre-cours entre les feigneurs de
Champagne & de Bar. V. 729. a , b. La noblene utérine
reconnue en Champagne. XI. 180. a , b. Foires de Champagne
oc de Brie, voye^ Foire. ’ ■
C hampagne ,point de ( Blafon ) Suppl. IV. 394. b. 4n . b.
I^MAMPACNE, (Teinture) cercle de fer , èTSon lîfage.
ÏI ^” gM^AGNE *^Blaf on ) ou plaine piece d’armoirie. Suppl.
CAMPAGNE, ( Philippe de ) peintre. V. 320. a. ■ •
AHAM PAN E , ( Marine ) bâtiment en ufage ,au Japon.
Il ne peut naviger dans la haute mer. III. 78.3
l’h om ^ n ANEL£ES l Srands f,nSes fort reffemblans à
men» n en a trouvé à Bornéo. Les Indiens.les nomment
Uurang-outang. ffl. 78. a,
C H A 271
CHAMPART, redevance qui confiftéén ¿liebortiôn de
fruits, frc. Etyup du mou Autres iloms qu’on lui donne. Ce
droit u heu en différentes Provuiees. Coutumes qui en font
mention. Trois fortes de champart. f f l.51810. Lepl,K ancieit
règlement fui le droit de champart. Ce que les êtSibliffemens
de faint Louis difent de ce droit. Ce qu’en difent Philippe
VI dans un mandement de 1331 , le roi Jean dans des lettres
de 1361, Charles VI 1393. Ufage qui s’obferve pré-
fentement ’par rapport à ce droit. Autre droit fur lès vignes
femblable au champart. Ibid. b. Quel eft le droit de champart
dans les pays de droit écrit La dixme fe perçoit avant ce
droit. Maxime des pays coutumiers que le champart n’eft pas
Vraiment feigneurial, à moins qu’il ne tienne lieu du cens*
Et dans ceux de droit écrit, il n’eft feigneurial que quand il
eft joint au cens. Prérogatives du champart feigneurial. Quotité
de ce droit. Il oblige à cultiver l’héritage fournis à'ce
droit. Ibid. 79. a. Le champart fe prend chaque année dans
le champ. Manière d’avertir le feigneur avant d’enlever la
dépouille. Tems où le feigneur doit comparaître. Le champart
feigneurial & qui tient lieu du cens eft imprefcriptiblei
Prefcription de celui de Dauphiné appellé vingtain. Ouvrages
à confulter. Ibid, b.
Champart, droit de champart appellé cinquième. III. 437. ai
; CHAMPÂRTAGE , fécond droit de. champart dans lar
coutume de Mantes. HL 79. b. En qùoi il confifte. Ouvrages
à confulter. Ibid. 80. a. . ■
CHAMPARTERESSE, ( Grange 1) pofleffeurs d’héritage
obligés de porterie champart en la grange champarterefle du
feigneur. Ouvrages à confulten Dame ehampartereffe. HL
80. a.
CHAMPARTEUR ,'celui qui perçoit le champart , &c.
Celui qui a droit de champart. III. 80. a.
v CHÂMPÀRTIR, prendre & lever le champart. Coutumes-
où ce mot eft en ufage. III. 80. a.'
CHAMPE, (Botan.) nom javanois d’une efiiece de champacam.
Ses différens noms. Caratteres qui diffinguent cette:
plante. Suppl. II. 316. b. Sa culture & fes qualités. Divers
ufages qu’on en retire. Ibid. 317^. Autres efpeces de champacam
dites cambang, biru , cubane , copattum. Leur deferip-
tion. Lieux où elles croiffent. Leurs quaUtés 8c ufages. Claifl-:
fication de ces plantes. Ibid. b.
CHAMPEAUX, ( Guillaume des) philofophe fcholaftiquej
XIV. 771. <z.'
CHAMPÊTRE, voyc[ Rusîiquè. Danfes champêtres. IV.
623. b.
_ CHAMPIGNON, (Hift.nat.) Néron appelloit les cham-t
pignons le ragoût des dieux. Négligence desphyficiens à en
examiner la nature. Utilité de cette connoiffance. Compas
raifon des champignons aux lychens. IIIl 80. b. Auteurs qui
fe font perfuadés que les champignons étoient, ou des maladies
des plantes fur lefquelles ils croiflbient, ou des éxpan-»
fions de quelques fibres de plantes pourries, ou des produc->
rions caufees par la fermentation de certains fucs. Toutes ces:
idées fe détruifent par l’examen de leur fubftance , de leur»
organifation, &c. Exiftence àpperçue de leur femence. Obfer-
varions qui ne permettent pas de . douter qu’ils ne foient de.
véritables..plantes. Ibid. 8ï. b. Caraôeres eftentiels des champignons.
Deux ferions générales des plantes fongueufes ; les
hrchens & les champignons. Subdivifion des champignons.:
Ceux qui ne portent que des graines ,ceux qui ont des graines
& des fleurs. Hiftoire botanique des champignons , projettée
par M. de, Juffieu , mais qu’il n’a pas exécutée. Ce qu’on a-
çaeonté de. la; groffeur prodigieufe de quelques champignons;
doit être mis au rang des fables. Champignons diftingués et*
nuifibles , & en bons à manger. Ibid. b. Defçription du cham- ,
pignon:, ordinaire. Lieux ou il vient. Maniéré d’élever des
champignons de couches. iéid. 82. a. A qui on doit la décou-!
verte de l’origine de cette.plante dans le crotin.du cheval.
II.n’eft point néceffaire de l’arrofer avec de la lavure de
champignon. Ibid. b. Champignons produits d’une bien étrange:
mamere. Le. bois du peupüer a la vertu d’en produire beaucoup
, de même que les collines dont on a brûlé le chaume
ou les landes. On peut encore élever des champignons en
plaine campagne. lieux de la campagne où croiffent les bons.
Ibid. 83.,a. Caraéleres diftinâifs.des bons & des mauvais.
Leur analyfe. Elle rend fort fufpeéle leur nature , même
celle qui eft réputée bienfâifante. Danger d’en faire ufage:
Symptômes que caufent les mauvais. Ibid. b. L’odeur de
quelques-uns eft même dângereufe. Champignons qui ont
caufe |a folie. A quoi l’on peut attribuer cette propriété vé-
néneufe. Comment on prétend la corriger. Reniedes à employer
s’il.arrivoit.qu’on eût mangé des champignons em-
poifonnés.. Ibid. b. ■
C hampignon , pierre qui a la propriété de produire des
champignons.. VII. 373. b. Différentes efpeces de champignons,
appellées oreille de Judas. XI. 620. b. Vefce-de-loup;
XVII: 190. b.\ Sa qualité malfaifante. Ibid. Agaric de chêne.
I. 166. a , b. Agaric de méléfe. X. 314. •Moufferon, X.
82'4. a. Morille. 713. a , b. Truffe. AVI. 723. é. Champi