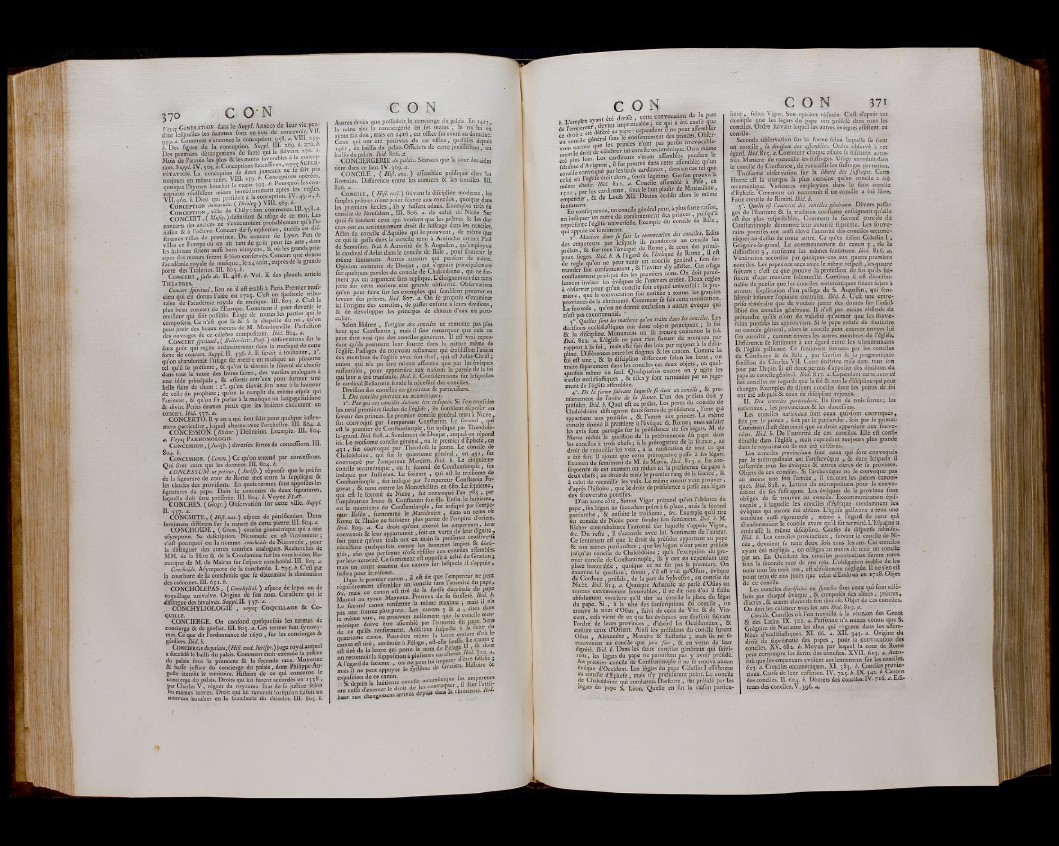
370 C O'N C O N
Vartt Gén4k a t io n dans le Suppl. Années de leur vie pendant
Wquclfcs les femmes font en f a t de concevoir. Vil.
geo. a. Comment s’annonce la conception. 958. a. vm . M9-
b. Des fienes de la conception. Suffi. 111. 169. b. ^70.0.
Des premiers dérangemens de fanté qui la -j?' '
Mois de Tannée les plus & les moins favorables à la conccp
jion. Suppl.IV. fovf-Conceptionsfi.çceffives,vwSOTC
viTATtSt. La.Uceptio,, de de.« , « £ “ £ £ 5
toujours en même tems. V I L - j ;>• b p0ï,rq„ oi lesconquoique
1 hymen bouchât le vagm. 39J - v l 1 r„ies
¿ptions réiifliflent mieux immédiatement après les réglés.
v f l . 960. 4. Dieu qui P l Î ^ L S i^ w l T r d i V ' ' C o n c e p t io n immaculée. ( Théolog.) Y 111.5 69* •
C o n c e p t io n , ville du ChUytfon commerce.U I .338.c.
CONCERT ( Mujtq. ) définition 8c ufage de ce mon Les
concerts des anciens ne s'exécutoient probablement qua l u-
riflon & à l’oflave. Concert de fymphomes, établis en différentes
villes de province. Du concert de Lyon. Peu de
villes en Europe ou on ait tant de gout pour les arts, dont
les Jiabitans foient àfiffi bons citoyens, 8c ou les grands principes
des moeurs foient fi bien confefvés. Concert que donne
(’académie royale de mufique ,1e 24 août, auprès de la grande
porte des Tuileries. III. 803. é. - .
C o n c e r t yfalle de. II. 488¿b. Vol. X des planch. article
T h é â t r e s . i t. • r
Concert fpirituel, lieu où il eft établi à Paris. Premier muli-
cien qui en donna l’idée en 1725. C’eft un foeélacle tributaire
de l’académie royale de mufique. III. 803. b. Geit le
plus beau concert de l’Europe. Comment il peut devenir e
meilleur qui foit poflible. Eloge de toutes les parties qui le
compofent.. Ce n’eft que là & à la chapelle du roi , qu on
peut jouir des beaux motets de M. Mbndonville. Perfection
des ouvrages de ce célébré compofiteur. Ibid. 804. a.
C o n c e r t fpirituel, ( Bclles-lettr. Poéf. ) obfervanons fur le
faux goût qui regne ordinairement dans la mufique.de cette
forte de concert. Suppl. II. 536. b. Il feroit àfouhaiter, 1 .
qu’on abandonnât l’uiage de mettre en mufique un ^feaume
tel qu’il fe préfente, 8c qu’on fe donnât la liberté de choilir
dans tout le texte des livres faints, des verfets analogues à
une idée principale, & affortis entr’eux pour former une
belle fuite de chant : 20. qu’on élevât fon ame a la hauteur
de celle du prophète ; qu’on le remplit du même efprit qui
l ’animoit, & qu’on fît parler à la mufique un langage fublime
& divin. Petits drames pieux que les Italiens exécutent en
concert, lbid.eyj. a. .
CONCERTO. Il y en a qui font faits pour quelque mitraillent
particulier, lequel alterne avec l’orcheftre. 1U. 804. *
CONCESSION. (R/iétor.) Définition. Exemple. III. 804.
a. Voyer PARHOMOLOGIE. . , n- n i
Con cess ion , ( Jurifp. ) diverfes fortes de concernons. 111.
Concession. ( Comm. ) Ce qu’on entend par concertions.
Qui font ceux qui les donnent. III. 804. b.
CONCESSUM ut petitur, ( Jurifp. ) réponfe que le préfet
de la iignature de cour de Rome met entre la fupplique &
les claufes des provifions. En quelstermes font appoféesles
Signatures du pape. Dans le concours de deux Signatures,
laquelle doit être préférée. III. 804. b. Voyez F i a t .
CONCHES. ( Géogr.) Obfervatibn fur cette ville. Suppl.
¿ ¿NCH1T E , ( Hijl.nat.) efpece de pétrification. Deux
' • ienümens diffêrens fur la nature de cette pierre. 111.804. a.
CONCHOIDE, ( Géom.') courbe géométrique qui a une
afymptote. Sa description. Nicomede en eft l’inventeur ;
c’eft pourquoi on la nomme conchoide de Nicomede, pour
la diftinguer des autres courbes analogues. Recherches de
MM. de la Hire & de la Condamine furies conchoïdes.Remarque
de M. de Mairan fur l’efpace conchoïdal. III. 805. a.
Conchoide. Afymptote de la conchoide. I.'79 s. E Ceilpar
la courbure de la conchoide que fe détermine la diminudon
des colonnes. III. 6ç 1. b. ;
CONCHÛLEPAS , ( Conchyljol. ) efpece delepas ou de
coquillage univalve. Origine de fon nom. Caraétere qui .le
distingue des bivalves. Suppl. II. 537. a. « ^2.
. CONCHYLIOLOGIE , voyei C o q u i l la g e & C o q
u i lle .
CONCIERGE On confond quelquefois les termes de
concierge 8c de géolier. III. 80$. a. Ces termes font.-Synonymes.
Ce que dit Pordonnance de 1670 , fur les concierges 8c
Autres droits que poffédoit le-.çoncierge du palais. En 1413,
la reine tint la conciergerie en fes mains , le roi lui en
I ayant fait don ; mais en 1416 , cet office fut réuni au domaine.
Ceux qui ont été pourvus dé.cet office, qualifiés depuis
1461, de baillis du palais.Offiçiérs de cette jurifdï&ion, ou
baillis du palais. Ibid. 806. a.
geôliers Abid.b. 5
Concierge da palais y (Hijl. mod. Jurifpr.) juge royal.auauel
a fuccédé le bailli du palais. Comment étoit exercée la .juftice
du palais, fous la première & la feçonde race. Moyenne
8c Baffe juftice du concierge du palais, dont Phibppe-Au-
gufte étendit le territoire. Hiftoire de ce qui concerne le
concierge du palais. Droits qui lui-Surent accordés en'13 58 ,
par Charles V , régent du royaume. Etat de fa juftice félon
les mêmes lettres. Droit qui lui revenoit lorfqu’on faifoit un
nouveau boucher en la boucherie du châtelet. 111. 805. b. I
CONCIERGERIE du palais. Séances que la cour des aides
tient dans ce Heu. IV. 369. a.
CONCILE , ( Hijl. anc. ) affcmblée publique chez les
Romains. Différence entre les comices & les conciles. UI.
806. a.
C o n c ile , ( Hifi. eccl. ) fuivant la difeipline moderne, les
funples prêtres n’ont point féance aux conciles, quoique dans
les premiers fiecles , ils y fuffent admis. Exemples tirés du
concile de Jérufalem , III. 806. a. de celui de Nicée. Sur
quoi fe fondent ceux qui veulent que les prêtres & les diacres
ont eu anciennement droit de fuffrago dans les conciles.
Aétes du concile d’Àquilée qui le prouvent, de même que
ce qui fe paffa dans le concile, tenu à Antioche contre Paul
de Samofatc. Ibid. b. Autorité de S. Auguftin, qu’employoit
le cardinal d’Arles dans le concile de Baie , pour foiuénir le
même fentiment. Autres auteurs qui penfent de même.
Opinion contraire de Doujat , qui s’appuie principalement
fur quelques paroles du concile de Chalcédoine, qui ne forment
pas un argument fans repüque. L’éloignementdes tems
jette, lur cette matière une grande obfcurité. Obfervations
qu’on peut faire fur les exemples qui femblent prouver eii
foveur des prêtres. Ibid. S07. a. On fe propofe d’examiner
ici l’origine des conciles, de paffer enfuite à leurs divifions,
& de développer les principes de châcun d’eux en particulier.
Selon Ifidore , l'origine des conciles ne remonte pas plus
haut que Conftantin ; mais il fout remarquer que cela ne
peut être vrai que des conciles' généraux. Il eft vrai cependant
qu’ils prennent leur fource dans la nature même de
l’églife. Partages du nouveau teftament qui établiffent l’union
des membres de l’églife avec fon chef, qui eft Jefus-Chrift ;
union qui n’a pu être mieux affermie que par les évêques,
raffcmblés, pour apprendre aux nations la parole de la foi
qui leur a été tranfmile. Ibid. b. Confidérations fur lefquelles
le cardinal Bellarmin fonde la néceffité des conciles,
Divifion des conciles en généraux 8c particuliers.
I. Des conciles généraux ou oecuméniques.
i°. Par qui ces conciUs doivent être indiqués. Si l’on confulte
les neuf premiers fiecles de l’églife , ils femblent depofer en
foveur des princes. Le premier concile général tenu à Nicee,
fut cçnvoqué par l’empereur Conftantin. Le fécond , qui
eft le premier de Conftanti'nople, fut indiqué par Tbéodofe-
le-grand. Ibid. 808. a. Sentiment de Doujat, auquel on répond
ici. Le troifieme concile, général, ou le premier d’Ephefe, en
43 1, fut convoqué par Théodofe le leune. Le concile de
Chalcédoine , qui fut , le quatrième général, en 451, fut
convoqué par l’empereur Marçien. Ibid. b. Le cinquième
concile oecuménique , ou le fécond de Conftantinople , fut
indiqué par Juftinien. Le fixieme , qui eft le troifieme de
Conftantinople , fut indiqué par l’empereur Conftantin Fo-
gonat ,• & tenu contre les MonothcUtcs en 680. Le feptieme,
qui eft le fécond de Nicée,, fut convooué l’an 783 , par
l’impératrice ïrene & Conftantin fon fils. Enfin le huitième,
ou le quatrième de Conftantinople , fut indiqué par 1 empereur
Bafile , furnommé le Macédonien , dans un tems ou
Rome & l’Italie ne faifoient plus partie de 1 empire d orient.
Ibid. 800. a. Ce droit qu’ont exercé les empereurs , leur
convenoit & leur appartenoit, foit en vertu de leur dign.tô
Toit parce qu’eux leuls ont en main la
néceffaire quelquefois contre les hommes impies oc dere
X afin que perfonne n’ofe réfifler au»: conciles affemblfa
par lem autorité. Ce fentiment eft oppofé à celui de Grauen |
S m court examen des canons fur lefquels .1 s appuie ,
^DariëVremtecanon , ¡1 <=<* * f c Tau pe«" "e peut
Marcel au. tyran Maxençe. Preuves de fa ftuffeté. /4, i 4.
Le fécond canon renferme la meme maxime , mais il
pas une fource plus pure. Les canons ) 8c 4 , “ 'és dans
fa même vue, ne prouvent nullement que le concde cecu
ménique doive être affemblé par lautome f a m W
de ce qu’ils renferment. Addition fufpefle à “ J S .’ÏÏ
quatrième canon. Peut-être même la lettre ennere doute
canon eft tiré, attribuée à Pelage, & dont
eft tiré de la lettre qui porte le^nom de Felage * ^ giQ p
on reconnoît la fuppofinon i plufieurs j.itre fSfi’fiê ;
A l’égard du fixieme , on ne peut luiung _ &
mais il ne peut appuyer le fyftême de
¿ dëtan^m«s a'rrivés depuis dans la chrétienté. i U
CON CON 3 7 1
i té divifé , cette convocation de la part
a Æ f ^devint impraticable ; ce qui a été caufe que
S déféré au pape : cependant 3 ne peut affembler
ce droit *t _Kn^xz\ fans Je confentement des princes. Obier-
1111 C°fncor! que les princes n’ont pas perdu in-èvocÆle.
v° “ , f “ jjoi, 3e célébrer un concile oecuménique. On a même
ï f 'lu s loin. Les cardinaux s’érant affembfc pendant, le
febimie d’Avignon , il fut prouvé dans cette aflemblêe qu un
fcniUne a b (, , i._l.j:nanv . dans un cas tel que
«lui oii l’ é g b fe étoit alors, feroit légitime. Gerfon prouvala
ï ï™ . ebofe Ibid. 811. a. Concile aflcmblè à Prie, en
< 11 par les cardinaux,' fous le bon plaifir de Maximiben,
empereur , 8c de Louis XU. Décius étabbt alors le meme
W B Ê m m U" “ Udle général peut, àplus forte rrifon,
en indiquer un autre du confentement des princes ! pu jSgft
repréfente l’églife univerfelle. Exemple du concdc de Baie ,
fait U convocation des conciles. Edits
des empereurs par lefquels ils mandoient au concde les
prélatTf 8c fur-tout l’évéque de Rome, 8c ceux des prmen
paux fieges. Ibti. 4. A l’égard de 1 ^ 3“ S mef ’„J 1“
de reele qu’on ne peut tenir un concile général » fans de
mander fon confenmment, 8c l’inviter
conftamment pratiqué dès les premiers tcms^ On dou pareil
lement inviter les évêques de 1 univers enner. Deux réglés
•à obferver pour qu’un concile foit réputé univerfel i ja premiere,
que la convocation foit notifiée iiuc u w i iiu v o u v i. -------- - ■ à toutes les gjr.r and. es
provinces de la chrétienté. Comment fe fait cette notification.
La fécondé, qu’on ne donne exclufion à aucun évêque qui
n’eft pas excommunié. ' . . . , - , . T
3°. Quelles font les matières qu on traite dans les conciles. Les
décifions ecdéfiaftiques ont deux: objets principaux ; la toi
& la difeipline. Monumens où fe trouve contenue la toi.
Ibid. 812. a. L’égUfe ne peut rien ftatuer de nouveau par
rapport à la foi, mais elle foit des loix par rapport à la diici-
pline. Différences entre les dogmes & les canons. Comme la
foi eft une , & la difcipUne différente félon les lieux , on
traite féparement dans les conciles ces deux objets , ou quelquefois
même un feul. Quelquefois encore on y agite les
caufes ecdéfiaftiques , & elles y font terminées par un jugement
de l’églife affemblée.
40. De la forme fuivant laquelle fe tient un concile, ex pre
mierement de l'ordre de la féance. L’un des prélats doit y
préfider. Ibid. b. Quel eft ce prélat. Les peres du concile de
Chalcédoine diftinguent deux fortes de préfidence , lune qui
appartient aux pontifes , & l’autre aux princes. Le meme
concile donne la première à l’évêquë de Rome ; mais enfuite
les avis font partagés fur la préfidence de fes légats. M. de
Marca réduit la queftion de la prééminence du pape dans
les conciles à trois chefs ; à la prérogative de la féance , au
droit de recueillir les voix, à la ratification de tout ce qui
a été fait. Il ajoute que cette prérogative paffe a fes légats.
Examen du fentiment de M. de Marca. Ibid. 813. g En con-
féquence de cet examen.on réduit ici la préfidence du pape^a
deux chefs j au droit de tenir le premier rang de la feance , oc
à celui de recueillir les voix. Le même auteur veut prouver,
d’après l’hiftoire, que le droit de préfidence a paffé aux légats
des fouveraihs pontifes. , 1
D’un autre côté , Simon Vigor prétend quen l àbfence du
pape , fes légats ne fuccedent point a fa place, mais le fécond
patriarche , & enfuite le troifieme, 6-c. Exemple qu il tire
du concile de Nicée pour fonder fon fentiment. Ibtd.b- M.
Richer contrebalance l’autorité fur laquelle s’appuie Vigor,
&c. Du refte , il s’accorde avec lui. Sentiment de 1 auteur.
Ce fentiment eft que le droit de préfider appartient au pape
& aux autres patriarches j .que les légats n’ont point préfidé
jufqu’au concile de Chalcédoine ; qu’à l’exception du premier
concile de Conftantinople, ils y ont eu cependant une
place honorable , quoique ce ne fut pas la première. On
examine la queftion; favoir, s’il eft vrai qu’Ofius, évêque
de Cordoue , préfida, de la part de Sylveftre, au concile de
Nicée. Ibid. 814. a. Quoique Athanafe ait parlé d’Ofius en
termes extrêmement honorables, il ne dit rien d’ou il faille
abfolument conclure qu’il tint* au concile la place, du légat
du pape. Si,, à la tête des fouferiptions du concile , on
trouve lè nom d’Ofius , fuivi de ceux de Vite & de Vincent
, cela vient de ce que les évêques ont fouferit fuivant
l’ordre, de leurs provinces , d’abord les Occidentaux, &
enfuite ceux d’Orient. Ainfi les préfidens du concile furent
Ofius , Alexandre , Macaire & Euftathe ; mais ils ne fe
trouvèrent au concile que jure fuo , & en vertu de leur
dignité. Ibid. b. Dans les deux conciles généraux'qui fuivi-
rent, les légats du pape ne paroiffent pas y avoir préfidé.'
Au premier concile de Conftànriiiople il ne fe trouva aucun
évêque ¿’Occident. Les légats du pape Céleftin I aflïfterent
au concile d’Ephefe, mais’ ri’y jpréuderent point. Le concile
de Chalcédoine qui condamna Diofcore , fttt préfidé par les
légats du pape S. Léon,,■ QQuuei lle en fut la râifon particulière
, félon, Vigor. Son.-opinion réfutée. C’eft d’après cet
exemple que les légats du pape ont préfidé dans tous les
conciles. Ordre fuivant lequel les autres évêques affiftent au
concile.
Seconde Ôbfervation fur la forme félon laquelle fe tient
un concile, la divifion. des ajfcmblées. Ordre , obfervé à cet
égard. Ibid.Sï ç. a. Comment chaque affaire fe difeutoit autrefois.
Maniéré de recueillir les fuffraçes. Ufaee introduit dans
le concile de Confiance , de recueillir les fuffrages par nation.
Troifieme obfervation fur la liberté des fuffrages. Cette
liberté eft la marque la plus certaine qu’un concile a été
oecuménique. Violences employées dans le faux concile
d’Ephefe. Comment on reconnoît fi un concile a été libre.
Faux concile de Rimini. Ibid. b.
30. Quelle eft l’autorité des conciles généraux. Divers paffa-
ges de l’Ecriture & la tradition confiante enfeignent qu’elle
eft des plus refpeétables. Comment le fécond coricile de
Conftantinople démontre leur autorité fuprême. Les fouve-
rains pontifes ont aufli élevé l’autorité des conciles oecuméniques
aU-deffus de toute autre. Ce qu’en difent Céleftin I ,
Grégoire-le-grand. Le commencement du canon 3 , de la
diftinétion 3 , renferme, les mêmes fentimens. Ibid. S i6. a.
Vénération accordée par quelques-uns, aux quatre premiers
conciles. Les papes ont reçu avec le même refpeél, les quatre
fiiivans ; c’eft ce que prouve la profeffion de foi qu’ils faifoient
d’une maniéré folemnelle. Combien il eft déraifon-
nable depenfer que les conciles oecuméniques foient fujets à
erreur. Explication d’un paffage de S. Auguftin, qui fem-
blerbit infinuer l’opinion contraire. Ibid. b. C’eft une entre-
prife téméraire que de vouloir jerter des doutes fur l’infail-
libité des conciles généraux. Il n’eft pas moins abfurde de
prétendre qu’ils n’ont de validité qu’autant que les fouve-
rains pontifes les approuvent. Si le pape refuie de fojifcrire
au concile général, alors le concile peut exercer envers lui
fon autorité , comme envers les autres, membres'de l’églifèt
Différence de fentiment à cet égard entre les ultramontains
& l’églife gallicane. Ce fentiment foutenu par les conciles
de Confiance & de Bâlc , par Gerfon & la pragmatique-
fan&ion de Charles VIL Cette doftrine mife dans tout fon
jour par Dupin. Il eft donc permis d’appeller des décifions du
pape au concile général. Ibid. 817. a. Cependant cette autorité
des conciles rie regarde que la foi & non la difeipline qui peut
changer. Exemples de divers conciles dont les points de foi
ont été adoptés & ceux de difeipline rejertés.
II. Des conciles particuliers. Ils font de trois fortes ; les
nationaux , lés provinciaux 8c les diocéfains.
Les coticiles nationaux font ceux qui «font convoqués y
foit par le prince , foit par le patriarche, foit par le primat.-
Comment il eft démontre que ce droit appartient aux fouve-
rains. Ibid. b. De l’autorité .de ces conciles. Elle eft confi-
dérable dans l’églife , mais cependant toujours plus grande
dans le royaume où ils ont été célébrés.
Les conciles provinciaux font ceux qui font convoqués
par le métropolitain ou l’arçhevêque > 8c dans lefquels il
raffemble tous les évêques 8c autres clercs de fa province.
Objets de ces conciles. Si l’archevêque nç le convoque pas
âii moins une fois l’année , il encourt les peines canoniques.
Ibid. 818. a. Lettres du métropofitain pour la convocation
de fes fuffragans. Les évêques de la province font
obligés de fe trouver au concile. Excommunication épif-
copale , à laquelle les conciles d’Afrique condamnent les
évêques qui auront été abfens. L’églife gallicane a tenu une
conduite aufli rigoureufe , même à 1 égard de ceux qui
âbandonnoiént le concile'avant qu’il fütterminé.L’Efpagne a
embraffé la même difcipUne. Caufes de difpenfe admifes.
Ibid. b. Les conciles provinciaux , fuivant le concile de Nicée
, devoient fe tenir deux fois tous les ans. Ces conciles
ayant été négligés ,. on obligea au moins'de tenir un concilie
par an. En Occident les conciles provinciaux furent rares
fous la fécondé race de nos rois. L’obligation établie de les
tenir tous les trois ans, eft abfolument négligée. Il nesenelt
point tenu de nos jours que celui d’Embrun en 1728. Objet
de ce concile. ' ■H) . . . ...
Les conciles diocéfains ou fynçdes font ceux qui font célébrés
par chaquè évêque , 8ç compofés_des abbés , prêtres,
diacres, & autres clercs dé fon diocefe. Objet de ces conciles.
On doit les célébrer tous les ans. Ibid. 819. a.
Concile. Conciles où l’on travailla à la réunion des Grecs
& des Latins. IX. 302. a. Perfpnne n’a mieux, connu que S.
Grégoire de Nazianze les abiis qui régnent dans les ¿Semblées
d’ecdéfiaftiques. XI. 66. a. XIL 343. «..Origine du
d r o it de fuprématie des papes , pour la convocation des
conciles. XV. 682. b. Moyen par lequel la cour de Rome
peut corrompre les écrits des conciles. XVIL 613. «. Autorité
que les empereurs avoient anciennement fur les conciles.
623. a. Conciles oecuméniques. XI. 383. b. Conciles provin-
ciaux..Caufe de leur ceflation. IV. 725. b. IX. 342- E Canons
des conciles. II. 604. b. Décrets des conciles. IV. 710. a. Editeurs
des conciles. V . 3 96. a.