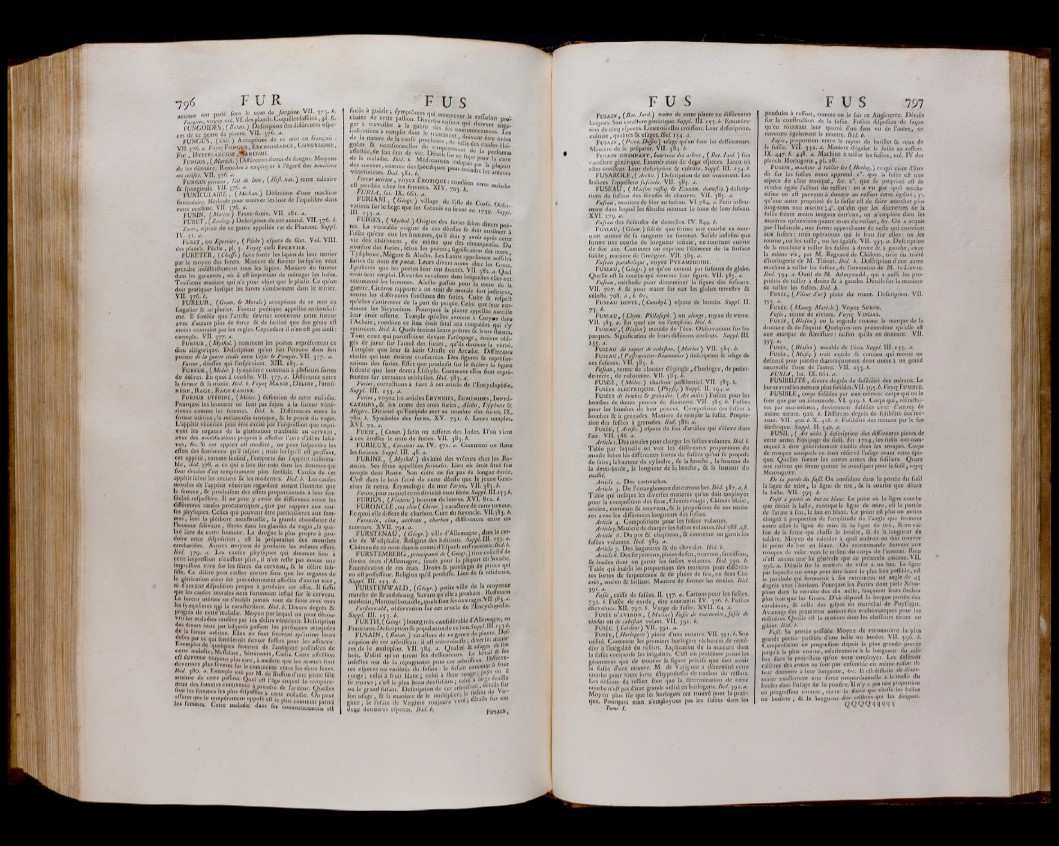
7 F U R
anciens ont m M f » 1« "»"• i l M Î È ® , 7 V §
S - « , v g w * vol. VI, des nlswch, Ç a juillwfc ffile s , pl. 6.
l'V N G O lP F J i , ( flotan, ) Defcrtpuon des différente* efpe-
ees de ce genre de plante, V U , 376» //.
FUEIGV.S (C hif,), Acceptions de ce mot en tra n ço is ,
V il, 376, a. A'syrï F q n g u s , E x c r o is s a n c e , C o n d v lpm e ,
FlC . rfoPERSÂRCOSE^ARCOME, . .
f u m w , ( m m , ) W m m m m 0 W IW
de les détruire. Remedes à employer a lézard des fouillons
ou ccrifcs, VII, 37/5, tt, . * K , ,
FuNGUsp«oL/, p dSr lune, ( Mffi, nat, ) terre calcaire
& fpongieufe. VU, Wÿ'fl',, \ t-»/./- « » » ■,
FUNICULAIRE , ( Méchnn,) Définition dune machine
funiculaire, Métlmde jwur trouver les loi* de l'équilibre dans
cene maclííne, VU, 176. u>
PI/N/N, (Marine) Franc-funin, VII, »81, a.
Pl/RET, Ç Z fo log f) Description de cet animal, VII, 376, b.
Furet, eipece de c e genre appellée rat de Pharaon, Suppl,
Fu ret , ou Epfrvitr , ( Pêche ) efpeee de filer, Vol. VIII,
despJancb, Pêche, pi, 3- Voy<i suffi Eperv ier,
FuRF.TER, ( Chaffe) faire forrir les lapins de leur terrier
par le moy en des furets, Maniere de fureter lorfqu’on veut
prendre indifiinftemenr tous les lapins, Maniere de fureter
dans les garennes, où il eft important de ménager les baies,
Troífieme maniere qui n’a pour objet que le plaifir. Ce qu’on
doit pratiquer lorfque Les furets s'endorment dans le terrier,
.VII, W b,
FUREUR, (Qram. & Morale) acceptions de ce mot au
fmgulier & au plurier. Fureur poétique appellée emlioufiaf-
me, II femble que l’arrifte devroit concevoir cette fureur
avec d'autant plus de force & de facilité que fon génie eft
moins contraint par les regles. Cependant il n’en eft pas ain.fi ;
exemple, VII, 377, a,
F u r e u r , (M y th o l.) comment les poëtes repréfentent ce
dieu allégorique, Description qu'en fait Pétrone dans fon
poème de la guerre civile entre Céfar (a Pompée, VII, 377, a.
Fureur, déeffes qui rmfpiroient, XIII, 183, a,
F u r e u r , ( Médee,) (ytmnàme commun àplufieurs fortes
de délires. Eu quoi il confine, VII, 377, a, Différence entre
la fureur de la manie, Ibid, b, Voyeç M a r i e , D é l i r e , P iiré-
nésie , R a g e , R a g e canine,
F u r e u r u t é r i n e , (Médee,) définition de cette maladie.
Pourquoi les hommes ne font pas fujets à la fureur véué*
tienne comme les femmes, Ibid, b, Différences entre la
fureur utérine, la mélancolie érotique, de le prurit du vagin.
L ’appétit vénérien peut être excité par l’imprelfion que reçoivent
les organes de la génération tranftnife au c e r v e a u ,
avec des modifications propres h affeûer fam é d’idées lafei-
ves, b ç , Si c et appétit eu m od é ré , on peut fufpendre les
effets des fentimens qu'il infpire \ mais lorfqii’il eu prefTanr,
cet appétit, comme len litif, l’emporte fur 1 appétit raifbnna-
b le , ibid, 378, //, ce qui a lieu fur-tout dans les femmes qui
font douées d'un tempérament plus fenfible, Caufes de cet
appétit félon les anciens & les modernes, Ibid, b, Les caufes
morales de l'appétit vénérien regardent autant l'homme que
la fem m e , de produifent des effets proportionnés h leur feu-
fihllité refpeélive. Il ne peut y avoir oe différence entre les
différentes caufes proestartiques, que par rapport aux caufes
phyfiqiies, Celles qui peuvent être particulières aux femmes
, font la pléthore menfiruelle, la grande abondance de
l'humeur fallvaire, filtrée dans les glandes du vagin, la qualité
fore de cette humeur, La drogue la plus propre k produire
cette difpofirion , eft la préparation des mouches
cantharide6. Autres moyens de produire les mêmes effets,
Ibid, 379, a, Les caufes phyfujues qui donnent lieu à
cette impreffion n’exiftanr p lu s .il n'en refte pas moins une
imprcffion vive fur les fibres du cerveau, & 1« délire f’ub-
fifte, C e délire peut exifter encore fans que les organes de
la génération aient été précédemment afteftés d'aucun v ic e ,
ni d’aueune difpofttion propre à produire cet effet. Il fuffit
que les caufes morales aient fortement influé fur le cerveau
La fureur utérine ne s’établit jamais tout de fuite avec tous
Iss fymptômes qyi la caraélérifent, Ibid, b, Divers degrés de
progrès de cette maladie, Mo y en par lequel on peut découvriras
maladies cauféespar les defirs vénériens, Defcripiion
«je* divers états par lefqnels paffent les perfounes attaquées
ne U fureur utérine, Elles ne font fouvent qu’irriter leurs
<lM fembleroit devoir fuiïtre pour les afTouvir,
de ^titiquité poffédèes de
S I S P p I I m i r a f i f e lW Cstre b/ M w.
m Ibid,W 0 M 9 , V a, P Exen m Ï *Ï
-rr çont» ^ m r § les deux fexes,
atteinte m i L d de . I cette l
1
F U S
i S ' . T ï T c- ü«, i travailler à la ¿ 7 5 , ! “ ' ' 'I'" M » eoita-
intlisaileiK à remplir dans le , ‘ " “ '»etteemens. U s
de la nature delaeaul'e prndiauie d^ L n a6" * i ,r ! P ' s l
^ owafionnelle« du temuiran.
affeéfée,de fon état de vie, Détails fur et* r • perfo/m»
de la maladie. Ibid, b, Médicamens i n d l i ï ^ T la, c,,rc
des auteurs, tomme d i j « B p o u r S P i 1®
vénértennes, Ibid, 381, b, fe les ardeurs
Fureur utérine, v o y e z É r o t iq u e : eoml^n
eft terrible chez les femmes, XIV, 701 b maladie
Fuma, loi. i x , 7 >' *
FU R IAN I , ( G é o g r village de l’iUe de Corfis n u
G iuoisen fireu teu
l'U K lk s , (M y .h a l,) Origine des furies félon divers oui-
tes. La véritable origine de ces déefles fe doit anribuer 1
Jidée qn om eue les nommes,qu’il doit v avoir an.a
4 “ ; ,de ,nl4'nc i" 1 <te ricompcnfe D Î
nombre des furtes, félon les poètes ; fianification d,,*
T y f t p t o n e .b l i g c r e & A l e J L e s ù i ' f f ^ Z ' e m S â
turies du nom de pa.m, Leurs divers noms c i te les Grecs
l'.piibeiçs (pie les poètes leur ont donnés, VII, 182 » fflîilf
ému leur emploi,Oiverfes oecafirms dans lefauelles’elicsunt
tourmenté les hommes, A lcilo palfoit pour la merc de la
guerre, Gtcéron rapporte à un trait de morale fort iiidiciciia
toutes les différentes fonilions des furies, Culte & refiicfi
nu elles 5 attirèrent de la part du peuple. Celui que leur ren-
dtuent les bicyonieiis. Pourquoi la plante appellée iiarcillé
f j r etplt offerte. Temple qu elles »voient à Ceryae dans
I Acbaiet combien ce lieu étolt fatal aux coupables nui s'v
¡enrôlent, lbiil. b, Quels érolenr leurs prêtres & leurs /lames,
1 ous ceux qui parollfoiem devant l'aréopage, éioient 0I1II-
gés d e jurer fur faute! des furies, qu’ils atroient la vérité.
Temples q u e leur fit bâtir O refte en Arcodie, Différentes
chofes qui leur étoient confacrées, Des figures de représentations
des furies. Effet que produifit fur le théâtre la figure
hideufe que leur donna Éfchyle, Comment elles font repré-
fenfées fur cerraines médailles, Ibid, 383, a,
Furier, cor refilon s à faire h c e t article de l'Encvclonédie.
Suppl, III, *33, a,
Furies f v o y e z les articles E ry n n ie s , Euménides , ImprE-
C a t i o r s , de les noms des trois furies, /liefia, Tijjphone de
Mégire. Divinité qn’liuripide met au nombre des furies, IX,
780, b, Symboles des furies, X V , 731, b. Leurs temples,
XVI, y%, a,
F u r i e , ( Comm.) fatin ou taffetas des Indes, D ’où vient
à ces étoffes le nom de furies. V il, 383, b,
FU RIEU X , Curateur nu, IV , 571, a, Comment on flatte
les furieux, Suppl, III, 48, a,
FU R INE , ( Mythol, ) divinité des voleurs chez les Romains,
Ses fêtes appelices furinales, Lieu où étoit fitué fon
temple dans Rome, Son cuire n e fut pas de longue durée,
C ’eft dans le bois facré de cette déeffe que le jeune Grac-
chus fe retira. Etymologie du motFurine, VII, 383, b,
Furine,'\otir auquel cette divinité étoit fétée,Suppl, l l l . t^ . b ,
FU RIUS, ( Frédéric) homme de lettres, XVI, 8ta, b.
FURONCLE ,011 clou ( Chiner. ) caraélere de cette tumeur.
En quoi elle différé du charbon. Cu re du furoncle, VII,383, b.
Furoncle» clou, anthrax f charbon t différences entre ces
tumeurs, X VII, 7 0 1 .0 .
FU R STEN AU , (G éo g r .) ville d’Allemagne, dans le cercle
de Weftphalie, Religion des hahitans, Suppl, III- MF a>
Château de ce nom dans le comté d’Efpach enVranconie.lbid.p.
FURSTEMI1E R G , principauté de ( Géogr.) titre c oM M d e
divers étais d’Allemagne, »tués pour la plupart enbouane.
Enumération de ces états. Droits & privilèges du |>tmçe qut
en eft poffeffeur, Religion qu'il profeffe. Lieu de fa réfiuencc»
Suppl, III, 133, b,
» F U y 1431 R S T r.E N N w w A A l I ,1 J ; ) , (i Géogr Géogr,,) ) petite ville Viuc u*de la 1 1..: (-(/»moyenne
.»tv,,,,, .. * " / * ,i ___ »«, vflni-iiin
«
«relie de Rraudeboiirg, Savans qu’elle a produits i ltoUjann
idecin 5 Mentzel botaniffe, quels font fes ouvrages, V 11,30 3 -/^'
Furflenwald, observation fur cet article de 1 Eucyclopéüie.
marche d<
médecin j i
Furflenwald, ohfervatlon fur cet a
Suppl, III, 133, b,
t Ù l i T l l , (Géogr, ) bourg trés-confidérable d Allemagne, en
Franconie.Defcription de population de ce lieii^’/9V;‘ '** 1M Ê
FU SA IN , ( 1h t an, ) caraélere de ce genre de plante, iw -
cripiioM de cet arbrlffeaii ; il eft irês-robuffe} diveri nuYnn
res de le multiplier, VIL 384. a, Qualité d e ty S 6®, *«£ jes
bois, Utilité qu'en tirent les deffinareurs, Le Mtati ^
infeéles ont de la répugnance pour cet arbrifleau, 1 , .
tes efpeces ou variétés du fuient : le fnfain conumn ^ ^
rouge j celui à fruit blanc» celui h fleur rou y e,J F feuille
fe trouve c’eff le plus beau des fufains ; celui a R;' ,j r„r
ou le grand fufaiu, Defcription de cei arbriffea * , y .^
fon uÆ ^ ^ S t *» m n l t r i é le " ’ iilllp l^ lj» f f , n , ccs
Sinie» lé fufiiiu de Virginie toujours
lu a dernières efpeces, Ibid, b, F usain,
F U S F U S 797
F u s a i n , (Æ01. Jard.) n om s d e c e t te p la n te en différentes
langues. Son caraéieregénérique,Supp!, III, 133.b, Enumération
de cinq efpeces. Lieux où elles croiffenr. Leur defcripiion,
culture, qualités de ufages, Ibid, 1 34, a.
Fu sa in , (P e in t,D e jjln ) ufagequ’en font lesdcftinateur6.
Maniere de le préparer, VII, 384, b,
d I-’u s AIN g r im p a n t , bourreau des arbres, ( flot, Jard, ) fon
araCtere générique. Enumération de dejpx efpeces. Lieux où
«Iles croïffent, Leur defcripfion & culture, Suppl, III, 134, b,
EUS A R O LE , ( A r c h it ) Defcripfion de cet ornement, Les
Italiens l’appellent fufciolo, VIL 383, a.
FU SEAU , ( MaiJbn ruflirj, & Èconom, domeflitj, ) deferip-
tions d u fu fea u des fileufes de chanvre, M il, 383, a,
Fufeau, maniere de filer au fufeau. VI, 784, a. Petit inffru-
ment dans lequel les fileufes mettent le bout de leur fufeau,
X V I, *79, a,
Fufeau des faifetifes de dentelles, IV, 844. b.
F useau, (Géom,) folide que forme une courbe en tournant
autour de fit tangente au fommet, Solide indéfini que
forme une courbe de longueur infinie, en tournant autour
de fon axe. Comment on exprime l’élément de la futface
folide: maniere de l’intégrer, VIL 383, a.
Fufeau parabolique, v o y e z P y b a m i d o i d e ,
F u s e a u , ( Géogr, ) c e qu’on entend par fufeaux de globe,
Quelle eft la courbe qui termine leur figure, VIL 383, a,
Fufeaut méthode pour déterminer la figure des fufeaux,
V IL noy, b, de pour tracer fur eux les globes terreftre de.
célefte. 708, a , b. b c .
F u s e a u d e n t é , (C on chy l.) efpcce de buccin, Suppl, II,
73, b,
F u s e a u , (Chym, Phîlofoph, ) ou alance, tuyau de verre.
V II. 383, a, En quel cas on l’emploie. Ibid, b,
F u s e a u , ( fllajbn ) meuble de l’écu, Obfervations fur les
parques. Signification de leurs différens attributs. Suppl, III.
rU S E A U du taquet de cabejlan, ( Marine) V IL 38 3 , b,
F u s e a u , ( Pajjementier-floutonnter ) defcripfion & ufage de
ces fufeaux,,VIL 3 8 3 , b.
Fufeau, terme de clontier d’épingle ,d ’borloger, de potier*
de-terre, de rubannier, VIL 3 8 3 , b,
FUSÉE, (M éd e c .) charbon peftilentiel, VII, 383, A
F u s é e s é l e c t r i q u e s , (P hy fu ¡.) Suppl. II, 1 9 4 , /;,
F u s é e s de bombes b grenades, ( Art milit.) Fnfées pour les
bombes de douze pouces de díametre, VIE 383, b, Fnfées
pour les bombes tic huit pouces, Compofuion des fnfées à
bombes & à grenades. Maniere de remplir la fin fée. Proportion
des fnfées à grenades, Ibid. 38 6 , a.
F u s é e , ( Artific, ) efpeee de feu d’artifice qui s’élève dans
Pair. VIL 0 6 , a.
Article t, Des moules pour charger les fnfées volantes, Ibid. h.
Table par laquelle on v o it les différentes proportions du
moule félon les différentes fortes de fnfées qu'on fe propofe
de fiiirej la hauteur du cylindre, de la broche, la hauteur de
la demi-boule, la longueur de la broche, de la hauteur du
maffif.
Article 9, Des cartouches.
Article 3. De l’etranglement descartouches, Ibid, 0 y .a ,b .
Table qui indique les diverfes matières qu’on doit employer
pour la composition des feux, Chinois rouge . Chinois blanc,
ancien, commun de non veau, de la prtwofiiion de ces matie*
res avec les différentes longueurs dest fnfées»
Article 4. Compofitions pour les fnfées volantes.
Ar ticlej, Maniere de charger les fufées volantes, lbid,0 fl, a A ,
Article 6, Du pot & chapiteau, de comment 011 garnit les
fnfées volantes, Ibid. 389, a.
Article 7, Des baguettes de du chevalet, Ibid, b,
Article 8. Des ferpenraux. pluies de feu, marrons, fauciffons,
de étoiles dont on garnit les fufées volantes, Ibid. 390. b.
Table qui établit les proportions des matières pour différentes
fortes de ferpenteaux de de pluies de feu , en feux Chinois,
ancien de brillant. Maniere de former les étoiles, Ibid.
2Q i, a,
Fufée, caiffe de fufées. II. 337. a, Cartons pour les fufées.
73», b, Fufée de corde, dire courantin, IV, 376, b, Fufées
chevelues, XII, 797, b, v e rg e de fufée. XVII, 64, a.
F u s é e d ’ a v i r o n , (Ma r in e ) Fttjée de tournevirc, fufée de
viudos ou de cabellan volant, VU, 391, b,
FUSÉE, (Cardeur) VII, 391, a.
F u s é e , (Horlogerie) plece d’une montre, V II, 391. h. Son
utilité, Comment les premiers horlogers râcherent de remédier
à l'inégalité du r effort, Explication de la maniere dont
la fufée compenfe les Inégalités, C'eft un problème parmi les
géomètres que de trouver la figure précife que doit avoir
la fufée d’une montre, M, de Variguon a déterminé cette
courbe pour toute forte d'hypothefes de rcnflon du refforr.
Les défauts du reffbrt font que la détermination de cette
courbe n’eft pas d'une grande utilité en horlogerie, Ibid, 3 q%,a,
Moyen plus fûr que les horlogers ont trouvé pour la pratique.
Pourquoi nous n'employons pas les fufées dans les
Tome I,
pendules I r effort, comme on le fait en Angleterre, Détails
fur la conftruwion de la fufée, Fufées diipofécs de façon
quen tournant leur quarré d’un fens ou de l’autre, on
remonte également la montre, Ibid, b.
F u ffe , proportion entre le rayon du barillet 6e ceux de
la fufée. VII, 33a, a. Maniéré d’égaler la fufée au refforr.
IX, 447, b. 448, a, Machine à tailler les fnftes, vol. IV des
pJanèh, Horlogerie, pi, 18,
F usées, machine à tailler les (Horlog.) ce qui vient d’étre
dit fur les fufées nous apprend t " . que la fufée eft une
efpeee de cône tronqué, b c . q u e fa propriété eft de
rendre égale l’a#ion du reffbrt : on a vu par quel média-
nifme on eft parvenu à donner au reffbrt cette égalité j y .
qu'une autre propriété de la fufée eft de faire marcher plus
long-tems une montre} 4", qu'afm que les diamètres de la
fufée foient moins inégaux entr'eux, on n’emploie dans les
montres qu’environ quatre tours du reffbrt, fyc. O n a acquis
par l'habitude, une forme approchante de c e lle q u i convient
aux fufées ; trois opérations qui fe finit fur elles ' on les
to u r n e ,o n les taille, on leségalife, VIL 303. a. Deferipi'ion
de la machine & tailler les fufées à droite dt, ii gauclie, avec
la même v is, par M, Rcgnaud de Châlons, tirée du traité
d'horlogerie de M, Tbiour, Ibid. b, Defcripriou d'une autre
machine à tailler les fufées, de l'invention de M, le Lièvre.
Ibid, 394, a. Outil de M. Admyrauld, qui a suffi les propriétés
de tailler à droite de à gauche. Détails fur la maniéré
de tailler les fufées, Ibid, b.
F u s é e , ( Filtur tCor) pîece du rouer, Defcripfion. VII.
/7USÉe, (Maneg. Maréch.) V o y e z Suaos.
Fu jée, terme de riviere, Foyer V indas.
F usée, (flla fo n ) pn la regarde comme la marque de la
droiture Üc de l'équité. Quelques-uns prétendent qu’elle eft
une marque de tlétriffure: raifon qu'ils en donnent. V U .
/7U6ÉE, ( fllafon ) meuble de Vécu. Suppl. UL 133, a.
F u s é e , (M u f iq .) trait rapide de continu qui monte ou
defeend pour joindre diatoniquement deux notes à. un grand
intervalle l'une de l’autre. V il, 153, b,
P U S !A , loi. IX. 6 6 1 . a.
FUSIBILITÉ, divers degrés de fufihilité des métaux. Le
borax rend lesmétaux plus fufibles. VIL 393, b, Poye^FusiULC.
FUSIftLÉ, eprps fufibles par eux*mêmes; corps qui ne le
font que par un intermède, VI. 91 o .b , Corps qui, réfraébi-
res par eux-mêmes, deviennent fufibles avec d’autres de
même nature, 910, b, Différens degrés de fufihilité des métaux,
VIL 400, b. X, 4%8, b. Fuftbiuté des métaux par le feu
éleélrique, Suppl, II, 340, a.
FU SIL, ( A n milit. ) description des différentes pièces de
cette arme. Equipage du fufil. En 1704, les fufds ont com mencé
k être généralement établis dans les troupes. Corps
de troupes auxquels en étoit réfervé l'ufage avant cette époque,
Quelles furent les autres armes des fufiliers, Quant
aux rations qui firent quitter le moufquet pour Je fufil, voyti
Mousquet.
De la portée du fufil. On confidere dans la portée du fufil
la ligne de mire, la ligne de tire, de la courbe que décrit
la balle, VU. 393, b,
Fufil d portée de but en blanc, Le point où la ligne courbe
que décrit la balle, recoupe la ligne de mire, eft la portée
de l'arme à feu, le but en blanc. Ce point eft plus ou moins
éloigné h proportion de l'amplitude (le l'angle que forment
entre elles la ligne de mire de la ligne de tire, de en ration
de la force qui cbaffe le boulet, & de la longueur du
calibre. Moyen de calculer h quel endroit on doit trouver
le point de but en blanc. Ou recommande fouvent aux
troupes de vifbr vers le milieu du corps de l'ennemi. Rien
n’eft moins une loi générale que c e prétendu axiome, VIL
396, a. Détails fur la manière de virer à un but. La ligne
par laquelle un coup peut être lancé le plus loin pofiiblc, eft
la parabole qui formeroit à fe s extrémités un angle de 43
degrés avec l'horizon. Pourquoi les Perfes dont parle Xéno-
phon dans la retraite des dix mille, lançaient leurs fléchés
plus loin que les Grecs. D’où dépend la longue portée des
carabines, & celle des gilbes du maréchal de Puyfégur.
Avantage des premières notions des mathématiques pour les
militaires. Quelle eft la maniéré dont les ehaffeurs tirent au
gibier, Ibid, b,
Fufil, Sa portée poflible. Moyen de -reconnonre la plu»
grande portée poffmle d'une balle ou boulet. VU, 390» b,
Compenfation en progreffion depuis la plus grande portée
jufqué la plus courte, relativement à la longueur du call'
bre dans la projcélion qu’on veut employer. Les différens
calibres des armes ne font pas enfemble en même raifon de
leur diamètre h leur longueur, b e . Il eft difficile de déterminer
exactement une force proportionnelle A la mafte du
boulet dans Ihifagc de 1s poudre. Il n’y a pat une proportion
en progreffion connue, entre la force qui cliaffe les balles
ou boulets , de la longueur des calibres qui les dirigent.
QQQQ<I<H<I<I