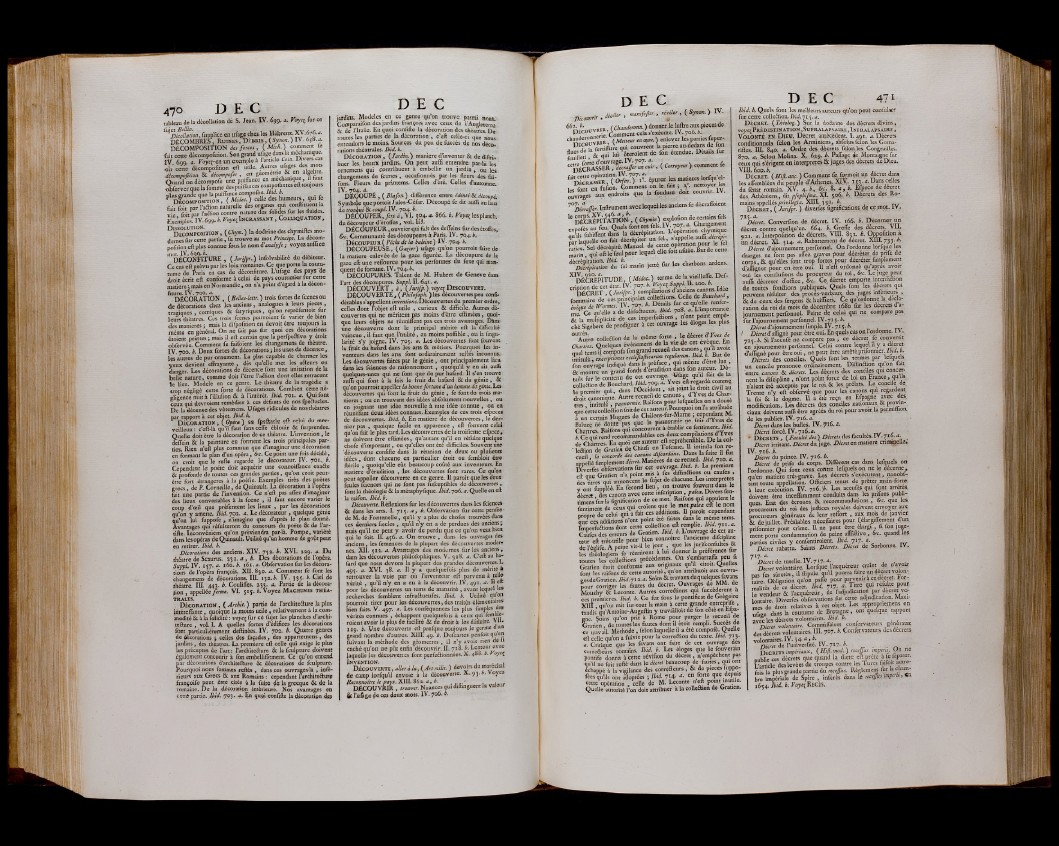
4 7 0 D E C
tableau de la décollation dé S. Jean. IV. 699. «. Koye{ fur ce
^ ‘¿foliation, fupplice en ufegechciles Hébreux. Xy.676.-r.
DÉCOMBRES, R u i n e s .Dé®*15 . (Synon. ) IV. éps.u.
DÉCOMPOSITION du forces , ( Mich. ) comment fe
fait cette décomposition. Son grand ufege dans la
IV 6oa a. Voyez-en un exemple a 1 arucle Coin. Divers cas
•où cette décompofuion eft unie. Autres ufages des mots
m Ê S ÿ , & aicompofcr, en géoméme & en algèbre
Onand on décompofe une puiflance en méchamque, il faut
omerverque lafomme deapSiffanc« compofantes eft toujours
dIus grande que la puiOEuiçe compoféo. lbtd. 4. .
D é c o m p o s i t i o n , ( Midtc. ) celle des humeurs, qui fe
fait foit par l’aâion naturelle des orapnes qui confiraient la
vie foit par l’aflion contre nature des folidesfur les flmdes.
IV. 699.4. MiyetlNCRASSANT , COUUQVATION ,
D DicoMPOSiTlON, (C/iya.) la doRrinedes chymilte modernes
fur cette partie, fe trouve au mot Principe. La décom-
pofition eft plus connue fous le nom à'analyfe ; voyez auifice
""DÉCONFITURE , ( Jurifpr.) infolvabfiité du débiteur.
Ce cas eft prévu par les loix romaines. Ce que porte la coutu-
tume de Paris en cas de déconfiture. L’ufage des pays 'de
droit écrit eft conforme à celui de pays coutumier iur cette
matière ; mais en Normandie, on n’a point d’égard à la déconfiture.
IV. 700. a. . e
DÉCORATION , ( BelUs-lcttr. ) trois fortes de lcenes ou
de décorations chez les anciens, analogues à leurs pièces,
tragiques , comiques & fatyriques, qu’on repréfentoit lur
leurs théâtres. Ces trois lcenes pouvoient le varier de bien
des maniérés ; mais la difpofition en devoir être toujours la
môme en général On ne fiut pas fur quoi ces décorations
étoient peintes; mais il eft certain que la perfpeétive y étoit
obfervée. Comment fe fàifoient les çhangemens de théâtre.
IV. 700. b. Deux fortes de décorations; les unes de décence,
les autres de pur ornement. La plus capable de charmer les
yeux devient effrayante, dès qu’elle met les afteurs en
danger. Les décorations de décence font une imitation de la
belle nature, comme doit l’être l’a&ion dont elles retracent
le lieu. Modèle en ce genre. Le théâtre de la tragédie a
trop négligé cette forte de décorations. Combien cette né-
glieencenuit à l’illufion & à l’intérêt. Ibid. voi. a. Qui font
ceux qui devroient remédier à ces défauts de nos lpeétacles.
De la déceneedes vêtemens. Ufages ridicules de nos théâtres
par rapport à cet objet. lbtd. b.
Quelle doit etre la oecoranon ae
deffein & la peinture en forment les trois principales par
ties Rien n’eft plus commun que d’imaginer une décoration
çn formant le plan d’un opéra, bc. Ce point une fois décidé,
on croit que le refte regarde le décorateur. IV. 7°i--
Cependant le poète doit acquérir une connoiffance exacte
& profonde de toutes ces grandesparries, qu’on croit peut-
être fort étrangères à la poéfie. Exemples tirés des poètes
grecs, de P. Corneille, de Quinault. La décoration à l’opéra
fait une partie de l’invention. Ce n’eft pas affez d’imaginer
des lieux convenables à la feene , il faut encore varier le
coup d’oeil que préfentent les lieux , par les décorations
qu’on y amene. Ibid. 702. a. Le décorateur , quelque génie
qu’on lui iuppofe , n’imagine que d’après le plan donné.
Avantages qui réfulteront au concours du poète & de far-
tille. Inconvéniens qu’on préviendra par-là. Pompe, variété
dans les opéras de Quinault. Utilité qu’un homme dé goût peut
en retirer. Ibid. b.
Décorations des anciens. XIV. 752. b. XVI. 229. a. Du
théâtre de Scaurus. 231. a , b. Des décorations de l’opéra.
Suppl. IV. 157. a. 160. b. 161. a. Obfervation fur les décorations
de l’opéra françois. XII. 830. a. Comment fe font les
çhangemens de décorations. III. 132. b. IV. 335. b. Ciel de
théâtre. III. 443. b. Couliffes. 233. a. Partie de la décoration
, appellée ferme. VL 5*5* é. Voyez Machines théa-
DêcÔration , ( Archit. ) partie de l’architeéhire la plus
idtéreffante, quoique la moins utile, relativement à la commodité
8c à la iplidité : voyei fur cé fujet les planches d’archi-
tefture , vol. L A quelles fortes d’edificcs les décorations
font particulièrement deftinées. IV. 702. b. Quatre genres
de décorations ; celles des façades, des appartemens , des
jardins, des théâtres. La première eft celle qui exige le plus
les préceptes de fart : l’architefture & la fculpture doivent
également concourir à fon embelliffement. Ce qu’on entend
par décorations d’architefture 8c décorations de fculpture-
Pourquoi nous foidmes reliés , dans ces puvrages-là , inférieurs
aux Grecs 8c aux Romains : cependant 1 architecture
françoife peut être citée à la fuite de la grecque 8c de la
romaine. De la décoration intérieure. Nos avantages en
cetté partie. Ibid. 703. 4. En qupi confiftc la décoration des
D E C
jardins. Modelés en ce genre qu’on trouve parmi nous.
Comparaifon des jardins françois avec ceux de l’Angleterre
& de l’Italie. En quoi confifte la décoration des théâtres. De
routes les parties de la décoration > c’eft celle-ci que nous
entendons le moins. Sources du peu de fuccès.de nos déco»
rations théâtrales. Ibid. b.
DÉCORATION, { Jardin. ) maniéré d’inventer 8c de diftrn
buer les. beaux jardin?- Qn peut auffi entendre par-là les
omemens qui contribuent à embellir un jardin , ou les
çhangemens de fcsnes, oçcafionnés par les fleurs des di-
fons. Fleurs du printems. Celles d’été. Celles d’automne,
IV. 704. a.
DÉCOUPÉ, ( Blafo.n) différence entre édenté8t.découpé.
Symbole que portoit Jules-Céfar. Découpé fe dit auffi au lieu
de tronbifé & coupé. IV. 704. b.
DÉCOUPER, fers à, VI. <04. a. 866. b. Voyeç lesplanch.
du découpeur d’étoffés, vol. IÎL
DÉCOUPEUR, ouvrier qui fait des deffeins fur des étoffes,
bc. Communauté des découpeurs â Paris. IV. 704. b.
D é c o u p e u r ( Pecht de la baleine ) IV. 704. b.
DÉCOUPEUSE, {Gabier) uiàge qu’on pourroit faire de
la matière enlevée de la gaze figurée. La découpure de la
gaze eft une reffource pour les perfonnes du fexe qui manquent
de fortune. IV. 704. b.
DÉCOUPURES. Talent de M. Hubert de Geneve dans
l’art des découpures. Suppl. II. 641. a.
DÉCOUVERT, à , ( Jurifp.) voyez D e s c o u v e r t .
DÉCOUVERTE , ( Philofopk. ) les découvertes peu confo
dérables s’appellent inventions. Découvertes du premier ordre,
celles dont 1 objet eft utile , curieux 8c difficile. Autres découvertes
qui ne méritent pas moins d’être eftimées, quoique
leurs objets ne réunifient pas ces trois avantages. Dans
une découverte dont le principal mérite eft la difficulté
vaincue, il fout que l’utifitè, au moins poffible, ou la Angularité
s’y joigne. IV. 705. a. Les découvertes font Couvent .
le fouit du haurd dans les arts 8c métiers. Pourquoi les inventeurs
dans les arts font ordinairement refiés inconnus.
Les découvertes foites par le génie, ont principalement lieu
dans les fciences de rationnement , quoiqu’il y en ait auffi
quelques-unes qui ne font que de pur hafard. Il s’en trouve
auffi qui font à la fois le fouit du hafard 8c du génie, 8c
qu’on pourroit appellcr la bonne fortune d’un homme da génie. Les
découvertes qui font le fouit du génie , fe font de trois maniérés
; ou en trouvant des idées abfolument nouvelles, ou
en joignant une idée nouvelle à une idée connue, ou en
réunifiant deux idées connues. Exemples de ces trois efpcces
de découvertes. Ibid. b. En matière de découvertes, le dernier
pas , quoique facile en apparence , eft fouvent celui
qu’on fait le plus tard. Les découvertes de la troifieme efpece ,
ne doivent être eftimées, qu’autant qu’il en réfulte quelque
chofe d’important, ou qu’elles ont été difficiles. Souvent une
’découverte confifte dans la réunion de deux ou plufieurs
idées, dont chacune en particulier étoit ou fembloit être
ftérile , quoiqu’elle eût beaucoup coûté aux inventeurs. En
matière d’érudition , les découvertes font rares. Ce qu’on
peut appeller découverte en ce genre. Il paroît que les deux
feules fciences qui ne font pas iufceptibles de découvertes,
font la théologie 8c la métapnyfique. Ibid. 706. a. Quelle en eft
la ration. Ibid. b.
Découverte. Réflexions fur les découvertes dans les fciences
& les arts. I. 715. a , b. Obfervation fur cette penfèe*
de M. de Fontenelle, qu’il y a plus de chofes trouvées dans
ces derniers fiecles , qu’il n’y en a de perdues des anciens ;
mais qu’il ne peut y avoir de perdu que ce qu’on veut bien
qui le foit. IL 436. a. On trouve , dans les ouvrages des
anciens, les femences de la plupart des découvertes modernes.
XII. 5x2. a. Avantages des modernes fur les anciens,
dans les découvertes philofophiques. V. 9x8. a. C’eft au lia-
fard que nous devons la plupart des grandes découvertes. I.
495. a. XVI. 38. a. Il y a quelquefois plus de mérite é
retrouver la voie par où l’inventeur eft parvenu à telle
vérité , qu’il n’y en a eu à la découvrir. IV. 491. a. fi eft
pour lés découvertes un tems de maturité , avant lequel lès
recherches femblent infry&ueufcs. Ibid. b. Utilité qu’on
pourroit tirer pour les découvertes, des traités élémentaires
bien faits. V . 497. Les conféquences les plus Amples des
vérités connues , échappent quelquefois à ceux qui femble-
roient avoir le plus de facilité 8c de droit à les déduire. Vil.
ÏX9. b. Une découverte eft prefque toujours le germe d’un
grand nombre d’autres. XIII. 49. b. Dcicartes penfoit qu en
Suivant la méthode des géomètres , il n’y avoir rien de fi
caché qu’on ne pût enfin découvrir. II. 710. b. Lenteur avec
laquelle les découvertes font perfectionnées. X. 488. b. Voyej
I n v e n t io n . . , , . ,
DÉCOUVERTE, aller à la, (Art milit. ) devoirs du maréchal
de camp lorfqu’il envoie à la découverte. 2Wÿj.rSj? oyez
Reçonnoîtrc le pays. XIII. 862. a, b. , i„„_
DÉCOUVRIR, trouver. Nuances qui diftinguent la valeur
& l’u&ge çle ces deux mots. IV. 706. b.
D E C
• JiciUr , manifefier.. Découvrir » <teceu , ; ^M t r , {Sy/im.) IV.
66a. b. , chauderonn. ) donner J e luftre aux piece&dc
DÉCOUV ’romment cela s’exécute. IV. 706. b.
chauderonneri • MeUeur en ^ ) enlever les parties fuper-
« qui couvrent la pierre.ru-dedjms de fon
feulîleti & qui lui ôteroient de fon étendue. Détails, fur
^DÉCRASSER» crajferuif cuir, ( Cuiroycur) comment fc
4p«r“ les matières lorfqu’el-
.« fonr en fofion &.mmenr on le foit ; «noyer t e
ouvrages sux endroits que 1a foudure don couvnr. IV.
7CpicrtPr. Infiniment avec lequel les anciens fe décraffoient
= ' « . S S i s r i A æ t a K i S
y Ê £ m m « matin jettl for les charbons ardens.
D£f-
Cnf)ÉCRET C Jurifpr. ) compilations ^anciens canot». Idée
fommaΫ de * ces priLpales concilions. Celle de Bcudmri,
■^ J, «formes. IV. 707. Détaüs for ce qu’elle renfermé
Ce qu’elle a de dèfeaueuit. Ibid. 708. a. L’importance
& ia miîriplici.é de ces impetfeaions. .font gprnt enapfe
ebé Sigébert de prodiguer à cet ouvrage les éloges les plus
0UAutW colleélion de la mêmej forte , le décret d’Tv« *
Chartres Ouelques événemens de la vie de cet éve^nie. En
intitulé. exccrptioncs eccleftafticamm regularum. Ibid. b. Rut de
fon ouvrage indiqué dans la oréfece, qui même d être lue ,
& montre un grand fonds d’érudmon dans fou auteur. Dé-
tails for lé contenu de cet ouvrage.'Ufagc qu il fait de la
“ ïeftion de Bouchard. I4W.7° 9- “■ Yves ett regardé commS
fe otemier qui, dans l’Occident , an lOint le drou c.vil au
le premi q , reçueil de canons, d Yves de Charm
f hitituli , 'pannormic. Raifons pour lefque»cs on a douté
„ “ cette colleâfon foit de cet ameur.Pourquoi on 1 a attribuée
ï ï n certain Hugues de Çhâlons-fur-Mame ; cependant M.
Baüfoé qè doute pas que la pa«orm.e ne foit d’Yves de
Chantes. Raifons qui conconrent à étabhr ce fennment. lbtd.
S p reeommandables ces dona compílanos d Yves
“ a ” t concorde des canons difcorddns. Dans la fuite U fut
..lia Umnlimeni décris. Matières de ce recueil. Ibid. 710. a.
Biverfes o^fervatioiis for cet ouvrage. b. La première
eft que Gratien n’a point mis à les diAnAons on caufes ,
des rares qui annoncent le fujet de chacune. Les interpretes
V ont fupplié. En fécond Ben, on trouve fouvent dans le
Jécret, Ses canons avec cette infcnpnon, palta. Divers fen-
timens fur la fignificatlon de ce mot. Raifons qu. appmentle
fentiment de ceux qui croient que le mot palea eft le nom
oroore de celui qui a fait ces additions. Il parott cependant
que ces additions n’ont point été fanes dans le meme tems.
Jmncrfeffions dont cette colleSion eft remplie, lbtd. p u . a.
Caufes des errenrs de Gratien. lbtd. b. L ouvrage de cet au-
teur eft très-urile pour bien conno,.re ’ancienne fefçipbne
del’égUfc. A peine viril le iont , que les ratifconfelies &
les théologiens fe réunirent i lm donner U préférence fur
toutes les colleôions précédentes. On s e^arraffa peu fi
Gratien étoit conforme aux originaux quil citoit. Quelles
foqt les raifons de cette autorité, qu on attnbuoit aux ouvra-
gesdeGratien./éii/.7ia.q. Soins &travauxdeqnelqurafevans
pour corriger les .fentes du décret. Ouvrages de MM. de
Mouchy & Leconte. Autres correâions qui foccéderent à
ces premières. Ibid. b. Ce fin fous le ponuficat de Grégoire
XIII qu’on mit fur-tout la main à cette grande entrepriie ,
tandis qu’Antoine-Auguftin y travaillóit de fon coté en Llpa-
ene. Soins qu’on prit 1 Rome pour purger le recueil de
Gratien de.tomes les fentes dont il étoit rempb. ouccés ne
ce travail. Méthode, félon laquelle il a été compofé. Quelle
eft celle qu’on a foivie pour la correftion du texte. Ibid. 713.
a. Critioue que les fcvans ont faite de cet ouvrage des
correaèurs romains. W - b. Les éloges que le fouveram
pontife donna à cette révifton du décret, nempêchent pas
qu’il ne foit tefté dans le dicte t beaucoup de fautes, qui ont
échappé à 1a vigilance des correfieurs , & de pièces foppo-
fecs qu'ils ont adoptées ; Ibid. 714. *■ =" ,f°rte que depuis
cette opération , celle de M. Leconte n eft pomt inutile.
Quelle autorité l’on doit attribuer à la collcâxon de Gratien.
D E C 4 7 1
Ibid. b.. Quels font les meilleurs auteurs qü’on peut confulter
fur cette collection. Ibid.
DÉCRET. ( Thiolog. ) Sqr la dodrine des décrets divins*
voycç Prédestination, Su pralap s aire , In f r a l aps aire >
VOLONTÉ EN, Dieu, Décret antécédent. 1. 401. ¿. Décrets
conditionnels félon les Arminiens,, abfolps. félon les Goma-
riftes. Bit 840. a. Ordre, des. décrets, félon lés Congruiftes.
8 70 , a. Selon Molina. X . 629. b. Paftage ^e.Mpntaignefur
ceux qui s’érigent en interprètes & juges des, décrets de Dieu.
VIIL 6oQ~,b, g ^ ,
D é ç r ix (Hifl.anc. ) Comment fe formoit up décret dans
les aftemblées du peuple d’Athènes, XIX- iÇ3-a-Dans celles
du fénat. romain. XV. 4-b , S. a ,b . Éfreçe de décret
des. Athéniens., àit pfephifrta. Xj. ç.o6. b. Décrets des Romains
appellés privilégia. XlIL 391. b.
D é c re t, (.Jurifpr. ) diverfes fignifications.de ce mot. i v .
^ !Décret. Converfton de décret. IV. 166. b. Décerner un
décret contre quelqu’un. 664.. b. Greffe des décrets. VIL
921. a. Interpofition de décrets. VIII. 822. b. Oppofitiona
un décret. XL 514. a. Rabattement de décret. XIU.733. A
Décret d’ajournement perfonneî. On l’ordonne lorfque les
charges ne font pas affez graves ppui décréter, de prife de
corps, 8c qu’elles font trop fortes .pour décréter Amplement
d’affigner pour en être oui. Il n’eft ordonné qu’après avoir
•'oui les conclurions du procureur du roi, 6*c. Le juge peut
aufli décréter d’office, 6-c. Çe. décret emporte mterdiètion
de toutes fondions publiques. Quels font les Çècrets qui
peuvent réfulter des. proces-v.erbaux des juges inférieurs ,
& de ceux des fergens &, hniffiers, Ce qu ordonne la déclaration.
du roi du mois de décembre 1680 uir; les décrets da-
journement perfonneî. Peine de celui qui ne compare pas
fur l’ajournement perfonneî IV. 715 . b.
Décret d’ajournement Ample. IV. 71 b.
/ Décret d’affigné pour être oui. En quels cas Ortl ordonne. IV.
713. b. Si l’accùfé ne compare pas, ce décret le convertit
en ajournement perfonneî Celui contre lequel il y a décret
d’afliené pour être oui, ne peut être arrêté prtionmer. Ifcd. b.
Décrets des conciles. Quels font les termes par lefquels
un concile prononce ordinairement Diftincuon quon tait
entre canons 8t décrets. Les décrets des cpnciles qui concm--
nent la dticipline , n’ont point force de loi en France, qu Us.
n’aient été acceptés par le roi 8t les. prélats. Le concile de
Trente n’y eft obfervé que pour les canons qui regardent
la foi & le dogme. Il a été reçu en Efpagne avec des,
modifications. Les décrets des conciles nationaux 8c provinciaux
doivent auffi être agréés dp roi pour avoir la permifiion
de les pubtieri IV. 716. a.
Décret dans les bulles. IV. 716.4.
Décret forcé. IV. 716.4. ,
i DÉCRETS, ( Faculté des") Décrets des facultés. IV. 716. a.
Décret irritant. Décret du juge. Décret en matière crimmeUe.
IV. 716. i .
Décret du prince. IV. 716. b.
Décret de prife de corps. Différens cas dans lefauels on
l’ordonne. Qui font ceux contre lefquels on ne le décerne ,
qu’en matière très-grave. Les décrets s’exécutent, nonobf-,
tant toute appellation. Officiers tenus de prêter mam-forte,
à leur exécution. IV. 716. [b. Les accufés qui font arrêtés,
doivent être inccffarament conduits dans les priions pubu-
ques. Etat des éeroues. & recommandations , (rc. que les
procureurs du roi des ¡uftices royales doivent envoyer aux
procureurs généraux de leur reffort , aux mois de janvier
& de iulUet. Préalables nèceffeites pour CêUrgifrement d’un
prifonnier pour crime. Il ne peut être élargi, n fon jugement
porte condamnation de peine affliftive, vc. quand les
parties civiles y confentiroient. Ibid. 717. a.
Décret rabattu. Saints Décrets. Décret de Sorbonne. IV.
717. 4.
Décret de tutelle. IV. 717. a.
Décret volontaire. Lorfque l’acquéreur cramt de U?voir
oas fes sûretés, il (lipide qu’il pourra fetre qn décretyolon-,
raire. Obligation qu’on pafle pour parvenir é ce décrep |ér-
ü,lT;s. de ce décret. Ibid. 7.7. « Titre qtu réfulte pofe
fe vendeur & l’acquéreur, de l'adjudication par décret volontaire.
Diverfes obfervadons fer cette adjudication. Maxt-
mesde droit relatives à cet objet. Les appropnemens en
uf“ dans U coutume de Bretagne, ont quelque rapport
avec les décrets volontaires. lbtd. b.
Dicta volo nta ire . Commiffaites confervateurs gênétamç
des dècre» volontaires. III. 707. b. Confervateurs des décrets
volontaires.IV. 34 n. b.
niera de l’umverfité. IV. 7 1 7 . b.
DÉCRETS implriaux, {Hift.mod.) rcccJTiis tmperu. On ne
oublie ces décrets que quand la diete eft prête à te leparer.
l ’articfe des levées de troupes contre les Turcs fetfeit am»-
fois la plus grande partie du rcccffus. Réglemei» fer la ch ~
bre impériale de Spire , inférés dans le rcccjfps tmpatt ,*n
1654. Ibid. b. Foyci Recès.