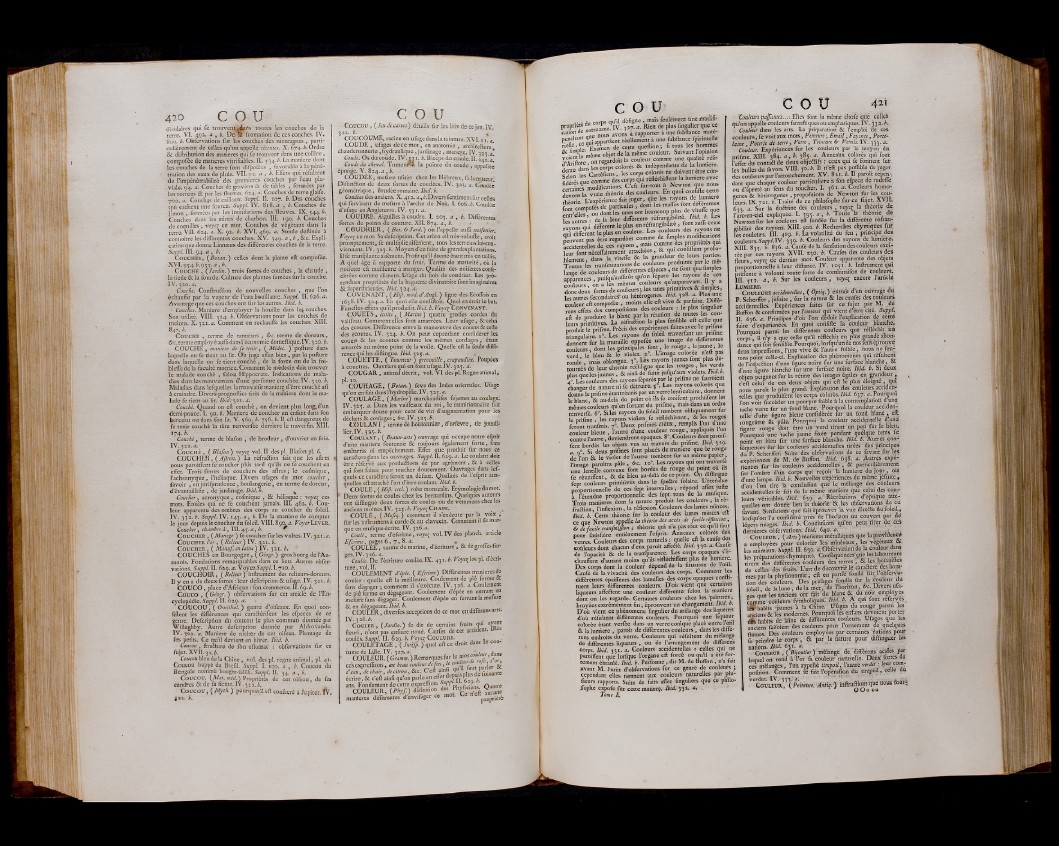
4 ^ 0 COU tiiculaires qui fë trouvent appris toutes les couches de la
terre. VI. 492. a , b. De la formation de ces couches. IV.
"¿op. b. Obfervations fur les couches des montagnes, particulièrement
de celles qu’on appêÎIe;récentes. X. 674. ¿.Ordre
8c diftribution des matières qui fe trouvent dans une colline,
compofée de matières vitrifiables. II. 534. b. La maniéré dont
les couches de la terre font difpofèes , favorable h la pénétration
des eaux de pluie. VII. 9?. 4 , b. Effets qui réfultent
de l’impénétrabilité des premières couches par l’eau plu-
. viale. 94. a. Couches'de graviers & de fables , formées par
les torrens 8c par les fleuves. 624. a. Couches de terre glaife.
700. a. Couchgs de cailloux. Suppl. II. 107. b. Des couches
qui cachent une fource. Suppl. IV. 818. a , b. Couches de
limon , formées par les inondations des 'fleuves. IX. 544. b.
Couches dans les mines de charbon. III. 100. b. Couches
de coquilles, voyez ce mot. Couches de végétaux dans la
terre. VII. 624. a. X. 92. b. XVI. 469. a. Sonde deftinée a
connoître les différentes couches. XV. 349. a , b, 8cc. Explication
que donne Linnæus des différentes couches de la terre.
Suppl. III. 94. a , b.
C o u c h e s , (Bot an.) celles dont la plante eft compofée.
XVI: 954. ¿.95 5. à i b.
C o u c h e , ( Jardin.) trois fortes de couches , la chaude ,
la tiede 8c la fourde. Culture des plantes femées fur la couche.
IV. 320. a.
Couche. Conftruôion de nouvelles couches , que l’on
échauffe par la vapeur de l’eau bouillante. Suppl. II. 626. a.
Avantage que ces couches ont fur les autres, Ibid. b.
• Couches. Maniéré d’employer la houille dans Ieîjj couches.
Son utilité. VIII. 324. b. Obfervations pour les couches de
melons. X. 321.4. Comment on rechauffe les couches: XIII.
847. b.
C o u c h e , terme de tanneurs, &c. terme de doreurs,
6-c. terme employé auffi dans l’économie domeftique.IV. 320. b.
COUCHÉ , maniéré de je tenir, (Médec. ) po.fture dans
laquelle on fe tient au lit. On juge affez bien, par la pofture
dans laquelle on fe tient couché 1 de la force ou de la foi-
bleffe de la faculté motrice. Comment le médecin doit trouver
le malade couché , félon Hippocrate. Indications de mala-
’ dies dans les mouvemens d’une perfônne couchée. IV. 320. b.
Maladies dans lefquelles la mauvaife maniéré d’être couché eft
à craindre. Divers prognoftics tirés de la maniéré dont le malade
fe tient au lit. /¿/4/321. a.
Couché. Quand on eft couché, on devient plus long, d’un
demi-pouce. I. 90. b. Maniéré de coucher un enfant dans fon
berceau ou dans fon lit. V. 569. b. 756. b. Il eft dangereux de
fe tenir couché la tête renverfée derrière le traverfin. XIII.
*74* Ü
Couché, terme de blafon , de brodeur, d’ouvrier en foie.
IV. 321.4.
C o u c h é , ( Blafon ) voye^ vol. II des pl. Blafon pl. 6.
COUCHER, ( Ajiron. ) La réfraâion fait que les aftres 1
nous paroiffent fe coucher plus tard qu’ils ne fe couchent en
effet. Trois fortes de couchers des aftres; le cofmique,
l’achronyque, l’héliaque. Divers ufages du mot coucher ,
favoir , enjurifprudence, boulangerie, en terme de doreur,
d’évantaillifte , de jardinage. Ibid.b. | v
Coucher, acronyque, cofmique , 8c héliaque : voyez ces
mots. Etoiles qui ne fe couchent jamais. III. 462. b. Cou- 1
leur apparente des ombres des corps au coucher du foleil.
IV. 332. b. Suppl. IV. 143.4, b. De la maniéré de compter
le jour depuis le coucher au foleil. VIII. 890. a. Voyer L e v e r .
Coucher, chambre à , III. 45.4, b. *
C o u c h e r , ( Manche ) fe coucher fur les voltes. IV. 3 2 1 .4 .
C o u c h e r / ’o r , ( Relieur| IV. 3 2 1 . b.
C o u c h e r , ( Manuf. en laine ) IV. 321. b.
COUCHES en Bourgogne , ( Géogr. ) gros bourg de l’Au-
tunois. Fondations remarquables dans ce lieu. Autres obfervations.
Suppl. II. 629.4. Voyez Sapp/.I. 710. b.
• COUCHOIR, (Relieur} inftrumént des relieurs-doreurs.
Il y en a de deux fortes : leur defeription 8c ufage. IV. 321. b.
COUCO, place d’Afrique : fon commerce. IL 69. b.
Co’uco , (Géogr. ) obfervations fur cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. II. 629. 4.
COUCOU, ( Omithol. ) genre d’oifeaux. En quoi con-
fiftent les différences qui caraélérifent les efpeces de ce
genre. Defeription du coucou le plus commun donnée par
Willughby. Autre defeription donnée par Aldrovande.
IV. 3*12. 4. Maniéré de nicher de cet oileau. Plumage de
fes petits. Ce qu’il devient- en hiver. Ibid. b.
Coucou, ftruclure de fon eftomac : obfervations fur ce
fujet. XVII. 32. b. .
Coucou bleu de la Chine , vol. des pl. regne animal , pl. 41.
Coucou huppé du Brefil. Suppl. I. 100. a , b. Coucou du
Bengale nommé bought-follik. Suppl. II. 34. a , b.
CO U C O U . ( Mat. méd. iriétés (0 Propriéi de cet oifeau, de fes
_.__r IV. 322.*.
C ou cou , (Myth. ) pourquoi il eft confacré à Jupiter. ÍV.
¿22. b.
cou COUCOU, (Jeu de cartes) détails fur les loix de ce jen. IV.
322. b. _ . |
COUCOUME, racine en ufage dans la teinture. XVI. u . a%
COUDE , ufages de ce mot, en anatomie , archiie&ure *
chauderonnerie, hydraulique » jardinage, manege. IV. 323.4*
Coude. Os du coude. IV. 531. b. Biceps du coude. II. 241.V
Coude du cheval. Tumeura la pointe du coude , appeliée
éponge. V. 824. a , b.
COUDÉE, mefure ufitée chez les Hébreux, fa longueur."
Diftinftion de deux fortes de1 coudées. IV. 323. 4. Coudée
géométrique, Îoudée romaine. Ibid. b.
Coudées des anciens. X. 412. a, b. Divers fentimens fur celles
qui fervirent de mefure à l’arche de Noè. I. 606. b. Coudée
d’ufage en Angleterre. IV. 531. a.
COUDRE. Aiguilles à coudre. 1. 203. a , b. Différentes
fortes de points de couture. XII. 874. 4, b. •
COUDRIER, I Bot. 6* Jard. ) on l’appelle aufli noifettier.
Voye3; ce mot. Sa defeription. Cet arbre elt très-robufte, croît
promptement, fe multiplie aifément, tous les terreinslui-con-
viennent. IV. 323 .b. Moyen d’en faire de grandes plantations.
Il fe tranfplante aifément. Profit qu’il donne étant mis en taillis.
A quel âge il rapporte du fruit. Terme de maturité, ou la
tioilette eft meilleure à manger. Qualité des noifettes confi-
dérées comme alimens. Ulage du bois de coudrier. Les prétendues
propriétés de la baguette divinatoire font imaginaires
& fuperititieufes. Ibid. 324.4.
COVENANT, ( Hijl. mod. d’Angl. ) ligue des Ecoffois en
1638. IV. 324.4. En quoieile connftoit. Quel en étoit le but.
Funeftes effets qu’il produifit. Ibid. b. Voyeç C o n v e n a n t .
COUETS, écoits, (Marine) quatre groffes cordes du
vaiffeau. Comment elles font amarrées. Leur ufage, & celui
des écoutes. Différence entre la manoeuvre des couets& celle-
des écoutes. IV. 324. b. On peut cependant confidérer les
couets & les écoutes comme les mêmes cordages, étant
amarrés au même point de la voile. Quelle eft la feule différence
qui les diftingue. Ibid. 225.4. .
COUETTE, ( Tourneur ) grenouille, crapaudine. Poupées
à couettes. Ouvriers qui en font ufage. IV. 32ç. 4.
COUGAR, animal décrit, vol. VI des pl. Regne animal,"
pl. 10.
COUHAGE, (Botan.) feve des Indes orientales. Ufage
qu’on en fait dans l’hydropifie. IV. 325.4.
COULAGE, (Marine) marchandifes fujettes au coulage."
IV. 325. 4. Dans les vaiflèaux du roi, le munitionnaire lait
embarquer douze pour cent de vin d’augmentation pour les
déchets.8c coulages ; &c. IV. 325. b.
COULANT, terme de boutonnier, d’orfevre, de jotiail-
lier.IV. 323. b. .
C o u l a n t , ( Beaux-arts) ouvrage qui occupe notre efprit
d’une maniere foutenue 8c toujours également forte, lans
embarras ni empêchement. Effet que produit fur nous ce
caraélere dans les ouvrages. Suppl. II. 629. a. Le coulant doit
être réfervé aux produirions ae pur agrément, 8c à celles
qui font faites pour toucher doucement. Ouvrages dans lef-
quels ce cara&erc feroit un défout. Qualités de l’efprit auxquelles
eft attaché l’art d’être coulant. Ibid. b.
COULE, ( Hijl. eccl.') robe monacale. Etymologie du mot."
Deux fortes de coules chez les bernardins. Quelques auteurs
ont diftingué deux fortes de coules ou de vêtemens chez les
anciens moines.1V. 323. b. Voye^C h a p e . . ,
COULÉ , ( Mufiq. I comment il s’exécute par la voix
fur les inftrumens à corde 8c au clavecin. Comment il fe marque
en mufique écrite. IV. 326.4.
Coulé y terme d’eferimet voye{ vol. IV des planch. article
Efcrime y pages 6 , 7 , 8. 4. * ■
COULÉE, terme de marine, d’écriture, 8cdegroflesror-
ges. IV. 326.4. ' ..
Coulée. De l’écriture coulée. IX. 431. b. Vjye{ les pl. d écriture,
vol. II. . ,
COULEMENT d'èpèe. ( Efcrime) Différentes manieres de
couler : quelle eft la meilleure. Coulemeñt de pié ferme 8c
fans dégager ; comment il s’exécute. IV. 226. a. Coulement
de pié ferme en dégageant. Coulement d’épée en entrant en
mefure fans dégager. Coulement d’épée en ferrant la mefure
8c en dégageant. 7¿i</. ¿. ,
COULER, diverfes acceptions de ce mot endifférensarrs.
IV. 32 6.b. . |S I
C o u le r , (Jardin.) fe dit de certains fruits qui ayant
fleuri, n’ont pas enfuite noué. Caufes de cet accident,
coulés. Suppl. II. ¿29. f j V oye{ Coulure. , .
COULETAGE, ( Janfp. ) quel eft ce droit dans 1* cou.
tume de Lille. IV. 327*4. J ,Une
COULEUR. ( Gramm. ) Remarques fur le É K «
ces expreflions, un beau couleur de feu y le coU,‘!lç „ jer &
écrire, 8c c eft ainfi qu on parle en ettet 9 ,
ans. Fondement de cette expreffion. Supp • • 9- • q ^
COULEUR, (Phyf.) définmon des .. oneufie
manieres différentes d’envifager ce mot. Ce n’eft aucune,
propriété
COU , 1J . « s ou’il dSfigne , niais feulèhtent une mudifi-
propnW“ 1' .vj.a . Rien de plus fingulierque «
cation de non s à rapporter à une fubftance mate-
E'"0113”' 3“ -, apparient réellement à une fi&ftance ï f f l g g g
neUe,çequi Kr queftion; fi tous les hommes
& S e 'm t T o b i e . de la même couleur. Suivant -oninmU
S o t e onreaardoitla couleur comme une qualité réfi-
In té dans les corps coloris & indépendante de la lumière.
■ H s Cartéfiens, les corps colorés ne doivent etre cdn-
Idé°rés nue comme dés corps emi réfléchiffenr la lumière avec
lidcres q rions> C’eft fur-tout à Newton que nous
f a a p vraie théorie des couleurs. En quoi confifte cette
. 7 ”! l ’pvnéricnce fait iueer, que les rayons de humere
fom’eompofés de particules > dont les maffes font différentes
ent ' S ou donï les unes ont b“ «“ »P|!.us.de,^‘ei e f '
îinmres • delà leur différente rèftangibilité. M & M 5
H différent le plus en réfrangibilité , font auffi ceux
S dffierent le plus en couleur. Les couleurs des ravons ne
S v em p i être regardées comme de fimples modihcations
B o B de ces ravons. mais Comme des propriétés qui
Lm f o é f n t^ em c ^ attéchées, & qui cou dient proto-
blcmcnt 9 dans la viteffe & la grandeur .de leurs parues.
Toutes les manfmutations de couleurs prodmtes par le mè-
lange de couleurs de différentes efpeces , ne font que fimples
amunences , puifqu’auffitôt qu'on fépare les rayons de ces
couleurs » i n a les mêmes couleurs qu'auparavant II y a
donedeux fortes de couleurs ; l e s - F —
les autres fecondaireS'ou hétérogènes. O M H j l f-, P1“iS? ,e
couleur eft compofée, moins elle eft vive & parfiute. Diffé-
rens effets des compofidons des couleurs : le plus fingulier
eft de produire le blanc par la réunion de toutes les couleurs
primitives. La réfraftion la plus fenfible eft celle.3“ê
produit le prifme. Précis des expénences ffinesavec le pnfme
triangulaire. l ”. Les rayons du foled traverfant un pnfme
donnent fur la muraille oppofée une image de
couleurs, dont les principales font, le rouge , Je Jaune, le
verd, le bleu & le violet. 1°. L’image colorée n eft pas
ronde, mais oblongue. 3°. Lés rayons jaunes font plus dé-
tournés de leur chelrin reffiligne que les ;rouges les verds
plus que les jaunes , & ainfi de fuite jufqu aux viole».
Les couleurs des rayons féparés par le prifme ne faurOient
changer de nature ni fe détruire. 3". Les rayons colorés que
donne le prifme étantréunis par un verre lenticulaire, donnent
le blanc, bt au-delà du point ou ilsfe croifent prodüifentles I
mêmes couleurs qu’en fortant du prifme, mais dans un ordre
renverfê 6°. Si les rayons du foleil tombent obliquement fur I
le prifme, les rayons violets fe réfléchiront, 6c les rougeä I
feront tranfmis. 7". Deux prifmes creux, remplis un d une
couleur bleue , l'autre d’une couleur rouge, apphqués lun
contre l’autre, deviendront opaques. 8 . Couleurs domparoif-
fent bordés les objets vus au travers du pnfine. Ibid. 329.
. Si deux prifmes font placés de maniéré que le rouge
de l’un 8c le violet de l’autre tombent fur un même papier,
l’image paraîtra pâle, fo. 10". Les rayons qu. onttraverfé
une îenuUe convexe font bordés de rouge du point ou ils
fe réunifient, 8c de bleu au-delà de ce point. On diftingue
fept couleurs primitives dans le fpeftre folaire. Léteddue
proportionnelle de ces fept intervalles, répond aflKtufte
à rétendue propordonnelle des fept. tons de la mufique.
Trois maniérés dont la nature produit les couleurs, la ré-
fraftion, l’inflexion, la réflexion. Couleurs des lames minces.
Ibid. b. Cette théorie fur la couleur des lames nnnees elt
ce que Newton appelle la thimt dis accis de facile réflexion,
& de facile'tranfitiijlon ï théorie qiii n’a pas tout ce qu il laut
pour fatisfaire entièrement l’efprit. Anneaux colorés des
verres. Couleurs des corps naturels : quelle eft la caufe des
couleurs dont chacun d’eux parait affefté. Ibid. 330. a. Cauie
de l’opacité 8c de la tranfparence. Les corps opaques Réchauffent
d’autant moins qu’ils réftéclnffent plus de lumière.
Des corps dont la couleur dépend de la fituanon de 1 ceiL
Caufe de la vivacité des couleurs des corps. Comment les
différentes épaiffeurs des lamelles des corps opaques conlti:
tuent leurs différentes couleurs. D’où vient que certaines
liqueurs affeôent une couleur- différente' félon la mamere
dont on les regarde. Certaines couleurs chez les peintres i
broyées extrêmement fin, éprouvent un changement! Ibid. b.
D’où vient ce phénomène fingulier du mélange des liqueürS
.d’où réfultent différentes couleurs. Pourquoi Une liqueur
colorée étant verfée dans un verre conique placé entro l’oeil
& la lumière , paroît de différentes couleurs , dans les diffé-
rens endroits du verre. Couleurs qui réfultent du mélange
de différentes liqueurs , ou de l’arrangement de différens
corps. Ibid. 331. 4. Couleurs accidentelles^- celles qui né
paroiffent que lorfque l’organe eft forcé ou qu’il a été fortement
ébranlé. Ibid. b. Perfonne, dit M. de Buffon, nafoit
avant M. Jurin d’obfervations fur ce genre de couleurs j
cependant elles tiennent aux couleurs naturelles par plu-
fieurs rapports. Suite de faits affez finguliers que ce philo-
ibphe expofe fur cette maûerç. Ibid, 33 a. 4,
Tome i.
COU CdulêùrS pajfahles.. ■. -. Elles font la même ch’ofe qtVè célleS
qu’on appelle couleurs fontaftiquesouemphatiqües.IV. 332. b.
- Couleur dans les arts. La préparation & l’empldi 'ae ces
couleurs, fe voit aux möts j Peinture-y Émail ; Fayence , Porcelaine
y Poterie de terre * Verre, Teinture 6* Vernis. IV. 3^3. a.
Couleur. Expériences fur les couleurs par le ‘moyen du.
prifme. XIII. 384. a ,b . 3851 é. Anneaux colbrès qui font
feffet du contai! de deux objeéHfs : ceux qui fe forment fut
les bulles du favom VIII. 301 f U n’éft pas poffible de juger
des couleurspar l’attouchemertt. XV. 821. ¿. Il paroit cepen-,
dant que chaque couleur particulière a fön efoece de mdeffé
ou d’apreté au fens du toucher. I. <¡61.0. Couleurs homogenes
8c hétérogènes, propofitiotis de Newton flir les cou-
leurs; IX. 721. ¿. Traité de ce philofophe fur ce fujet. XVIL
623. 4. ¿ur la doôrine des couleurs , voye{ la théorie de
l’arc-en-ciel expliquée. I. '595,. a , b. Totite lâ théorie dé
Newton fur les couleurs eft fondée fur la différente réfran-
eibilitô des rayons. XIII. 96p. b. Recherches cliymiqiies fui.
les couleurs; III. 419. ¿- La volatilité dü feu ; principe dei
couleurs;Suppl.IV. 339. b. Couleurs des rayons de lumière.
XIII. 833. b. 836. 4. Caufédela fenfation des coùleurs excitée
par Ces rayons. XVII. 23Ö; ¿¿ Caufes des couleurs des
fleurs voyer ce dernier mot. Couleur apparente des objets
proportionnelle à leur diftance. IV; io çi. b. Inftrumént qui
prélente à volonté toute forte de combipaifon de Couleurs.
III. 511. 4, b. Sur les couleurs , voyc{ encore l’articlé
LUMIERE; . il •. ’ i i
Couleurs accidentelles, ( Ôpttq.) extrait dun ouvrage dit
P. Scherffer, jéfuite i fur la nature 8c les caufes des couleurs
accidentelles; Expériences faites fut ce fulet pàr M. dé
Buffon 8c confirmées par l’auteur qui vient d être cité. Sùppl.
II. 636. 4. Principes d’où l’on déduit l’explication de cette
fuite d’expériences; En quoi codfifte la cöuleur blâncfié.
Pourquoi parmi lès différentes couleurs quë réfléchir tui
corps il nV à que celle qü’il réfléchit en pliis grande abondance
qui foit fenfible. Pourquoi, lorfau’unde nos feris êprouyp
deux impreflionsi l’une vive 8c l’autre foible, hous ne tentons
point celle-ci. Explication des phénomènes qui rèfultertt
de l’infpeétion d’une figure noire fur une furface blanclie , «
d’une figufe blanche iur une furfoce noire; Ibfd. b. Si deüx
objets peignent fur la rétine des images égalés én graftdèur ?
c’eft celui de ces deux objets qui eft le plus éloigné j Qui
nous paroît le plus grand; Explication des couleurs, acfcideh-
tclles que produlfent les corps colofés. Ibid. 637; a. Pourquoi
l’on voit fuccéder un pourpre foible à la cohtemplaüott d und
tache verte fur un fond blanc. Pourquoi la côuléur accideri-
telle’ d’uhe figure bleue confidêrée fur Un fond blanC , elt
rougeâtre 8c pâle/ Pourquoi la couleur accidentelle d,utfé
figure rouge doit être un verd tirant un peli llir le bleli.
Pourquoi une tache jaune fixée peridant quélque tehis le
peint en bleu fur une furfoce blanche. Ibid. b. Autrés çon-
féquences fur les couleurs accidentelles tiréës des principes
duP Scherffer. Suite dés çbfejwations de ce fovant fur les
1 expériences de M: de Büffon. ‘ Ibid. : 638. 4; Autres expériences
fur lès couleurs accidentelles , 8c particulièrement
fur l’ombre d’un corps qui reçoit ' là lumière du jôür, oii
d’une lampe. Ibid. b. Nouvellès expériences du même jéfpite ,
d’où l’on tire la conclufion què le; mélange dés couleurs
accidentelles fe fait de la même manière que celtu des coin I leurs véritables. 'Ibid. ‘ 639! a.1 Récréations doptiqûe auxquelles
ont donné' lieti la théorie* 8c .les ôbfervationS de c?
favant. SehfatiÔft's que’ foit èpfduvër la vue direfte dû loleil * I lotfqu’on l’a confidèré près de l’horizon qu côuVjert par de
f légers- nuages. Ibid. b. Cohctafioni'^ü^ c â II d• erCnoieurelse uobrf e, r(v aAtriotns)s :h Iiabtiidë:r è6s4 m0:é taa.l liq'ü çS que alau piirMovSijdi eanqcae I a employées pour coloriér lés' minéraux , les végétaux II lleess apnriémpaaurxa-t.i-o Snusp cphl:y mHi. q6u3eps.. ¿ÇJoOnbfféeqfuväètritocneMrqed ela l.eÇfp lÿiioguurrdeaunr?s I tirent des différentes couleurs des. terres .,
1 de celles des fruits. L’art de décoiiyrii; lé càm^érë des ho;m»
1 mes par la phyfioiiomie; eft en partfe" fondé für 1 pbferya-
tion des couleurs. Des préfages fondés fur. la .Couleur du
I foleil, de la lune-, délia nier,"de l’horizon, ¿*c..DiV.ersufa-
ees que les anciens ont fiji^du blanc 8c du n6ir,,empl(jy|s
conime côüleùfs' fÿhjboliijueS: Ibid, b. A qm fönt rèfervès.
lSF habits m m à la Chine, j Ufages du rouge .parmi lgs
1 anciens 8c les modernes. Pourquoi lés enfons devoient porte?
1 dis habits de laînè de différentes'couleurs. Ufages que les
] anciens faifoient des couleurs pour l’ornement de quelque?
j ftâtues! Dés côulëurs employées par certaines nations poui*
I fe peindre le corps , - 8c par la nature pour diftinguer les
1I nations. Ibid. 03i» 4. .... r,., I . C o u l e u r , ( Bijoutier ) mélange de. différens acides par II lceeqsu mel éolann greesr t,d là’u nl’ oarp pfael 'lcèo ulilnepuor iln aturelle.v érdel i lefôurri ecso mde- I pofition. Comment le foit l’opérâtlon du".titepoil, celle du
I verdet. .• ii^y-a. ’ V • . , I H H n H
j C o u leu r , (Peinture, Ariiiq:')' inftruftions qtie rrôüs foùi:-;
1 9 v 1 * O O 0 0 0