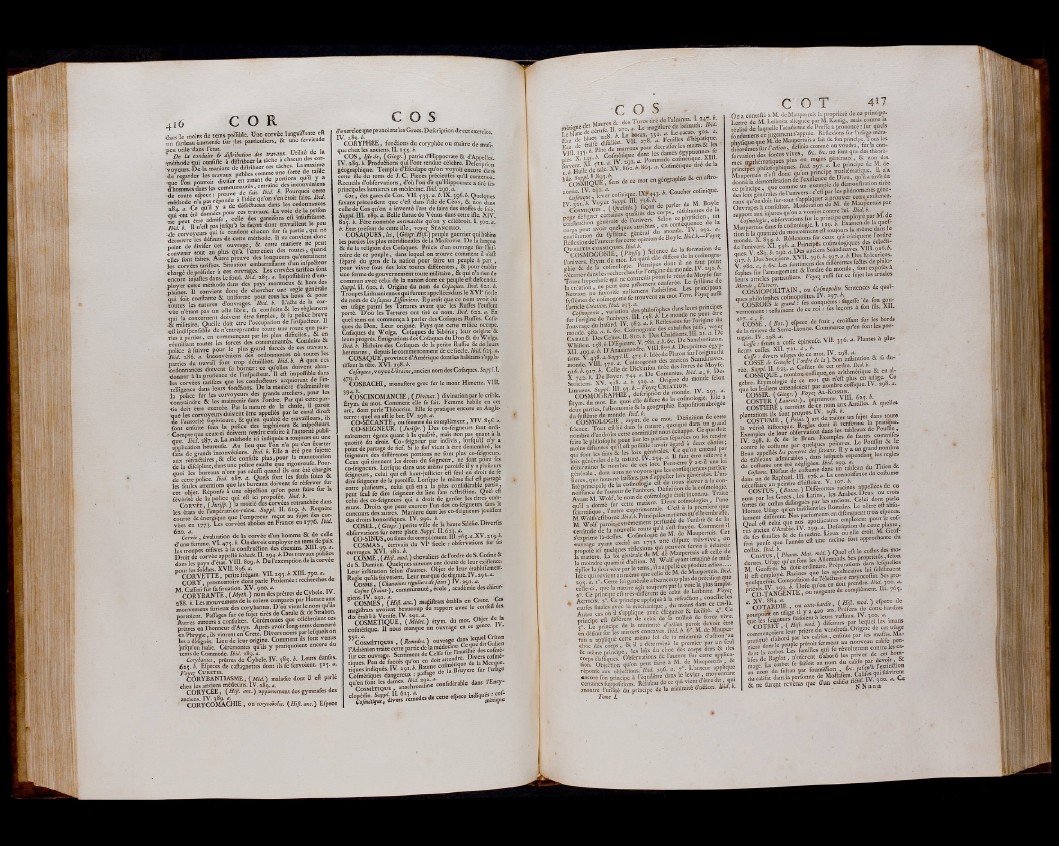
4 i 6 C O R cos
g » * moins 3e tems poffiMe. Une corvée languiffante eft
un fardeau immer,fc furie s particuliers, & une fervitude
ÎC£lt"'Ï Æ Ê ^ È diflnbulion des MMBï. Utiljté de la
méthode oui concilie à
voyeurs.Dc la manière de diftnbuer ces
de reaarder les travaux publics comme une forte de: taille
a P U i fo a s répondu à Kdée qu’on s’en étolt faite, lkid.
méthode n a pas P° d ..feilueux da„ s les ordonnances
S I t f . l Jour ces travaux. .La voie de la prifon
T Ô ™ , é t r f â S T celle des ganrifons eft infuffifante.
'ibidb Itn’eft pas.jufqu’à la façon dont travaillent le peu
de corvoyeurs L le rendent chacun fur fa parue, qu. ne
découvre les défauts de cette méthode. Il ne convient donc
point de divifer cet ouvrage, & cette mamere ne peut
convenir tout au plus qu’à l’entretien des routes, quand
.elles font «tes. Autre preuve des longueurs quennament
les corvées tarifées. Situation embarraffante d un înfpeaeur
chargé de prèfider à ces ouvrages. Les corvées tarifées font
encore injuftes dans le fond. Ibid. 285. a. Impoffibihté demployer
cette méthode dans des pays montueux & horsdes
piaules. Il convient donc de chercher une regle générale
qui foit confiante & uniforme pour tous les lieux & pour
toutes les natures d’ouvrages. Ibid. A Laite deJ a “ T
vée n’étant pas un afle libre, fa conduite & lesréglemens
qui la concernent doivent être funples, & la police breve
.& militaire. Quelle doit être l’occupanon delmfpefteur. Il
-eftlndifpenfable de n’entreprendre toute une route.lue patries
à parties, en commençant par les plus difficiles, 8c^ en
réunifiant toutes les forces des communautés. Conduite Sc
police à fuivte pour le plus grand fucces de ces travaux.
Ibid 286. a. Inconvéniens des ordonnances ou toutes les
parties du travail font trop détaillées, /«d. A A quoi ces
■ordonnances doivent fe borner: ce quelles d eum tjdxm-
donner à la prudence de rmfpeâenr. Il efl împoffible dans
.les corvées tarifées que les condufteurs acquièrent de 1 intelligence
dans leurs fondions. De la mamere dadminifirer
la police fur les corvoyeurs des grands attellera, po« «
contraindre 8c les maintenir dans Tordre.
lie doit être exercée. Par la nature de la chofe, il par0J
que les corvoyeurs doivent être appellés par le canal dire»
3 e l’autorité fupérieure, 8c qu’en qualité de travaJleurs.ls
font enfuite fous la police des ingénieurs & mfpeaeurs.
' Compte que ceux-ci doivent rendre enfuite à 1 autorité publi-
oue Ibid 287. a. La méthode ici indiquée a toujours eu une
application heureufe. Au lieu que l’on n’a pu s en écarter
¿ ¡ s de grands înconvéniens. Ibid. b. Elle a été peu fujette
aux réfraftaires , 8c elle confifte plus,pour la manutennon
delà difeipline, dans une police exafte que ngoureufe. Pourquoi
les bureaux n’ont pas rétrffi quand ils ont éte chargés
Re cette police. Ibid. 287. u. Quels font Ics feuls foms &
les feules attendons que les bureaux doivent fe réferver fur
cet objet. Réponfe à une objeftion qu on peut faire fur la
févérité de la police qui eft ici propofée. Ibid. b.
C o r v é e ( Jurifp. ) la moitié des corvées retranchée dans
les étws 1 impératrice-reine. Suppl. II. U M f e g
courte & énergique que l’empereur reçut au ^jet des cordées
en 1773. Les corvées abolies en France en 1776. Ibid.
%°Corvit évaluation de la corvée d’un homme & de celle
d’une femme. VI. 475- % dcJ oit employer en temsde paix
les troupes oifives à la conftruftion des chemins. XUl.99. tf.
Droit dè corvée appellé bohade. II. 294. b. Des travaux publics
dans les pays d’état VIEL 809. b. Del’exempuon de la corvée
pour les loldats. XVII. 836.^.
CORVETTE, petite frégate. VIL 293.é.Xin. 790. «.
COR Y , promontoire dont parle Ptolemée : recherches de
M. Caftmifurfafiruati0n.Xy.900.il. TV
d’exercice qne prenoientles Grecs. Defcriptioh de cet exercice
IV. 280. b.
CORYPHÉE, fonctions du coryphée ou maître de muft-
que chez les anciens. IL 155.
COS , Ifle de, (Géogr.) patrie d’Hippocrate& d’Appelles.
IV. 289. b. Productions qui f-ont rendue célébré. Defcription
géographique. Temple dEfculape qu’on voyoit encore dans
cette ifle du tems de J. C. Pièces précieufes qu’il contenoit.
Recueils d’obfervations , d’où l’on dit qu’Hippocrate a tiré fes
principales lumières en médecine. Ibid. 290. a.
Cos , des gazes de Cos. VII. 533.a.b. IX. 396. b; Quelques
favans prétendent que c’eft dans l’ifle de Céos, & non dans
celle de Cos qu’on a inventé l’art de faire des étoffes de foie.
Suppl. III. 189. tf. Belle ftatue de Vénus dans cette ifle. XIV.
823. b. Fête nommée antimachit qu'on y célébroit. I. 502:11.
b. Etat préfent de cette ifle, voyer S ta n ch iO .
CORYB ANTE, (Mytk. ) nom des prêtres de Cybcle. IV.
a88 A Les mouvemens-de la colere comparés par liorace aux
mouvemens furieux des corybantM. D ouvie:nijlenom quids
nortoient. Paflàges fur ce fujet tirés de Catule MeStrabon.
Autres auteurs à confulter. Cérémonies que «lêbro.ent ces
prêtres en l’honneur d’Atys. Apres avoir fong-tems demeuré
en Phrygie, ils vinrent en Crete. Divers noms par lefquels on
les a déminés. Lieu de leur origine. Comment ils font venus
jufqu’en Italie. Cérémonies qu’ils y pratiquoient enco
tems de Commode. Ibid. 289. a. , -
■ Coryhantes, prêtres de Cybele. IV. 585. b. Leurs danies.
£25. b. Efpeces de caftagnettes dont ilsfe fervoient. 515- Â*
^ ISrYBANTIASME, (Mid.) maladie dont B eft parlé
chez les anciens médecins. IV. 289. a.
CORYCÉE, (Hiß- tf«.) appartement des gymnafes des
anciens. lV.380.tf.
CORYCOMACHIE , ou corycololie. {Hiß. anc.) Efpece
COSAQUES, les, (Géogr.'Hijt.) peuple guerrier qui habite
les parties les plus méridionales de la Mofcovie. De la langue
8c de la religion des Cofaques. Précis d’un ouvrage fur l’hif-
toire de ce peuple, dans lequel on trouve comment il s’eft
féparé du gros de la nation pour faire un peuple à part,
pour vivre fous des loix toutes différentes, 8c pour établir
une forme de gouvernement toute militaire , 8c qui n’a rien de
commun avec celui de la nation dont ce peuple eft defeendu.
Suppl. II. 620. b. Origine du nom de Cofaques. Ibid. 621. b.
Troupes Lithuaniennes qui furent appelléesdans le XVIe ficcle
du nom de Cofaques LiJJoviens. 11 paroît que ce nom avoit été
en ufage parmi les Tartares avant que les Ruffes l’euffent
porté. D’où les Tartares ont tiré ce nom. Ibid. 622. a. En
quel tems on commença à parler des Cofaques Ruffes. Cofaques
du Don. Leur origine. Pays que cette milice occupe.
Cofaques du Wolga. Cofaques de Sibérie ; leur origine 8c
leurs progrès. Émigrations des Cofaques du Don 8c du w olga.
Ibid. b. Hiftoire des Cofaques de la petite Ruflie 8c de leurs
hetmanns, depuis le commencement de ce fiecle. Ibid. 623. a.
COSAQUE , province d’Amérique dontles habitans s’appla-
tiffent la tête. XVI. 198. b.
Cofaques 9 voyez Ukraine, ancien nom des Cofaques. Suppl. 1.
47COSBACHI, monaftere grec fur le mont Himette. V1IL
COSCINOMANCIE , {Divinat.) divination par le crible.
Étym. du mot. Comment elle fe fait. Femme habile en cet
art, dont parle Théocrite. Elle fe pratique encore en Angleterre:
quel en eft le but. IV. 290. tf. •xrf'tr o /■
CO-&ÉCANTE, ou fécante du complément, XIV. 856. a.
CO-SEIGNEUR. {Jurifpr.) Des co-feigneurs font ordinairement
égaux quant à la qualité, mais rton pas quant à la
quotité du droit. Co-feigneur par indivis, lorfqu’il ny a
point de partage de fief. Si le fief vient à être démembré, les
feigneurs des différentes portions ne font plus co-feigneurs.
Ceux qui tiennent les droits du feigneur, ne font point fes
co-feieneurs. Lorfque dans une même paroiffe il y a pluueurs
feigneurs, celui qui eft haut-jufticier eft feul en_droit de fe
dire feigneur de la paroiffe. Lorfque le même fief eft partage
entre plufieurs, celui qui en a la plus confidérable partie,
peut foui fe dire feigneur du lieu fans reftnihon. Quel eit
celui des co-feigneurs qui a droit de garder les titres communs.
Droits que peut exercer l’un des co-feigneurs fans le
concours des autres. Maniéré dont les co-feigneurs jomffent
des droits honorifiques. IV. 290. b. rw r f i*
COSEL , ( Géogr. ) petite ville de la haute Siléfie. Diverfes
obfervations fur cette place. Suppl. II. 623. tf.
CO-SINUS,oufinus du complément. 111. 70^.a. a v • a t 9/ *
COSMAS, écrivain du VIe fiede : obfervanons fur fe»
°UCO?ME, {Hifl. rno'd. ) chevaliers de l’ordre de S. Cofme&
de S. Damien. Quelques auteurs ont douté de leur exiftence.
Leur inftitution félon d’autres. Objet de leur établ.ffemenu
Réglé qu’ils fuivoient. Leur marque de dignité. IV. 29 i.tf.
COSME, (Chanoines réguliers de Jamt) 1V.JWI. a.
Cofine (Saisie-), communauté, école , académie des chrnif
^ CO SM lS ]'(HiJ!.anc.) magillrats établis en Crere; . ,9 '
magiftrats avoient beaucoup de rapport avec le confed acs
dix établi à Venifc. IV. 291. tf. «. ■ . ¿e u
COSMÉTIQUE, (Midec.) étym. du mot. Objet de 1
cofmétique. Il nous manque un ouvrage en ce gem •
’ ^ C o sm é t iq u e s , (Remedes.) ouy,raf ' ^ q J î d f t G a S
l’Athénien traite cette pm e de fe g j g a H BH des cofiné-
fur cet ouvrage. Senument de Gelfe lu Dlvers cofnlé-
tiques. Peu de fuccês qu on en doit atten ^ Me
tiques indiqués. IV. aç l.i. Baume g Bruyère fur l’ufage
Cofmétiqucs dangereux : paflage
qUS sM fa ! “ utar "a "™ X .e o n f id é r a b l= dans l’Encyde
cette efpece M q u ^
c o s .
Le blanc de ceruie. 7 . a Le ca c a o . 302. tf.
Eau de blue^ y u a. Feuilles d’hépatique.
Eau de f r f | .f fa e L r Z p J u r d é c r a f f e r l e sm a .n s 8 t les
VIII-135- b- ? Cofiiiérique dont les dames égyptienne *
piés. X- 14Ï- • j y 202. a. Pommade cofméuqne. XIII.
f rH u i l e de talc. XV.86a. b. 863. é Cofmétique tué de la
“ ‘e S l Q u l ’; feus de ce mot en géographie 8c en aftro-
D°Co/rn^uè Jlever oofmique. ÏXP443. b. Coucher cofinique.
IV. 321. b. V o y« SuppL ni. 736. • 1 ¿e M. Boyle
C osmiques , f iuâlnés deS corps, réfultantes de la
pour défigner certaines qu.^_^^_ g ejon ce phyficien, un
conftriiélion générale de , ' conféquence de la
Qu A lités oesMlQVES. fAd. A de la formation de
COSMOGONIE, ( % / î ’ | . .. jjjpere de la cofmogra-
' point
phie 8c de la « fm“ 1XW u " "ow n e d um o n d e .IV .a o a ;.A
s’écarter dans les recherches g . de M oyfo for
fyftêmcs de c^«ogoidefe trouvent.au mot Terre. Voyeg_ aufli
¡ p i 'SîMËÊÊÊ Cofmogome , variaÊtioMn | p„M lofopl.es dans legurs pperuintcipes
for l’origmede lumvms. Ul. t Réf)exions for forigine du
l’ouvrage du u ^ cabaliftes „ ifs , voyrî
monde. 980. a.. A g e . Ç-Oim g chal(lésns.IH. 2J. a. D e
C a b a le . Des Celtes. 11.8 . g,c De Sanchomaton.
Whifton. 1 58.b.D Épicure.V. 7 • • • Desprêtres égypl
i S n l "• ■nonde felon
du fÿftême du monde. /Ad. A néfinition de cette
I .d )SM O L °G IE é ^ . r m grand
fcience. Tout eft lié dans la narui., S- ,! ■ c eq u edoit
nombre d’endroits c e t t e ou le’ rendre
à deux chofes;
moins foix générales. | e qu’on entend par
qiu font les laits oc ie» w s ^ faut être reforvé à
litéprincipale delà Défininondelacofinologie.
i v â m p i w ■
qu’il a donné for cette m , ç>eft à la première que
s’exprime là-deffus. Cofmologie de KL « „ ¡U i v c , on
ouvrage ayant excité en 173 . ePnt fetvir à éclaircir
nropole ici $ d? Maupertuis eft celle de
la manere. La loi g „ . M W olf ayant imaginé de mul-
la moindre quantité daétion. M . ¿ c epfoduitu«on....
tiplier \2 force vive pat_le tems .l ae JP M d ^ ertuis./i«.
celle-ci, que la nature agit toujours par la voie la plus fimpte.
2? Ce principe eft très-différent de celui de Leibnitz. qv î
A c t i o n . n\ Ce principe appliqué à la rêfraftion, concilie les
caufes finales avec la mèclianique , du morns dans ce ras-la.
Antre cas où il s’applique avec élégance 8c taciute. 4 •.
principe eft différent de celui de la nullité de force vive.
<° Le principe de la minimité d’aflion paroit devoir être
en défaut fur les miroirs concaves. Ibid. A 6”. M . de Maupçr-
tuisa appliqué cette même loi de la mmimité daflion au
daJs £
certaines fuppofitions. Rélultat de ce qui vie t.’: j l
montre l’utilité du, principe de la muunutè d aw n.
Tome I.
C O T 4 1 7
On a conteftè à M. de Maupertuis la propriété de ce principe.
Lettre de M. Leibnitz alléguée par M. Kænig, mais contre la
réalité de laquelle l’académie de Pruffe a prononcé : for quels
fondemens ce jugement s’appuie. Réflexions fur 1 ufage méta-
Dhvfique que M. de Maupertuis a fai. de fou principe: Tous les
théorèmes fur l'ailion, définie comme on voudra, fur la con-
tfhoervoareumone sd es f- o ^ v v• e esS^ o^^c. n.e¿ fornaut ^qu e& d esn tohnè odreèsmes
I^ptliémalnqj““ P1“ ' Le principe de M. de
principes phdo ep l „ „ ’un principe mathématique. II n’a
Maupertuis neftdonc q u u u u n n j ^ a tlr4Wl,
donné la d4monto“ ° "^ ! * exemple dp démonftration tirée
ce principe, q u e . a p g . l _ c,eftP les phénomènes géné-
M J I S d e ML^de SèSSïïSSSKï? tion | rm|r=
monde. X. 8 y . cofmologlques des é c l# c
S U b 4 1 Des anJiens Scandh^es. VIII. A.
"cOSMOPOLITAIN, ou Cofiiofolise Sentences dequel-
^RoSt ÊÊÊSSBm ¡v* p f vernement^teftament de ce roi : fes leçons à fon fils. XII.
41 TOSSe" f Bot. ) efpece de fruit , croiflant Air les bords
de U r iv to de Serre-Lionne. Commerce qu'en font les por-
S S i * épineufe. Vlfc 33«. - 4 pl“ ‘
fieurs coffes. XII. 711- Æ ^ TV «
f e n ^ a p L ^ À queUe,
pkCOSTUMEfoT S o ) Satt de^traiter un fnjet dans toute
cintra le coftume par quelques peintras. L e pohffm & =
du coftume ont été négligées. Ibid ap9- • du TMen &
nom par les Grew, les » anciens. Celui dont parle
fortes deT^oftus5Î î n|ifdientles Romains. Le nôtre eft abfo-
Horace. Ufage q narfomeurs en diftinguent trois efpeces.
coftus. Ibid. A . Q . u fo coilus des mo-
C o s t u s , ( Pharm- Mat m e d .)e jM e i t ‘ & fdon
dernes. Ufage qu’en font les,Mem^ds.^JP ,ef uelles
M. Geofiroi. Sa dofe ordinal . P ^ . pù fobffituent
il eft employé. ^ c o f l in . Ses proquelquefois.
Compofition de prendre: Ibid. 300. a.
fr‘C O -T A N & T E Jou’ tangente du complément. 111. | j |
pourpoi^ en ufage il y 4 g vaffaux. IV. 300. a.
’ “C O TM ÏT® / * - '«'*■'> difo“ “ re'P”r .1' !luc' f c ■ 7 -
Jnraiem leur priera du vendredi. Ongtne de cet u&ge
ma g e La ccnbet ?e°faifoit an nmn du calife |»t devmt, &
au nom du fultan par foumiffion , & c . mlqu :■ ^
du califat dans la perfonne de rV.’ joo. I Ce.
8c ne furent revêtus que d un califat ” N ^ nna