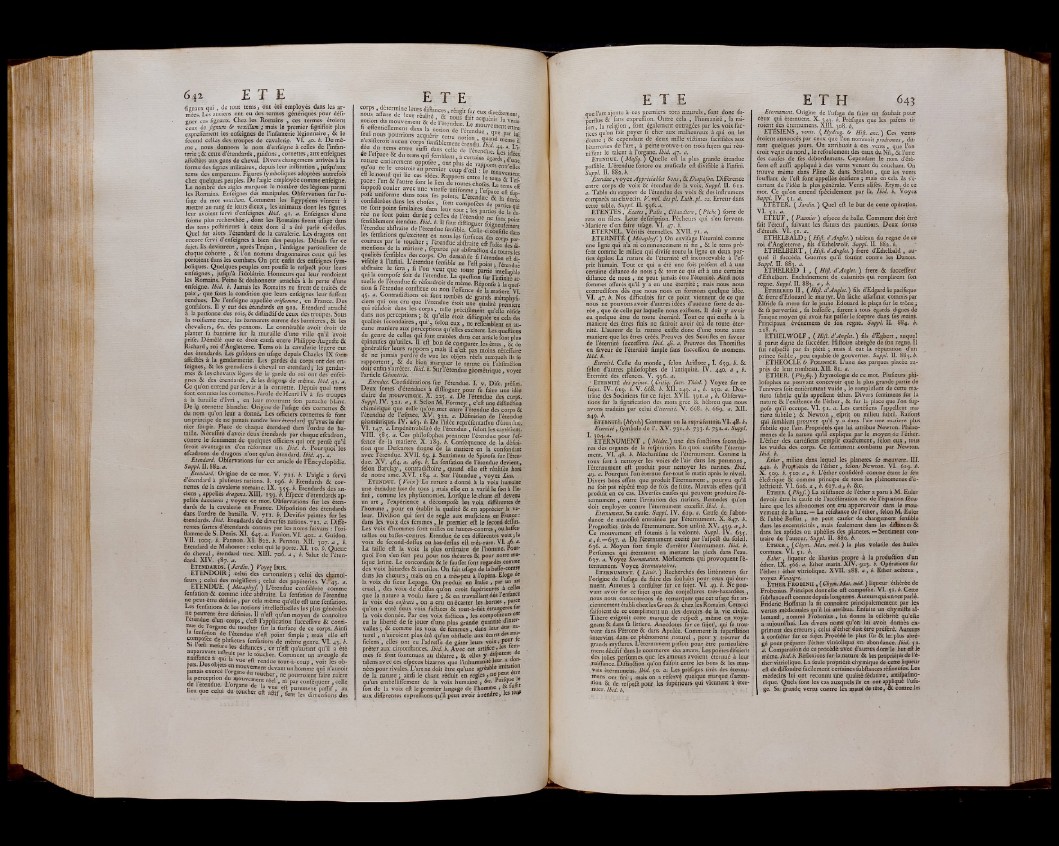
6 4 2 E T E E T E
Signaux qui, de tout tems, ont été employés dans les armées.
Les anciens ont eu des termes génériques pour désigner
ces fignaux. Chez les Romains , ces termes- étoient
ceux de flgnum & vexillum ; mais le premier fignifioit plus
expreflement les enfeignes de l’infanterie légionnaire, oc le
fécond celles des troupes de cavalerie. VI. 40. b. De même
, nous donnons le nom d’enfeigne à celles de l’infanterie
; & ceux d’étendards, guidons, cornettes, aux enfeignes
affefté.es aux gens de cheval. Divers changemens arrivés a la
forme des lignes militaires, depuis leur inltitution , jufqu’aux
tems des empereurs. Figures iymboliques adoptées autrefois
chez quelques peuples. De l’aigle employée comme enfeigne.
Le nombre des aigles marquoit le nombre des légions parmi
les Romains. Enfeignes des manipules. Obfervation fur l’u-
fage du mot vexillum. Comment les Egyptiens vinrent à
mettre au rang de leurs dieux, les animaux dont les figures
leur avoient lervi d’en feignes lbid. 41. a. Enfeignes d’une
forme plus recherchée , dont les Romains firent ufage dans
des tems poftérieurs à ceiix dont il a été parlé ci-deffus.
Quel fut alors l’étendard de la cavalerie. Les dragons ont
encore lervi d’enfeignes à bien des peuples. Détails fur ce
fujet. Ils devinrent, après Trajan, l’enfeigne particulière de
chaque cohorte , 8c l’on nomma dragonnaires ceux qui les
portoient dans les combats. On prit enfin des enfeignes fym-
boliques. Quelques peuples ont pouffé le refpeft pour leurs
enfeignes, jufqu’à l’idolâtrie. Honneurs que leur rendoient
les Romains. Peine 8c déshonneur attachés à la perte d’une
enfeigne. lbid. b. Jamais les Romains ne firent de traités de
paix ,- que fous la condition que leurs enfeignes leur fuffent
rendues. De l’enfeigne appeÛée oriflamme, en France. Des
gonfalons. Il y eut des étendards en 922. Etendard attaché
à la perfonne. des rois, 8c diftinélifde ceux des troupes. Sous
la troifieme race, les bannerets eurent des bannières, 8c les
chevaliers, &c. des pennons. Le connétable avoit droit de
planter fa banniere fur la muraille d’une ville qu’il avoit
prife. Démêlé que ce droit caufa entre Philippe-Àugufte 8c
Richard, roi d’Angleterre. Tems où la cavalerie légère eut
des étendards. Les guidons en ufage depuis Charles IX fon»
affeftés à la gendarmerie. Les gardes du corps ont des enfeignes,
8c les grenadiers à cheval un étehdard; les gendarmes
8c les chevaux légers de la garde du roi ont des enfeignes
8c des étendards, 8c les dragoijs de même. lbid. 42. a.
Ce qu’on entend par fervir à la cornette. Dépuis quel tems
font connues les- cornettes,-Parole de Henri IV à jfès troupes
à la bataille d’ivri , en leur montrant fon panache blanc.
De 1? cornette blanche. Origine dé l’ufage des cornettes 8c
du nom qu’on leur a donné. Les officiers cornettes fe font
un principe de ne jamais rendre leur étendard qu’avec le dernier
foupir. Place de chaque étendard dans Tordre de bataille.
Néceffué d’avoir deux étendards par chaque efeadron,
contre le fendment de quelques officiers qui ont penfé qu’il
feroit avantageux d’en réformer un. lbid. b. Pourquoi les
efeadrons de dragons n’ont qu’un étendard. lbid. 43. a.
Etendard. Obfervations fur cet arricle de l'Encyclopédie.
Suppl. II. 882. a.
Etendard. Origine de ce mot. V. 711. b. L’aigle a fervi
d’étendard à plufieurs nations. I. 196. ¿.Etendards 8c cornettes
de la cavalerie romaine. IX. 333. b. Etendards des anciens
, appelles dragons. XIII. 139. b. Éfpece d’étendards appelés
bannières ; voyez ce mot. Obfervations fur les étendards
de la cavalerie en France. Difbofirion des étendards
dans l’ordre de bataille. V . 711. b. Devifes peintes fur les
étendards, lbid. Etendards de diverfes nations. 712. a. Différentes
fbrtesd’étendards connus par les noms fuivans : l’oriflamme
de S. Denis. XI. 643. a. Fanion. VI. 402. a. Guidon.
VII. 1003. b. Pannon. XI. 822. b. Pennon. XII. 307. a , b.
Etendard de Mahomet : celui qui le porte. XI. 10. b. Queue
de cheval, étendard mrc. XIlI. 706. a , b. Salut de l’étendard.
XIV. 387. a.
E t e n d a r d s . ( Jardin, ) Voye^ I r i s .
ETENDOIR ; celui des cartonniers ; celui des çhamoi-
feurs ; celui des mégifliers ; celui des papéteries. V/43. a.
ETENDUE. ( Mitaphyf. ) L’étendue confidérée comme
fenfation 8c comme idée abftraite. La fenfation de l’étendue
ne peut-être définie, par cela même qu’elle eft une fenfation.
Les fenfations 8c les notions intelleéluelles les plus générales
va Pej vent ^Ire définies. Il n’eft qu’un- moyen de connoîtrc
»étendue d’un corps, c’eft l’application fucceffive 8c continue
de 1 organe du toucher fur la furface de ce corps. Ainfi
P i P£tendue n’eft point fimple ; mais elle eft
S! l’Ln66 r P , r? fcnfatiohs de même genre. VI. 43. b.
auDîiravanfwi <^1^anc®s > ce n’eft qil’autant qu’il a été
n J kn ceà q n™ vpuai ¡ S l i p Comment un aveugle de
j . .. P rendue tout-à-coup , voit les objamais
exercé ,,n homme I I ¡ p È l
h »crcpnfinn touchcr, ne pourroient faire naître
de ¡étendue eft Par l Ê p I Ê
lieu que celui M l | des
corps , détermine leurs diftances, réagit fur eux diîSÉ
nous affure de leur réalité M / ‘ ^ “ fe«emenf
notion du mouvement 8c de* l’étendue Le m T ” " Vraie
fi effentiellement dans l i l f ô l l É i i à T °UVement en*e
feulnous pourrions “ equérir eet.e „ „ ™ S ’ ’ f ‘*
n'ex'fleroit aucun corpsjfcnfiblcmem é t e n d i t “ ' J ^ î , 1
dée du tems entre auffi dans celle de l’étendùe'
de 1 efpace & du tems qui femblent, à cettains “Stds f e
nature entièrement oppofie , ont plus de rapports emrlï“
quon ne le croiroit au premier coup d’oeil - le
S M B Me ces fdées. Rapport entre le S £ F &
pace : 1 un & 1 autre font le lien de toutes chofes. Le tems eff
fuppofé couler avec une viteffe uniforme j l’efpace eft f„n
pofé uniforme dans tous fes points. L’étendue & I, l T
confidérées dans les chofes , Vont « X X ^ d e J • -
ne font point fimilarres dans leur tout ; les parties de la T
rée ne font point durée; celles de l’étendue ne fon-
fenfiblement étendue, lbid. b. Il faut diftinauer foieneif
’étendue abftraite de l’étendue fenfible. ( E g S »
les fenfations qu excitent en nous les fnrfaces des corus f f f
courues par e toucher; l’étendue abftraite eft l'idée desÜ
menfions de la manere, féparée par abftraâion de toutes Us
qualités feufiblcs des corps. On demandé ftl’étendue efttf!
W k i \mf m- A étendue fenfible ne l’eft point; l’étendî;
abftraite le fera , fi Ion veut que toute partie intelligible
» f i l fur l’ùifinitè actuelle
de 1 etendue fe réfoudroif de même. Réponfe à lanuef-
uon fi 1 étendue conftitue ou non l’eflence de la matière VI
45- n. Contradictions où font tombés de grands métapbvfi-
ciens qui ont cru que l’étendue étoit une qualité première
qui réfidoit dans les corps, telle précifément qu'elle réfide
dans nos percepuons ; & qu’elle ¿toit diftinguée en ceU des
qualités fécondants, qm’, félon eux , ne refferoblent en aucune
manière aux perceptions qu’elles excitent. Les ¡méfiions
du. genre de celles qui font traitées dans cet ardde font plus
emneufes qu uules. Il eft hon de comparer, les êtres , & de
généraljfer leurs rapports; mais il n’eu pas moins néceffaire
de ne jamais perdre de vue les objets ré.els auxquels ils fe
rapporteur, & de bien marquer le terme où l’abftraftiou
doit enfin sarrêter, lbid. b. SurTétendue géométrique, voyez
l’article Géométrie.
Etendue. Çonfidérations fur l’étendue. I. v. Difc. prélim.
Deux fortes d’étendues à diftingueç pour fe faire une idée
claire du mouvement. X. 225. a. De l’étendue des corps.
Suppl. IV. 321. a , b. Selop M. Formey., c'eft une diftinétioo
chimérique que celle qu’on met entire l’étendue des corps 8c
l’étendue de l’efpace. XV. 322. a. Définition de l’étendue
eéométrique. IV. 263. b. De l’idée repréfentative d’étenduç.-,
VI. 147. a. Impénétrabilité de Tétendue , félon lés cartéfiens.
VIII. 583. a. Ces philolophes prennent l’étendue pour l’ef-
fcnce de la matière. X. 189. b. Conféquence de la définition
que Deicartes donné de |a matière en la confondant
avec l’étendue. XVII. ¿SI* b- Sentiment de Spinofa fur l’étendue.
XV. 464, a. 469. b. La fenfation de l’étendue devient,
félon Barclay, contradiâoire , quand elle eft réalifée hors
de notre ame. XVI. 184. a. Sur l’étendue , voyez Lieu. .
E t e n d u e . (Voix) La nature a donné à la voix humaine,
une étendue, fixe de tons ; mais elle en a varié le fon à l’infini
, comme les. phyfionomies, Lorfque le chant eft devenu
un art , l’expérience a décompofé les voix différentes de
l’homme , pour en établir la qualité 8c en apprécier la valeur.
Divifion qui fert de réglé aux muficiens en France :
dans les. voix des femmes, le premier eft le fécond deffus.
Les VOix d’hommes font tailles ou hautes-contres, oubaffes-
taillcs ou baflès-contres. Etendue de ces différentes voix ; la
voix de fecofid-deffus ou bas-deffus eft très-rare. VI. 46. a.
La taille eft la voix la plus ordinaire de l’homme. Pourquoi
l’on s’en fert peu pour nos théâtres 8c pour notre mu-
fique latine. Le concordant 8c le fauffet foqt regardés comme
des voix bâtardes 8c inutiles. On fait ufage de la baffe-contre
dans les choeurs ; mais on en a très-peu à l’opéra. Eloge de
la voix du fieur Lepage. On produit en Italie , par un art
cruel, des voix de deffus qu’on croit fupérieures à celles
que la nature a voulu faire ; 8c en travaulant dès l’enfance
la voix" des caflrati, on a cru en écarter les bornes, parce
qu’on a enté deux voix faâices 8c tout-à-fàit étrangères fur
la voix donnée. Par ces voix faélices, les compofiteurs ont
eu la liberté de fe jouer d’une plus grande quantité d’intervalles
; 8c comme les voix de femmes , dans leur état naturel
, n’auroient plus été qu’un obftacle aux écarts des muficiens
, elles ont eu l’adreffe de gâter .leurs voix » P0“1"
prêter aux circonftances. lbid. b. Avec cet artifice, tei*}~
mes’ fe font foutenues au théâtre, 8c elles y difputent e
talens avec ces cfpeces bizarres que l’inhumanité leur, a données
pour rivales. L’art ne doit être qu’une agréable tmitatio
de la nature ; ainfi le chant réduit “ I B I
au un embelhffement de la voix humaine , d’f.
ion de la voix eft le premier langage de l’homme , oc lu
aux différentes exprefiions qu’il peut avoir à rendre, les * o»
E T E E T H 6 4 3
que l’art ajoute à ces premiers. tons naturels, font donc fu-
perflus 8c fans expremon. Outre cela , l’hùmanité , la rai-
fon la religion , font également outragées par les voix factices
qu’on fait paver fi cher aux malheureux à qui on les
donne ; 8c cependant de deux mille viétimes facrifiécs aux
bizarreries de l’art, à peine trouve-t-on trois fujets qui réunifient
le talent à l’organe. lbid. 47. a.
E t e n d u e . ( Muflq. ) Quelle eft la plus grande étendue
poifible. L’étendue ionore ou muficale eft divifible à l’infini.
Suppl. II. 882. b.
Etendue, voyez Appréciables Sons, 8c Diapafon. Différence !
entre corps de voix 8c étendue de la voix. Suppl. II. 612. :
a. Table du rapport de l’étendue des voix 8c desinftrumens
comparés au clavecin. V. vol. des pl. Luth. pl. 22. Erreur dans
cette table. Suppl. II. 396; a.
ETENTES, Eûtes , Palis, Cibaudiere, (Pêche) forte de
rets ou filets. Leur defeription. Pêcheurs qui s’en fervent.
Manière d’en faire ufage. VI. 47. b.
ETERNEL. Vérités éternelles. XVII. 71. a.
ÉTERNITÉ ( Métaphyf. ) On envifage l’éternité comme
une ligne qui n’a ni commencement ni nn , 8c le tems pré-
fent comme le milieu qui divife toute la ligne en deux parties
égales: La nature de l’éternité eft inconcevable à l’ef-
prit humain. Tout ce qui a été une fois préfent eft à une
certaine diftance de nous ; 8c tout ce qui eft à une certaine
diftance de nous , ne peut jamais être l’éternité. Ainfi nous
fommes affurés qu’il y a eu une éternité ; mais nous nous
contredifons dès que nous nous en formons quelque idée.
VI. 47. b. Nos difficultés fur ce point viennent ae ce que
nous ne pouvons avoir d'autres idées d’aucune forte de durée
, que de celle par laquelle nous exiftons. Il doit y avoir
eu quelque être de toute éternité. Tout ce qui exifte à la
maniéré des êtres finis ne fauroit avoir été de toute éternité.
L’auteur de la nature exifte donc d’une toute autre
maniéré que les êtres créés. Preuves des Scotiftes en faveur
de l’éternité fucceffive. lbid. 48. a. Preuves des Thomiftes
en faveur de l’éternité fimple fans fucceflion de momens.
lbid. b.
Eternité. Celle du monde , félon Ariftote , I. 639. b. 8c
félon d’autres philofophes de l’antiquité. IV. 440. a , b.
Eternité des eifences. V. 996. a.
• E t e r n i t é des peines. ( Critiq.Jdcr. Tkéol. ) Voyez fur ce
fujet. IV. 619. b. V. 660. b. XÏI. 249. a , b. 230. a. Doctrine
des Socinicns fur ce fujet. XVII. 391. a , b. Obfervations
fur la lignification des mots grec. 8c hébreu que nous
avons traduits par celui d'éternité. V . 668. b. 669. a. XII.
349- PPP , r
E t e r n i t é . (Myth.) Comment on la repréfentoit. VI. 48. b.
Eternité, fymbole de 1’. XV. 731. ^. 733. b. 732. a. Suppl.
I. 304. a.
ETERNUMENT , (Médec.) une des fondions fecondai-
res dès organes de la relpiration. En quoi confifte l’éternu-
ment. VI. 48. b. Méchanifme de l’éternument. Comme la
toux fert à nettoyer les voies de l’àir dans les poumons,
l’éternument eft produit pour nettoyer les narines. lbid.
49. a. Pourquoi l’on éternue fur-tout le matin après le réveil.
Divers bons effets que produit l’éternument, pourvu qu’il '
ne foit pas répété trop ae fois de fuite. Mauvais effets qu’il
produit en ce cas. Diverfes caufes qui peuvent produire l’é-
ternument , outre l’irritation des narines. Reinedes qu’on
doit employer contre l’éternument exceffif. lbid. b.
Eternument. Sa caufe. Suppl. IV. 619. a. Caufe de l’abondance
de mucofité entraînée par l’éternument. X. 847. b.
Prognoftics tués de l’éternument. Son utilité. XV. 439. a, b.
Ce mouvement eft fournis à la volonté. Suppl. IV. 633.
a , ¿.— 637. a. De l’éternumcnt excité par l’afpeél du -foleil.
636. a. Moyen fort fimple d’arrêter léternument. lbid. b.
Pcrfonnes qui éternuent en mettant les pieds dans l’eau.
637. a. Voyez Sternutation. Médicamens qui provoquent l’é-
ternument. Voyez Sternutatoires.
E t e r n u m e n t . ( Littér. ) Recherches des littérateurs fur
l’origine de l’ufage de faire des foühaits pour ceux qui éternuent.
Auteurs à consulter fur ce fujet. VI. 40. b. Ne pouvant
avoir fur ce fujet que des conjectures très-hazardées ,
.nous nous contenterons de remarquer que cet ufage fut anciennement
établi chez les Grecs 8c chez les Romains. Ceiurci
faifoient de ce compliment un des devoirs de la vie civile.
Tibere exigeoit cette marqué de refpeét, même en voyageant
8c dans fa littiere. Anecdotes fur ce fujet1, qui fe trouvent
dans Pétrone 8c dans Apulée. Comment la iuperftition
•intervint dans ce phénomène naturel , pour y trouver de
grands myfteres. L eternument paffoit pour être particulièrement
décifif dans le commerce des amans. Les poètes difoient
des jolies pcrfonnes, que les amours avoient éternué à leur
.naiffance. piftinCtion qu’on faifpit entre les bons 8c les mau-
Vais éternuraeas. lbid. 30. a. Les préfages tirés des éterny-
mens ont fini'; mais on a réiervé quelque marque d’atten-
jtion 8c de refpéft pour les fupéfieqrs qui viennent à éternuer.
lbid. b. ymt
Eternument. Origine de l’ufage de faire un ibuhait pour
céux qui éternuent. X. 343. b. Préfages que les païens ti-
roient des éternumens. XIII. 308. b.
ETÉSIENS, vous. ( Hydrcg. 6 H\f. .ne.) Ces vents-
étoient annoncés par ceux que l’on nommoit prodromes , durant
quelques jours. On attribuoit à ces vents, que l’on
croit vepir du nord, le refoulement des eaux du Nil., 8c l’une
des caufes de fes débordemens. Cependant le nom d’été-
fiens eft auffi appliqué à des vents venant du couchant. On
trouve même dans Pline 8c dans Strabon , que les vents
foufflant de l’eft font appellés étéfiens ; mais en cela Us s’écartent
de l’idée la plus générale. Vents atyfés. Etym. de ce
mot. Ce qu’on entend fpécialement par là. lbid. b. Voyez
Suppl. IV. 31. a.
ETÊTER. ( Jardin. ) Quel eft le but de cette opération.
VI. 31. a.
ETEUF, ( Paumier) efpece de balle. Comment doit être
fait l’éteuf, fuivant les ftatuts des paumiers. Deux fortes '
d’éteufs. VI. 51. a.
ETHELBALD ; ( Hiß. d’Anglet.) tableau du regne de ce
roi d’Angleterre , fils d’Ethelwolf. Suppl. 11. 882. b.
ETHELBERT, (Hift. d’Anglet. ) frere d’Ethelbald , auquel
il fuccéda. Guerres qu’il foutint contre les Danois.
Suppl. II. 883. a.
ETHELRED I , ( Hift. d’Anglet. ) frere 8c fucceffeur
d’Ethelbert. Enchaînement de calamités qui remplirent fon
regne. Suppl. II. 883. a t b.
E t h e l r e d I I , ( Hifi, d’Anglet. ) fils d’Edgard le pacifique
8c frere d’Edouard le martyr. Un lâche affamnat commis par
Elfride fa mere fur le jeune Edouard le plaça fur le trône ;
8c fa perverfité, fa baffeffe , furent à tous égards dignes de
l’inique moyen qui avoit fait paffer le feeptre dans fes mains.
Principaux événemens de fon regne. Suppl. II. 884. b.
218. b.
ETHELWOLF, (Hift. d'Anglet. ) fils d’Egbert, auquel
il parut digne de fuccéder. Hiftoire abrégée de ion regne. Il
fut refpeâé par fa piété ; mais il eut la réputation d’un
prince foible, peu capable de gouverner. Suppl. II. 883. b.
ETHEOCLE & P o l i n i c e . L’une des parques placée auprès
de leur tombeau. XII. 81. a.
ETHER. (Phyflq.) Etymologie de ce mot. Plufieurs phi-
lofophes ne pouvant concevoir que la plus grande partie de
l’univers foit entièrement vuide, le rempliffent de cette matière
fubrile qu’ils appellent éther. Divers fentimens fur la
nature 8c l’exiftence de l’éther, 8c fur la place que l’on fup-
pofe qu’il occupe. VI. 31. a. Les eartèfiens l’appellent matière
iubtile; & Newton ,.efprit ou milieu fui>til. Raifons
qui femblent prouver qu’il y a dans l’air une matière plus
iubtile que l’air. Propriétés que lui attribue Newton. Phénomènes
ae la nature qu’il explique par le moyen de l ’éther.
L’éther des cartéfiens remplit exaétement, félon eux , tous
les yuides des corps. Ce fentiment combattu par Newton.
lbid. b.
Ether, milieu dans lequel les planetes fe meuvent. III.
442. b. Propriétés de l’éther , félon/ Newton. VI. 619. b.
X. 509. b. 310 a , b. L’éther confidéré- comme étant le feu
éleélrique 8c comme principe de tous les phénomènes d’é-,
leâricité. VI. 616. a , b. 617. a , b. 8cc.
E t h e r . ( Phyf. ) La réfiftaqçe de l’éther a paru à M. Euler
devoir être la caufe de l’accélération ou de l'équation fécu-
laire que les aftronomes ont cru appercevoir dans le mou-
vement de la lune. — La réfiftançe de l’éther, félon M- Euler
8c l’abbé Boffut , ne peut çaufer de changeaient fenfible
dans les excentricités, mais feulement dans les diftances 8c
dans les apfides ou aphélies des planetes. — Sentiment contraire
de l’auteur. Suppl. II. 886- b.
E t h e r , (Chym. Mat. méd. ) la plus volatile des huiles
connues. Vl. 31. b. .l .v; .
Ether, liqueur de libavius propre à la production d’un
éther. IX. 566. a. Ether marin. XIV. 923. b. Opérations fur
j l’éther : éther vitriolique. XVII. 288. a , b. Ether acéteux ,
voyez Vinaigre,
E t h e r F r o b e n i i , ( Chytn.-Mut. méd. ) liqueur éthérée de
Frobenius. Principes dont elle eft compofée. Y L 5i.b. Cette
fubftançeeft connue depuis long-tems. Auteurs qui en ont parlé.
Frideriç Hoffman la fit connoitre principalemement.par les
vertus médicinales qu’il lui attribua; Enfuite un chymifte allemand
, nommé Frobenius , lui donna la célébrité qu’elle
a aujourd’hui. Les divers noms qu’on lui avoit donnés expriment1
des erreurs ; celui d’éther': doit être préféré. Auteurs
à confulfer fur ce fujet Procédé le plus fûr 8c le: plus abrégé
pour préparer l’éther vitriolique én- abondance, lbid. 32.
a. Comparaifon de ce procédé, avec d’autres donc le but eft le
même. lbid. b. Réflexions fur lamqture 8c les propriétés de l’éther
vitriolique. La feule propriété chymique de cette liqueur
eft de diffoudre facilement certaines fubftances réfineufes. Les
médecins lui ont reconnu une qualité.fédative , antifpafmo-
dique. Quels font les cas auxquels ils en ont applique l’ufâ-
ge. Sa grand^ vertu contre les 8c contre les