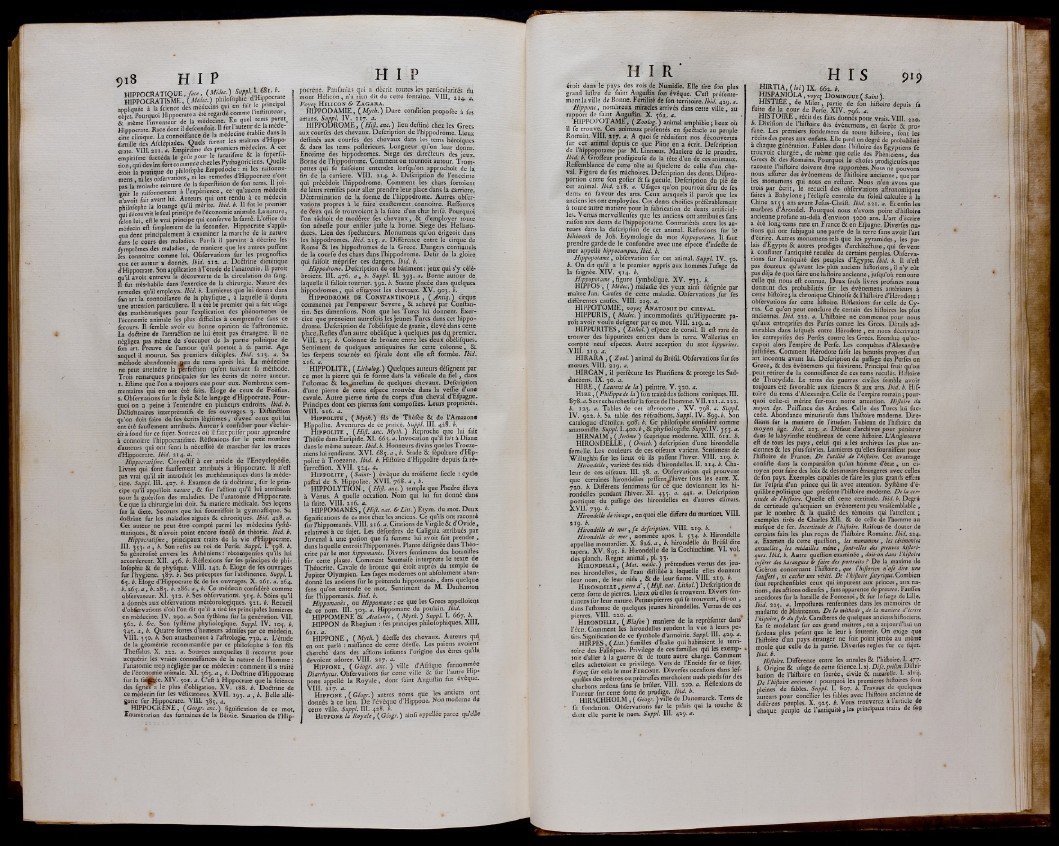
918 H I P
H IP PO C R A T IO U E , fa c e , (M U " - ) S u p p l.I. f f l 1- *•
HIP PO CR A T ISM E , {M U c c .) phitofoph.e JHippocraK
appliquée à la fcicnce des médecins qui en j l j S l f f l g
obiet Pourquoi Hippocrare a éié regardé comme 1 mltirureur,
& même l’inventeur de la médecine. En quel rems parut.
Hippocrare. Race dont il defeendoit. 11 fut 1 auteur de la médecine
clinique. La connoiffance de la médecine établie dans la
fimiUe de^Afelépiades. Qu els furent
crate. VIII. a n . e. Emplriline des premiers tnédec ns A cet
empiriime fuecéda le goût pour le fanatifme & la funerfli
«ion, qui devint fort commune chez les Pythagoriciens. Qu elle
étoit la pratique du philofophe Empedode : ni les railonne-
tnens, ni les ¿bfervations, n. les remedes d Hippocrate n ont
pas la moindre teinture de la fuperftmon de fon tems. 11 joignit
le raifonnement à l’expérience, ce 'q u au cu n médecin
¿■avoir fait avant lui. Auteurs qui ont rendu à ce médecin
philofophe la louange qu’il mérite. Ibid. b. I l fut le premier
qui découvrit le feul principe de l’économie animale. La nature ,
félon lui, eft le vrai principe qui conferve la famé. L’office du
médecin eft fimplement de la féconder. Hippocrate s’appliqua
donc principalement à examiner la marche de la nature
dans le cours des maladies. Par-là il parvint à décrire les
fymptômes des maladies , de maniéré que les autres puflent
les connoître comme lui. Obfervations fur les prognoftics
que cet auteur a donnés. Ibid. 2x2. a. Doélrine diététique
d’Hippocrate. Son application à l ’étude de l’anatomie. Il paroît
qu’il avoit entrevu la découverte de la circulation du fang.
J fut très-habile dans l’exercice de la chirurgie. Nature des
remedes qu’il employa. Ibid. b. Lumières que lui donna dans
fon art la connoiffance de la phyfique , à laquelle il donna
une attention particulière. Il a été le premier qui a fait ufage
des mathématiques pour l’explication des phénomènes de
l ’économie animale les plus difficiles à comprendre fans ce
fecours. Il femble avoir eu bonne opinion de l’aftronomie.
La doélrine de l’attraélion ne lui étoit pas étrangère. 11 ne
négligea pas même de s’occuper de la partie politique de
fon art. Preuve de l’amour qu’il portoit à fa patrie. A g e
auquel il mourut. Ses premiers difciples. Ibid. 213. a. Sa
méthode abandonnée jxeu de tems après lui. L a médecine
ne peut atteindre la * r fe é lio n qu’en iuiVant fa méthode.
Trois remarques principales fur les écrits de notre auteur.
1. Eftime que l’on a toujours eue pour eux. Nombreux commentaires
qui en ont été faits. Éloge de ceux de Foëfius.
2. Obfervations fur le ftyle & le langage d’Hippocrate. Pour-
Suoi on a peine à l’entendre en plufieijrs endroits. Ibid. b.
•idhoYinaires interprétatifs de fes ouvrages. 3. Diftinélion
qu’on doit faire de fes écrits légitimes, d’a v e c ceux qui lui
ont été fauffement attribués. Auteur à confulter pour s’éclaircir
à fond fur ce fujer. Sources ou il faut puifer pour apprendre
à connoitre l’hippocrarifme. Réflexions fur le petit nombre
d’auteurs qui ont fenti la néceffité de marcher fur les traces
d’Hippocrate. Ibid. 214.a .
Hïppocratifmc. Correétif à cet article de l’Encyclopédie,
liv r e s qui font fauffement attribués à Hippocrate. 11 n’efl
pas vrai qu’il ait introduit les mathématiques dans la médecine.
Suppl. III. 427. b. Examen de fa doélrine, fur le principe
qu’il appelloit n ature,8 c fur l’aélion qu’il lui attribuoit
pour la guérifon des maladies. D e l’anatomie d’Hippocrate.
C e que la chirurgie lui doit. Sa matière médicale. Ses leçons
fur la diete. Secours que lui fourniffoit la gymnaflique. Sa
doélrine fur les maladies aiguës 8c chroniques. Ibid. 428. a.
.Cet auteur ne peut être compté parmi les médecins fyfté-
matiques, & n’avoit point encore fondé de théorie. Ibid. b.
Hïppocratifmc, principaux traits de la v ie d’Hippocrate.
III. 353» a , b. Son refus au roi de Perfe. Suppl. I. 398. b.
Sa generofité envers les Athéniens : récompenfes qu’ils lui
accordèrent. XII. 456. b. Réflexions fur fes principes de p h i-,
lofophie & de phyfique. V I I I . 142. b. Eloge de fes ouvrages
fur l’hygiene. 387. b. Ses préceptes fur l’abflinence. Suppl. I.
63. b. Éloge d’Hippocrate 8c de fes ouvrages. X . 261. a . 264.
b. 265. a , b. 28 3. b. 286 . a , b. C e médecin confidéré comme
qbfervateur: X I. 312. ¿ .S e s obfervations. 313. b. Soins qu’il
a donnés aux obfervations météorologiques. 321. b. Recueil
d’obüervations d’où l’on dit qu’il a tiré fes principales lumières
en médecine. IV . 290. a. Son fyftême fur la génération. V II.
362, b. & c . Son fyftême phyfiologique. Suppl. IV . 103. b.
43. a , b. Quatre fortes d’humeurs adraifes par ce médecin.
/III. 330. b. Son attachement à l’aftrologie. 730. a. L’étude
de la géométrie recommandée par ce philofophe à fon fils
Theffalus. X. 222. a . Sources auxquelles il recourut pour
acquérir les vraies connoiffances de la nature de l’homme :
l’anatomie trop négligée par ce médecin ; comment il a traité
de l’économie animale. a I . 363. a , b. D o â rin e d’Hippocrate
fur la fajfe^e. X IV . 301. a. C ’eil à Hippocrate que la fcience
des f ign e ra le plus d’obligation. X V . 188. b. Doélrine de
ce médecin fur les véficatoires. X V I I . 193. a , b. Belle allégorie
fur Hippocrate. VIII. 383. a.
V
H IP PO C R ÈN E , {Géogr . a nc.) fignification de ce mot.
Enumération des fontaines de la Béotie. Situation de l’Hip
H I P
pocréne. Paufanias qui a décrit toutes les particularités du
mont HélicOn, n’a rien dit de cette fonraine. V I I I , 214. a.
Foyer H e u CON & Z A G A R A .
H IP PO D AM IE , ( M y th. ) D u re condition propofée à fes
amans. Suppl. IV . 1 1 7 . a .
H IP P O D R O M E , ( H if i. a n c .) lieu deftiné chez les Grecs
aux courfes des chevaux. Defcription de l’hippodrome. Lieux
deflinés aux courfes des chevaux dans les tems héroïques
8c dans les tems poftérieurs. Longueur qu’on leur donna.
Enceinte des hippodromes. Siege des direéteurs des jeux.
Borne de l’hippodrome. Comment on tournoit autour. Trompettes
qui fe faifoient entendre lorfqu’on approchoit de la
fin de la carrière. V I I I . 214. b. Defcription de l’enceinte
qui précédoit l’hippodrome. Comment les chars fortoient
de leurs remifes pour aller prendre leur place dans la çarriere.
Détermination de la forme de l’hippodrome. Au tres obfer-
vations propres à le faire éxaélement, connoître. Reffource
de deiix qui fe trouvoient à la fuite d’un char brifé. Pourquoi
l’on tâchoit de modérer fes ch e v a u x , 8c d’employer toute
fon adreffe pour enfiler jufle la borne’. Siege des Hellano-
dices. Lieu des fpeélateurs. Monumens qu’on érigeoit dans
les hippodromes. Ibid. 213.(1. Différence entre le cirque de
Rome & les hippodromes de la Grece.’ Dangers continuels
de la courfe des chars dans l’hippodrome. D e iir de la gloire
qui faifoit méprifer ces dangers. Ibid. b.
Hippodrome. Defcription de ce bâtiment : jeux qui s’y célé*
broient. III. 476. a , b. Suppl. H. 393. a . Borne autour de
laquelle il falloit tourner. 302. b. Statue placée dans quelques
hippodromes, qui efft^yoit les chevaux. X V . 903. b.
H i p p o d r o m e d e C o n s t a n t in o p l e , { A n t i q . ) cirque
commencé par l’empereur S e v e r e , 8c achevé par Conftan-
tin. Ses dimenfions. Nom que les T urc s lui donnent. Exer-
cice que prenoient autrefois les jeunes T u rc s dans cet hippodrome.
Defcription de l’obélifque de granit , é le v é dans cette
place.Reftes d’un autre obêlifque à quelques pas du premier.
V I I I . 213. b. Colonne de bronze entre les deux ooélifques.
Sentiment de quelques antiquaires fur cette co lo n n e , 8c
les ferpens tournés- en ipirale dont elle e il formée. Ibid.
216. a.
H IP P O L IT E , ( Litholog. ) Quelques auteurs déflgnent par
ce mot la pierre qui fe forme dans la véficule du f ie l , dans
l’eflomac 8c les jnteftins de quelques chevaux. Defcription
d’une pierre de cette efpece trouvée dans la veffie d’une
cavale. A u tre pierre tirée du corps d’un cheval d’Efpagne.
Principes dont ces pierres font compofées. Leurs propriétés.
V I I I . 216. a.
H i p p o l i t e , ( M y th . ) fils de THéfée 8c de l’Amazone
Hippolite. Aventures de ce prince. Suppl. III. 428. b.
H i p p o l i t e , {H i ß . anc. M y th .) Reproche que lui fait
T h éfée dans Euripide. X I. 663. a. Invocation qu’il fait à Diane
dans le même auteur. Ibid. b. Honneurs divins que les T roeze -
niens lui rendirent. X V I . 683. a , b. Stade & fépulture d’Hip-
politc à Troezene. Ibid. b. Hifloire d’Hippolite depuis fa r é-
furreélion. X V I I . 324. à.
H i p p o l i t e , ( Saint- ) é v ê q u e du tro iiiem e f ie c le : c y c l e
p a fta l d e S. H ip p o lite . X V I Ï . 768. a , b.
H IP P O L Y T IO N , ( H ifi. anc. ) temple que Phedre éleva
à Vénus. A quelle occafion. Nom qui lui fut donné dans
la fuite. V I I I . 216. a.
H IP POM AN È S , {H ifi. nat. 6* L i t t . ) Etym. du mot. D e u x
lignifications de ce mot chez les anciens. C e qu’ils ont raconté
fur l’hippomanès. V I I I . 2 16. a. Citations de Virgile & d’O v id e ,
relatives à c e fujet. Les défçrdres de Caligula attribués par
Juvenal à une potion que fa femme lui avoit fait prendre ,
dans laquelle entroit l’hippomanès. Plante défignée dans T h éo cri
te par le mot hippomanès. D iv er s fentimens des botaniiles
fur cette plante. Comment Saumaife interprète le texte de
Théocrite. Ca va le de bronze qui étoit auprès du temple de
Jupiter Olympien. Les fages modernes ont abfolument abandonné
les anciens fur le prétendu hippomanès »dans quelque
fens qu’on entende ce mot. Sentiment de M. Daubenton
fur l’hippomanès. Ibid. b. _
Hippomanès, ou Hippomane : ce que les Grecs appelloieijt
de ce nom. III. 303. a . Hippomane du poulain. Ibid.
HIPPOM EN E & A ta la n t e , ( M y th . ) Suppl. I. 667. b.
H IP PO N de Rhegium : fes principes philofophiques. XIII.
2H IP P O N E , {M y t h . ) déeffe des chevaux. Auteurs qu\
en ont parlé : naiffance de cette déeffe. Les païens a voient
cherché dans des allions infâmes l’origine des êtres qu il?,
devoient adorer. V I I I . 2 17 . a. . ,
H i p p o n e , (G é o g r . anc. ) ville d’Afrique furnommee
Diarrhytus. Obfervations fur cette v ille 8c fur l’autre Hîp*
pone appelle la R o y a le , dont faint Auguflin fut évêque.
V I I I . 2 17 . a. ' . ■ .
H i p p o n e , ( Géogr. ) autres noms que les anciens ont
donnés à ce lieu. D e l’évêque d’Hippone. Non moderne d«
cette ville. Suppl. III. 428. b.
H ip p o n e la R o y a le , {G é o g r .) ainfi appeüée parce que lle
H I R /
étoit dans le pays des rois de Numidie. Elle tire fon plus
grand lùflre de faint Auguflin fon évêque. C’eil préfente-
ment la ville de Bonnes. Fertilité de fon territoire. Ibid. 429. a.
H ip p o n e , nombreux miracles arrivés dans cette v i l le , au
rapport de faint Auguflin. X . 36^. a.
H IP P O P O T AM E , ( Z oo log. ) animal amphibie} lieux où
il fe trouve. Ces animaux prefentés en fpeélacle au peuple
Romain. VIII. 217. a. A quoi fe réduifent nos découvertes
fur cet animal depuis ce que Pline en a écrit. Defcription
de l’hippopotame par M. Linnaeus. Maniéré de le prendre.
Ib id. b. Groffeur prodigieufe de la tête d’un de ces animaux.
Reffemblance de cette tête au fquelette de celle d’un che-
val. Figure de fes mâchoires. D efcription des dents. Difpro-
portion entre fon goiter 8c fa gueule. Defcription du pie de |
ce t animal. Ibid. 218. a. Ufages qu’on pourroit tfrer de fes j
dents en faveur des arts. C eu x auxquels il paroît que les
anciens les ont employées. Ces dents choifies préférablemerit
à toute autre matière pour la fabrication de dents artificielles.
Vertus merveilleufes que les anciens ont attribuées fans
raifon aux dents de l’hippopotame. Contrariétés entre les auteurs
dans la defcription de cet animal. Réflexions fur le
béhémoth de Job. Etymologie du mot hippopotame. Il faut
prendre garde de le confondre avec une efpece d’in fcâ e de
mer appellé hippocampus. Ibid. b.
Hippopotame, obfervation fur cet animal. Suppl. IV . ¿Oi
l . O n dit qu’il a le premier appris aux hommes l'ufage de
la faignée. X lV . 314. b.
Hippopotame, figure fymbolique. X V . 733. b.
H IP P O S , { M ed ec .) maladie deS yeux ainfi défignée par
maître Jan. Caufes de cette maladie. Obfervations fur fes
différentes caufes. VIII. 210. a.
H IP P O T OM IE , voye^ A n a t o m i e d u c h e v a l .
H IP PU R IS , ( Médec. ) incommodités qu’Hippocratc paro
ît avoir voulu defigner par ce mot. VIII. 2x9. a.
H IP PU R IT E S , ( Lithol. ) efpece de corail. Il eft rare de
trou ver des hippurites entiers dans la terre. Wallerius en
compte neu f eipeces. Au tre acception du mot hippurites.
,V I 1I. 219. a.
HIR A R A , ( Z o o l. ) animal du Bréfil. Obfervations fur fes
moeurs. VIII. 219. a.
H IR C A N , il perfécute les Pharifiens 8c protégé lesSad-
ducéens. IX. 30. a.
H IR E , ( Laurent de l a ) peintre. V . 320. a.
H i r e , ( Philippe de la ) fon traité des feélions coniques. III.
S78. a. Scs recherches fur la force de l’homme. V I I . 12 î . a. 122.
b. 123. a. Tables de cet aftronome, X V . 798. a. Suppl.
IV . 922. b. Sa table des réfractions. Suppl. IV . 899. b. Son
catalogue d’étoiles. 908. b. C e philofophe confidéré comme
anatomifle.S u p p l.1. 400.b , 8cphyfiologifte.Su p pl.IV . 333 .a.
H IR N A IM , ( Jérôme ) feeptique moderne. XIII. 6 1 1 . b.
H IR O N D E L L E , ( Om ith .) defcription d’une hirondelle
femelle. Les couleurs de ces oifeaux varient. Sentiment de
.■Wïllughbi fur les lieux où ils paffent l’h iver. VIII. 219. b.
Hirondelle, variété des nids d’hirondelles. II. 214. b. Chaleur
de ces oifeaux. III. 38. a. Obfervations qui prouvent
que certaines hirondelles paffent^’hiver fous les eaux. X.
720. b. Différens fentimens fur ce que deviennent les hirondelles
pendant l’hiver. X I. 433. a. 441. a. Defcription
poétique, du paffage des hirondelles en d’autres climats.
X V IL 739. b. _tt
Hirondelle de rivage, en quoi elle différé du martinet VIII.
2 19. b.
Hirondelle de m e r .fa defcription. VIII. 119 . h.
Hirondelle de mer, nommée apos. I. 534- (.Hirondelle
appeüée moutardier. X . 8z6. a , b. hirondelle du Bréftl dite
tapera. X V . 8 9 5 .* . Hirondelle de la Cochinchine. V L v o l
des planch. Regne animal, pl. 33-
H ir o n d e l l e , (M a t . mcdic.) prétendues vertus des jeunes
hirondelles, de l’eau diftillèé à laquelle elles donnent
leur nom, de leur nids , & de leur fiente. VIII. 119 . é.
H ir o n d e l l e , pierre d ’ , {H ifi. nat. L ith o l.) Defcription de
cette forte de pierres. Lieux où elles fe trouvent. D iv er t fentimens
fur leur nature. Petites pierres qui fe trouvent, dit-on ,
dans l’eflomac de quelques jeunes hirondelles. Vertus de ces
pierres. V I I I . 220. a . *
H ir o n d e l l e , { B la fon ) maniéré de la repréfenter dans
l’écu. Comment les hirondelles rendent la vu e à leurs petits.
Signification de c e fymbole d’armoirie. Suppl. III. 429. a.
H IR P E S , { L i t t . ) familles d’Italie qui habitoient le territoire
des Falifques. Privilège de ces familles qui les exemp-
ioit d’aller à la guerre 8c de toute autre charge. Comment
elles achetoient ce privilège. V ers de l’Eneïde fur ce fujet.
Voy ez fur cela le mot F e r o n ie . Diverfes occafions dans lef-
uuelles des prêtres ou prêtreffes marchoient nuds pieds fur des
charbons ardens fans fe brûler. V I I I . 220. a. Réflexions de
l’auteur fur cette forte de prodige. Ibid. b.
H IR SCH H O LM , ( Géogr. ) v ille de Danemarck. 1 ems de
- fa fondation. Obfervations fur le palais qui la touche 8c
dont elle porte le nom. Suppl. III. 4a9-
H I S 919
H IR T lA , { l o i ) IX. 662. b.
S { c ? n i î î^ L A * voy cl D o m in GUE ( Saint ).
H IS T IE E , de M ile t , partie de fon hiiioire depuis fa
fuite de la cour de Perfe. X IV . 796. a.
H IS TO IR E , récit des faits donnés pour vrais. VIIÎ. 220,
b. Divifion de l’hifloire des événemens, en facrée 8c pro-*
fane. Les premiers fohdemens de toute hifloire, font les
récits des peres aux enfàns. Elle perd un degré de probabilité
a chaque génération. Fables dont l’hiftoire des Egyptiens fe
trouvoit chargée, de même que celle des Phéniciens, des
Grecs 8c des Romains. Pourquoi le chofcs prodigieufes que
raconte l’hiftoire' doivent être rapportées, brous ne pouvons
nous affurer des événemens de l’hifloire ancienne, que par
les monumens qui nous en réftent. Nous n’en avons que
trois par éc r it, le recueil des obfervations agronomiques
faites à Babylone ; l’éclipfe centrale du foleil calculée a la
Chine 2133 ans avant Jefus-Chrifl. Ibid. 221. a. Et enfin les
marbres d’Àrondel. Pourquoi nous n’avons point d’hifloire
ancienne profane au-delà d’environ 3000 ans. L’art d’écrire
a été long-tems rare en France 8c en Efpagne. Diverfes nations
qui ont fubjugué une partie de la terre fans avoir l’art
d’écrire. Autres monumens tels que les pyramides, les palais
d’Egypte 8c autres prodiges d’architeâure, qui fervent
à conflater l’antiquité reculée de certains peuples. Obfervations
fur l’antiquité des peuples d’Egypte. Ibid. b. Il n’efl
pas douteux qu’avant les-plus anciens hifloriens, il n’y eût
pas déjà de quoi faire une hifloire ancienne, jufqu’où remonte
celle qui nous eft connue. D eu x feuls livres profanes nous
donnent des probabilités fur les événemens antérieurs à
cette hifloire j la chronique Chinoife 8c l’hiftoire d’Hérodote j
obfervations fur cette hifloire. Réflexions fur celle de C y -
rus. C e qu’on peut conclure de certain des hifloires les plus
anciennes. Ibid. 222. a. L ’hifloire ne commence pour nous
qu’aux entreprifes des Perfes contre les Grecs. Détails admirables
dans lefquels entre Hé rodote, en nous décrivant
les entreprifes des Perfes contre les Grecs. Etendue qu’oc-
cupoit alors l’empire de Perfe. Les conquêtes d’Alexandre
juflifiées. Comment Hérodote faifit les beautés propres d’un
art inconnu avant lui. Defcription du paffage des Perfes en
G re ce , 8c des événemens qui fuivirent. Principal fruit qu’on
peut retirer de la connoiffance de ces tems reculés. Hifloire
de Thucydide. Le tems des guerres civiles femble avoir
toujours été favorable aux fciences 8c aux arts. Ibid. b. Hif-
toire du tems d’A lexandre. Celle de l’empire romain ; pourquoi
celle-ci mérite fur-tout notre attention. Hifloire du
moyen, âge. Puiffance des Arabes. C e lle des Turcs lui fuc-
cede. Abondance minutieufe dans l’hifloire moderne. Dire-
¿lions fur la maniéré de l’étudier. Tableau de l’hifloire du
moyen âge. Ibid. 223. a. Défaut d’archives p ou r pénétrer
dans le labyrinthe ténébreux de cette hifloire. L ’Angleterre
eft de tous les p a y s , celui qui a les archives les plus anciennes
8c les plus fuivies. Lumières qu’elles fourniflent pour
l’hiftoire de France. D e Futilité de l'hifloire. Cet avantage
confifle dans la comparaifon qu’un homme d’é ta t , un citoyen
peut faire des loix 8c des moeurs étrangères avec celles
de fon pays. Exemples capables de faire les plus grands effets
fur l’elprit d’un prince qui lit avec attention. Syflême d’équilibre
politique que préfente l’hifloire moderne. D e la certitude
de Fhifioire. Quelle eft cette certitude. Ibid. b. Degré
de certitude qu’acquiert un événement peu vraifemblable ,
par le nombre 8c la qualité des témoins qui l’atteflent ;
exemples tirés de Charles XII.. & de celle de l’homme au
mafque de fer. Incertitude de Fhifioire. Raifons de douter de
certains faits les plus reçus de l’hifloire Romaine. Ibid. 224.
a. Examen de cette queftion, les monumens, les cérémonies
annuelles, les médailles même, font-elles des preuves hifiori-
ques. Ibid. b. Autre queftion examinée , doit-on dans Fhifioire
inférer des harangues v faire des portraits ? D e la maxime de
Cicéron concernant l’hifloire, que l ’hiftorien n ’o fe dire une
fa u jfe té , ni cacher une vérité. D e Fhifioire fatyrique. Combien
font repréhenfibles ceux qui imputent aux princes, aux na-,
tions, des allions odieufes, fans apparence de preuve. Fauffes
anecdotes fur la bataille de Fontenoi, 8c fur lefiege de Lille.
Ibid. 223. a . Impoflures renfermées dans les mémoires de
madame de Maintenon. D e la méthode, de la maniéré d ’écrire
Fhifioire ', 6* du fiy le . Caraôeres de quelques anciens hifloriens.
En fe modelant fur ces grand maîtres, on a aujourd’hui un
fardeau plus pefant que le leur à foutenir. On exige que
l’hifloire d’un pays étranger ne foit point jettée au même
moule que celle de la patrie. Diverfes réglés fur ce fujet.
Ibid. b.
Htfioire. Différence entre les annales 8c l’hifloire. I, 477-
b. Origine 8c ufage de cette fcience. I. xj. Difc.vrtlim- Diflri-
bution de l’hiftoire en facrée, civile & naturelle. I. xlvij.
D e Fhifioire ancienne : pourquoi les premières hifloires font
pleines de fables. Suppl. 1. 807. b. Travaux de quelques
auteurs pour concilier les fables avec l’hifloire ancienne de
différens peuples. X . 923. b. Vous trouverez à larticle de
chaque peuple de l’antiquité , les principaux traits de fop