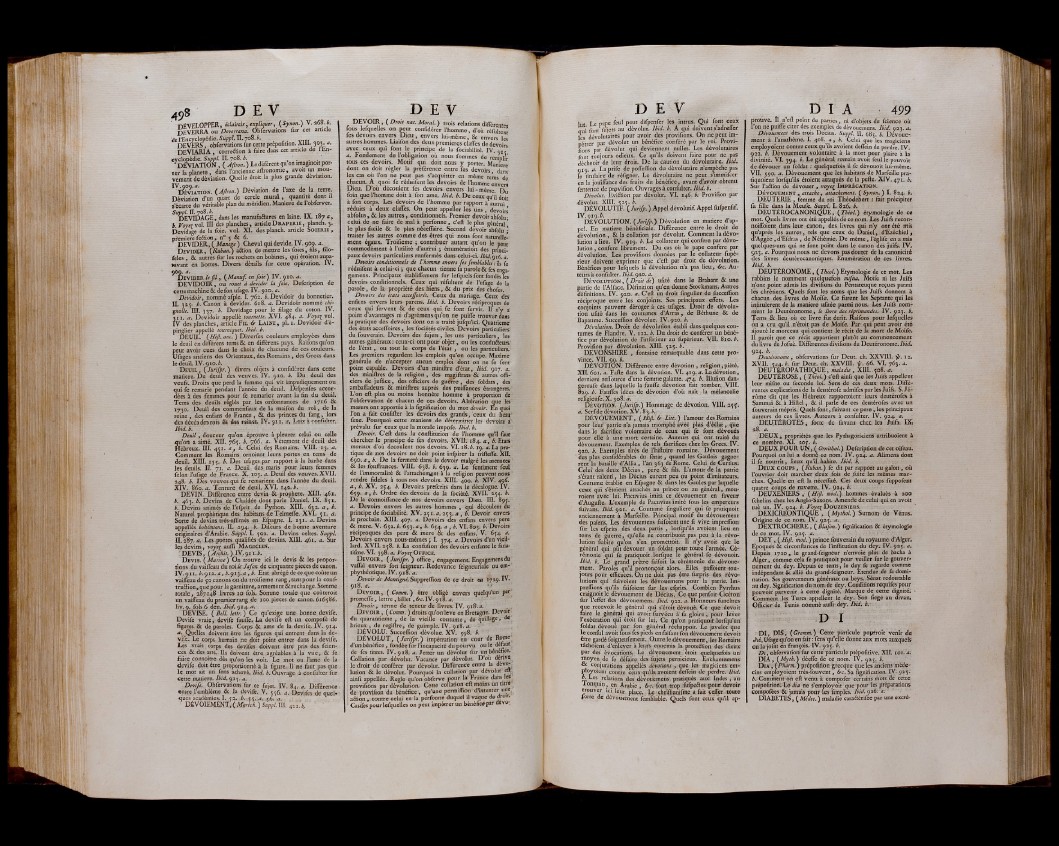
498 D E V
DÉVELOPPER, ¿claircir, expliquer, ( Synon.) V.268.6.
DEVERRA ou Deverrana. Obfervations fur cet article
de l’Encyclopédie..Suppl.M. 708.6.
DEVERS, obfervations fur cette prépofiuon. AHi. 303. a.
DEVIARIA , correction à faire dans cet article de 1 En-
^ D É ^ U T lÔ S t ^Aflnn. ) Le déférent qu’on imaginoit por-
la planete, dans l’ancienne aftronomie, avoit un moulent
ter
vement
de déviation. Quelle étoit la plus grande déviation.
IVi?èviATlON. ( Ajlron.) Déviation de l’axe de la terre.
Déviation d’un quart de cercle murÿ , quantité dont il
s’écarte du véritable plan du méridien. Maniéré de lobferver.
^ΣevÙ5aG É , dans les manufactures en laine. IX. 187 <*,
I. Voyn vol. III des planches, article D r a p e r ie , planch. 3.
Devidage de la foie. vol. XI. des planch. article S o ie r ie ,
première feftion, n° 3 & 6.
DEVIDER, ( Manège ) Cheval qui devide. IV. 909. a.
De vid e r , (Ruban.) aCtion de mettre les foies, ms, filo-
feles , 8c autres for lesrochets en bobines, qui étoientauparavant
en bottes. Divers détails fur cette opération. IV.
^°Î3e vider le f i l , ( Manuf. en foie) IV. 910. a.
DEVIDOIR, ou rouet à. devider la foie. Defcription de
cette machine 8c de fon ufage. IV. 910. a.
Dévidoir, nommé afple. I. 76a. 6. Dévidoir du bonnetier.
II. 323. b. Canon à devider. 618. a. Dévidoir nommé chi-
gnolle. III. 337. b. Devidage pour le filage du coton. IV.
311. a. Dévidoir appellé toumette. XVI. 484. a. Voye^vo 1.
IV des planches, article F it & L a in e , pl. 1. Dévidoir d’é-
pinglier appellé tourniquet. Ibid. b.
DEUIL. ( Hijl.anc. ) Diverfes couleurs employées dans
le deuil en dilférens tems 8c en différens pays. Kaiions qu’on
peut avoir eues dans le choix de chacune de ces couleurs.
Ufages anciens des Orientaux, des Romains, des Grecs dans
ledeuiL IV. 910.b.
D e u i l , ÇJurifpr. ) divers objets à confidérer dans cette
matière. Du deuil des veuves. IV. 910. b. Du deuil des
veufs. Droits que perd la femme qui vit impudiquement ou
qui fe remarie pendant l’année du deuil. Difpenfes accordées
à des femmes pour fe remarier avant la fin du deuil.
Tems des deuils réglés par les ordonnances de 1716 8c
1730. Deuil des commenfaux de la maifon du roi, de la
reine, des enfàns de France, 8c des princes du fang, lors
des décès des rois 8c des reine*. IV. 911. a. Loix à confulter.
Ibid. b.
Deuil, douceur qu’on éprouve à pleurer celui ou celle
qu’on a aimé. XII. 763. b. 766. a. Vêtement de deuil des
Hébreux. III. 431. a , b. Celui des Romains. VIII. 13. a.
Comment les Romains ornoient leurs portes en tems de
deuil. XIII. 133. b. Des ufages par rapport à la barbe dans
les deuils. II. 71. a. Deuil des maris pour .leurs femmes
félon l’ufage de France. X - 103. a. Deuil des veuves. XVII.
248. b. Des veuves qui fe remarient dans l’année du deuil.
XIV. 860. a. Tenture de deuiL XVl, 142. b.
DEVIN. Différence entre devin 8c prophète. XIII. 461.
b. 463. b. Devins de Chaldée dont parle Daniel. IX. 851.
b. Devins animés de l’efprit de Python. XIII. 632. a , b.
Naturel prophétique des habitans oeTelmeffe. XVI. 31. a.
Devins
appellés bohémiens. II. 294. b. Dileurs de bonne aventure
originaires d’Arabie. Suppl. I. 302. a. Devins celtes. Suppl.
II. 287. a. Les poëtes qualifiés de- devins. XIII. 461. a. Sur
les devins, voyez auffi M a g ic ien .
' DEVIS, CArchit. ) IV, 91 i.b.
D e v is . (Marine ) On trouve ici le devis 8c les proportions
du vameau du roi le Jafon de cinquante pièces de canon.
IV. 911. b. 912. a , b. 913.4, b. Etat abrégé de ce que coûte un
vaiifeau de 30 canons ou du troifieme rang, tant pour la conf-
truélion, que pour la garniture, armement 8crechange. Somme
totale, 287148 livres 10 fols. Somme totale que coûteroit
un vaiffeau du premier rang de 100 pièces de canon. 616386.
liv^Q. fols 6 den. Ibid. 914. a.
DEVISE. ( Bell. leur. ) Ce qu’exige une bonne devife.
Devife vraie, devife fauffe. La devile eft un compofé de
figures 8c de paroles. Corps 8c ame de la devife. IV. 914.
tf. Quelles doivent être les figures qui entrent dans la de-
vue. Le'Corps humain ne .doit point entrer dans la devife.
Les vrais corps des devifes doivent être pris des feien-,
ces 8c des arts.. Us doivent être agréables à la vue, 8c fe
faire connoître dès qu’on les voit. Le mot ou. l’ame de la
devife doit être proportionné à la figure.rII'ne faut pas que
le mot ait un fens achevé. Ibid. b. Ouvrage à confulter fur
cette matière. Ibid. 915. *.
Devife. Obfervations fur ce dujet. IV. 84. a. Différence
entre l’emblême & la devife. V. 336. a. Devifes de quelques
académies. I. 32. b., f<j.a. .561 a. j
DÉVOIEMÉNT, ( Marée h. ) Suppl. III. 421. /j.
D E V
DEVOIR, ( Droit nat. Moral. ) trois relations différentes
fous lefquelles on peut confidérer l’homme, d’où réfuhent
fes devoirs envers Dieu, envers lui-môme, 8c envers les
autres hommes. Liaifon des deux premières claffcs de devoirs
avec ceux qui font le principe de la fociabilité. IV. o u
a. Fondement de l’obligation où nous fommes de remplir
tous ces devoirs. Motif qui doit nous y porter. Maniéré
dont on doit régler la préférence entre fes devoirs, dans
les cas où l’on ne peut pas s’acquitter en même tems de
chacun. A quoi fe réduifent les devoirs de l’homme envers
Dieu. D’où découlent fes devoirs envers lui-même. Du
foin que l’homme doit à fon ame. Ibid. b. De ceux qu’il
à fon corps. Les devoirs de l’homme par rapport à autrui
réduits à deux claffes. On peut appeller les uns, devoirs
abfolus, 8c les autres, conditionnels. Premier devoirabfolu-
celui de ne faire de mal à perfonne, c’eft le plus général ’
le plus facile 8c le plus néceffaire. Second devoir abfolu *
traiter les autres comme des êtres qui nous font naturellement
égaux. Troifieme ; contribuer autant qu’on le peut
commodément à l’utilité d’autrui ; énumération des principaux
devoirs particuliers renfermés dans celui-ci. Ibid.ai6.a.
Devoirs conditionnels de l'homme envers fes femblables : ils fe
réduifent à celui-ci ; que chacun tienne fa parole 8c fes engage
mens. Principaux établiffemens fur lefquels font fondés les
devoirs conditionnels. Ceux qui réfultent de l’ufage de la
parole, de la propriété des biens, 8c du prix des chofes.
Devoirs des états acceffoires. Ceux du mariage. Ceux des
enfàns envers leurs parens. Ibid. b. Devoirs réciproques de
ceux qui fervent 8c de ceux qui. fe font fervir. Il n’y a
point a’avantages ni d’agrémens qu’on ne puiffe trouver dans
la pratique des devoirs dont on a traité jufqu’ici. Quatrième
des états acceffoires, les fociétés civiles. Devoirs particuliers
du fouverain. Devoirs des fujets, les uns particuliers, les
autres généraux : ceux-ci ont pour objet, ou les condufteurs
de l’état, ou tout le corps de l’état , ou les particuliers.
Les premiers regardent les emplois qu’on occupe. Maxime
générale de n’accepter aucun emploi dont on ne fe fent
point capable. Devoirs d’un miniftre d’état, Ibid. 917. a.
des miniftres de la religion, des magiftrats 8c autres officiers
de. juftice, des officiers de gu&re , des foldats, des
ambaffadeurs 8c minières auprès des puiffances étrangères.
L’on eft plus ou moins honnête homme à proportion de
l’obfervation de chacun de ces devoirs. Altération que les
moeurs ont apportée à la lignification du mot devoir. En quoi
l’on a fait confifter les devoirs des grands, ‘ceux du beau
fexe. Pourquoi cette maniéré de déterminer les devoirs a
prévalu fur ceux que la morale impofe. Ibid. b.
Devoir. C ’eft dans- la conftitütion de l’homme qu’il faut
chercher le principe de fes devoirs. XVII. 184. a , b. Etats
moraux d’où découlent nos devoirs. VI. 18. b. 19. a. La pratique
dé nos devoirs ne doit point infpirer la trifteffe. AIL
690. a , b. De la fermeté dans le devoir malgré les menaces
8c les fouftranccs. VIII. 638. b. 630. a. Le fentiment feui
de l’immortalité 8c l’attachement à la religion peuvent nous
rendre fideles à tous nos devoirs. XIII. 400. b. XIV. 496.
a , b. XV. 234. b. Devoirs preferits dans le décalogue. IV.
639. a, b. Ordre des devoirs de la fociété. XVII. 234. b.
De la connoiffance de nos devoirs envers Dieu. III. 89«.
a. Devoirs envers les autres hommes, qui découlent au
principe de fociabilité. XV. 231. a. 233. a , b. Devoir envers
. le prochain. XIII. 407. a. Devoirs aes enfans envers pere
8c mere. V. 632. b. 633. a , b. 634. a , b. VI. 803. ¿. Devoirs
réciproques des pere 8c mere 8c des enfàns. V. 634. a.
Devoirs envers nous-mêmes; I. 374. a. Devoirs d’un vieillard.
XVIL 238. b. La confofion des devoirs enfante le fana-
tifine. VI. 398. a. VoyerO f f i c e .
D e v o i r , ( Jurijpr. ) office, engagement. Engagemensdu
vaffal envers fon feigneur. Redevance feigneunale ou cm-
phythéotique. IV. 918. a.
Devoir de Montignè. Supprefiïon de ce droit en Ï729. IV.
918. a.
D e v o i r , ( Comm. ) être obligé envers quelqu’un par
promeffe, lettre, billet, &c. IV. 910. a.
Devoir, terme de teneur de livres. IV. 918. a. , .
, D e v o i r , ( Comm. ) droits qu’onieve en Bretagne. Devoir
du quarantième . de la vieille coutume, de quillage, de
brieux , de regiftre, de guimplc. IV. 918. a.
DÉVOLU. Succeifion dévolue. XV. 398. b.
DÉVOLUT, ( Jurifpr.) impétration en cotlr de
d’un bénéfice, fondée fur 1 incapacité du pourvu ou le défaut
de fes titres. IV. 918. a. Jetter un dévolut fur Un bénéfice.
Collation par dévolut. Vacance par dévolut. D ’où dénvç
le droit de conférer par dévolut. Différence entre la dévor
lution 8c le dévolut. Pourquoi la collation par dévolut cl
ainfi appelléc. Réglé qu’on obferve pour la "France dans les
provifions par dévolution. Cette collation eft, moins un titre ^
de provifion du bénéfice , qu’une perraiffion d'intenter une,
j aâion, contre celui en la perfonne duquel il vaque de droit.
• Cauïes pour lefquelles on peut impétrer un bénéficèpar d*vo-
D E V
lut Le pape feul peut difpenfer les intrus. Qui font ceux
qui font fujets au dévolut. Ibid. b. A qui doivent s’adreffer
les dévolutairès pour avoir des provifions. On ne peut impétrer
par dévolut un bénéfice conféré par le roi. Provisions
par dévolut qui deviennent nulles. Les dévolutairès
font toujours odieux. Ce qu’ils doivent faire pour rte pas
décheoir de leur droit. De la caution du dévolutaire. Ibid.
019. a. La prife de poffeffion du dévolutaire n’empêche pas
(e titulaire de réfigner. Le dévolutaire ne peut simmifeer
en la jouiffance des fruits du bénéfice, avant d’avoir obtenu
fentence de provifion. Ouvrages à confulter. Ibid. b.
Dévolut. Eviâion par dévolut. VI. 146. bi Provifion par
dévolut. XIII. 323. b. r
DÉVOLUT1F. ( Jurifp. ) Appel dévolutif. Appel fufpenfif.
IV. 919.6.
DÉVOLUTION. ( Jurifp.) . Dévolution en matière d’appel.
En matière bénéficiale. Différence entre le droit de
dévolution , 8c la collation par dévolut. Comment la dévolution
a lieu. IV. 919. b. Le collateur qui conféré par dévolution
, conféré librement. Du cas où le pape conféré par
dévolution. Les provifions données par le collateur fupé-
rieur doivent exprimer que c’eft par droit de dévolution.
Bénéfices pour lefquels la dévolution n’a pas lieu, &c. Auteurs
à confulter. Ibid. 920. a.
D é v o lu t io n , ( Droit de) ufité dans le Brabant 8c une
partie de l’Alface. Définition qu’eu donne Stockmans. Autres
définitions. IV. 920. a. C’eft un droit fingulier de fucceftion
réciproque entre les conjoints. Ses princioaux effets. Les
conjoints peuvent déroger à ces ufages. Droit de dévolution
ufité dans les coutumes d’Arras, de Béthune 8c de
Bapaumc. Succeifion dévolue. IV. 920. b.
Dévolution. Droit de dévolution établi dans quelques coutumes
de Flandre. V. 122. b. Du droit de conférer un bénéfice
par dévolution de l’inférieur au fupérieur. VU. 810. b.
ProvifiOn par dévolution. XIII. 323. b.
DEVONSHIRE , fontaine remarquable dans cette province.
VII. 99. b.
DÉVOTÎQN. Différence entre dévotion , religion, piété.
Xn. 601. a. Fafte dans la dévotion. VI. 419, a. La dévotion,
derniere refi'ource d’une femme galante. 474. b. Illufion dan-
gereufe dans laquelle la fauffe dévotion fait tomber. Vni.
§29. b. Fauffcs idées de dévotion d’où naît la mélancolie
religieufe. X. 308; à.
D é v o t io n , f Jurifp.) Hommage de dévotion; V 1U. 233.
a. Serf de dévotion. XV. 83.6..
DÉVOUEMENT, ( Hijl. & Litt. ) l’amour des Romains
pour leur patrie n’a jamais triomphé avec plus d’éclat, que
dans le facrifice volontaire de ceux qui fe font dévoués
pour elle à une mort certaine. Auteurs qui ont traité du
dévouement. Exeihples. de tels facrifices chez les Grecs. IV.
920. b. Exemples tirés de l’hiftoire romaine. Dévouement
des plus confidérablcs du fênàt , quand les Gaulois gague-
rent la bataille d’AUia, l’an 363 de Rome. Celui de Curtius.
Celui des deux Décius, pére 8c fils. L’amour de. la patrie
s’étant ralenti, les Décius eurent peu ou point d’imitateurs.
Coutume établie en Efpagne 8c dans les Gaules,par laquelle
ceux qui s’étoient attachés au prince ou au général, mou-
roient avec lui. Pâcuvius imita ce dévouement en faveur
d’Augufte. L’exemple de Pacuvius imité fous les empereurs
fuivans. Ibid. 921. a. Coutume finguliere qui fe pratiquoit
anciennement à Marfeille. Principal motif du dévouement
des païens. Les dévouemens fàifoient une fi vive impreffion
fur les cfprits des deux partis , lorfqu’ils avoient lieu en
tems de guerre, qu’elle ne contribuoit pas peu à-la révolution
fubite qu’on s’en promcttôit. Il n’y avoit que le
général qui pût dévouer un foldat pour toute l’armée. Cérémonie
qui fe pratiquoit. lorfque le général fe dévouoit.
Ibid. b. Le grand prêtre faifoit la cérémonie du .dévouement.
Paroles qu’il prononçoit alors. Elles, paffoient toujours
poiir efficaces. On ne doit pas être furpris des révolutions
qui fuivoient les dévouemens pour la patrie. Im-
prefiions qu’ils fàifoient fur les efprits. Combien Pyrrhus
craignoitle dévouement de Décius. Ce que penfoit Cicéron
fur l ’effet des dévouemens. Ibid. 022. a. Honneurs funebres
que recevoit le général qui s’étoit dévoué* Ce que devoit
faire le général qui avoir furvécu à' fa gloire, pour lever
l’exécration qui étoit fur lu},'Ce qu’on pratiquoit lorfqu’un
foldat dévoue jpar fon général réchappoit. Le javelot que
le conful avoit fous fes pieds en faifant fon dévouement devoit
être gardé foigqeufement. Outre le dévouement, les Romains
tâchoient d’enlever à leurs: ennemis la proteélion des'dieux
par des ¿vocations. Le déYPuemcnt, etoit quelquefois Un
moyen.de fe défaire des fujets pernicieux. Encnantemens
8c conjurations appellés dévotions, que les magiciens em-
ployoicrit contre ceux1 qu’ils avoient aeffein de perdre. Ibid.
b. Les relations des dévouemens1, pratiqués aux. Indes, au
Tonquin, en Arabie , 6v. font trop fufpeéles poùr. devoir
trouver ici leur place. Le : chfUlianifmc a fait ceffer toute
jorte de dévouement fcmblable. Quels font ceux qu’il ap-
D I A 499
proüvC. Il n eft point de parties, ni d’objets de foience où
l’on ne puiffe citer des exemples de dévouemens. Ibid. 923. a.
Dévouement dés trois Décius. Suppl. II. 683. b. Dévouement
à l’anathême. I. 408. a , b. Celui que les magiciens
employoient contre ceux qu’ils avoient deffein de perdre. IV.
922. b. Dévouement volontaire à la mort pour plaire à la
divinité. VI. 394. b. Le général romain avoit feul le pouvoir
de dévouer uu foldat : quelquefois il fe dévouoit lui-même.
VII. 330. a. Dévouement que les habitans de Marfeille pra-
tiquoient lorfqu’ils étoient attaqués de la pefte. XIV. 471. bt
Sur l’aétion de dévouer, voye^ I m p r é c a t i o n .
D é v o u em e n t , attache, attachement. ( Synon. ) I. 824. b.
DEUTER1É , femme du roi Théodebert : fait précipiter
fa fille dans la Mcufe. Suppl. I. 826. b.
DEUTÉROCANONIQUE, (Théol.) étymologie de ce
mot. Quels livres ont été appellés de ce nom. Les Juifs recon-
noiffoient dans leur canon, des livres qui n’y ont été mis
u’après les autres, tels que ceux de Daniel, d’Ezéchiel,
’Aggée, d’Efdras, de Nénémie. De même, l’églife en a mis
quelques-uns qui ne font point dans le canon des juifs. IV.
923. a. Pourquoi nous ne devons pas douter de la canonicité
des livres deutérocanoniques. Enumération de ces livres*
Ibid. b.
DEUTÉRONOME, ( Théol. ) Etymologie de ce mot. Les
rabbins le nomment quelquefois mifna. Moïfe ni les Juifs
h’ont point admis les divifions du Pentateuque reçues parmi
les chrétiens. Quels font les noms que les Juifs donnent à
chacun des livres de Moïfe. Ce furent les Septante qui les
intitulèrent de la maniéré ufitée parmi nous. Les Juifs nomment
le Deutéronomé., le livre des réprimandes. IV. 923. bt
Tems 8c lieu où ce livre fut écrit. Kaifons pour lefquelles
on a cru qu’il .n’étoit pas de Moïfe. Par qui peut avoir été
ajouté le morceau qui contient le récit de la mort de Moïfo.
Il paroît que ce récit appartient plutôt au commencement
du livre de Jofué. Différentes divifions du Deutéronome. Ibid.
924. b.
Deutéronome, obfervations fur Deut. ch. XXVIII. 'ÿr. 12.
XVII. 344. b. fur Deut. ch. XXVIII. •ÿ. 66. VI. 763. a.
DEUTÉROPATHIQUE, maladie, XIII. , 308. 0.
DEUTËROSE, ( Théol. ) c’eft ainfi que les Juifs appellent
leur mifne ou fécondé loi. Sens de ces deux mots. Différentes
explications de ladeutérofe admifespar les Juifs. S. Jérôme
dit que les Hébreux rapportoient leurs deuterofes à
Sammaï 8c à Hillel, 8c il parle de ces deutérofes avec un
fouverain mépris. Quels font, fuivant ce pere, les principaux
auteurs de ces livtés. Auteurs à confulter. IV. 924. a.
DEUTÉROTES, forte de favans chez les Juifs. IX
28.
, DEUX, propriétés que les Pythagoriciens attribuoient à
ce nombre. XI. 203. b.
DEUX POUR UN, (Omit/toi.) Defcription de cet oifeau.
Pourquoi on lui a donné ce nom. IV. 924. a. Alimens donc
il fe nourrit, fieux qu’il,habite. Ibid. b.
D eu x COUPS , (Ruban.) fe dit par rapport au galon , où
l’ouvrier doit marcher d,eux.fois de fuite les mêmes marches.
Quelle en eft la néceffué. Ces deux coups fuppofent
quatre coups de navette«. IV. 924. b.
DEUXENÏÉRS ,- ( Hiß. mod,.) hommes évalués à 20a
fchelins chez les Anglo-Saxons. Amende de celui qui en avoit
tué un. IV. 924. b. Voyer D o u z e n ie r s .
DEXICREONTIOUE , ( Mythol.) Surnom de Vénus.
Origine dç ce nom. IV. 923. a.
DEXTROCHERE, (B la fon.) fignification 8c étymologie
de ce ipot. IV. 923. a.
DEY, (Hiß. mod.) prince .fouverain du royaume d’Alger.
Epoques 8c circonftances dé l’inftitution du dey. IV. 923. a.
Depuis 1710, le grand-feignéur n’envoie plus de bacha à
Alger, comme cela fe pratiquoit pour veiller fur le gouvernement
du dey. Depuis ce tems, le dey fe regarde comme
indépendant 8c allié du grand-feigneur. Etendue de fa domination.
Ses gouverneurs généraux ou beys. Sénat redoutable
au dey. Signification du nom de dey. Conditions requifës pour
pouvoir parvenir à cette dignité. Marque de cette dignité. -
Comment les Turcs appellent le dey. Son fiegé au divan.
Officier de Tunis nommé aufirdey. Ibid. b.
D I
DI , DIS, ( Gramm. ) Cette particule popfroit venir de
cT/d.Ufage qu’on en fait : fens qu’elle donne aux mots auxquels
on la joint en françois. lV. 923. b.
D iy obfervation fur cette particule ptépofitive. XII. 101. ai
DIA, (Myth.) déeffe de ce nom. IV. 023. b.
Dia , (*Pharm.) prépofition grecque queles anciens-médecins
employoient très-fouvént, &c. Sa fignification. IV. 923.
6. Comment on eft venu à compofer certains mots 3e cette
prépofitiori.: Le dia ne s’employoit que pour les prépararions
compofées 8c jamais pour les fimples. fbid.016: a: •
DIABETES, ( Médec.) maladie caraftérifee par une excré