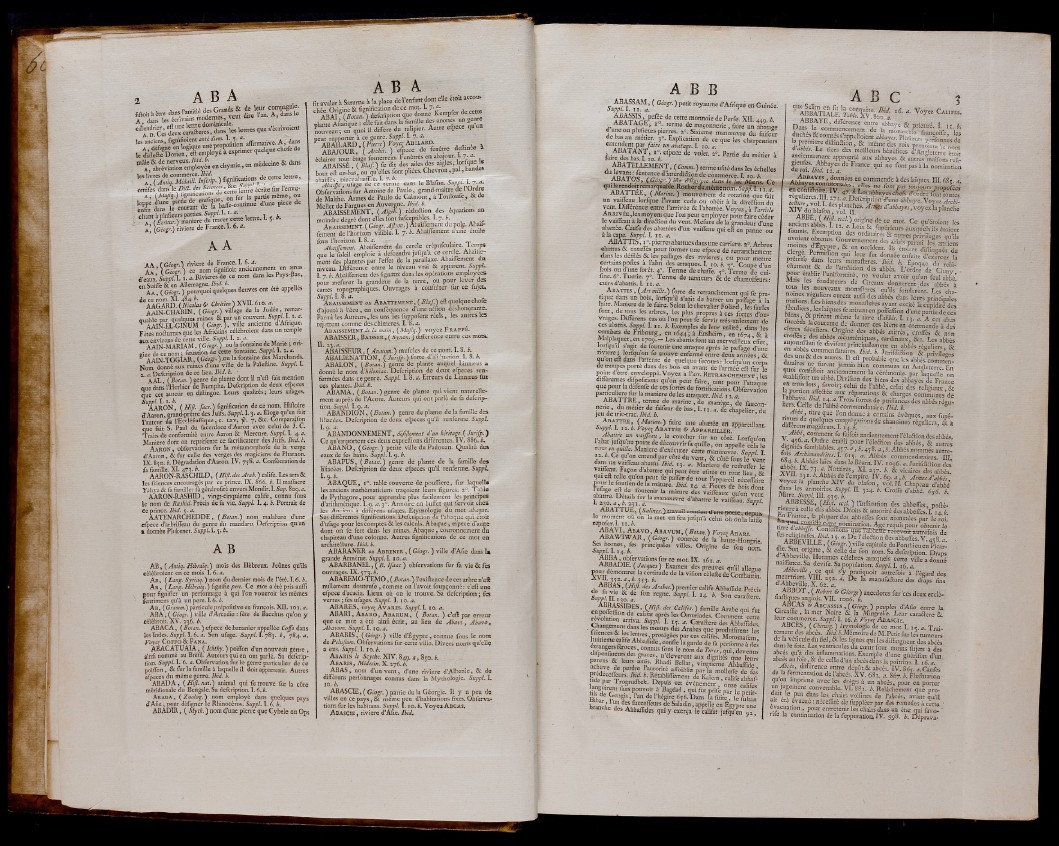
Il
IlSSl
^a §3 A B AÜfétfSSS A , dans les écrivains modernes, veut «u
tÆèÉËàlffîiÊmm '»«s gg s’écrivoient
en chymie., en médecine f t dans iesrrAw^^; )%“"Tdf c?,e iMre’ omifes dans l e ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ p | j g S écrite fur l’enve-
A , T t o la partie même, ou
m & m 1 de ?\ba“ ”ue d,une **■*"- A . (Géogr.) riviere de France.!. 6. a.
A A
A A f Géosr.) riviere de France. I. 6. a.
A a * CGéogr.) ce nom fignifioit anciennement un s^as
d’e tîx I a- K*™«5 de ce nom danS y ’
' " i f ' l Æ X o ^ ' Î u e s fleuves ou. été appcllés
d°AAGARD. (JJicoùsSt Chrétien) XVII.610. a.
AAIN-CHAÏ1IN , (Géogr.) village de la Judée, remarquable
par quelque« ruines & par un couvent. Suppl. U *.
AAIN-EL-GINUM (Géogr.), ville ancienne dAfrique.
Fêtes noflumes que les Africains célébroient dans un temple
aux environs de cette ville. Suppl. I. gg s
AAIN-MARIAM, ( Géogr.) ou la fontaine de Marie, origine
de ce nom ; fituation de cette fontame. Suppl. 1. I. «.
A A1N-T0 G1AR1 (.Géogr-; ) .ou la fontame des Marchands.
Nom donné aux ruines d’une ville, de la Paleftine. Suppl. L
a u.Defcription de ce fieu. Aid. i. -
AAL ( Botan. ) genre de plante dont u n e lt tait mention
eue dans l’Herbier de Rumphe. Defcription de deux efpeces
que cet auteur en diftingue. Leurs qualités; leurs ufages.
Suppl. I. a. b.
l ’auteur de îxccieuaiiique, t. w v , y . y, va.«..
que feit S. Paul du facerdoce d’Aaron avec celui de J. C.
Traits de conformité entre Aaron & Mercure. Suppl. I. 4. a.
Maniéré dont on repréfente ce facrificateur des Juifs. Ibid. b.
A a r o n , obfervations fur la métamorphofe de la verge
d’Aaron, & fur celle des verges des magiciens-de Pharaon.
IX. 850. b. Dégradation d’Aaron. IV. 758. a. Confécration de
fa famille. XI. 473. b.
AARON-RASCHILD, ( Hiß. des Arab. ) calife. Les arts &
les fciences encouragés par ce prince. IX. 866. b. Il maifacre
Yahya & fa famille: la gënérofité envers Mondir.I. Sup. 809. a.
AARON-RASHID, vingt-cinquieme calife, connu fous
le nom de Rashid. Précis de fa vie. Suppl. 1. 4. b. Portrait de
Ce prince. Ibid. 5. a.
AATENARCHEDDE, ( Botan.) nom malabare d’une
efpece d’arbrifleau du genre du mandaru. Defcriptioa qu'en
a donnée Plukenet. Suppl. L 3. b.
A B
A B , ( Antiq. Hibraïq.) mois des Hébreux. Jeûnes qtfils
célébroient en ce mois. I. 6. a.
A ß, ( Lang. Syriaq. ) nom du dernier mois de l’été. 1. 6. b.
Ab , {Lang. Hébrà'iq.) fignifie pere. Ce mot a été pris aufli
pour fignifîer un perionnage à qui l’on voueroit les mêmes
fentimens qu’à un pere. 1.6. b.
A b, ( Gramm.) particule prépofitive en françois. XII. 101 .a.
ABA, (Géogr.) ville d’Arcadie : fête de Bacchus qu’on y
cèlèbroit. XV. 236. b.
ABACA, {Botan.) efpece de bananier appellée Coffo dans
les Indes. Suppl. 1. 6. a. Son ufage. Suppl. 1. 783. A, 784.0.
Voyc{ C o ffo & F a n a .
ABACATUAIA, ( Ickthy. ) poiffon d’un nouveau genre,
ainfi nommé au Bréfil. Auteurs qui en ont parlé. Sa deferip-
tion. Suppl. I. 6. a. Obfervation fur le genre particulier de ce
poiiTon, 8c fur la famille à laquelle il doit appartenir. Autres
efpeces du même genre. Ibid. b.
ABADA , ( Htfl. nat.) animal qui fe trouve fur la côte
méridionale du Bengale. Sa defcriprion. 1. 6.b.
A bad a , ( Zoolog. ) nom employé dans quelques pays
d’Afie, pour déftgner le Rhinocéros. Suppl. 1. 6. b.
ABADIR, ( Myth. ) nom d’une pierre que Cybele ou Ops
ABA, fit avaler à Saturne S. la place de l’enfant dont elle étoit acco*
chee: Origine & fignificatiçm de ce ç de cette
A RAI (Botan. ! defcription que donne ivempter
peut rapporter à ce genre. Suppl. I. 7. a.
ABAILARD, ( Pierre ) V oyer A b e la r d . y
ABAJOUR, {Archit. ) efoece de fenêtre deiünèe
éclairer tout étage fouterrein. Fenêtres en abajour. L 7. .
ABAISSÉ, ( Blaf. ) fe dit des ailes des aigles, Iniqueî le
bout eft en-bas, ou qu’elles font pliées. Chevron, pal, bandes
fohge'dô ce terme dans le Blafon. SuppLl^j.a,
Obfervations for Antoine de Paulo, grand-maitre de 1 Ordre
de Malthe. Armes de Paulo de Calmont, à Touloule, ût de
Mellet de Fareues en Auvergne. IbiJ.b.
ABAISSEMENT, ( Aigéb. ) réduction des équanons an
moindre degré dont elles font fofcepnbles. 1 .7. b
A b a i s s e m e n t . (Géogr. JJlron.) Àbaifiement du pôle. AbiuT-
fement de l’horizon vifible.I. 7. h. Abaifiement d une étoile
fous l’horizon. 1 .8. a. v,— • .
AbaifTement. AbaiiTemént du cercle crépufculaire. Temps
que le foleil emploie à defeendre jufqu’à ce cercle. Abaifle-
ment des planetes par l’effet de la parallaxe. AbaifTement du
niveau. Différence entre le niveau vrai 8c apparent. SuppL
I. 7. b. AbaifTement des fignaux dans les opérations employées
pour mefurer la grandeur de la terre, ou pour lever des
cartes topographiques. Ouvrages à confulter fur ce iujet.
Suppl.l. o. a. . 1 r
A b a is sem en t ou A b a t t em e n t , ( Blaf.) eft quelque choie
d’ajouté à l’écu, en conféquence d’une aftion déshonorante.
Parmi les Auteurs,les uns les fuppofent réels, les autres les
rejettent comme des chimeres. I. 8. a.
A baissement de la main, ( Mufiq. ) voyez F r ap p e .
ABAISSER, Ba is ser , ( Synon, ) différence entre ces mots,
II. 23.a.
ABAISSEUR, ( Anatom.) mufcles de ce nom. 1. 8. b.
AB ALIÉNATION, (jurifp.) forte d’aliénation. I. S.b.
ABALON, (Botan.) genre de plante auquel Linnæus a
donné le nom d'hélonias. Defcription de deux efpeces renfermées
dans ce genre. Suppl. 1.8 . a. Erreurs de Linnæus fut
ces plantes. Ibid. b.
ABAMA, {Botan.) genre de plante qui vient naturellement
auprès de l’Acore. Auteurs qui ont parlé de fa defcription.
Suppl. 1. 9. a: •
ABANDION , {Botan.) genre de plante de la famille des
liliacées. Defcription de deux efpeces qu’il renferme. SuppL
I.9. a.
ABANDONNEMENT, défilement tTun héritage. ( Jurifp. )
Ce qu’emportent ces deux expreffions différentes. IV . 886. b.
ABANO, {Géogr. ) petite ville du Padouan. Qualité des
eaux de fes bains. Suppl. 1. 9. b.
ABAPUS, {Botan.) genre de plante de la famille des
liliacées. Defcription de deux efpeces qu’il renferme. SuppL
L 9. b.
ABAQUE, i°. table couverte de poufliere, fur laquells
les anciens mathématiciens traçoient leurs figures. 20. Table
de Pythagore, pour apprendre plus facilement les principes
d’arithmétique. Î. 9. a. 30. Armoire en buffet qui fervoit chez
les Ancien« à différens ufages. Etymologie au mot abaque.
Ses différentes lignifications. Defcription de l’abaque qui ctoit
d’ufage pour les comptes 8c les calculs. Abaque, elpece d'auge
dont on fe fert dans les mines. Abaque, couronnement du
chapiteau d’une colonne. Autres lignifications de ce mot en
architeâure. Ibid. b.
ABARANER ou A brener , ( Géogr. ) ville d’Afie dans la
grande Arménie. Suppl. I. 10. a.
ABARBANEL, ( R. ïfaac ) obfervations fur fa vie & fes
ouvrages. IX. 573. b.
ABAREMO-TEMO, {Botan.) l’exiftence de cet arbre n’eft
nullement douteufe, comme on l’avoit foupçonné : c’eil une
efpece d’acacia. Lieux où on le trouve. Sa defcription ; fes
vertus ; fes ufages. Suppl. I. 10. a.
ABARES, voye^ A v a r e s . Suppl.l. 10. a.
ABARI, A b a r o , A b a r u m , ( Botan. ) c’efi par erreur
que ce mot a été ainfi écrit, au lieu de Abavi, Abavo,
Abavum. Suppl. I. 10. a.
ABARIS, ( Géogr. ) ville d’Égypte , connue fous le nom
de Pelufium. Obfervations fur cette ville. Divers noms qu’ello
a eus. Suppl. I. 10. b.
A b a r i s le Scythe. XTV. 849. a , 850. b.
A b a RIS , Médecin. X. 276. b.
ABAS, nom d’un vent, d’une riviere d’Albanie, & de
différens perfonnages connus dans la Mythologie. Suppl. L
zo. b.
ABASCIE, | Géogr. ) partie de la Géorgie. Il y a peu de
villes en ce pays, oc même peu d’habitations fixes. Obfervations
fur les habitans. Suppl. 1.10. b. Voyez Abcas,
Abascie , riviere d’Aue. Ibid.
A B B ABC 3 I c ABASSÀM, ( Géogr. ) petit royaume d’Afrique en Guinée!
ouppL. 1. h . a. -
A RATÂTPpeft e de cette,monn°îe de Perfe. XII. 44p. b.
f l W P 1 • oerme maçonnerie, faire un abatage
d une ou plufieurapterres 2». Sixième manoeuvre du fidfeur
■ p n â s ^ .ïïs i r ^de voler-1Pattiie'sdu w4 t^ATEL LEMENT, ( Comm. ) terme ufité dans les échelles
d™ « di® °” ¡8 commerce. I. to. b.
f, , - r ' lun.Mæns. Ce
quibrendoit remarquable. Rocher du même nom îSJvT: ï 'i a
AB A T TÉ E , (Marine. ) mouvement de rotation que ¿ it
un vameau lorfque l’avant cede ou obéit à la direftion du
vent. Différence-entre l’arrivée & l’abattée. V oyez, à l’article
A r r iv é e ,le s moyens que l’on peut employer pour faire céder
le vaifleau à la direflion du vent. Mefure de la grandeur d’une
abattée. Caufe des abattées d’un vaifleau qui eft en panne ou
à la cape. Suppl. L u .a . ■
ABATTIS, 1°. pierres abattues dansune carrière. 2°. Arbres
abattus & entaffés pour former une efpece de retranchement
dans les défilés & les paflages des rivieres, ou pour mettre
certains pofles a l’abri des attaques. I. to .i. 3». Coupe d’un
bots ou dune forêt, £ . Terme dechafle. 5”.Terme de cui-
fine.fi Tuerte. 7». Terme de tanneurs & de chamoifeurs-
cuirs d abattis. L n .a .
. A b a t t is , (Art milit.) forte de retranchement qui fe pratique
dans un bois, lorfqu’il s’agit de barrer un p^Tage à la
fiate. Maniéré de le faire. Selon le chevalier Folard, lesfaules
font, de tous les arbres, les plus propres à ces fortes d’ouvrages.
Differens cas ou 1 on peut ie fervir très-utilemenr de
ces abattis. Suppl. I. n . b. Exemples de leur utilité, dans les
combats de Fribourg, en 16 4 4 ;à Ensheim, en 1674, & à
Malplaquet, en 1709.— Les abattis font un merveilleux effet
loriqu il s agit de foutenir une attaque après lè paifage d’une
tiviere ; lorfqu’on fe trouve enfermé entre deux armées &
quon eft dans l’attente de quelque fecours: lorfqu’un corps
de troupes porte dans des bois eft avant de l’armée eft fur le
point d être enveloppé. Voyez à Van. R e tranch ement les
différentes dilpofinons qu’on peut faire, tant pour l’atta’quë
que pour ladefenfe de ces fortes de fortifierions. Obfervation
pameuhere fur la manière de les attaquer. Ibid. 1 1 a
ABATTRE , terme de marine , de manège,' de fauconnerie
, du méner de faifeur de bas, I. n . n. d l chapeber, du
jeu de tnc-trac. Ibid. b. r ’
A b a t t r e , (Marine.) fidre une abattée en appareillant
Suppl L rz. i. roye{ A b a t té e g A p p a re ille r .
1 C - r “ coucher for un côté. Lorfqu’on
lebatjnfquan point tledéeouvrirfaquiUe, on appelle c 5 a I
v.rcr en qutlle. Maniéré d executer cette manoeuvre. Suppl. I
ta. b. Ce qu on entend par côté du vent, & côté fous fe vent
dam un tratfleau abattit. Ibid. ,3. a. Manière de redrefler le
vameau. Façon d abattre qm peut être ufitée en tout lieu, & ¡¡pi tcbe _qn on peut fe paflef de tout l’appateü néceffaire
pour le foutien de la mature. Ibid. 14. a. Pièces de bois dnnf I
s ce Dédmi.sfr t nir I mâture i
L Z 3 o a i i 3 I l miw.oeuvre d’abattre le vaiffeau. Suppl.
A BATTUE, (^ ¿ g g j^ ira vnii ««Pmîtw tfu iw p oelc, depuis
le moment où on la met en feu jufqu’à celui où ônla laifie 1
repofer.1.11. b.
A b a v o > Abavum, (Botan.) Foyer A b a r i
A CAW IW A R , ( Géogr. ) contréê de la haute-Honvrie.
Ses bornes, fes principales villes. Origine de fou nom.
àUppL. 1.14. b.
Ann^r.îc1'/"'3“0”5fur “ mot IX' 2<Sr- *• AÜBAOIE. ( Jacques ) Examen des preuves qu’il allemie
démontrer la certitude de la vifiôn célefte de Conftantin
a* m$:
de ( W S premier calife Abbaflide. Précis
s l p p ï i i î o . ? f° ” ^ SUPPLI- t | I f «raflerc!
criibolfeÿSIDËS, (ÆïJP. des Califes. ) famille Arabe qui fut
S i l f d? eptès les Omurîades. Commenfréne
Chana men T “- , ^ 1 f Cataflere des Abbaflldes.
• fcknces & lL w ! moeuf des Ar=>bes que prodnifirent les
lnuufiltriieemmee craahliftee AAMbb afnl'i^dre°, confciSe ?laa rg aSrd er adle!f efas pMèroforonmnea àf edmes,
«rangersféroces, connus fous le n lm de Furerfqui,devenus
tbfpenfateure des grâces, n’éleverent aux dignité que ¿ura
achevé ,
9noe p^ar T3rogr u^dbe kI . Depuis cet évédnee Kmaeïcnmt i ° o cnaz^ee caablbifaefci
languirent fans pouvoir à Bagdad, oui fut prife par le petit-
B ib iC enS*s 5 j ’311 §1 l’hégire 636. Dans la fuite, le lultan
branchi desfucceifeurs de Saladin, appelle en Égypte une
des Abbaifides qui y exerça le califat jufqu’en 92,
^ I b Ì É É ' I S I Ì ^ Voyez C alile;.
AB BAYE , différence entre abbaye & pri-uré I t t i
Rr comipencement de la monarchie francoif- les
duchés &comtés s’appelloient abbayes. Piiifleuri^? r ~ ’ ii
l p g i® ® ! I & même L W Ê m m m
d abbes. Le tiers des meilleurs bénéfices d’Angleterre é t S
anciennement approprié aux abbayes & autres maifons relï
I „ “ '/¿y ayej “ ■ ^ ne font P“ à k nomination
/ A b ty e fcom ’u f c t 5 à d“
/ S i t ADefcripnòltTftme abbaye. Voyez Archi*
X IV d'uVblafon 8 § p d’May es- v° y ^ |planche
u n t ic i M W Ì M È 0 É ' - ' - I d o l e n t les
fournis j-Lppt &.fuperieurs auxquels ils étoient
fournis. Exemption des ordbialres & autres privilèges au’ils
avoient obtenus. Gouvernement des alibfe parmi lef anéfons
moines d’Égypte, & en occident. Us B OE g i i M f f î g
W leur fot donnée enfolte d’exercer la
prêtrife dans leura monafteres. Ibid. b. Époque du relâ-
dos abbés. L’ordre de Clunvr i
fM --îb , l sï ffoon dda teurs de "CAit eVa0uuxl "d oanTnOèirre n©t ®dnés feaubblaésb &à
tous les nouveaux monafteres qu’ils fondèrent. Les cha1noi1nes1
re Hguh beSrs Seurâen t aufli des abbés dans leurs principales nipnafteres ayant excité fa B| ! • ques/ e mirent en pofleflion d’une partie de ces
biens 8cprirent même le titre d'abbés. I. x3, H
clercs J r CVUtllnn B biens en commende à des
fg É i i feÇubers. Origine des abbés mitrés: croffès & non
auîmwf-i deSraiÎ ésroeCuraénigues » cardinaux, &c. Les abbés
en divifent principaîement en abbes réguliers &
I l T me taiTres' Ibid- b‘ lurifdiaion & privilèges
d a t ó S Ì e fi,mT - ' I1.ei P robablo-q»«les abbés commfn-
■ ne forent jamais bien communs en Angleterre En
S M o n anciennement-la ccrémonlp. par ^quelle on
efenb Utrf0T,so tIto tusn apbab é. Divcidfiuoin ddee s^ biens ^des kbbayes T France
la portion affeaee aux réparations & charges comiiunes de
¿ r ex“A¿ d ie f l’4hhi comnifc°nrd?aSt sdiCre P. uIbififda.n bc.e 5 des .régu-
“ ‘1 que r °n d ?Iln£! à ooràins évêques, aux fupé-
dim qoelques congrégations de chanomes régnbers, & à
dtiférens magiftrats. 1 .1 4. b. • ■ ’
V ¡ r P S cP™?ent/ e ftifob anciennement leleSlon des abbés.
wB S S k » itabl1 Pour l’éleaion des abbés, & autres
l l f m ■a.b. Abbés nommés autre!
Vfl. 6! ^ a- Abbés oommendataires. ffl.
abbés k ÏA v d” S k B “ rn- M I0S«-1dnrlfdiaion des
J T V T I S 2F ’ A «■'dcàires desabbés.
?3 /•■'V>b™ î 1 fmÇ1,rq: i l «S- “ .h- Armes d'abbés,
Voyez la planche XTV du biafon, vol. II. Chapeau d’abbé
dans les atmoines. Suppl. H. 3z4. b. Croffe d'abbé. 6e6. b.
Mitre. Suppl. III. 939. b.
ABBESSE, (Hijl. eccl.) l’inftitiirion des abbeffes, poflé-
rieure h celle des abbés. Droits & autorité des abbelfes. I. i 4.i.
niu-ance, la plupart des abbeffes font nommées par le roi.
^ PW''K OlitK Jorabiation. A ge requis pour obtenir le
titre d abbejfe. CoSeffinis que l'Ibbinfe-rcêevÎfi-antréTois de
¡1 A R lfF v Î fi r i A5-' "■ ? e- i ’aeifion des Rbbefles. V . 45 8. a.
ABBEVILLE, (Gtogr. ) ville capitale duPonthieuen Picard’
AKh0n-nr'S« e ’ î , de 8 nom. Sa defcription. Draps
nnaaififiaf^nccre. fSiaa ?de°viTfe. eS| a c piolepbu"laBti.o Pn!a Sâuppp#l. 1c.o 1n6o. av.illead onié
d l f c v S e X fiA u.' ‘ 13 manufi,il^ure d“ d£,Kecdi-
^ui s’y ¿ratiquoit autrefois à l’égard des
1S É t S l f p » | Géogr. ) peuples d’Afie entre la
, reame, mcr Noire & la Mingrelie. Leur carattere &
I COl5merCe- Supplì I, 16. b. Voyez ABASCIE.
ABCÈS, ( Chirurg.) étymologie de ce mot.I. i< .a Traitement
des abcès. Ibid .bM moire de M. Petit fur les tumeurs
de la véficule du fiel, & les figues qui les diftinguent des abcès
dans le foie. Les ventricules du coeur font moins fuiets à des
abcès qua des inflammations. Exemple d’une giiérifon d’.m
abcès nu foie, & de ceUe d’un abcès dans la poltrin“ l T« a
cüfLr.enceJ e"» e dépôt & abcès. IV. 86ç. u.Caufes
de là fermentation de l’abcès.-XV. 682. 4. 867. b. Fluftuation
quon imprime avec les doigts à un abcès, pour en porter
un Jugement convenable. VI. 881. ¿.Relâchement que pro-
fiJrS ? ,pus Ies clîairs voifiues de l’abcès, avant qu’il
etc évacué : nSceflité de fuppléer par des remedes à cette ■
évacuation , pour entretenir les chairs dans un état qui favo- ’
nie la continuation de la fuppuration, IV. 998. b. Déprava