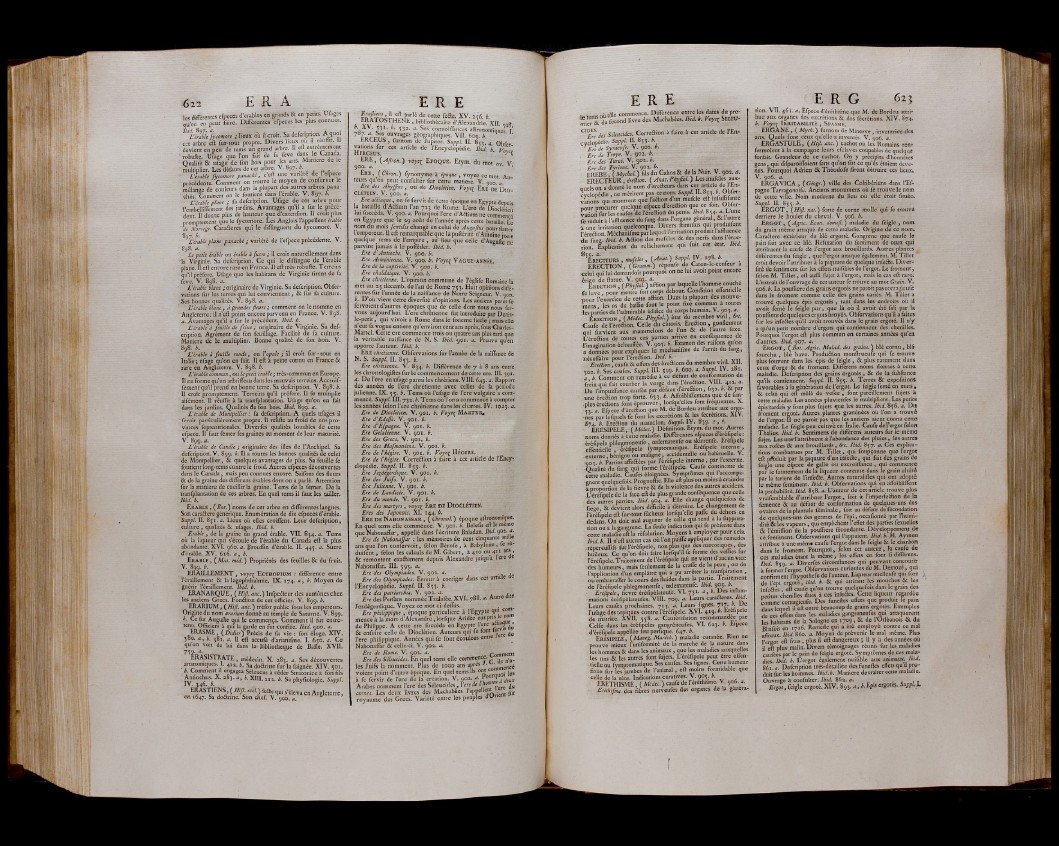
E R A
les différentes efpeces d'erablcs en grands & en petits. Üfages
qu'on en peut faire. Différentes efpeces les plus connues.
1 l'trallc 'fycomore ; lieux ou il croît. Sa defcription. A quoi
cet arbre éft fur-tout propre. Divers lieux ou il réufltt. 11
■ devient en peu de tlffls un grand arbre. Il eft extrêmement
robufte. Ufage que l’on fait de & feve dans le Canada.
Qualité & ufage de fon bois pour les arts. Maniéré de le
multiplier. Les défauts de cet arbre. V. 897. ç.
L’irabU fyeomort panaché, c’eft une vanété de lefpece
précédente. Comment on trouve le moyen de conferver le
mélange de couleurs dans la plupart des autres arbres pana-
chés. Comment on le foutient dans 1 érable. V. 897. |
L’irdble plane ; fa defcription. Ufage de cet arbre pour
i’embejliffemcnt des jardins. Avantages qu'il a fur le précèdent.
Il donne plus de hauteur que d’extenfion. Il croît plus
promptement que le fycomore. Les Anglois l’appellent érable
de Norvège. Cara&eres qui le diftinguent du fycomore. V.
érable plane panaché *• variété de l’efpece précédente. V.
■ 80. a*
Le petit érable ou érable à fucre ; il croît naturellement dans
"la Virginie. Sa defcription. Ge qui le diftingue de l’érable
plane. Il eft encore rare en France. Il eft très-robufte. Tcrreins
qu’il préfère. Ufage que les habitans de Virginie tirent de fa
feve. V. 898. a. |
Vérable blanc ; originaire de Virginie. Sa defcription. Obfer-
vations fur les terres qui lui conviennent, & fur fa culture.
.Ses bonnes qualités. V. 898. a.
L’érable blanc, à,grandes fleurs ; comment on le nomme en
Angleterre: il n’eft point encore parvenu en France. V. 898.
a. Avantages qu’il a fur le précédent. Ibid. b.
L’érable à feuille de frêne ; originaire de Virginie. Sa defcription.
Agrément de fon feuillage. Facilité de fa culture.
Maniéré de le multiplier. Bonne qualité de fon bois. V.
8 0 . b.
L’érable à feuille ronde, ou l’opale ; il croît fur - tout en
Italie ; ûfage qu’on en fait. Il eft a peine connu en France &
rare en Angleterre. V. 898. b.
L’érable commun, ou le petit érable ; très-commun en Europe.
Il ne forme qu’un arbrifleau dans les mauvais terreins. Accroif-
fement qu’il prend en bonne terre. Sa defcription. V. 898. b.
Il croît promptement. Terreins qu’il préféré. 11 fe multiplie
aifément. Il réuftit à la tranfplantation. Ufage qu’on en fait
dans les jardins. Qualités de fon bois. Ib'td. 899. a.
L’érable de Montpellier : fa defcription. A quels ufages il
feroit particulièrement propre. Il rélifte au froid de nos provinces
feptentrionales. Diverfes qualités louables de cette
efpece. Il faut femer fes graines au moment de leur maturité.
V. 899. a. ...............................
L’érable de Candie ; originaire des ifles de l’Archipel. Sa
defcription. V. 899. b. Il a toutes les bonnes qualités de celui
de Montpellier, & quelques avantages de plus. Sa feuille fe
foutient long-tems contre le froid. Autres efpeces découvertes
dans le Canada, mais peu connues encore. Saifons des fleurs
& de la graine des différens érables dont on a parlé. Attention
fur la maniéré de cueillir la graine. Tems de la femer. De la
tranfplantation de ces arbres. En quel tems il faut les tailler.
Ibid. b.
E r a b l e , (Bot.) noms de cet arbre en différentes langues.
Son cara&ere générique. Enumération de dix efpeces d’érable.
Suppl. II. 831. a. Lieux où elles croiflpnt. Leur defcription,
culture , qualités & ufages. Ibid. b.
Erable, de la graine au grand érable. VII. 834. a. Tems
où la liqueur qui s’écoule ae l’érable du Canada eft la plus
abondante. XVI. 960. a. Brouflin d’érable. II. 445. a. Sucre
d’érable. XV. 616. a , b.
E r a b l e , (Mat. méd.) Propriétés des feuilles & du fruit.
V. 899. b.
ERAILLEMENT , voye[ E c t r o p i u m : différence entre
Téraillement & la lagopn thaï mie. IX. 174. a , b. Moyen de
guérir l’éraillement. Ibid. b.
ERANARQUE, (//¿A anc.) Infpeâeur des auniônes chez
les anciens Grecs. Fonaion de cet officier. V. 899. b.
ERAR1UM, (Hifl. anc.) tréfor public fous les empereurs.
Ong ¡ne du nom ctrarium donné au temple de Saturne. V . 899.
b. Ce fut Augufte qui le commença. Comment il fut entre-
Icnu-Officiers à qui la garde en fut confiée. Ibid. 900. a.
ERASME, ( Didier) Précis de fa vie : fon éloge. XIV.
380. a,.b. 381. a. Il eft accufé d’arianifme. I. 630. a. Ce
quon voit de lui dans la-bibliothèque de Bafle. XVII.
759- -C I
ERASISTRATE, médecin. X. 283. a. Ses découvertes
anatomiques. I. ¡ ¡ ¡g b. Sa doitrine fur la faignée. XIV. 501.
b. Commenta engagea Séleucus à céder Stratonice à fon fils
Annochus.X. *83. a, b. XIII. aï2. b. Sa phyfiologie. Suppl.
E^ASTIENS, ( Hifl. eccl.\feûe qui s’éleva en Angleterre,
en 1647. Sa doctrine. Son chef. V. 900. a.
E R E
o P 1' MM a- Ses connoiffances agronomiques I*
7 Zn%r,%ouyr'^es 8eographiq»«- v u . 6 0 9 . b. .
fcKLfcUS, fumom de Jupiter. Suppl. II. ¡ ¡ „ . - 01.0..
HER°CEUs“ r art'Cle dC I'£ncy ,:l°i’é‘lte » • b
ERE, ( Afirm.) voyrj E poque. Etym. du mot en V
900. a. »• ».
E re f (Chron.) fynonyme à époque , voyez ce mot Auteurs
quon peut confulter fur cette matière. V. 900 ’a
Ere des AbyJfins, ou de Dioclétien. Foyer Ere d e Dm
CLÉT1EN. V. 900. a. ' ' .
• Ere aüiaque, on fe fervit de cette époque en Egypte demii«
la bataillé d’Aflium l’an 7*3 de Rome.\’ere d f f i i o c i S
lui fuccéda. V. 900. a. Pourquoi l’ere d’Aftium ne commença
en Egypte que le 29 -août de l’année après cette bataille. Le
nom du mois fextilis changé en celui de Auguflus pour flatter
l’empereur. Il eft remarquable que la poftérité d’Antoine jouit
quelque tems de l’empire , au’ lieu que celle d'Augufte ne
parvint jamais à le pofféder. Ibid. b.
Ere d’Antioche. V . 900. b.
Ere Arménienne. V. 900. b. Voye{ VAGUE-ANNÉE.
Ere de la captivité. V. 900. b.
Ere chaldaique. V. 900. b.
Ere chrétienne. L’opinion commune de l’églife Romaine la
met au 25 décemb. de l’an de Rome 753. Huit opinions diffé-
rentes fur l’année de la naiflance de Notre Seigneur. V. 900.
b. D’où vient cette diverfité d’opinions. Les anciens peres fe
fervoient d’autres époques que de celle dont nous nous fer-
vons aujourd’hui. L’ere chrétienne fut introduite par Denis-
le-petit, qui vivoit a Rome dans le fixieme fiecle ; mais elle
n’eut fa vogue entiere qu’environ cent ans après, fous Charles-
Martel. Cette ere commence trois ou quatre ansplus tard que
la véritable naiflance de N. S. Ibid. 901. a. Preuve qu’en
apporte l’auteur. Ibid. b.
E r e chrétienne. Obfervations fur l’année de la naiflance de
N. S. Suppl. II. 853. b.
Ere chrétienne. V. 834. b. Différence de 7 à 8 ans entre
les chronologiftes fur le commencement de cette ere. III. 391.
a. De l’ere en ufage parmi les chrétiens. VIIL 643. a. Rapport
des années de l’ere chrétienne avec celles de la -période,
julienne. IX. 33. b. Tems où l’ufage de l’ere vulgaire a commencé.
Suppl. III. 732. b. Tems où l’on a commencé à compter
les années lelon l’ere chrétienne dansles chartes. IV. 1023. a.
Ere de Dioclétien. V. 9 0 1 . b. Voyeç M a r t y r «
Ere d’EdeJfe. V. 901. b.
Ere d’Efpagne. V. 901. b.
Ere Gelaléenne. V . 901. b.
Ere des Grecs. V. 901. b.
Ere des Hafmonéens. V. 901. b.
Ere de l’hégire. V. 9 0 1 . b. Voyeç H ÉGIRE,
Ere de l ’hegire. Correétion à faire à cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. II. 853. b.
Ere Jeçdégerdique. V. 901. b.
Ere des Juifs. V. 90 T. b.
Ere Julienne. V. 901. b.
Ere de Laodicée. V. 901. b.
Ere du monde. V. 901. b.
Ere des martyrs, voye^ E r e DE D IOCLÉTIEN.
Eres des Japonois. XI. 144. b. ,■
Ere de Nabo n a ssa r , ( Chronol. ) époque afttonomique.
En quel tems elle commence. V. 901. b. Belefis eft le même
que Nabonaflar, appelle dans l’écriture Baladan. Ibid. 901.
Ere de Nabonaflar : les mémoires de cent cinquante mille
ans que l’on confervoit, félon Bérofe, à Babylone, fe re-
duifent, félon les calculs de M. Gibcrt, à 410 0114** an* >
& remontent exaâement depuis Alexandre jufqu’à lere de
Nabonaflar. III. 393. a.
Ere des Olympiades. V. 902. a. , .
Ere des Olympiades. Erreur à corriger dans cet article
l’Encyclopédie. Suppl. II. 853. b.
Ere des patriarches. V. 902. a. ,.
Ere desrerfans nommée Tzelafée. XVI. 788. a. Autre
Jezdégerdique. Voyez ce mot ci-deflùs. .
Ere philippique , époque particulière à l’Egypte quj co
mence à la mort d’Alexandre, lorfque Aridée eut pris 1le
de Philippe. A cette été fuccéda en Egypte l’ere atüfl *
& enfuite celle de Dioclétien. Auteurs qui fe font ie ^
l’ere philippique. Années qui fe font écoulées entre
Nabonaflar & celle-ci. V. 902. a.
Ere de Rome. V. 902. a. Comment
. Ere des Séleucides. En quel tems elle com m en c e. n>a_
les Juifs la nomment. Plus de 1000 ans après )• • menCé
voient point d’autre époque. En quel tems ils °p* rau0, les
à fe fervir de l’ere de la création. V. 9oa* A ... m~( à deux
Arabes nomment l’ere des Séleucides, l’ere de1 0 ., c
cornes. Les deux livres des Machabécs 1 appellent ‘
royaume'des Grecs. Variété entre les peuples dvncn
E R E
CI° ES- , siUacidcs: Correflion à faire,à cet article de l'Enc
y c lo p é d ie . SttppL IL 853. b.
Ere Je Syracufe: V. 90a . b.
, Ere ic Troyc. V. 901. i.
Ere des Turcs. V. 902. b.
. Ere des Tyriens. V. 902. b.
EREBE. ( Mythol.) fils du Cahos & de la Nuit. V. 902. a.
ERECTEUR, éreflion. ( Anat. Phyfiol. ) Les mufcles auxquels
on a donné le nom d’érefteurs clans cet article de 1 Encyclopédie
, ne méritent pas ce nom- Suppl. II. 8 « . b. Obfervations
qui montrent que l’aélion d’un mufcle eft tnfuffifante
pour procurer quelque efpece d’éredion que ce foit. Obfer-
vation fur les caufes de l’éreftiorr du pems. Ibid8-¡4. a. Lune
fe réduit à l’affluence du fang dans l’organe général, & 1 autre
-à une irritation quelconque. Divers ftimulus qui produifent
l’éreftion. Méchanifme par lequel l’irritation produit 1 affluence
xlu fang. Ibid. b. Adion des mufcles & des nerfs dans 1 érection.
ExpUcadon du relâchement qui fuit cet état. Ibid.
^¿RECTEURS , mufcles , (Anal.) Supvl. IV. 278. b.
ERECTION, ( Gramm.) réponfe de Caton-le-cenleur a
celui qui lui demandoit pourquoi on ne lui avoir point encore
^'tuECTmN'rC a'ffion par laqueUe l’homme couché
fe leve, pour mettre fon corps debout. Condition effenttelle
-pour l'exercice de cette affion. Dans la plupart des mouve-
mens, les os du baffin font le point fixe commun à toutes
lesparties de l'admirable édifice du corps humain. V. 903. a.
E r e c t i o n , (Mlicc. Phy/iol.) état du membre viril, 6*.
Caufe de l’éreftion. Celle du Clitoris. EreSion, gonflement
qui furvient aux mammelons de l’un 6c de lautre fexe.
L’éredion de toutes ces parties arrive en conféquence de
•l’imagination échauffée. V. 9031 b. Examen des railons quon
a données pour expliquer le méchanifme de 1 arrêt du fang,
néceflaire pour i’éreoion. Ibid. b.
Ereflion, caufe & effets des éredions du membre viril. XII.
302. b. Ses caufes. Suppl III. 199- b- 6oo\a' SuPfL 1V: 28 !'
a , b. Comment on remédie à ce défaut de conformauon du
frein qui fait courber la verge dans l’éredion. VIII. 412. a.
De l’impuiflance caufée par défaut d’éredion, 632. b. 8c_par
une éredion trop forte. 633. b. Affoibhffemens que de fim-
ples éredions font éprouver, lorfqu’elles font fréquentes. X.
I l Efpece d’éredion que M. de Bordeu attribue aux orga-
•nes par lefquels fe font les excrétions & les fecréuons. XIV.
B74. b. Eredion du mamelon. Suppl. IV. 839. a , b.
ERÉSIPELE, ( Médec. ) Définition. Etym. du mot. Autres
noms donnés à cette maladie. Différentes efpeces d éréfipele :
éréfipele phlegmoneufe, oedemateufe ou skirrenfe. Eréfipele
effentielle , éréfipele fymptomatique. Eréfipele interne ,
externe, bénigne ou maUgne, accidentelle ou habituelle. V.
003. b. Parties affedées par l’éféfipele interne, par 1 externe.
•Qualité du fang qui forme l’éréfipele. Caufe continente de
cette maladie. Caufes éloignées. Symptômes qui 1 accompagnent
quelquefois. Prognoftic. Elle eft plus ou moins à craindre
1 proportion de la fievre & de la violence des autres accidens.
.Lréréfipele de la face eft de plus grande conféquence que ceUe
des autres parties. Ibid. 904. ». Elle change quelquefois de
liège, 8c devient alors difficile à détruire. Le changement de
l’éréfipele eft fur-tout fâcheux lorfqu’elle paffe du dehors en
dedans. On doit mal augurer de celle qui tend a la fuppura-
tion ou à la gangrene. La feule indication qui fe préfente dans
cette maladie eft la réfolution. Moyeris à employer pour cela.
Ibid. b. Il n’eft aucun cas où l’onpuiffe appliquer des remedes
,répercuflifs fur,l’éréfipele, non plus que des narcotiques, des
huileux. Ce qu’on doit faire lorfqu’il fe forme des veflies fur
l’éréfipele. Traitement de l’éréfipele qui ne vient d aucun vice
:des humeurs, mais feulement de la craffe de la peau, ou de
l’application d’un emplâtre qui a pu arrêter la tranfpiration,
ou embarraffer le cours des fluides dans la partie. Traitement
de l’éréfipele phlegmoneufe ,■ oedemateufe. Ibid. 905. p.
- Eréfipele-, fievre éréfipélateufe. VI. 731. », b. Des mtlam-
- mations éréfipélateufes. VIII. 709. ». Leurs caractères. Ibid.
Leurs caufes prochaines. 71 q. a. Leurs fignes. 717- ~e
l’ufage des topiques contre l’éréfipele. XVI. 4x9. b. Eréfipele
de matrice. XVII. 558. a. Cautérifation recommandée par
Celfe dans les éréfipeles gaiigréneufes. VI. 623. b. Efpece
d’éréfipelc appellée feu perfique. 647. b.
E r é s i p e l e , (Maneg. Maréch.) maladie cutanée. Rien ne
prouve mieux l’uniformité de la marche de la nature dans
les hommes & dans les juiimaux, que les maladies auxquelles
les uns & les autres font fujets. L’éréfipele peut être eflen-
tielle ou fymptomatique. Ses caufes. Ses fignes. Cette humeur
fixée fur les jambes de l’animal, eft moins formidable que
celle de la tète. Indications curatives. V. ooç. b.
FUCTuic»*v t raufe de 1 éréthiime. V. 000. a.
E R G 6 23
tion. VIL 561. ». Efpece d’ércthifme qùè M. de Bordeu attribue
aux ofganes des excrétions & des fécrétions. XIV. 8j|Î
b. Voyei I r r i t a b i l i t é , S p a s m e .
ERGANE, ( Myth.) furnom de Minerve, inventrice dcS
arts. Quels font ceux qu’elle a inventés. V . 906. ».
ERGASTULE, (Hifl. anc.) cachot où les Romains ren*
fermoient à la campagne leurs cfdavcs coupables de quelque
forfait. Grandeur de ce cachot. On y précipita d’honnêtes
gens, qui difparoifloient fans qu’on fut ce qu’ils étoient devenus.
Pourquoi Adrien & Théodofe firent détruire ces lieux*
V. 906. ».
ERGAVICA, ( Géogr. ) ville des Celtibériens dans l*Ef-
pagne Tarragonoife. Anciens monumens où fe trouve le nom
de cette ville. Nom moderne du lieu où elle étoir fituée*
Suppl. II. 855. b.
ERGOT, (Hifl. nat.) forte de corne molle qui fe trouve
derrière le poulet du cheval. V. 006. b.
E r g o t , (Agric. Econ. domeft.) maladie du feigle-, nom
du grain même attaqué de cette maladie. Origine de ce nom*
Caraétere extérieur du blé ergotté. Gangrene que caufe le
pain fait avec ce blé. Réfutation du fentiment de ceux qui
attribuent la caufe de l’ergot aux brouillards. Autres plantes 5
différentes du feigle, que l’ergot attaque également. M. Tillet *
croit devoir l’attribuer à lapiquure de quelque infeôe. Diver-
fité de fentiment fur les effets nuifibles de l’ergot. Le froment,
félon M. Tillet, eft aufli fujet à l’ergot, mais le cas eft rare*
L’extrait de l’ouvrage de cet auteur fe trouve au mot Grain. V.
906. b. La poufliere des grains ergotés ne paroît pas coiltagieufe
dans le froment comme celle des grains cariés. M. Tillet a
trouvé quelques épis ergotés, tant dans les endroits où il
avoit femé le feigle pur, que là où il avoit été fali par la
poufliere de quelques ergots broyés. Obfervations qu’il a faites
fur les infeôes qu’il avoit trouvés dans le grain ergoté. Il n’y
a qu’un petit nombre d’efgots qui contiennent des chenilles.
Pourquoi l’ergot eft plus commun en certaines années qu’en
d’autres. Ibid. 907. ».
E R G O T , (Bot. Agric. Malad. des grains.) blé cornu, blé
fourchu, blé have. Production monftrueufe qui fe trouve
plusfouvent dans les épis de feigle, &plus rarement dans
ceux d’orge & de fromenr. Diflérens noms donnés à cette
maladie. Defcription des grains èrgotés, & de la fubftance
qu’ils contiennent. Suppl. II. 835. b. Terres & expofitions
favorables à la génération de l’eiigor. Le feigle femé en mars *
& celui qui en mêlé de vefee , font pareillement fujets à
cette maladie. Les années pluvieüfes le multiplient. Les petits
épis tardifs y font plus fujets que les autres. Ibid. 856. », Du
froment ereoté. Autres, plantes graminées où l’on a trouvé
de l’ergot. B ne paroît pas que les anciens aieijt connu cette
maladie. Le feigle peu-cultivé en Italie. Caufe de l’ergot félon
Thalius. Ibid. b. Sentimens de différens auteurs fur le même
fujet. Les unsTattribuent à l’abondance des pluies, les autres
aux rofées & aux brouillards,. fiv. Ibid. 837. ». Ces explications
combattues par M. Tillet, qui foupçonne que l’ergot
eft pfcduit par la piquure d’un irtfeâe, qui fait des. grains de
feigle une efpece de galle ou excroiflance , qui commencé
par le fuintement de la liqueur contenue dans le grain altéré
par la tariere de l’infeéfe. Autres naturaliftes qui ont adopté
le même fentiment. Ibid. b. Obfervations qui en affoibliflent
la probabilité. Ibid. 838. ». L’auteur de cet article, trouve plus
vraifemblable d’attribuer l’ergot, foit à l’imperfeétion de la
femence & au défaut de conformation de quelques-uns des
ovaires de la plantule féminale, foit au défaut de fécondation
I de quelques-uns des germes de l’épi, occafionnê par l’humidité
& les vapeurs, qui empêchent l’effet des parties fexuelles
& l’émiffion de la poufliere fécondante. Développement de
ce fentiment. Obfervations qui l’appuient. Ibid. b. M. Aymen
attribue à une même caufe l’ergot dans le feigle & le charbon
dans le froment. Pourquoi, félon cet auteur, la caufe de
ces maladies étant la même, les effets en font fi différens.
Ibid 830 ». Diverfes circonftances qui peuvent concourir
à former l’ergot. Obfervations curieufes de M. Demozé, qui
confirment l’hypothefe de l’auteur. Liqueur mielleufc qui fort
de l’épi ergoté, ibid. b. 8c qui attirant les mouches Sc fes
infeftes ■ eft caufe qu’on trouve quelquefois dans le grain des
petites chenilles dues à ces infeâes. Cette liqueur regardée
comme contagieufe. Des funeftes effets que produit le pain
dans lequel il eft entré beaucoup de grains ergofes. Exemples
de ces effets dans les maladies gangreneufes qui attaquèrent
les habitans de la Sologne en 1709, 8c de l’Orléanois & du
Blaifois en 1716. Remede qui 3 été employé contre ce mal
affreux. Ibid. 860. ». Moyefl de prévenir le mal même. Plus
l’ergot eft frais, plus il eft dangereux -, il y a des années où
il eft plus-malin. Divers témoignages réunis fur les maladie»
caufées par le pain de feigle ergoté. Symptômes de ces mala>
dies. Ibid. b. L’ergot également nuifible aux animaux. Ibid.
861*». Defcription très-détaillée desiuneftes effets qu’il produit
fur les hommes. Ibid. b. Manière de traiter cette maladie.
Ouvrage à confulter. lbidi 8.61, ». . . . -
Ergot, feigle ergoté. XIV. 893, » , b. Epis ergotés. Suppl.1,
r