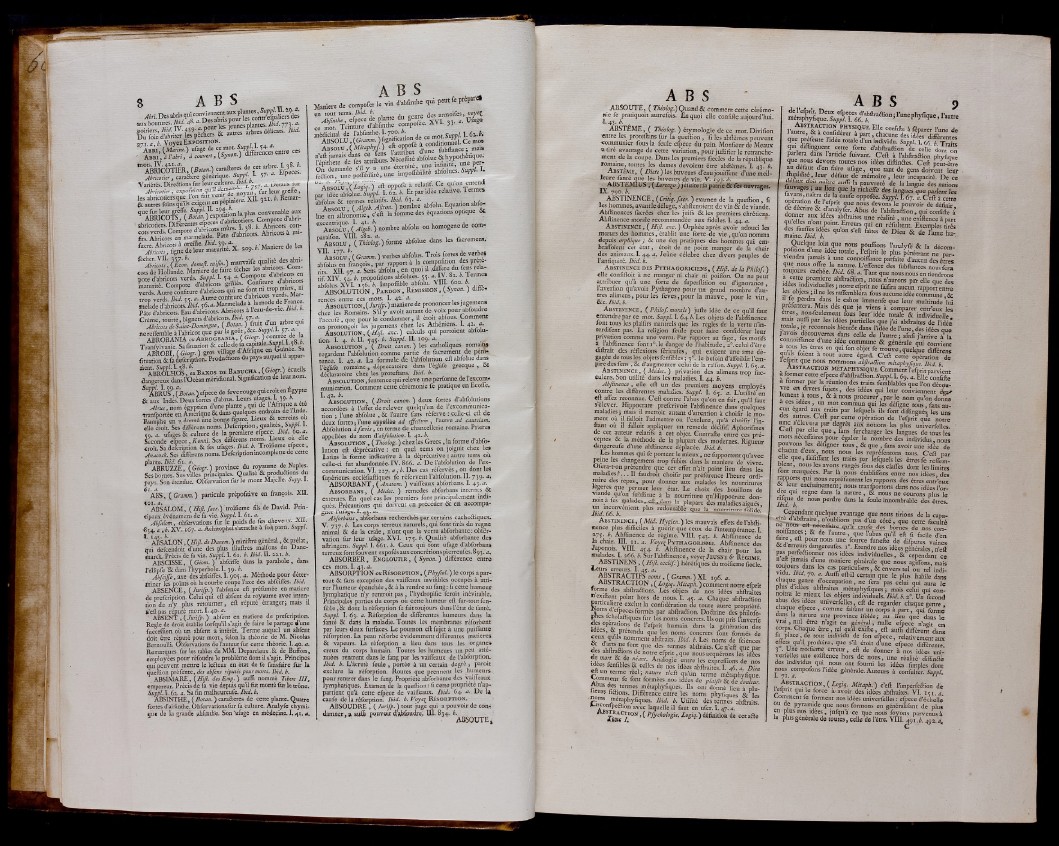
8l àllAaAg tBi aSeSSBe ikrste i ip & i p tffftfe
m ABMCOTm'R,(SoM».) caraileres de cet a r h r c A ^ Î ;
Abricotier, caraftere eénénaue. Suppl. L 57
Variétés. Dire&ions fur leur culture, p g g • Æ ¿ eiaijs air
Abricotier, expofifion ou'Udca^ ^ ’ fur leur greffe,
abriconers. Différentes efpec ^ j „ 4 Abricots cont
e M t o « 7 nCa7 1 d=. Pâte d’abricots. Abricots à ¡ g
aog. ¿/Maniéré de les
{é% ^ 'Æ o n .d om J l.c u iJ iu .) mauvaife qualité des f r i cots
de Hollande. Maniéré de faire ^ Î ^ Z Î S r i c o t s en
note' d’abricots verds. Suppl. 1. 54; f.i d’abricots
maturité ComDOte d’abricots grillés. Confiture aaDncots
verds. Autre confiture d'abricots qui ne font m trop mu.n ,m
troD verds Ibid. ? !. n. Autre confiture d abricots verds. mar
nreE.de d’abricots. IbU. 5«-‘I-M“ ™ lad^ i * ” 7 %te i S i
Pâte d'abricots. Eau d'abricots. Abricots a 1 eau-de-vie. Ibid.
Crème, tourte, bicnets d’abricots. Ibid. 57; a\ , .
ne reffemble à l’abricot que par le gout,,8cc.SuppLL Î 7- •
■ ABROBANIA ou AbrOGBANIA , ( Gtogr. ) contrée de la
TranMvmie. Safituadon 8c W M K t m à t Ê K É M à .
AB&OBI ( Géogr. ) gros village d Afrique en Gumee. Sa
fituadon&fàdefcri^tioiu Produ&ions dupays auquel .1 appar-
” eMR(SÎHQ,s ',ouBaxos DEBABOCHA,(Geogr.) ècuerls
dangereux dam l'Océan méridional. Signification de leur nom.
^ T b R U ^ {Botan.') efpece de f e v e rouge qpi croit en Égypt.
& aux Indes. Deux fortes d'abrus. Leurs ufages. L 39. g
Abrus, nom égyptien d’une plante, qui de 1 Afrique a été
tranfportée en Amérique & dans quelques endroits de llnde
Rumphe en a d o n n é une bonne figure. Lieux & terreurs 00
elle croit. Ses différens noms. Defcnpnon, qualités1, Suppl. L
«0. a. ufages 8c culture de la première efpece. Ihd. 60. a.
Seconde eïpece, Konni. Ses différens noms. Deux ou elle
croit. Sa defcription Si fes ufages. Ihd. b. Troifieme efpece,
Anacock. Ses différens noms. Defcripuon incomplette de cette
plante. Ibïd. 61. a. I XT H S
ABRUZZE, ( Géogr. ) provmce du royaume deNaples.
Ses bornes. Ses villes principales. Qualité & produébons du
pays. Son étendue. Obfervatiort furie mont Ma;elle. Supp. 1.
^ A B S , ( Gramm. ) particule prépofirive en françois. XII,
°ABSALOM, ( Hift. facr. ) troifieme fils de David. Prin
cipaux. évenemens de fa vie. Suppl. 1. 61. a.
Abfalom, observations fur le poids de fes_ dheven.v. XLL.
«54. a ,-b. XV. 167. a. Achitophefs’attache à foi* paru. Suppl.
A^SALON, {Hift. de Danem. ) miniftre général, & prélat,
tiui defcendoit d’une des plus illuftres maifons du Dane-
ûiarck. Précis de fa vie. Suppl. L 61. b. Ibïd. H. 2.2.1. b.
ABSCISSE, (Géom.) abfciffe dans la parabole, dans
l’ellipfe & dans l’hyperbole. I. 39. b. .
Abfciffe, axe des abfciffes. I. 905. a. Méthode pour deter-
ininer les points où la courbe coupe l’axe des abfciffes. Ibid.
ABSENCE, {Jurifp.) l’abfence eft préfumée en matière
de prefeription. Celui qui eft abfent du royaume avec intention
de n’y plus retourner, eft réputé étranger; mais il
a’eft pas réputé mort. 1 .40. a. _ . • ; .
5 ABSENT, {Jurifp. ) abfent en matière de prelcnpuon.
Réglé de droit établie lorfqu’il s’agit de faire le partage d’une
fucceflion où un abfent a intérêt. Terme auquel un abfent
doit être réputé pour mort, félon la théorie de M. Nicolas
Bernoulli. Obfervadons de l’auteur fur cette théorie. 1. 40. a.
Remarques furies tables de MM. Deparcieux & de Buffon,
employées pour réfoudre le problème dont il s’agit. Principes
qui peuyent mettre le lefteur en état de fe fatisfaire fur la
queftion préfente, des abfens réputés pour morts. Ibid. b.
ABSIMARE, (.Hjft- desEmp.) aufli nommé Tibère III,
empereur. Précis de ia vie depuis qu’il fut monté fur le trône.
Suppl. 1. 62. a. Sa fin malheureuie. Ibid. b.
ABSINTHE, ( Botan. ) carafteres de cette plante. Quatre
fortes d’abfimhe.Obfervationsfur fa culture. Analyfe chymi-
que de la grande abfinthe. Son'ufagc en médeçine. 1, 41. a.
A B S
Maniéré de compofer le vin d’abfinthe qui peut fe pr SëS» du ce mot. Teinture d’abfmthe compofée. XVI. 33’
médicinal de l’abfinthe. 1. 7°° ; b: mot. Suppl. I- C a.i.
ABSOLU (Grain,n) g y H B conditionnel. Ce mo»
A b so lu , (M.MyéyA) eft oppot fubftanCe ; mats
“ ■suppU *
m Ê ^ m Ê S È ^ abfoln. Equarion abf^
lu e en afaonotnie, c’eft la femme des équations opttque &
CX A bsolu j {Mgib. ) nombre abfolu ou homogène de com-,
^ A bsolu î ( Thcolog. ) forme abfolue dans les facremens;
^ A b so lu ! ( Gramm.) verbes abfolus. Trois fortes de verbe*
abfolus en françois, par
rits. XII. 97. a. Sens abfolu, en quoi il M M I B
tif. XIV. ta. 4. propofitions abfolues. çç. e. IV. 8a. ». lerme»
abfolus. XVI. 156. 4. Impoflible abfolu. VIII. 600. 4. _
ABSOLUTION , Pa r d o n , R émission , (Syuon. ) ditte-
rences entre ces mots. I. 4®* a' . ,
A b s o lu t io n , ( 7ar/7p.) maniéré de prononcer les jugemens
chez les Romains. S’il y avoir autant cle v o i x pour abfoudre
î’accufé, que pour le condamner, il étoit abfous. Comment
on prononcoit les jugemens chez les Athéniens. 1.
A bsolu tio n , ( /&/?• anc-) calculs qui portoient ablolu-
tion. I. 4. b. II. 545. b. Suppl. II. 109. a.
A b solution , ( Droit canon. ) les catholiques romaïqj
regardent l’abfoludon comme partie du facrement de pénitence.
I. 42.. a. La formule de l’abfolution eft abfolue dans
l’èglife romaine, dèprêcatoire dans l’églife grecque, Se
déçlaratoire chez les proteftans. Ibid. b. ^
A bso lu tio n ,fentence qui releve une perfonne de 1 excommunication.
Comment cette cérémonie fe pratique en Ecoffe.
A bso lu tio n , ( Droit canon. ) deux fortes d’abfolutions
accordées à l’effet de relever quelqu’un de l’excommumca-
tion ; l’une abfolue , 8c l’autre fans réferve : celle-ci eft de
deux fortes, l’une appellée ad ejfeâum , l’autre ad cautelam.
Abfolution à feevis, en terme de chancellerie romaine. Prières
appellées du nom $ abfolution.!. 42 .b.
A b so lu tio n , ( Théolog. ) chez les Grecs, la forme d’abfo-
lution eft déprécative : en quel tems on joignit chez les
Latin* la forme indicative à la déprécative : autre tems où
celle-ci fut abandonnée. IV. 866. a. De l’abfolution de l’excommunication.
V I. 227. a ; b. Des cas referves , ou dont les
fupérieurs eccléfiaftiques fe réfervent l’abfolution. II. 739. a.
ABSORBANT, ( Anatom. ) vaiffeaux abforbans. I. 43.a.
A bso rbans , ( Médec. ) remedes abforbans internes &
externes. En quel cas les premiers font principalement indiqués.
Précautions qui doivent en précéder 8c en accompagner
l ’uiage. L 43. **. —
Abforbans, abforbans recherchés par certains cachectiques.
V . 737. b. Les corps terreux naturels, qui font tirés du regne
animal 8c de la craie, n’ont que la vertu abforbante : oblér-
varion fur leur ufage. XVI. 175. b. Qualité abforbante des
aftringens. Suppl. 1. 061. b. Ceux qui font ufage d’abforbana
terreux font fouvent expofés aux concrétions pierreufes. 893. n,
ABSORBER, En g l o u t ir , ( Synon. ) différence entre
ces mots. I. 43. a.
ABSORPTION ou R é so rptio n , ( Phyfiol. ) le corps a partout
8c fans exception des vaiffeaux invifibles occupés à attirer
l’humeur épanchée, 8c à la rendre au fang : fi cette humeur
lymphatique n’y rentroit pas, l’hydropifie feroit inévitable.
Principales parties du corps où cette humeur eft fur-tout fen-
fible ,8c dont la réforption fe fait toujours dans l’état de fanté.
Suppl. I. 63. a. Réforption de différentes humeurs dans la
fanté 8c dans la maladie. Toutes les membranes réforbent
par leurs deux furfaces. Le poumon eft fujet à une puiffantç
réforption. La peau réforbe évidemment différentes matières
8c vapeurs. La réforption a lieu dans tous les organe»
creux du corps humain. Toutes les humeurs un peu atténuées
rentrent dans le fang par les vaiffeaux de l’abforption.
Ibid. b. L’âcreté feule, portée à un certain degré, paroit
exclure la réforption. Routes que prennent les Humeurs
pour rentrer dans le fane. Propriété abforbante des vaiffeaux
lymphatiques. Examen de la queftion : fi cette propriété n’appartient
qu’à cette efpêce de vaiffeaux. Ibid. 64. a. De U
caufe de la réforption. Ibid. b. Voyeç R é so rptio n .
ABSOUDRE, ( Jurifp. ) tout juge qui a pouvoir de cou-;
damner, » au& pvuyoù: d’gb&udre, LU. 834. b.
ABSOUTE j
A B S
ABSOUTE, ( Théolog.) Quand & comment cette cérémonie
fe pratiquoit autrefois. En quoi elle confifte aujourd’hui.
I. 43. b.
ÀBSTÊME, ( Théolog. ) étymologie de ce mot. Divifion
entre les^ proteftans fur la queftion, fi les abftèmes peuvent
communier fous la feule eipece du pain. MonfieurdeMeaux
a tiré avantage de cette variation, pour juftifier le retranchement
de la coupe. Dans les premiers fiecles de la république
romaine, toutes les dames devoient être abftèmes. I. 43. b.
Abstéme, ( Diete ) les buveurs d’eau jouifienr d’une meilleure
lanté que les buveurs de vin. V. *s j - %__1.
ABSTEMÎUS, ( Lorenzo ) jé fuite :fa patrie 8c fés ouvrages.
IX. 79 0; b.
ABSTINENCE, ( Crltiq. facr. S examen de la queftion, fi
les hommes, avantle déluge, s’abftenoient de vin 8c de viande.
Abftinences facrées chez les juifs 8c les premiers chrétiens.
Abftinence morale recommandée aux fideles. I. 44. a.
A bstinence , ( Hift. anc. ) Orphée après avoir adouci les
moeurs des hommes, établit une forte de v ie ,qu’on nomma
depuis orphique ; 8c une des pratiques des hommes qui em-
brafloient cet état, étoit de ne point manger de la chair
des animaux. 1. 44. a. Jeûne célebre chez divers peuples de ‘
l ’antiquité. Ibid. b.
A bstinence des P y t h a g o r ic ie n s , ( Hift. de la Philof. )
elle confiftoit à ne manger ni chair ni poiflon. On ne peut ,
attribuer qu’à une forte de fuperftition ou d’ignorance,
l’averfion qu’avoit Pythagore pour un grand nombre d’autres
alimens, pour les feves, pour la mauve, pour le v in .
&ç. Ibid. b.
A bst inen ce, ( Philof. morale') jufte idée de ce qu’il faut
entendre par ce mot. Suppl. I. 64. b. Les objets de l’abftinence
font tous les plaifirs naturels que les regles de la vertu n’in-
terdifent pas. La religion feule peut faire confidérer leur
privation comme une vertu. Par rapport au fage, fes motifs
à l’abftinence font i° .le danger de l’habitude, 20. celui d’être
diftrait des réflexions férieufes, qui exigent une ame dégagée
de tous les objets fenfibles ; 30. le befoin d’affoiblir l’empire
des fens , 8c d’augmenter celui de la raifon. Suppl. 1. 6e. a.
A b st in en ce , ( Médec. ) privation des alimens trop fuc-
culens. Son utilité dans les maladies. I. 44. b.
Abftinence, elle eft un des premiers moyens employés
contre les différentes maladies. Suppl. I. 65. a. L’utilité en
eft affez reconnue. C’eft contre l’àbus qu’on en fait, qu’il fout
sélever. Hippocrate preferivoit l’abftinence dans quelques
maladies; mais il mettoit autant d’attention à choifir le moment
où il folloit l’admettre ou l’exclure, qu’à choifir l’in-
ftant où il folloit appliquer un remede décifif. Aphorifmes
de cet auteur relatifs à cet objet. Contrafte entre ces préceptes
8c la méthode de la plupart d.es modernes. Rigueur
dangereufe d’une abftinence déplacée. Ibid. b.
Les hommes qui fe portent le mieux, ne fupportent qu’avec
peine les changemens trop fubits dans la maniere de vivre.
Ufera-t-on prétendre que cet effet n’ait point lieu dans les
maladies. . . . Il faudrait choifir par préférence l’heure ordinaire
des repas, pour donner aux malades les nourritures
îegeres que permet leur état. Le choix des bouillons de
viande qu °n fubftitue a la nourriture qu’Hippocrate don-
n c tà f e s yalades > plupart’ des maladies aigu«,
an inconvénient plus redoutable que la ffiSB îSH ffifitSSl
Ibid. 66. b.
A b s t in e n c e , ( Méd. Hygien.) les mauvais effets de l’abftinence
plus difficiles à guérir que ceux de l’intempérance I
275. g Abftinence de régime. Vm. 543. b. Abftinence de
Ja chair. III. n . a. Voye^ P y th a g o r ism e . Abftinence des
Japonois. VIH. 454. b. Abftinence de la chair pour les
10 a nCS‘ l ‘ l’abftinence, voye^ Jeu sn e 6» Régime.
ABSTINENS, ( Hift. eccléf. ) hérétiques du troifieme fiecle.
4 -eurs erreurs. I. 45. a.
ÀBSTRACTIFS noms, ( Gramm. ) XI. 196. a.
ABSTRACTION , ( Logiq. Métaph. ) comment notre efprit
rorme des abftraétions. Les objets de nos idées abftraites
n exutent point hors de nous. I. 45. a. Chaque abftraétion
j.ere exc^ut confidération de toute autre propriété.
X « V u T formés ab%aftion. Doftrine des philofo-
5 « ^ • ques fur R noms concrets. Ils ont pris Pinverfe
îÎupc a?*10 aS I I l’el'prit humain dans la génération des
luees, oc prétendu que les noms concrets font formés de
nomment abftraits. Ibid. b. Les noms de fciences
£ e k Í Ía -6 . que des termes abftraits. Ce n’eft que par
des abftrathons de notre efprit, que nous acquérons les idées
\AiTfrL 7 . , Z antu Al?alogie entre les expreflîons de nos
dées fenfibles 8c celles de nos idées abftraites. I. 46. a. Dieu
C o Z 7 " V e P p ï ï l m m Krme luétaphyfique.
formées nos .àées de pUiJIrSiâo dolur.
W fiI-,ermS .J ? itaPhy flIlues; Ils ont Heu à plu-
1 : fictions. Différence entre les noms phyfiques 8t les
Cm on/n7 pl'yriqUeS’ I li i ' des termes abftraits.
W M P n f avec laquelle il faut en ufer. I. 47. q.
^ “ a c t io n , ( pjychologit. Logiq.) définition de cet aSe
A B S 9
■ Æ Ê S Ê sm m m m i w de 1 autre, oc a confidérer à part, chacune des idees différent^«
?.ri . e t0ta)-e d’“ n i*tlividu- SulPl- L 66. i Traits
qui diflmguem cette forte d’abftraâion de celle don, on
parlera dans 1 article fuivant. C’eft à l’abftràaion phyfique
que nous devons toutes nos idées diftinaes. C’eft peut-être
an dé&ut d’en fiire ufage, que tant de gens doivent leur
ttupitbté, leur défaut de mémoire, leur incapacité. De ce
: f à ü Z e s ^ i S ' f e t T C P 4 de h langue des nations
lauvages , au le u que la richê/Te des langues que parlent les
fevans naîtra de la caufe oppofée. Suppl. E 67. 1 c S à cet“
opération de 1 efprit que nous devons le pouvoir de définir
de décrire 8c d analyser. Abus de l’abftra&on, qui conMe à
qu”e Z 3“X idé“ ^ ftraites " ” e Ü P ■ ê X n « à part
d 7 i , Æ 0n,uP0mt'.Erre,UrnS ¥ en réfulre” t- Exemples tirés
maint Ê i q“ 0" $ efl “ tes de Die“ & de l ’L e hu-
„ „ r ? uelï e loi” ,? u<: fi?1“ pouffions l’analyfe' & la décom-
|P o f'“ on dune idée totale , felprit le plus pénétrant ne par.
viendra jamais à une connoiflance parfoite d’aucun des êtres
que nous offre la nature. L’effence des fubftances nous fera
toujours cachée. Ihd. 68. q. Tant que nous nous en t ie n d 'Z
?,,cett.e preuuerc abftraéliori, nous n’aurons par elle que des
rééesindividuelles; notre efprit ne faifira aucun rapport entre
les; objets ; fine les raftemblera fous aucune idéecommiiné 8c
u le perdra dans le cahos immenfe que leur multitude’lui
préfentera. Mais des que je viens à comparer entr’eux les
etres, non-feulement fous leur'idée totale 8c individuelle
mais auflï par les idées partielles que j’ai abftraites de l’idée '
totale, je reconnois bientôt dans l’idée de l ’une, des idées que
Z r 7 eC0U;.ert“ A ‘m ceIIe de |,autrei auifi j’arrive a la
cornioiffance dune idée commune 8c générale qui convient
¿ ¡S i ? etr,es en q“ fou ohiet fe trouve, quelque différens
a “ ut outre égard. C’eft cette opération de
elpnt que nous nommons abftratlion métaphyjmue. Ibid b
ï AfiVTRACTlON mev ap h Ysiqu£. Comment/’efprit parvient
a former cette efpece d’abffraéHon. Suppl. L 69. q. ÈUe confifte
a former par la réiuuon des traits femblables que l’on découvre
en divers fujets, des idées qui leur conviennent êaP
lement a tous , 8c à nous procurcf, par le nom qu’on donne
a ces idées , un mot commun qui les défigne tous, fans aucun
égard aux ttaits par lefquels ils font dillingués les uns
des aun-es. C eft par cette opération de l’efprit que notre
ame s élevera par degrés aux notions les plus univerfelles. '
eu par elle que, fans furcharger les langues de tous les
mots néceffaires pour égaler le nombre des individus, nous
pouvons les défigner tous, 8c que, fans avoir une idée de
chacun deux, nous nous les repréfentons tous. C ’eft par
elle que, faififfant les traits par lefquels les êtres fe reffem-
blent, nous les avons rangés feus des claffes dont les limites
font marquées. Par là nous établirons entre nos idées des
rapports qui nous repréfenrent les rapports des êtres entr’eux
oc leur enchaînement ; nous tranfeortons dans nos idées l ’or-
dre qui regne dans la nature, 8c nous ne courons plus le
rilqiie de nous perdre dans la foule innombrable des êtres.
Ibid. b.
. • F eSèinq ant queItIue avantage que nous tirions de la capat
gitedabltraire, n oublions pas d’un côté , que cette faculté
nJTîous - T • Î W r l|nflT||||f des bornes le ncsTcnt
fahîZft ; 1 autre, que l’abus qu’il eft fi facile d’en
raire, eft pour nous une fource fimefte de difputes vaines
8c d erreurs dangereufes. r°. Etendre nos idées générales n’eft
pas perfeftionner nos idées individuelles, 8c cependant ce
Z i n T '¡ne mamere générale que nous agiffons, mais
toujours dans les cas parncuUers, 8c envers tel ou tel individu.
Ibid. 70. q. Aufli eft-il certain que le plus habile dans
Î , j rA enre doccupation, ne fera pas celui qui aura le
plus did-es abftraites métaphyfiques ; mais celui qui con-
noitra le mieux les objets individuels. Ibid. b. 1°. Un fécond
abus des idées univerfelles, eft de regarder chaque genre,
chaque eipece, comme foifont un coips à part, qui forme
dans la nature une province ifoièe; au lie u que dans fo
v ra i, nul être n’agit en général, nulle efpece n’agit en
corps. Chaque être , tel ou il exifte, eft aufli différent dans
fa place, de tout individii de fon efpece, relativement aux
ehets qui( produira, que s’il étolt tfune efpece différente
3 . Une troifieme erreur, eft de donner à nos idées uni-
verfelles une exiftence hors de nous, une réalité' diftinfté
des individus qui nous ont fourni les idées impies dont
nous compofonslidée générale. Auteurs à confultcr. Suppl.
., A b s t r a c t io n , {Logiq. Mitaph.) c’eft l’imperfeftion de
lelpnt qui le force à-avoir des idées abftraites. VI. 151. q.
omment fe forment nos idées univerfelles : eipece d’échelle
ou de pyramide que nous formons en généraufont de plu»
en-plus nos idées, jufqu'àce que nous foyons parvenus à
la plus générale de toutes, celle de l’être. VIII. ^9 1 . b. 49a. a.