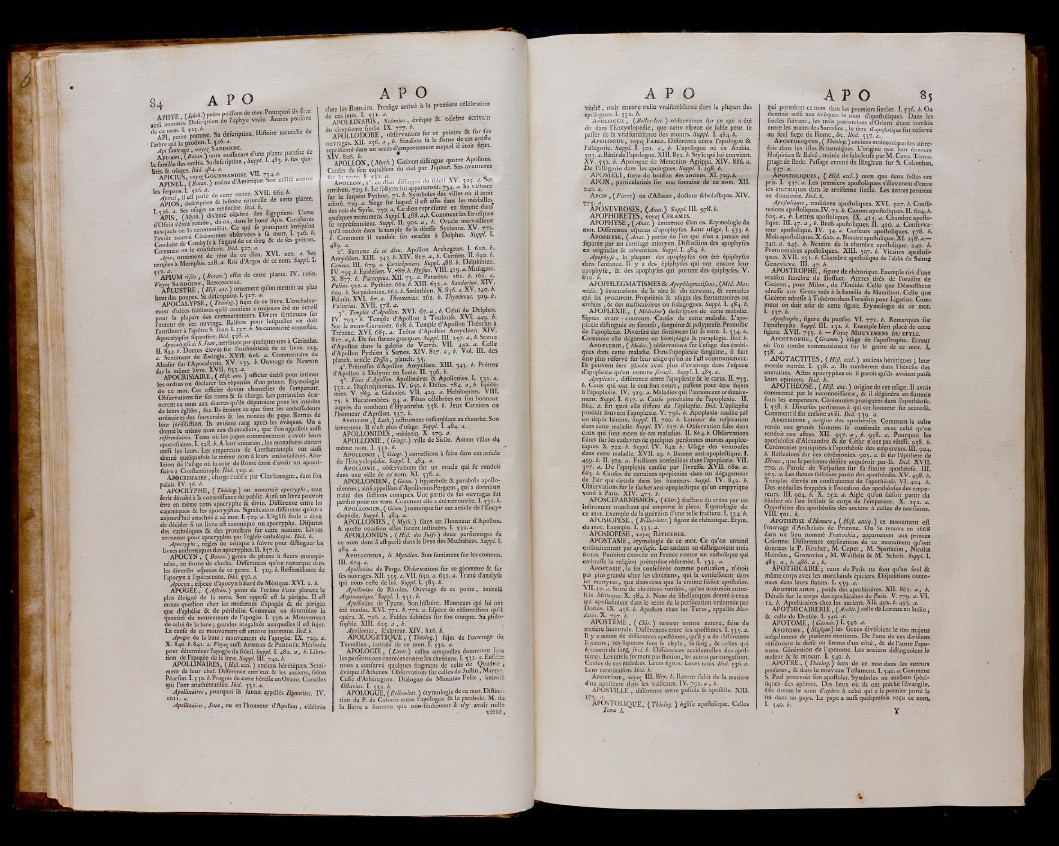
8 4 A P O
di^ l " 7 edK pomme. Sa defcription. Hiftoire naturelle de
• l'arbre qui la produit. I . 1; î6. a.
Î Û ^ W Ê Ê Ê Ê S Ê M d'une plante ¡ ¡ ¡ g de
la femiUtTfiès orchis. Sa defcription, Suppl, I, 483. i.fes ,ua-
lités & ufages. Ibid. 484. a.
APÎCIU?> voyez Gou rmand ise . VII. 7$4-a‘
S a , ( 7 . » . ) racine d’Amérique. <U urdtté contre
t m f, /t Ses ufaees en medecme. Ibfd. b. •
APIS* (M y A divinité célébré des Egyptiens. Lame
vJ\r • UtAÏf retirée dit-on, dans le boeuf Apis. Cara&eres
auxquels on le reconnoiffoit. Ce qrn fe pratiquoit lorfquon
l^voit trouvé. Cérémonies obfervées a fa mort. L 5*6. i.
(induite de Cambyfe à l’égard de ce dteu & de fes pretres.
Comment on le confultoit. Ibid. 5a7- ¿* n <>
Apis, ornement de tète de ce dieu. XVI. aoa. e. Ses
tempes à Mempbis.ai8.e. Ro. d’Argos de cenom. Suppl. I.
55AP1UM rijüs, (Botan,) effet de cette plante. IV. 1060.
Voyez Sardoine , Renoncule. .
ÀPLUSTRE, ( Hifi. anc. ) ornement qu on mettoit au plus
haut des poupes. Sa defcription. 1. 527. a.
A POC A LY PSE, ( Théolog.) fujet de ce livre. L enchaînement
d’idées fubümes qu’il contient
pour la plupart des commentateurs. Divers fentimens lur
Fauteur de cet ouvrage. Raifons pour lefquelles on doit
l’attribuer à l’apôtre S. Jean. L 527. b. Sacanomcité conteftée.
Apocalypfes fuppofèes.Ibtd. 520. a. •
Avocalypfe de S. Jean, attribuée par quelques-uns à Cérmthe.
U Saa ¿.Doutes élevés fur l’authenticité de ce livre. 22a.
Sentiment de Zwingle. XYÜ. 616. a. Commentaire de
Alcafar fur l’Apocalvpie. XV. 133. ¿.Ouvrage de Newton
fur le même livre. XVII. 635. a.
APOCRIS1A1RE, ( Hifi- anc.) officier établi pour intimer
les ordres ou déclarer lesréponfes d’un prince. Etymologie
de ce mot. Cet officier devint chancelier de 1 empereur.
Obfervations fur fes noms & fa charge. Les patriarches donnèrent
ce nom aux diacres qu’ils députoient pour les intérêts
de leurs églifes, &c. Ils étoient ce que font les ambaffadeurs
ordinaires des fouverains & les nonces du pape. Bornes de
leur iunfdiftion. Ils avoient rang après les évêques. On a
donné le même nom aux chanceliers, que 1 on appellent auiti
référendaires. Tems où les papes commencèrent à avoir leurs
apocrifiaires. I. 528. b. A leur imitation, les monafteres eurent
auffi les leurs. Les empereurs de Conftantinople ont auffi
donné quelquefois le même nom à leurs ambaifadeurs. Abolition
de l’ufage où la cour de Rome étoit d’avoir un apocri-
iiaire à Conftantinople. Ibid. 520. a.
A po c r is ia ir e , charge étabfie par Charlemagne, dans fon
palais. IV. 3 6. b.
APOCRYPHE, (Théolog.) on nommoit apocryphe, tout
écrit dérobé à la connoiifance du public. Ainfi un livre pouyoit
être en même tems apocryphe & divin. Différence entre les
canoniques & les apocryphes. Signification différente qu’on a
aujourd’hui attachée à ce mot. I. 529.\a. L’églife feule a droit
de décider fi un üvre eft canonique ou apocryphe. Difputes
des catholiques & des proteftans fur cette matière. Livres
reconnus pour apocryphes par l’églife catholique. Ibid. b.
Apocryphe, réglés ae critique à fuivre pour diilinguer les
livres autnentiques des apocryphes. II. 857. b.
APOCYN, (Botan.) genre de plante à fleurs monopé*
taies, en forme de cloche. Différences qu’on remarque dans
les diverfes efpeces de ce genre. L 529. b. Reffemblance de
l’apoçyn à l ’ipecacuana. Ibid. 330.a.
Apocyn. efpecc d’apocyn bâtard du Méxique. XVL 2. b.
APOGÉE, ( Aftron.) point de l’orbite d’une planete le
plus éloigné de la terre. Son oppofé eil le périgée. Il eft
moins question chez les modernes d’apogée 8c de périgée
que d’aphélie & de périhélie. Comment on détermine la 3uantité du mouvement de l’apogée. I. 530. a. Mouvement
e celui de la lune ; grandes inégalités auxquelles il efl fujet.
La caufe de ce mouvement eft encore inconnue. Ibid. b.
Apogée de la lune : mouvement de l’apogée. IX. 729. a.
X. 840. b. 841. a. Voyc^ auffi A psides & Per igÉe. Méthode
pour déterminer l’apogée du foleil. Suppl. 1. 482. a , ¿.Libration
de l’apogée de la lune. Suppl. III. 740. b.
APOLLINAIRES, (Hifi. eccl.) anciens hérétiques. Sentiment
de leur chef. Différence entr’eux & les anciens, félon
Péarfon.1. 330. ¿.Progrès de cette héréfie en Orient. Conciles
qui l’ont ânathématifèe. Ibid. 331. a.
Apollinaires, pourquoi ils furent appelles Dimarites. IV.
1011. a.
Apollinaires, Jeux, ou en l’honneur d’Apollon , célébrés
A P O
chez les Romains. Prodige arrivé à la première célébration
^ A P o 'llÏn A rŸ s 1,' Sidomus, évêque & célébré écrivain
*'aPOLLODORE obfervations fur ce peintre & fur ies
0 uvnu esX a a56.111 b. Sinalion fit la ftatue de cet amfte
représenté dans un accès Emportement auquel d etott fujet.
APOLLON, (Myth.) Cicéron diftingue quatre Apollons.
Caufes de fon expulfion du ciel par Jupiter. Ses aventures
diffingUé du foleü.XV. , î f . ; S Scs
attributs. 7Ï9. 1 Le fphynx lui appartenoir .734. Sa victoire
fur le ferpent Python. 71. b. Symboles des villes «u il e oit
adoré. 7S9. a. Siege fur lequel il eft affis dans les médadh»
des rois de Svrie. 730. a. Ce dieu repréfenté en femme dans
quelques monumens. Suppl. 1.488. aj>. Comment lés Etrufques
le repréfentoient. Suppl. n . 00*. a ,b . Oracle mcrvedleux
qu’il rendoit dans le temple delà déeffe Smenne. XV. 77a.
t. Comment il rendoit fes oracles à Delphes. Suppl, 1.
Surnoms de ce dieu. Apollon Archegetes. I. 610. b.
Amydéen. XIII. 343- b- XIV. 817. a, b Carmen. II. 690. b.
Conçus, n i. 679. u. Çortbtipotens. Suppl. b. Delphimen.
IV. 795. b. Epidelien. V . 787. É. Hyjius. V f f l . 419 Mufagete.
X. 877. b. Pamopius. XII. 73. rcPataréen. 161. b.
Poilus.mu.a. Pythieu. 66a. b. XIH. 63a. u Sandanus. XIV.
600. ¿. Sarpédonien. 662. b. Sminthien. X. 8 <6. a. XV. 240. b.
Palatin. XVI. 67. a. Theoxenius. 261. ¿. Thymbreus. 309. ¿.
Vulturius. XVH. 378. a. .
30. Temples d'Apollon. XVI. 67. « , b. Celui de Delphes.
I\ r 703.* b. Temple d’Apollon à Touloufe. XVL 449. b.
Sur le mont-Geranien. 638. b. Temple d’Apollon Théorius a
Trézene. XVI. 683. a: Trône d’Apollon Amycléen. XIV.
817. a, b. De fes ftatues grecques. Suppl. III. 237. a, b. Statue
d’Apollon dans la galerie de Verres. VII. 442. ¿ -C e lle
d’Apollon Pythien à Saraos. XIV. 827. a , b. Vol. III. des
planch. article DeJJîn, planch. 33.
4°. Prètreffes d’Apollon Amycléen. XIII. 343. ¿. Pretres
d’Apollon à Didyme en Ionie. IL 396. b.
30. Fêtes d'Apollon. Apollinaires & Apollonies. I. 131. a.
332. a. Daphnéphories. IV. 630. b. Délies. 784. a , b. Épidémies.
V. 789. a. Galaxies. VII. 4*9- a- Hebdomées. VIII.
73. b. Hecatombées. 04. a. Fêtes célébrées en fon honneur
auprès du tombeau d?Hyadnthe. 338. b. Jeux Carniens en
l’honneur d’Apollon. 337. ¿. „ t
A pol lon , ( Luth, ) infiniment reffemblant au thuorbe. Son
inventeur. Il n’eft plus d’ufage. Suppl. I. 484. a. g
APOLLONIDES médecin. X. 279. a.
APOLLONIE, ( Ge’ogr. ) ville de Sicile. Autres villes du
même nom. I. 331. b. ■
A pollonie , ( Géogr. ) corrections à faire dans cet article
de l’Encyclopédie. Suppl. I. 484. a.
A po l lo n ie , obfervations fur un oracle qui fe rendoit
dans une ville de ce'nom. XI. 336. a.
APOLLONIEN, ( Géom. ) hyperbole 8c parabole apollo-
niennes ; ainfiappellées d’Apollonius Pergæus, qui a donné un
traité des feétions coniques. Une partie de fes ouvrages fiit
perdue pour un tems. Comment elle a été retrouvée. 1. y i . i .
A pol lon ien, ( Géom. ) remarque fur cet article de l’Ency»
clopédie. Suppl. 1. 484. a.
APOLLONIES, (Myth.) fêtes en l’honneur d’Apollon.
A quelle occafion elles furent inftituées. I. 332.fr.
APOLLONIUS , (Hifl. des Juifs) deux perfonnagès de
ce nom dont il eft parlé dans le livre des Machabées. Suppl. I.
484. a.
A pollonius , le Myndien. Son fentiment fur les cometes.
IH. 674. a.
Apollonius de Perge. Obfervations fur ce géometre & fur
fes ouvrages. XII. 3 53. a. VII. 630. a. 631. a. Traité d’analyfe
qui nous refte de lui. Suppl. L 383. b.
Apollonius de Rhodes. Ouvrage de ce poëte, intitulé
Argonautique.rSuppl. I. 331. b.
Apollonius de Tyane. Son hiftoire. Honneurs qui lui ont
été rendus. XVI. 771. b. 772. a. Efpece de réfurreftion qu?il
opéra. X. 726. a. Fables débitées fur fon compte. Sa philo-
’ fophie. XIII. 623. a , b.
Apollonius, fculpteur. XTV. 816. b.
APOLOGÉTIQUE, (Théolog.) fujet de l’ouvrage de
Tertullien, intitulé de ce nom. 1. 332. a.
APOLOGIE, (Littér.) celles auxquelles donnèrent lieu
les perfécutions exercées contre les chrétiens. I. 5 3 a-f-Eufebe
nous a confervé quelques fragmens de celle de Quadrar ^
évêque d’Athenes. Obfervations fur celles de Juitin, Martyr.
Celle d’Athénagore. Dialogue de Minutius Félix , intitulé
Ollavius. I. 332. b. _
APOLOGUE, (Belles-lett. ) étymologie de ce mot. Diftinc-
tion du P. de Colonia entre l’apologue & la parabole. M. dô
la Barre a foutenu que non-feulement il n’y avoit nulle
yèrite,
A P O A P O
Verîtè, mais encofre nulle vraifeniblance dans la plupart des
apologues. I. 33a. ¿.
A p o l o g u e , (Belles-lett. ) obfervàtion fur ce qui a été
dit dans l’Encyclopédie, que cette efpece de fable peut fe
paffer de la vraifemblance des moeurs. Suppl. I. 484. b.
A p o lo g u e ¡> voye^ F a ble. Différence entre l’apologue &
l’allégorie. Suppl. I. 301. a , b. L’apologue né en Arabie.
303. a. Récit de l’apologue. XIII. 832. b. Style qui lui convient.
XV. 332. b. Apologue de Menenius Agrippa. XIV. 886. a.
De l’allégorie dans les apologues. Suppl. I. 298. b.
APOMELI, forte de boiflon des anciens. XI. 729. b.
APON, particularités fur une fontaine de ce nom. XII.
240. a.
A p o n , ( Pierre) ou d’Albano, doéteur fcholaitique. XIV.
773. a.
APONEVROSES, (Anat.) Suppl. III. 978. b.
APOPHORETES, voye? C érames.
APOPHYSE, (Anat.) éminence d’un os. Étymologie du
mot. Différentes efpeces d’apophyfes. Leur ufage. I. 333. ¿.
A p o ph y se , (Anat.) partie de l’os qui n’en a jamais été
féparée par un cartilage mitoyen. Diftinétion des apophyfes
en originales & adventices. Suppl. I. 484. b.
Apopkyfc, la plupart des apophyfes ont été épiphyfes
dans l enfance. Il y a des épiphyfes qui ont encore leur
apophyfe, & des apophyfes qui portent des épiphyfes. V.
810. b.
APOPHLEGMATISMES 8cApophlegmatifans, (Méd. Mat.
médic. ) évacuations de la tête & du cerveau, oc remedes
qui les procurent. Propriétés & ufages des fternutatoires ou
errhins , & des mafticatoires ou fialagogues. Suppl. I. 484. b.
APOPLEXIE, (Médecine) defcription de cette maladie.
Signes avant - coureurs. Caufes de cette maladie. L’apoplexie
diftinguée en féreufe', fanguine &polypeufe. Pronoftic
de l’apoplexie. Diverfité des fentimens fur la cure. I. 334. a.
Comment elle dégénéré en hémiplégie & paraplégie. Ibid. b.
A po p le x ie , (Médec.) obfervations fur l’ufage deséméti-
ques dans cette maladie. Dans l’apoplexie fanguine, il faut
être plus réfervé fur leur ufage qu’on ne l’eft communément.
Ils peuvent être placés avec plus d’avantage dans l’efpece
d’apoplexie qu’on nomme féreufe. SuppL 1. 483. a.
Apoplexie, différence entre l’apoplexie & le carus.II. 733.
b. Ceux qui ont le cou fort court, paffent pour être fujets
à l’apoplexie. IV. 319. a. Maladies qui l’annoncent ordinairement.
Suppl. I. 637. a. Caufe prochaine de l’apoplexie. H.
864. a. En quoi elle différé de l’épilepfie. Ibid. L ’épilepfie
produit fouvent l’apoplexie. V. 796. b. Apoplexie carnée pal-
un dépôt laiteux. Suppl. 11. 700. b. Lenteur “de refpiration
dans cette maladie. Suppl. IV. 617. b. Obfervàtion faite dans
ceux qui font morts de ces maladies. II. 864. b. Obfervations
faites lur les cadavres de quelques perfonnes mortes apoplectiques.
X. 722.- b. Suppl. IV. 84a. b. Ufage des ventoufes
dans cette maladie. XVII. 29. b. Baume anti-apopleétique. I.
499. b. II. 302. a. Friftions confeillées' dans l’apoplexie. VIL
307. a. De l’apoplexie caufée par l’ivreffe. XVlI. 680. a.
083. b. Caufes de certaines apoplexies dans un dégagement
de l’air qui circule dans les humeurs. Suppl. IV. 842. b.
Obfervations fur le fachet anti-apopleétique qu’un empyrique
yend à Paris. XIV. 473. b.
APOSCEPARNISMOS, (Chir.) fraélure du crâne par un
inftrument tranchant qui emporte la piece. Étymologie de
ce mot. Exemple de la guériion d’une telle fraâure. I. 334. b.
APOSIOPESE, (Belles-lettr.) figure de rhétorique. Étym.
du mot. Exemple. I. 333. a.
APOSIOPESE, voyei R éticence.
APOSTASIE, étymologie de ce mot. Ce qu’on entend
ordinairement par apofafie. Les anciens en diftinguoient trois
fortes. Punition exercée en France contre un catholique qui
embraffe la religion prétendue réformée. I. 333. a.
A po s t a s ie , ' la foi confidérée comme penuafion, n’étoit
pas plus grande chez les chrétiens, qui la confeffoient dans
les martyres, que dans ceux que la crainte faifoit apoftafier.
VII. 17. a. Sorte de chrétiens tombés, qu’on nommoit autrefois
Mit tentes. X. 384. b. Nom de libellatiques donné à ceux
qui apoftafioient dans le tems de la perfécution ordonnée par
Decius. IX. 438. b. Apoftats chez les Turcs, appellésMor-
dates. X. 707. b. 1
APOSTÊME, (Chir.) tumeur contre nature, faite de
matière humorale. Différences entre les apoftêmes. I. 333. a.
Il y a autant de différentes apoftêmes, qu’il y a de différentes
liqueurs ; ces liqueurs font le chyle, le fang, & celles qui
émanent du fang. Ibid. b. Différences accidentelles des apoftêmes.
Les uns fe forment par fluxion, les autres par congeition.
Caufes de ces maladies. Leurs lignes. Leurs tems. Ibid. 336. a.
Leur terminaifon. Ibid. b.
A postême, voyeç III. 867. b; Retour fubit de la matière
d’un apoftème dans les vaiflèaux. IV. 792. a , b.
APOSTILLE , différence entre polulle 8c apoitille. XIII.
APOSTOLIQUE, (Théolog.) églife apoftolique. Celles
Tome I,
qui pqftoicnt ce nom dans les premiers fiecles. I. 336. b. Oit
donnoit auffi aux évêques le nom d’apoftoliques. Dans les
liecles fuivans, les trois patriarchats d’Orient étant tombés
entre les mains des Sarrafins, le titre $ apoftolique fut réfervé
au feul liege de Rome, &c. Ibid. 337. a.
A postol iqu es , ( Théolog.) anciens moines répandus autrefois
dans les ifles Britanniques. L’origine que leur donnent
Hofpinien & Balcé, traitée de fabuleule par M. Cave. Témoignage
de Bede. Paffage erroné de Bingham fur S. Colomban,
I. 337. a.
A postol iqu es , ( Hiß. eccl. ) nôm que deux feaes ont
pris. I. 337. a. Les premiers apoftoliques s’élevèrent d’entre
les encratiques dans le troifieme fiecle. Les autres parurent
au douzième. Ibid. b.
Apoßoliques , traditions apoftoliques. XVI. 307. b. Coniti*
tutions apoftoliques. IV. 72. b. Canons apoftoliques. II. 604. bt
605. a, b. Lettres apoftoliques. IX. 413. a. Chambre apofto-*
lique. III. 47. a , b. Brefs apoftoliques. II. 410. a. Conferva-i
teur apoftolique. IV. 34. a. Curleurs apoftoliques. 378. ¿*
Mois apoftoliques. X. 620. a. Notaire apoftolique. XI. 238. *.—»
240. a. 243. b. Notaire de la chambre apoftolique. 240. ¿*
Protonotaires apoftoliques. XQI. 307. b. Vicaires apoftoli- 2lies. XVII. 231. b. Chambre apoftolique de l’abbé de Saints
enevieve. III. 47. b.
APOSTROPHE, figure de rhétorique. Exemple tiré, d’une
oraifon fùnebre de Boffuet. Autres tirés de l’oraifon de
Cicéron, pour Milon, de l’Enéide. Celle que Démofthene
adreffe aux Grecs tués à la bataille de Marathon. Celle que
Cicéron adrefle à Tubéron dans l’oraifon pour Ligarius. Comment
on doit ufer de cette figure. Étymologie de ce mor.
I. 337.bi
> Apofirophe, figure de, penfée. VI. 771. b. Remarques fui
l’apoftrophe. SuppL III. 1.3 2, b. Exemple bien placé de cette
figure. XVII. 733. b. — Voyez M ouvemens d u st y le .
S A postr oph e , ( Gramm. ) ufage de l’apoftrophe. Erreut
ou l’on tombe communément fur le genre de ce mot. I«
338. a.
APOTACTITES, ( Hiß. eccl. ) anciens hérétiques ; leur
morale outrée. L 338. a. Us tombèrent dans l’hèrèfie des
encratites. Ailes apocryphes où il paroît qu’ils avoient puifè
leurs opinions. Ibid. b.
APOTHÉOSE, ( Hiß. anc. ) origine de cet ufage. Il avoit
commencé parla reconnoiffance, 8c il dégénéra en flatterie
fous les empereurs. Cérémonies pratiquées dans l’apothéofe*
I. 338. b. Diverfes perfonnes à qui cet honneur fut accordé»
Comment il fut enfuite avili. Ibid. 339. a.
A pothéose , origine des apothéofes. Comment le culte
rendu aux grands hommes fe confondit avec celui qu’ort
rendoit aux aftres. XII. 937. a , b. 938. a. Pourquoi les
apothéofes d’Alexandre & de Céfar n’ont pas réuffi. 938. b.
Cérémonies pratiquées à l’apothéofe des empereurs. IH. 904*
b. Réflexions fur ces cérémonies. 903. a. & fur l’épithete de
Divus, que la perfonne déifiée acquérait par-là. Ibid. XVII.
770. a. Parole de Veipafien fur ik future apothéofe. III*
903. a. Les ftatues faifoientparrie des apothéofes. XV. 498. ¿*
Temples élevés en conféquence de l’apothéoiè. VI. 404. ¿*
Des médailles frappées à l'occafion des apothéofes des empereurs.
HI. 904. b. X. 232. a. Aigle qu’on faifoit. partir du
bûcher où l ’on brûloit le corps de l’empereur. X. 232. a.
Oppofition des apothéofes des anciens à celles de nos faints.
VIII. 301. b.
A pothéose à!Homere, ( Hiß. antiq. ) ce monument eft
l’ouvrage d’Archelaüs de Prienne. On le trouva en 1668
dans un lieu nommé Frattochia, appartenant aux princes
Colonne. Différentes explications de ce monument qu’ont
données le P. Kircher, M. Cuper, M. Spanheim, Nicolas
Heinfius, Gronovius, M. Welftein & M. Scholt. Suppl. I.
483. a , b. 486. a , b.
APOTHICAIRE ; ceux de Paris ne font qu’un feul &
même corps avec les marchands épiciers. Difpofitions contenues
dans leurs ftatuts. I. 339. a.
A poth ic air e s , poids des apothicaires. Xn. 861. a , b.
Détails fur le corps des apothicaires de Paris. V. 779. a. V I.
12. b. Apothicaires chez les anciens. XII. 492. b. 493. a.
APOTHIC AIRERIE, ( Archit. ) celle dp Lorette en Italie ,
8c celle de Drefde. I. 340. a.
APOTOME, ( Géomét.) I. 340. a.
A potome , (Mufiquc) les Grecs divifoient le ton majeutf
inégalement de plufieurs maniérés. De l’une de ces diviuons
réfultoient le diefe ou limma d’un côté, & de l’autre l’apo-
tome. Génération de l’apotome. Les anciens diftinguoient le
majeur & le mineur. I. 340. b.
APOTRE, (Théolog.) fens de ce mot dans les auteurs
profanes, & dans le nouveau Teftament. I. 340. a. Comment
S. Paul prouvoit fon apoftolat. Symboles ou attributs fjpéci-
fiques des apôtres. Des lieux où ils ont prêché l'évangile*
On donne le nom d'apôtre à celui qui a le premier porté la
foi dans un pays. Le pape a auffi quelquefois reçu ce nonu
L 540. b.
\