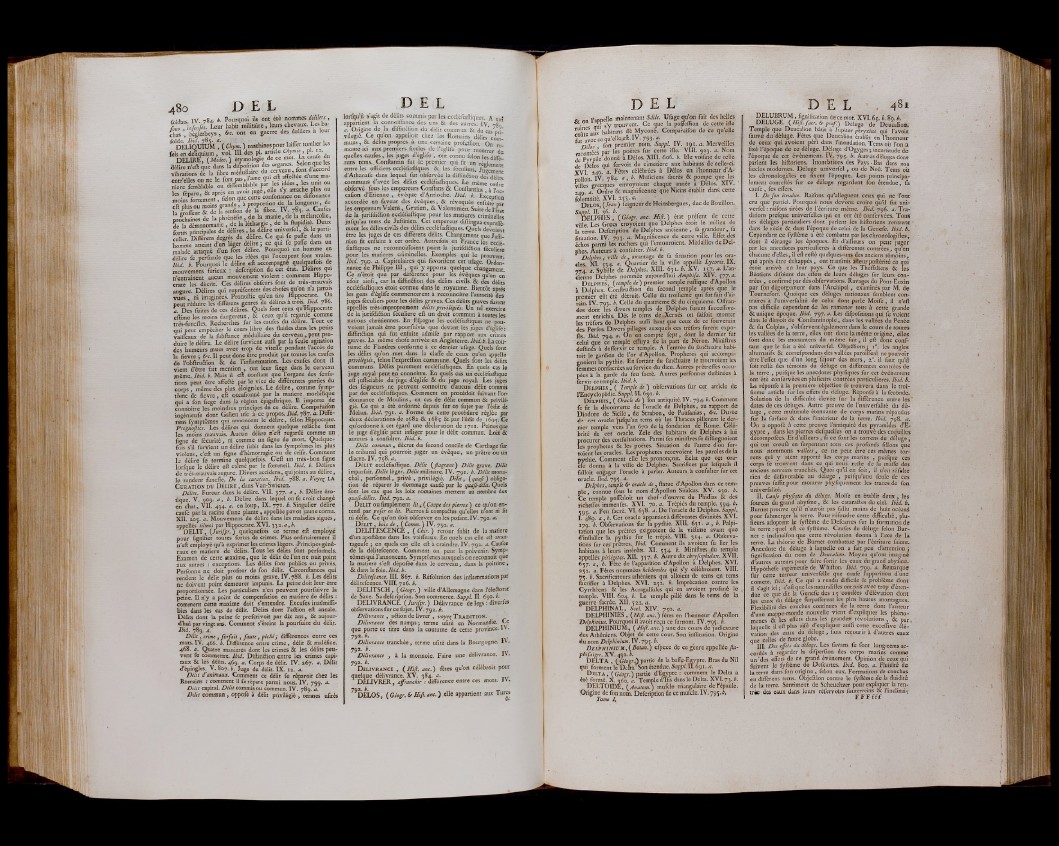
480 D E L
Ï ÏSÏ Ïüw-ThS' E S
¿1,as'” beglerbcys , S i. ont en guerre des defflers a leur
^DEUOÙlUM , ( Ckym. ) machines pour biffer tomber les
fels en defiquium, vol. IU des pl. article Chyme, j f e g v a
DELIRE, (McJec.) étymologie de ce mot. La caulc du
Hélirc n’eft que dans la diioofition des organes. Sdon quedes
vibrations de la fibre mèiuUaire
entr’ebes ou ne le font pas, l'ame qui eft affcSée d une: ma
niere femblable ou
'"■f^ rV cm t r r fe“ n ; r c r i c o n t ^ L o f d i ( f o “ uc=
a f S f T S L ' 'g r a n d e ? à uroporfion f f î g n g *
Se b démonomanie de la léthargie, de la ftup.thté Deux
fortes principales de débres, le délue nniverfel, & le partt-
cuber. Différens degrés de déhre. Ce qui fe paffe dans un
homme atteint d’un léger délire; ce qui fe paffe dans un
malade attaqué d’un fort délire: Pourquoi un homme en
délire fe perfnade que les idées qui l’occupent font vraies.
Ibid b. Pourquoi le délire eft accompagné quelquefois de
mouvemens furieux : defcription de cet état. Délires qui
n’entraînent aucun mouvement violent : comment Hippo-
crate les décrit. Ces délires obfcurs font de très-mauvais
augure. Délires qui repréfentent des chofes qu’on n a Jamais
vues, ni imaginées. Pronoflic qu’en tire Hippocrate. On
peut réduire les différens genres de debres à trois. Jbid. 786.
a Des fuites de ces délires. Quels font ceux qu’Hippocrate
eilime les moins dangereux, 8c ceux qu’il regarde comme
très-fitneftes. Recherches fur les caufes du délire. Tout ce
qui peut empêcher le cours libre des fluides dans les petits
Vàïfleaux de la fubflance médullaire du cerveau, peut produire
le déliré. Le délire furvient suffi par la feule aguanon
des humeurs mues avec trop de vitefle pendant l’accès de
la fievrë ; &c. 11 peut donc être produit par toutes les caufes
de l’obftriiàion 8c de l’inflammation. Les-caufes dont il
vient d’être fait mention , ont leur fiege dans le cerveau
même. Ibid. b. Mais il eft confiant que l’organe des fenfa-
tions peut être affefté par le vice de différentes parties du
corps, même des plus éloignées. Le délire, comme fymp-
tôme de fièvre, ell occafionné par la matière morbifique
qui a fon fiege dans la région épigaftrique. 11 importe de
connoître les moindres principes de ce délire. Compafaifon
ingénieufe dont Galicn ufc à ce propos. Ibid. 787. a. Différens
fymptômes qui annoncent le délire, félon Hippocrate.
Prognojlics. Les délires qui donnent quelque relâche font
les moins mauvais. Aucun délire n’eft regardé comme un
ligne de fécurité, ni comme un figne de mort. Quelquefois
s’il furvient un délire fubit dans les fymptômes les plus
violens, c’eft un figne d’hémorragie ou de crife. Comment
le délire fe termine quelquefois. C’eft un très-bon figne
lorfque le délire eft calmé par le fommeiL Ibid. b. Délires
de très-mauvais augure. Divers accidens, quiioints au délire,
le rendent funefte. De la curation. Ibid. 788. a. Voye{ LA
C u r a t io n d u D é lire , dans Van-Swieten.
Délire. Fureur dans le délire. VII. 377. a , b. Délire érotique.
V. 909. a , b. Délire dans lequel on fe croit changé
en chat, vÜ. 434. a. en loup, IX. 771. b. Singulier délire
caufe par la racine d’une plante, appellée pavot jaune cornu.
XII. 205. a. Mouvemens de délire dans les maladies aiguës,
appellés tilmoi par Hippocrate. XVI. 332.a,b.
DELIT, (Jurifpr.) quelquefois ce terme eft employé
pour fignifier toutes fortes de crimes. Plus ordinairement il
n’eft employé qu’à exprimer les crimes légers. Principes généraux
en matière de délits. Tous les délits font perfonnels.
Examen de cette maxime, que le délit de l’un ne nuit point
aux autres : exceptions. Les délits font publics ou privés.
Perfonne ne doit profiter de fon délit. Circonftances qui
rendent le délit plus ou moins grave. IV. 788. b. Les délits
fie doivent point demeurer impunis. La peine doit leur être
proportionnée. Les particuliers n’en peuvent pourfuivre la
peine. Il n’y a point de compenfation en matière de délits :
comment cette maxime doit s’entendre. Excufes inadmifli-
bles dans les cas de délit. Délits dont l’aétion eft annale.
Délits dont la peine fe preferivoit par dix ans, 8c aujourd’hui
par vingt ans. Comment s’éteint la pourfuite du délit.
Ibid. 789. a.
Délit, crime, forfait, faute, péché; différences entre ces
mots.IV. 466. b. Différence entre crime, délit 8c maléfice.
468. a. Quatre maniérés dont les crimes 8c les délits peuvent
fe commettre. Ibid. Diftinétion entre les crimes capitaux
8c les délits. 469. a. Corps de délit. IV. 267. a. Délit
d’épingles. V. 807. b. Juge du délit. IX. 12. a.
Délit d’animaux. Comment ce délit fe réparait chez les
Romains : comment il fe répare parmi nous. IV. 799* a.
Délit capital. Délit commis ou commun. IV. 789. a.
Délit commun, oppofé à délit privilégié, termes ufités
D E L
lorfqu’il s’agit de délits commis par les eccléfiaftiques. A qui
appartient la connoiffance des uns 8c des autres. IV. 78 0
a. Origine de la diftinétion du délit commun 8c du cas n i
vilegié. Ce qu’on appelloit chez les Romains délits communs,
8c délits propres à une certaine profeffion. On remonte
ici aux premiers ftecles de l’églife pour montrer de
quelles caufes, les juges d’églife , ont connu félon les différens
tems. Conftantin fut le premier qui fit un réelemerr
entre les officiers eccléfiaftiques 8c les féculiers. Jugement
d’Athanafc dans lequel fut obfervée la diftinétion des délits
communs d’avec les délits eccléfiaftiques. Le même ordre
obfervé fous les empereurs Conftans 8c Confiantes, à l’oc-
cafion d’Etienne , évêque d’Antioche. Ibid. b. Execution
accordée en faveur des évêques, 8c révoquée enfuite par
les empereurs Valens, Gratien, 8c Valentinien. Suite de l’état
de la jurifdiétion eccléfiaftique pour les matières criminelles
jufqu’au tems de Juftinien. Cet empereur diflingua expreffé-
ment les délits civils des délits eccléfiaftiques. Quels devoient
être les juges de ces différens délits. Changement que Juftinien
fit enfuite à cet ordre. Autrefois en France les eccléfiaftiques
ne reconnoiffoient point la jurifdiétion féculierè
pour les matières criminelles. Exemples qui le prouvenr.
Ibid. 790. a. Capitulaires qui favoriient cet ufage. Ordonnance
de Philippe I I I , qui y appona. quelque changement.
Ce n’étoit que par déférence pour les évêques qu’on en
ufoit ainfi, car la diftinétion des délits civils 8c des délits
eccléfiaftiques étoit connue dans le royaume. Bientôt après
les gens d’églife commencèrent à reconnoitre l’autorité des
juges féculiers pour les délits graves. Ces délits graves furent
appcllés très-improprement délits privilégiés. Un tel exercice
de la jurifdiétion féculiere eft un droit commun à toutes les
nations chrétiennes. En Efpagne les eccléfiaftiques ne pouvoient
jamais être pourfuivis que devant les juges d’égtife:
diftinétion qui fut enfuite admife par rapport aux crimes
graves. La même chofe arrivée en Angleterre. Ibid. b. La coutume
de Flandres conforme à ce dernier ufage. Quels font
les délits qu’on met.dans la claffe de ceux qu’on appelle
privilégiés y félon l’expreflion commune. Quels font les délits
communs. Délits purement eccléfiaftiques. En quels cas le
juge royal peut en cOnnoitre. En quels cas un eccléfiaftique
eft jufticiable du jiige d’églife 8c au juge royal. Les juges
des feigneurs ne peuvent connoître d aucun délit commis
par des eccléfiaftiques. Comment on pracédoit fuivant l’ordonnance
de Moulins, en cas de défit commun 8c priviléfié.
Ce qui a été ordonné depuis fur ce fujet par l’édit de
lclun. Ibid. 791. a. Forme de cette procédure réglée par
deux déclarations de 1682 8c 1685 8c par l’édit de 1695. Ce
qu’ordonne à cet égard une déclaration de 1711. Peines que
le juge d’églife peut infliger pour le défit commun^ Loix 8c
auteurs à confulter. Ibid. b.
Délit commun, décret du fécond concile de Carthage fur
le tribunal qui pourrait juger un évêque, un prêtre ou un
diacre. IV. 758. a.
D é l i t eccléfiaftique. Délit ( flagrant ) Délit grave. Délit
imparfait. Délit léger. Délit militaire. IV. 791. b. Délit mona-
chal, perfonnel, privé , privilégié. Délit, ( quafi ) obligation
de réparer le dommage caufé par le quafi-déut. Quels
font les cas que les loix romaines mettent au nombre des
quafi-délits. Ibid. 792. a.
D é l it ou Amplement lit, ( Coupe des pierres ) ce qu’on entend
par pofer en lit. Pierres fi compactes qu’elles n ont ni lit
ni délit. Ce qu’on doit obferver en les pofant. IV. 792. a.
D élit , bois de, (Comm. ) IV. 792.a.
DELITESCENCE , ( Chir. ) retour fubit de la matière
d’un apoftême dans les vaiffeaux. En quels cas elle eft avantageufe
; en quels cas elle eft à craindre. IV. 792. a. Caufes
de la délitefcence. Comment on peut la prévenir. Symptômes
qui l’annoncent. Symptômes auxquels on reconnoit que
la matière s’eft dépofée dans le cerveau, dans la poitrine,
8c dans le foie. Ibid. b.
Délitefcence. IU. 867. b. Réfolution des inflammations par
délitefcence. VUI. 716. b.
DELITSCH, ( Géogr. ) ville d’Allemagne dans l’éleâoraf
de Saxe. Sa defcription. Son commerce. Suppl. II. 690. b.
DELIVRANCE. ( jurifpr. ) Délivrance de legs : diverfes
obfcrvarions fur ce fujet. IV. 792. b.
Délivrance , aétion de livrer , voyeç T r a d it io n . _
Délivrance des namps ; terme ufité en Normandie. Ce
que porte ce titre dans la coutume de cette province. IV.
792. b.
Délivrance tranchée, terme ufité dans la Bourgogne. IV-
792. b.
Délivrance , à la monnoie. Faire une délivrance. IV.
792. b.
D é l iv r a n c e , ( Hîfl. anc. ) fêtes qu’on célébrait pour
quelque délivrance. XV. 384. a. .
DELIVRER, affranchir : différence entre ces mots. IV.
792. b. —.
DELOS, (Gcogr.&ttfl.arx.) elle appartient aux Turcs
D E L
S î a ü x habitans dè Myconé. Comparaifon de ce qu’elle
fut aveccequ’ellc.eft;lV. 793- „
D'-los fon premier nom. Suffi. IV. tpi. a. Merveilles
ontèel par les poètes fur cette ifle. VIII. {¡Jg a. Nom
j Pyrpile donné à Détos. XIII. 606. 4. Me voifine de celle
de Délos qui fervoil de cimetiere aux habitaus de celle-ci.
XVI. 249. a. Fêtes célébrées à Délos en l’honneur d'Apollon.
IV. 784 a , b. Muficiens facrés 8c pompe que les
villes grecques envoyoient chaque année à Délos. XIV. ’
249. a. Ordre 8c magnificence que Nicias établit dans cette
folemnité. XVI. 253. a. . •
D elo s , ( Jean) feigneur de Heinsbergucs, duc de üouillon.
^f^ELPHES, ( Géogr. anc. Hiß. ) état préfent de cette
ville. Les Grecs croyoierit que Delphes étoit le milieu de
la terre. Defcription de Delphes ancienne, fa grandeur, fa
fituarion. IV. 793. # Magnificence de cette ville. Effetdes
échos parmi les rochers qui l’entouraient. Médaillés de Delphes.
Auteurs à confulter. Ibid. b.
Delphes; ville de, avantage de fa fituation pour les oracles
XI 534. a. Quartier de la ville appellé Lycorée.lX.
774. i Sybille de Delphes. XIII. 631. A XV. 157• L u cienne
Delphes nommée aujourd’hui Amphifa. XIV. 577.0.
D e l ph e s , (templeAe) premier temple ruftique d Apollon
à Delphes. Conftruétion du fécond, temple après que^ le
premier eût été détruit. Celle du troifieme qui fut fait d’airain.
IV. 793. A Celle du quatrième 8c du cinquième. Offrandes
dont les divers temples de Delphes furent fucceflive-
ment enrichis. Dès le tems de,Xerxês on faifoit monter
les tréfors de Delphes aufli haut que ceux de ce fouverain
des PerfeS. Divers pillages auxquels ces tréfors furent expo-
fés. Ibid. 794. a. On en compte fept, dont le dernier fut
celui que ce temple effuya de là part de Néron. Miniftres
deitinés à deffervir ce temple. A l’entrée du fonétuaire habi-
toit le gardien de l’or d’Apollon. Prophètes qui accompa-
gnoiènt la pythie. En fortant dH fonétuaire fe trouvoiènt les
femmes confocrées au fervice du dieu. Autres prétraites occupées
à la garde du feu facré. Autres perfonnes deftinées à
lervir ce temple. Ibid. b. ..
D elph e s , ( Temple de ) obfcrvations fur cet article de
l'Encyclopédie. Suppl. II. 691. A .
D e l ph e s , ( Oracle de ) fon antiquité. IV. 794. b. Comment
fe fit la découverte de l’oracle de Delphes, au rapport de
Diodore de Sicile, de Strabon, de Paüfanias, &c. Durée
de cet oracle 'jufqu’au tems où les Thraces pilleront le dernier
temple vers l’an 670 de la, fondation dé Rome. Célébrité
de cet oracle. Zelc des habitans de Delphes à lui
Îirocure.r des confultations. Parmi fes miniftres fe diftinguoient
eS prophètes 8c les poëtes. Situation de l’antre d’où for-
toient les oracles. Les prophètes recevoient les paroles de la
pythie. Comment elle les prononçoir. Eclat que cet oracle
donna à la ville de Delphes. Sacrifices par lefquels il
falloit engager l’oracle à parier. Auteurs à confulter fur cet
oracle. Ibid. 795. a.
Delphes, temple 6* oracle de, ftatue d Apollon dans ce temple,
connue fous le nom d’Apollon Sitalcas. XV. 220. A
Ce temple poffédoit un chef-d’oeuvre de Phidias 8c des
richeffes immenfes. XVI. 70. a. Tréplés du temple. 594. A
<95. a. Feii facré. VI. 638. a. De l’oracle de Delphes. Suppl.
I. 489. a , b. Cet oracle appartint à différentes divinités. XVI.
179. A Obfervations fur la pythie. XIII. 631. a , A Palpitation
que les prêtres exieeoient de la viâime avant que
d’inftaller la pythie fur le trépié. VIII. 314. a. Obfervations
fur ces1 prêtres.. Ibid. Comment ils avoient fu fier les
habitans à leurs intérêts. XI. 534. A Miniftres du temple
appellés périégetes. XII. 357. A Autre dit chryfophulax. XVII.
657. a , b. Fête de l’apparition d’Apollon à Delphes. XVI.
252. a. Fêtes nopimées hebdomées qui s’y célébraient. VIII.
75. A Sacrificateurs athéniens qui alloient de tems qn tems
facrificr à Delphes. XVI. 252. A Imprécation contre les
Cyrrhéens 8c les Acragallides qui en avoient profané le
temple. VIII. 604. A Le temple pillé dans le tems de la
guerre faej-éc. XII. 522. a.
DELPHINAL, Seel. XIV. 750. a.
DELPHINIES , (Hiß. anc.) têtes en l’honneur d’Apollon
Delphinius. Pourquoi il avoit reçu ce furnom. IV. 795. A
DELPHINIUM, ( Hiß. anc. ) une des cours de judicature
des Athéniens. Objet de cette cour. Son inftitution. Origine
du nom Delphinium. IV. 79«. A
Delphinivm,(B otan.) efpece de ce genre appellée fia-
phifajgre. XV. 492. A
DELTA , {Géogr.j) partie de la baffe-Egypte. Bras du Nil
qui forment le Delta. Son étendue. Suppl. U. 691. a.
D e l t a , (Géogr.) partie d’Egypte : comment le Delta a
été formé. X. 360. a. Temple dlfis dans le Delta. XVI. 73. A
DELTOÏDE, (Anatom.) mufcle triangulaire de l’épaule.
Origine de fon nom. Defcription de ce mulcle. IV. 795. A
Tome I,
D E L .481
DELUBRUM, lignification de ce mot. XVI. 6e. b. 80.4.
DELUGE. ( HÎJl. Jacr. & prof.) Déluge de Dcucalion.
Temple que Deucalion bâtit à Jupiter phryxius qui l’avoie
lauvé du déluge. Fetes que Dcucalion établit en l'honneur
de ceux qui avoient péri dans l’inondation. Tems où l’on a
fixé l’époque de ce déluge. Déluge d’Ogyges ; incertitude de
l’époque ae cet événement. IV. 795. A Autres déluges dont
parlent les hiftoriens. Inondations des Pays • Bas dans nos
fiecles modernes. Déluge univerfel, ou de Noé. Tems où
les chronologiftes en fixent l’époque. Les points principalement
conteftés fur ce déluge regardent fon étendue, fa
caufe, fes effets.
I. De fon étendue. Raifons qu'alleguent ceux qui ne l’ont
cru que partiel. Pourquoi nous devons croire qu’il fut univerfel
: raifons tirées de l’écriture même. Ibid. 796. a . Traditions
prefque univerfelles qui en ont été confervées. Tous
les déluges particuliers dont.parlent les hiftoriens rentrent •
dans le récit 8c dans l’époque de celui- de la Genefe. Ibid. A
Cependant ce fyftême a été combattu par les chronologiftes,
dont il dérange les époques. Et d’ailleurs on peut juger
par les anecdotes particulières à différentes contrées , qu en
chacune d’elles, il eft refté quelques-uns des anciens témoins,
qui après être échappés , ont tranfmis Meur poftérité cè qui
etoit arrivé en leur pays. Ce que les Theffaliens 8c les
Béotiens difoient des effets de leurs déluges fur leurs éon-
trées , confirmé par dès obfervations. Ravages du Pont-Euxin
par fon dégorgement dans l’Archipel, examinés par M. de
Tournefort. Quoique ces déluges nationaux femblent contraires
à l’univerfaiité de celui dont parle Moïfe, il n’eft
pas difficile cependant de les ramener tous à cette grande
8c unique époque. Ibid. 797. a. Les difoofitiqns qui fe voient
dans le détroit de Conftantindple, dans les vallées du Penée
8c du Colpias, s’obfiirvent également dans le cours de toutes
les vallées de la terre, elles ont donc la même origine, elles
font donc les monuinens du même f a i t i l eft donc confi-
tant que le fait a été univerfel. Objections: i°. les angles
alternatifs 8c correfpondans des vallées paroiïïent ne pouvoir
être l’effet que d’un long féjour des mers, 20. il faut qu’à
foit refté des témoins du déluge en différentes contrées de
la terre , puifque les anecdotes phyfiques fur cet événement
ont été confervées en plufieitrs contrées particulières. Ibid. b.
La réponfe à la premiere objection fe trouvera dans le troifieme
article fur les effets du déluge. Réponfe à la fecónde.
Solution de la difficulté élevée fur la différence entre les”
dates de ces déluges. Autre preuve de l’univerfalité du déluge
, cette multitude étonnante de corps marins répandus
fur la furface 8c dans l’intérieur de la terre. Ibid. 798. a .
On a oppofé à cette preuve l’antiquité deç pyramides d’Egypte
, dans les pierres defquelles on a trouvé des coquilles
décompofées. Et d’ailleurs, fi ce font les torrens du déluge,
qui ont creufé en ferpentant tous ces profonds filions que
nous nommons values, ce ne peut être'ces mêmes torrens
qui y aient apporté les corps marins , puifque ces
corps fe trouvent dans ce qui nous refte de la maffe des
anciens terrains tranchés. Quoi qu’il en foit, il n’en refaite
rien de défavorable au déluge , puifqu’une feule de ces
preuves fuffit pour montrer phyfiquement les traces de fon
univerfalité.
II. Caufe phyfique du déluge. Moïfe en établit deux, les
fources du grand abyfme, oc les cataraâes du ciel. Ibid. A
Burnet prouve qu’il n’aurait pas fallu moins de huit ocèani
pour fubmerger la terre. Pour réfoudre cette difficulté, plu-
lieurs adoptent le fyftême de Defcartes fur la formation de
la terre : quel eft ce fyftême. Caufes du déluge félon Burnet
: inctinaifon que cette révolution donna à l’axe de la.
terre. La théorie de Burnet combattue par l’écrituré fainte.
Anecdote du déluge à laquelle on a fait peu d’attention ;
lignification du nom de Dcucalion. Moyen qu’ont imaginé
d’autres auteurs pour foire fortir les eaux du grand abylinè.'
HypOthefe ingénieufe de Whifton. Ibid. 709. a. Remarque
fur cette terreur univerfelle que caufe rapparition d’une
comete. Ibid. b. Ce qui a rendu difficile le problème dont
il s’agit ici ; • c’eft que les naturaliftes ont pris avec trop d’étendue
ce que dit la Genefe des 11 ‘coudées d’élévation dont
les eaux du déluge furpafferent les plus hautes montagnes.
Flexibilité des couches continues de la terre dont l’auteur
d’une mappe-monde nouvelle vient d’expliquer les phénomènes
8c les effets dans les grandes» révolutions , 8c par.
laquelle il eft plus aifé d’expliquer aufli cette exceffive élévation
des eaux du déluge, fans recourir à d’autres eaux
que celles de notre globe.
III. Des effets du déluge. Les faVans fe font long-tems ap-
. cordés à regarder la difperfion des corps marins comme
un'des effets de ce grand événement. Opinion de ceux qui
fu iv e n t le fyftême de Defcartes. Ibid. 800. a. Fluidité de
la terre dans fon origine, félon eux. Formations de couches
en différens tems. Objection contre le fyftême de la fluidité
de la terre. Sentiment de Scheuchzer pour expliquer la rentrée
des eaux dans leurs réfervoirs fouterreins Sc l’inclinai