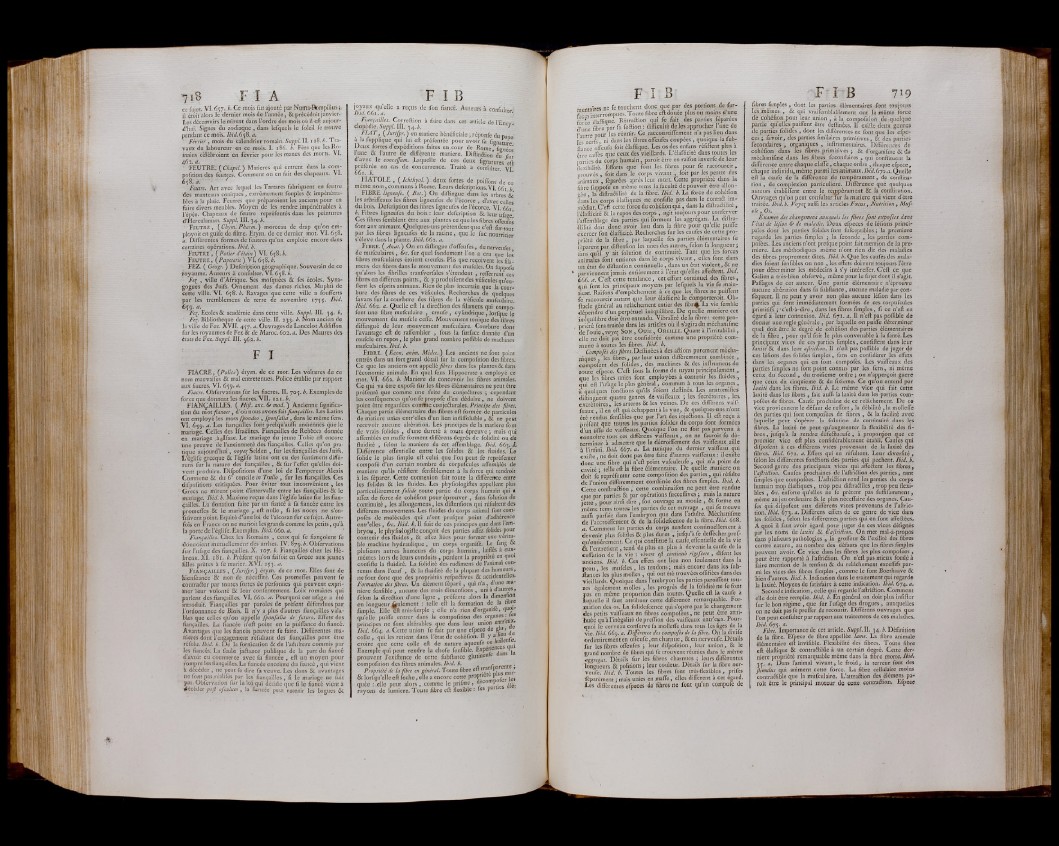
'7i8 F I A
cc fujet. VI. 657. b. Cc mois fut ajouté par Numa-Rompilius ;
il ¿toit alors le dernier mois de l’année, Se précédoit janvier.
Les diccipyirs lemirent dans l’ordre des mois où il cft aujourd’hui.
Signes du zodiaque, dans lcfqucls le folcil fc trouve
pendant cc mois. Ibid.6^8. a.
■ Février, mois du calendrier romain. Suppl. II. 118. b. Travaux
du laboureur «n cc mois. I. 186. I. Fête que les Romains
célébroicnt en février pour les mânes dös morts. VI.
46a. a.
FEUTRE. ( Chapel.) Matières qui entrent dans la compofition
des feutres. Comment on en fait des chapeaux. VI.
658." à . ' ' '
Feutre. A r t avec lequel les Tartarcs fabriquent en feutre
des manteaux coniques, extrêmement fouplcs & impénétrables
à la pluie. Feutres que préparaient les anciens pour en
faire divers meubles. Moyen de les rendre impénétrables à
l’énée. Chapeaux de feutre repréfentés dans les peintures
d’Herculanum. Suppl. III. 34. b.
■ Feutr e , ( Chym. Pharm. ) morceau de drap qu’on cm-
ployoit en guife de-filtre. Etym. de cc dernier mot. VI. 678.
a. Différentes formes de feutres qu’on emploie encore dans
certaines opérations. Ibid. b.
F e u t r e , ( Potier d1étain) V I. 658. b.
FEUTRE, {Papeterie) VI. 658.b.
FEZ. ( Géogr. ) Defeription géographique. Souverain de cc
royaume. Auteurs à confultcr. V I ,6 s S .b .
F e i , ville d ’Afrique. Ses mofquces 8e fes écoles. Synagogues
des Juifs. Ornement des dames riches. Muphti de
cette villé. V I. 658. b. Ravages que cette ville a foufferts
par les trcmblcmcns de terre de novembre 1755. Ibid.
059. a.
Fe{. Ecoles & académie dans cette ville. Suppl. III. 34. b.
• Fer. Bibliothèque de cette ville. II. 233. b. Nom ancien de
la ville de Fez. XVII. 477. a. Ouvrages de Lancelot Addiffon
fur les royaumes de Fez & de Maroc. 602. a. Des Maures des
états de Fez. Suppl. III. 962. b.
F I
FIA CRE , ( Police) étym. de ce mot. Les voitures de ce
nom mauvaifes Se mal entretenues. Police établie par rapport
aux fi acres. VI. 659. a.
Fiacre. Obfcrvations für les fiacres. II. 705. b. Exemples de
force que donnent les nacres. V II. 12 1 . b.
FIANÇAILLES. ( H iß . anc. 6* mod. ) Ancienne fignifica-
tion du mot fianeer, d’où nous avons fait fiançailles. Les Latins
ont employé les mots fpondeo, fponfalta, dans le même fens.
V I . 659. a. Les fiançailles font prciqu’auffi anciennes que le
mariage. Celles des Ifraélitcs. Fiançailles de Rcbêcca donnée
en mariage .à«Ifaac. Le mariage du jeune Tobic cft encore
une preuve de l’ancienneté des fiançailles. Celles qu’on pratique
aujourd’hui , voye^ Seiden , fur les fiançailles des Juifs.
L ’églife grecque Se l’cglifc latine ont eu des fentimens différons
fur la nature des fiançailles, & fur l’effet qu’elles doivent
produire. Difpofitions d’une loi de l’empereur Alexis
Comncnc & du <5* concile in Trullo , fur les fiançailles. Ces
difpofitions critiquées. Pour éviter tout inconvénient, les
Grecs ne mirent point d'intervalle entre les fiançailles & le
mariage. Ibid. b. Maxime reçue dans l’églifc latine fur les fiançailles.
La donation faite par un fiancé à fa fiancée entre les
promeffes 8c le mariage , cft nulle, fi les noces ne s’en-
fui vent point. Equité d’une loi de l’alcoran fur ce fujet. Autrefois
en France on ne marioit les grands comme les petits, qu’à
la porte de l’églifc. Exemples. Ibtd. 660. a.
Fiançailles. Chez les Romains , ceux qui fc fiançoient fc
dbnnoicnt mutuellement des arrhes. IV. 079. b. Obfcrvations
fu r ¡’ufage des fiançailles. X. 107. b. Fiançailles chez les Hébreux.
X I. 181. b. Prèfent qu’on faifoiten Grèce aux jeunes
filles prêtes à fe marier. X v l . 253. a.
F ia n ç a i ll e s , ( Jurifpr.) étym. de cc mot. Elles font de
bicnféancc & non de néceftitè. Ces promeiTcs peuvent fc
contraétcr par toutes fortes de nerfonnes qui peuvent exprimer
leur volonté Se leur confcntemcnt. Loix romaines qui
parlent des fiançailles. V I. C60. a. Pourquoi cet ufage a été
introduit. Fiançailles par paroles de préfent défendues par
¿’ordonnance de Blois. Il n’y a plus d’autres fiançailles valables
que celles qu’on appelle fponfalia de futuro. Effets des
fiançailles. La fiancée n cft point en la puiffancc du fiancé.
Avantages que les fiancés peuvent fe faire. Différentes maniérés
dont l'engagement réfultant des fiançailles peut être
réfolu. Ibid. b. De la fornication & de l’adultcrc commis par
les fiancés. La feule jaélance publique de la part du fiancé
d’avoir eu commerce avec fa fiancée , cft un moyen pour
rompre les fiançailles. La fiancée enceinte du fiancé, qui vient
h décéder , ne peut fc dire fa veuve. Les dons 8c avantages
ne font pas réalités par les fiançailles , fi le mariage ne fuie
pas. Obfcrvation fur la loi qui décide que fi le fiancé vient à
décéder pofl ofculum, la fiancée peut retenir les bagues 6c
F I B
ioyau* qu’elle a reçus de fon fiancé. Auteurs à confultcr;
Fiançailles. Correétion à faire dans cet article de l'E n ru
clopédic. Suppl. III. 34. b.
. F ¥ T \. O urif P f ) en matière bénéficiée ; réponfe du pane
a la fuppliquc qui lui cft préfentéc pour avoir fa fignaturc
Deux fortes d’expéditions faites en.cour de Rome fienées
l’une & l’autre de différente maniéré. Diftinélion du fiat
d’avec le conceffum. Laquelle de ces deux fignaturcs cft
préférée en cas de concurrence. Traité à confultcr. VI
061. b. ' '
F IATOLE , ( Ichthyol. ) deux fortes de poiffons de ce
même nom, communs à Rome. Leurs dcfcriptions.Vl. 6 6 1 .b
FIBRE ligneufe. ( Bot. ) On diftineuc dans les arbres 8c
les arbriffeaux les fibres ligneufes de l’écorce , d’avec celles
du.bois. Defeription des fibres Hgneufes de l’écorcc. VI. 661
b. Fibres ligneufes du bois : leur defeription & leur ufage!
Ces fibres fcmblcnt être aux plantes ce que les fibres offeufes
font aux animaux. Quelques-uns prétendent que c’cft fur-tout
par les fibres ligneufes de la racine, que le fuc nourricier
s’élève dans la plante. Ibid. 662. a.
F ibre. ( Anat.) On en diflinguc d’offeufes, denerveufes
de mufculaircs, v c . fur quel fondement l’on a cru que les
fibres mufculaircs étoient crcufcs. Plis que reçoivent les filament;
des fibres dans le mouvement des mufclcs. On fuppofe
qu’alors les fibrilles tranfverfalcs s’étendent , refferrent ces
fibres en différens points, & y praduifent des véficulcs qu’enflent
les cfprits animaux. Rien île plus incertain que la courbure
des fibres de ces véficulcs. Recherches de quelques
favans fur la courbure des fibres de la véficule mufculairc.
Ibid. 662. a. Quelle cft la direction des filamens qui compo-
fent une fibre mufculairc , creufc, cylindrique, lorfquc le
mouvement du mufcle celle. Mouvement tonique des fibres
diftingué de leur mouvement mufculairc. Courbure dont
l’avantage eft de raffcmbler , fous la furfacc donnée d’un
mufcle en repos, le plus grand nombre poffiblc de machines
mufculaircs. Ibid. b.
F ib re . ( Econ. anim. Mid ec .) Les anciens ne font point
entrés dans un fort grand détail fur la compofition des fibres.
C c que les anciens ont appcllé fibres dans les plantes & dans
l’économie animale. En quel fens Hippocrate a employé ce
mot. VI. 662. b. Manière de concevoir les fibres animales.
Ce qui va être expofé fur les fibres élémentaires ne peut être
préfenté que comme une fuite de conjcélurcs ; cependant
les conféqucnces qu’on fc propofe d’en déduire, ne doivent
point être regardées conrimc conjecturales. Principe des fibres.
Chaque partie élémentaire des fibres cft formée de particules
de matière unies cntr’clles d’un lien indiffolublc, & ne peut
recevoir aucune altération. Les principes de la matière font
de vrais folidcs , d’une dureté a toute épreuve ; mais qui
affcmblés en maffe forment différens degrés de folidité ou de
fluidité , félon la maniéré de cet affcmblagc. Ibid. 6 6 3. a.
Différence cffcnticllc entre les folidcs & les fluides. Le
folidc le plus fimplc cft celui que l’on peut fe repréfenter
compofé d’un certain nombre de corpufculcs affcmblés de
mamere qu’ils réfiftent fcnfiblcmcnt à la force qui tendrait
à les féparcr. Cette connexion fait toute la différence entre
les folidcs 8c les fluides. Les phyfiologiftcs appellent plus
particulièrement folide toute partie du corps humain qui a
a liez de force de cohéfion pour éprouver , fans folution de
continuité, les allongcmcns, les diftenfions qui réfiiltcnr des
différens mouvemens. Les fluides du corps animal font coin-
pofés de molécules qui n’ont prefquc point d’adhérence
cntr’ellcs , b c . Ibid. b. Il fuit de ces principes que dans l’em-
bryou, le phyfielogiftc conçoit des parties affez folidcs pour
contenir des fluides , Se affez liées pour former une véritable
machine hydraulique, un corps organifé. Le fang Se
pluficurs autres humeurs du corps humain, laiffés à eux-
mêmes hors de leurs conduits , perdent la propriété en quoi
confiftc la fluidité. La folidité des rudimens de l’animal contenus
dans l’oe uf , & la fluidité de la plupart des humeurs,
ne font donc que des propriétés refpeaiv.es Se accidentelles.
Formation des fibres. Un élément féparé , qui n’a , d’une manière
fenfiblc, aucune des trois dimenfions, uni à d’autres,
félon la dircétion d’une ligne , préfente alors la dimçmjon
en longueur feulement ; telle eft la formation de la fibre
fimplc. Elle eft trés-fimple ; elle n’a rien d’organifé, quoiqu’elle
puiffe entrer dans la compofition des organes : fes
principes ne font altérables que dans leur union entr e u .
Ibid. 664. a. Cette union fc fait par une cfpece de glu >
co lle , qui les retient dans l'état de cohéfion. Il y a heu
croire que cette cplle cft de nature aqueufe ou h*“ ;
Exemple qui peut rendre la chofc fenfiblc. Expénen I
prouvent l’cxiftcnce de cette fubftance glutinculc
compofition des fibres animales. Ibid. b. •
Propriété de la fibre en général. Toute fibre cft tnut I j '
Se lorfqu’cllc cft fcch c, elle a encore cette propriet • p . •
quée : elle peut alors , comme le prifmç >
rayons de lumicre. Toute fibre cft flexible : fes 1
F I B
mentaircs ne fe touchent donc que par des portions de fur-
f c"s interrompues. Toute fibre eft douée plus ou moins d une
force élaftique. Rétraôion qui fc fait des parties féparées
d’une fibre par fa feélion : difficulté de les approcher l’une de
l’autre pour les réunir. Ce raccourciffement n’a pas lieu dans
les nerfs, ni dans les fibres offeufes coupées, quoique la fubftance
offeufe foit élaftique. Les os des enfans réfiftent plus à
être caffés que ceux des vieillards. L’élafticité dans toutes les
parties du corps humain, paraît être en raifon inverfe de leur
flexibilité. Efforts que font les fibres pour fe raccourcir,
prouvés , foit dans le corps v iv an t , foit par les peaux des
animaux , féparées après leur mort. Cette propriété dans la
fibre fuppofe en même tems la faculté de pouvoir être allongée
, la diftraélilitê de la fibre. Ibid. b. La force de cohéfion
flans les coîps élaftiques ne confiftc pas dans le contaél immédiat.
C ’cft cette force de cohéfion qui, dans la diftraftilité,
1 elafticité Se le repos des corps , agit toujours pour conferver
l’affcmblagc des parties qui forment les aggrégats. La diftra-
éVilité doit donc avoir heu dans la fibre pour qu’elle puiffe
exercer fon élafticité. Recherches fur les caufes de cette propriété
de la fibre, par laquelle fes parties élémentaires fe
i¿parent par diftenfion les unes des autres, félon fa longueur ;
fans qu’il y ait folution de continuité. Tant que les forces
animales font entières dans le corps vivant, elles font dans
un état de diftenfion continuelle, dans un état violent, & ne
* parviennent jamais entièrement a 1 état qu elles affeélent. Ibid.
666. a. C ’cft cette tendance, cet effort continuel des fibres,
qui font les principaux moyens par lefqüels la vie fc maintient.
Raifons d’empêchement k cc que les fibres ne puiffent
le raccourcir autant que leur élafticité le comporterait. Ob-
ftaclc général au relâchement entier des fibrtfc La vie fcmble
dépendre d’uu perpétuel inéquilibre. De quelle maniere cet
inequilibre doit être entendu. Vibralité de la fibre: cette propriété
fera traitée dans les articles ou il s’agira du méchanifmc
de l’ouïe, voye[ S o n , Ou ïe , O r e i l le . Quant à l’irritabilité,
elle ne doit pas être confidéréc comme une propriété commune
à toutes lés fibres. Ibid. b.
Compofés des fibres. Deftinées à des aftions purement mécha-
niques, les fibres, parleur union différemment combinée ,
compofent des folidcs, des machines & des inftrumcns de
toute cfpcce. C e ft fous la forme de tuyau principalement,
que les fibres unies font employées à contenir les fluides,
qui cft l’ufagc le plus générai, commun à tous les organes,
à quelques fonélions qu’ils foient deftinés. Les anatomiftes
diftinguent quatre genres de vaiffeaux : les fccrétoircs, les
excrétoires, les artères Se les veines. De ces différens vaiffeaux
, il en eft qui échappent k la vu e , Se quelques-uns n’ont
été rendus fenfibles que par l’art des injeftions. Il cft reçu à
préfent que toutes les parties folides du corps font formées
d ’un tiffu de vaiffeaux. Quoique l’on ne foit pas parvenu à
connoître tous ces différens vaiffeaux, on ne finirait fc déterminer
à admettre que le décroiffcmcnt des vaifteaux aille
k l’infini. Ibid. 667. a. La tunique' du dernier vaiffeau qui
exifte ne doit donc pas être faite d’autres vaiffeaux : il exiftè
donc une fibre qui n’eft point vafculcufc , qui n’a point de
cavité ; telle cft la fibre élémentaire. De quelle maniere on
doit fe repréfenter cette compofition des parties, qui réfultc
de l’union différemment combinée des fibres fimplcs. Ibid. b.
Cette conftruftion , cette combinaifon ne peut être rendue
que par parties Se par opérations fucccflives ; mais la nature
je tte , pour ainfi dire , ion ouvrage au moule , & forme en
même tems toutes les parties de cet ouvrage , qui fe trouve
aüih parfait dans l’embryon que dans l'adulte. Méchanifmc
de l’accroiffcmcnt Se de la folidcfccnce de la fibre. Ibid. 668.
a. Comment les parties du corps tendent continuellement k
devenir plus folidcs & plus dures , jufqu’à fc dcffécher pref-
qu’cntiércmcnt. Cc qui conftitiie la caule,effcnticlle de la vie
Se l’entretient, tend de plus en plus k devenir la caufe de la
ccffation de la vie : vivere efi continuò rigefeere, difent les
anciens. Ibid. b. Ces effets ont lieu non feulement dans la
peau, les mufclcs , les tendons; mais encore dans les fub-
ftanccs les plus molles , qui ont été trouvées oflifiées dans des
vieillards. Quoique dans l’embryon les parties paroiffent toutes
également molles , les progrès dtf la folidité ne fe font
pas en même proportion dans toutes. Quelle cft la caufe k
laquelle il faut attribuer cette différence remarquable. Formation
des os. La folidcfccnce qui s’opère par le changement
des petits vaiffeaux en fibres compoiccs, ne peut être attribuée
qu’à l’inégalité de preffion des vaiffeaux cntr’cyx. Pourquoi
le cerveau conferve fa mollcffe dans tous les âges de là
vie. Ibid. 669. a. Différence des compofés de la fibre. On la divife
ordinairement en oueufc,en charnue, Seen nerveufe. Détails
fur les fibres offeufes ; leur difpofition, leur union, & le
grand nombre de fibres qui fe trouvent réunies dans le même
aggregai. Détails fur les fibres charnues ; leurs différentes
longueurs Se pofiftons; leur couleur. Détails fur la fibre nerveufe.
Ibid. b. Toutes les fibres font très-flexibles, prifes
féparément ; mais unies en maffe, elles différent à cet égard.
Les différentes efpeccs de fibres ne font qu’ un compofé de
F I B 719
fibres fimplcs, dont les parties élémentaires font toujours
les mêmes , & qui vraifcinblablement ont la même force
de cohéfion pour leur union , à la compofition de quelque
partie qu’elles puiffent être deftinées. Il exifte deux genres
de parties folides, dont les différences ne font que les cfpe-
ccs ; fa v o ir , des parties fimilaircs primitives, Se des parties
fécondaires , organiques , inflrumcntaires. Différences de
cohéfion dans les fibres primitives ; 8c d’organifmc Se dû
méchanifme dans les fibres fecondaircs , qui conftituent la
différence entre chaque claffe, chaque ordre , chaque eipcce ,
chaque individu, même parmi les animaux. Ibid. 6yo.a. Q uelle
eft la caufe de la différence de tempérament, de conftitu-
tion, de complexion particulière. Différence que quelques
auteurs établiffent entre le tempérament Se la conilitution.
Ouvrages qu’on peut confultcr fur la matière qui vient d-'être
traitée. Ibid. b. Voyc^ aufft les articles Foetus, Nutrition, Mufi
c le , Os.
Examen des changement auxquels les fibres font expo fées dans
l'état de léfion & de maladie. Deux cfpcces de léfions principales
dont les parties folidcs font fufccptiblcs ; la première
regarde les parties fimples ; la fécondé , les parties corn-
pofées. Les anciens n’ont prcfque point fait mention de la première.
Les méthodiques même n’ont rien dit des maladies
des fibres proprement dites. Ibid. b. Que les caufes des maladies
foient fenfibles ou non , les effets doivent toujours l’être
pour déterminer les médecins à s’y intéreffer. C e ft ce que
Galien a très-bien obfcrvé, même pour le fujet dont il s’agit.
Paffages de cet auteur. Une partie élémentaire n’éprouve
aucune altération dans fa fubftance, aucune maladie par con-
féquent. Il ne peut y avoir non plus aucune léfion dans les
parties qui' font immédiatement formées de ces corpufculcs
primitifs ;*c’eft-à-dirc, dans les fibres fimples, fi ce n’eft eu
égard à leur coilncxion. Ibid. 671. a. Il n’eft pas pofliblc de
donner une règle générale , par laquelle on puiffe déterminer
quel doit être le degré de cohéfion des parties élémentaires
de la fibre , pour qu’il foit le plus convenable à la fanté. Les
principaux vices de ces parties fimplcs, confident dans leur
laxitè 8e dans leur aflriélion. 11 n’eft pas pofliblc de juger dje
ces léfions des folides fimplcs, fans en confidérer les effets
dans les organes qui en font compofés. Les vaiffeaux des
parties fimplcs ne font point connus par les fens, ni même
ceux du iccond, du troificme ordre ; on n’apperçoit guère
?[uc ceux dit cinquième Se du fixieme. Ce qu on entend par
axité dans les fibres. Ibid. b. Le même vice qui fait cette
la xi té dans les fibres, fait âuïïï la laxité dans les parties com-
pofées de fibres. Caufe prochaine de cc relâchement. De co
Vice proviennent le défaut de reffort, la débilité , la molleffe
des parties qui font compofécs de fibres , 8c la facilité avec
laquelle peut s’opérer la folution de continuité dans les
fibres. La laxité ne peut qu’augmenter la flexibilité des fibres
, jufqu’à la rendre dcfeéhicufe, à proportion que ce
premier vice eft plus confidérablcment établi. Caufes qui
dilpofcnt à ces différens vices provenant de la laxité des
fibres. Ibid. 672. a. Effets qui en réfultcnt. Leur diverfité ,
félon les différentes fonctions des parties qui pechenr. Ibid. b.
Second genre des principaux vices qui affectent les fibres,
Yafiriflion. Caufes prochaines de l’aftriéHon des parties, tant
fimplcs que compofécs. L’aflriftion rend les parties du corps
humain trop élaftiques, trop peu diftraéliles , trop peu flexibles
, &c. enfortc qu’elles ne fc prêtent pas fufnlamment,
même au jeu ordinaire & le plus néccffairc des organes. Cau-
I fes qui difpofcnt aux différens vices provennns de l’aftric-
tion. Ibid. 673. a. Différens effets de c e genre de vice dans
les folidcs, lelon les différcntesspartics qui en font affe&ées.
A quoi il faut avoir égard pour juger de ces vices défignés
par les noms de laxité Se d'ajlriflion. On met mal-à-prop.os
dans pluficurs pathologics , la groffeur 8c l’exilité des fibres
contre nature, au nombre des défauts que les fibres fimpjes
peuvent avoir. Ce vice dans les fibres les plus compofées ,
peut être rapporté à l’aftriâion. On n’eft pas mieux fondé à
faire mention de la tenfion Se du relâchement exceflifs parmi
les vices des fibres fimples, comme le font Boerhaave Se
Ficn d’autres. Ibid. b. Indication dans le traitement qui regarde
la laxité. Moyens de fatisfaire à cette indication. Ibid. 674. a.
Seconde indication, celle qui regarde l’aftriâion. Comment
elle doit être remplie. Ibid. b. En général on doit plus infifter
fur le bon régime , que fur l’ufagc des drogues, auxquelles
on ne doit pas fc preffer de recourir. Différens ouvrages que
l’on peut confultcr par rapport aux traitemens de ces maladies.
Ibid. 67Ç. a. (
Fibre. Importance de cet article. Suppl. II. 34. b. Définition
de la fibre. Efpecc de fibre appcllée lame. La fibre animale
élémentaire eft invifiblc. Flexibilité des fibres. Toute fibre
cft élaftique Se contraéliblc à un certain degré. Cette dernière
propriété remarquable même dans la fibre morte, Ibid.
*e. a. Dans l’animal vivant, le froid, la terreur font des
fltmulus qui animent cette force. La fibre cellulaire moins
I contraélible que la mùfculairc. L’attraélion des démens parait
être le principal moteur de cette contraflion, Efpecc