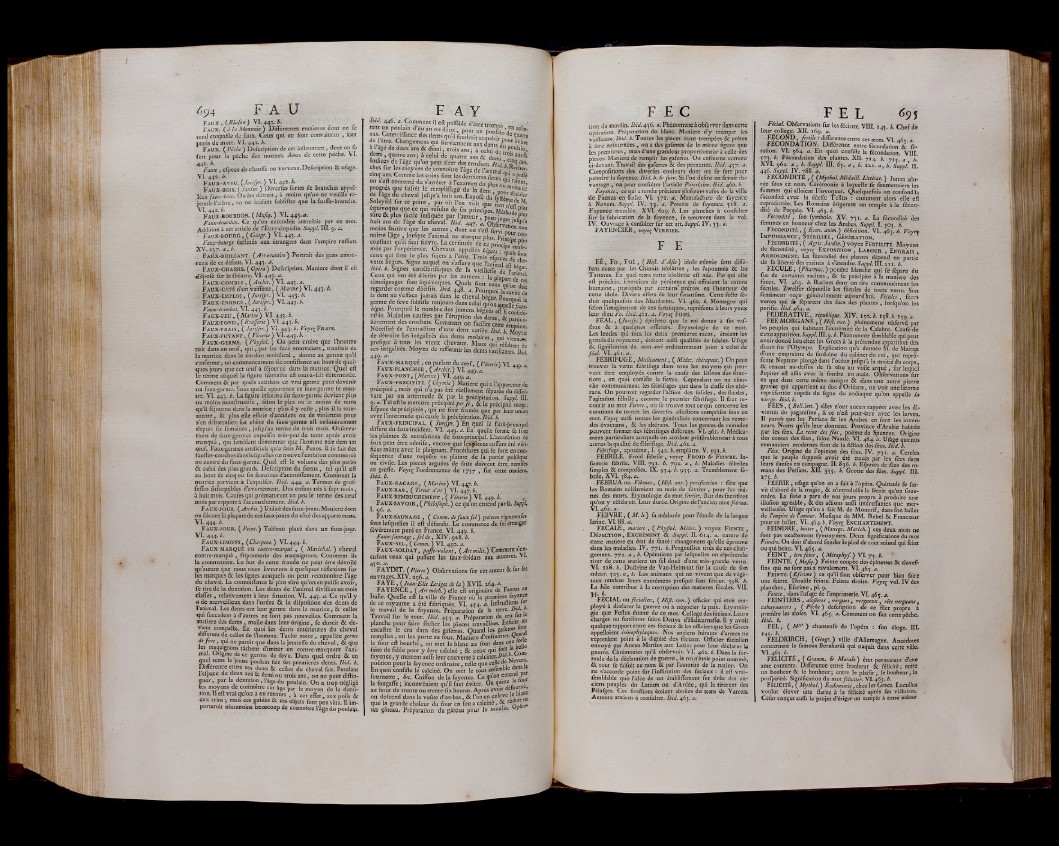
6 9 4 F.A U
F a u x , ( Blafon ) VI. 442. b.
F a u x . ( ù la Monnoie) Différentes maniérés dont on fe
rend coupable de faux. Ceux qui en font convaincus , font
punis de mort. VI. 442. b.
F a u x . (Pèche ) Defcription de cet infiniment, dont on le
fert pour la pêche des morues. Abus de cette pêche. VI.
Faux ï efpece de chauffe ou verveux. Defcription & ufage.
. VI. 442. b.
F a u x - a v e u . {Jurifpr.) V I .442.*.
Faux-bois. ( Jardin. ) Diverfes fortes de branches appelle
s faux-bois. On les détruit, à moins qu’on ne veuille rajeunir
l’arbre, en ne laidant fubfifter que la faufle-branche.
F a u x -b o u r d o n . (Mufiq. ) VI. 443.a.
Faux-bourdon. Ce qu’on entendait autrefois par ce mot.
Addition à cet article de l’Encyclopédie. Suppl. III. 9. a.
F à UX-b O U R G , ( Géogr. ) Vl. 443. a.
Faux-bourgs deftinés aux .étrangers dans l’empire ruffien.
XV. 237. a y b.
FaüX-brillant. {Artoratoire) Portrait des gens amoureux
de ce défaut. VI. 443. a.
E a u x - c h a s s i s . ( Optra ) Defcription. Maniéré dont il eft
(difpofé fur le théâtre. VI. 442. a.
F a u x - c o m b l e , {Archit. ) VI. 443. a.
F a u x - c ô t é d’un vaifleau, {Marine) VI. 443. b.
F a u x -e m p l o i , | Jurifpr. | v l. 443. b.
F A U X -É N O N C É , {Jurifpr.) VI.443.b.
Faux-e'tambot. VI. 443. b.
F a ÛX-FEÜ , {Marine) Ml. 443.b.
F A U X -F O N D , ( Brafferie) V I.443.b. g
F a u x -f r a i s , ( Jurifpr. ) VI. 443. b. V F r a i s .
F a u x -f u y a n t , ( Vénerie ) VI. 443. b.
F a u x - g e r m e . {Phyfiol.) Ou peut croire que l’homme
naît dans un oeuf, qui, par les -fucs nourriciers, tranfmis de
la matrice dans le cordon ombilical, donne au germe qu’il
renferme 3 un commencement de confiftance au bout de quelques
jours que cet oeuf a féjournê dans la matrice. Quel eft
le terme auquel la figure hùmaine eft tout-à-fJr déterminée.
Comment & par quels accidens ce vrai germe peut devenir
un faux-germe. Sous quelle apparence ce faux-germe fc montre.
VI. 443. b. La figuré informe du faux-germe devient plus
ou moins monftrueufc , félon le plus ou le moins de tems
qu’il féjournê dans la matrice : plus il y refte | plus il la tourmente
, & plus elle effuie d’accidens ou de violences pour
s’en débarralfer. La chute du faux-germe eft ordinairement
depuis fix femaines, jufqu’au terme de trois mois. Obfervations
de faux-germës expuifés très-peu de tems après avoir
manqué, qui femblent démontrer que l’homme naît dans un
oeuf. Faux-germes artificiels qu'a faits M.: Puzos. Il fe fait des
fauffes-couches dans lefquelles on trouve l’embrion commencé
au centré du faux-germe. Quel eft le volume des plus petits
& celui des plus grands. Defcription du foetus, tel qu’il eft
au bout de cinq ou fix femaines d’accroiftement. Comment la
matrice parvient à l’expulfer. Ibid. 444. a. Termes de grof-
fefles fulceptibles d’avortement. Des enfaus nés a fept mois,
à huit mois. Caufes qui prématurent un peu le terme des neuf
mois par rapport à l’accouchement. Ibid. b.
F a u x -j o u r . ( Archit. ) Utilité des faux-jours. Maniéré dont
on décore la plupart de ces faux-jours du côté des appartemens.
VI. 444. b.
F a u x - j o u r . ( Peint. ) Tableau placé dans un faux-jour.
VI- 444. b.
FA U X -L IM Ô N S , {Charpent.) V I .444.b.
F a u x -MARQU É ou contre-marqué , ( Maréchal:) cheval
-contre-marqué, friponnerie des maquignons. Comment ils
la commettent. Le but de cette fraude ne peut être dévoilé
qu’autant que nous nous livrerons à quelques réflexions fur
les marques 8c les fignes auxquels on peut reconnoître l’âge
du cheval. La connoiftance la plus sûre qu’on en puiffe avoir,
fe tire de la dentition. Les dents de l’animal divifées en trois
claffes , relativement à leur fituation. V I. 445. a. Ce qu’il y
a de merveilleux dans l’ordre & la difpofition des dents de
l’animal. Les dents ont leur germe dans la matrice, & celles
qui fuccedent à d’autres ne font pas nouvelles. Comment la
«natiere des dents, molle dans leur origine, fe durcit 8c devient
compacte. En quoi les dents antérieures du cheval
différent de celles de l’homme. Tache noire , appellée germe
de feve, qui ne paraît que dans la jeuneffe du cheval, 8c que
-les maquignons tâchent d’imiter en contre-marquant l’ani- «nql l ’| lr•i o■m . , —__ —_— UUIHIV.I vni l VVIIliV Him. iJ1U II■ IIk nI UIHmal.
s; Urigine de ce germe de feve. Dans quel ordre & en
quel tems le jeune poulain fait fes premières dents. Ibid. b.
hfférence entre ces dents &■ celles du cheval fait. Pendant 1 efpace de deux ans & demi ou trois ans, on ne peut diftin-
«lier, par la dennuon, l’âge du poulain. On a trop négligé
f e moyens de connoître cet âge par le moyen delà dlnîi-
tton. Il eft vrai qu on a eu recours , à cet effet, aux poils &
aux crins -, mais ces guides & ces obiers font peu sûrs. Il importerait
néanmoins beaucoup de connoître l’age du poulain.
E A Y
S g g S ÉS S i g f Éi * * ^
ans Connoiffance des dents qu'il faudrait aCquérir L I"11"
de:,1lêtre. Changement qui fumeraient aux dents £ T ‘
41 âge de deux ans & demi, trois ans : à celui ■ ■ !
demi, quatre ans; 4 celui de quatre ans & demi ? ans&
Indices de 1 âge qu'on peut tirer des crochets. * ¿ , 1 , “ #■
ches fur les moyens de connoître l'âge de l’animal * . ech»-
cinq ans. (pommé les coins font les dernières dents 2 • J
on s eft contenté de s'arrêter 4 l'examen du plus 02 "f’
progrès que faifotr le rempliffagé de la denr, pbiir S “ . ^
de lage du cheval ¡nlqu'à huit ans.Expofé
Soleylel fur ce point, par ou l’on voit que rien ¡ ¡ ¡ P Î1'
ejinvoqne que ce qui réfulre de fes principes. Méthod. Pf “
sûre
huit
moins fautive que les autres, dont on s’eft fervl 22?“ non
& plus facile indiquée par l'auteur , pour ¡UM?feff
ans de lage du cheval. Ibid. 447. a. ObfemU™1 *
noitre
confiant
!3ge , lorfque l’animal ne marque plus, P n 'K ? "
m qu’il faut fuivre. La certitude de ce princia? raPe'!
mee par l’expérience. Chevaux appellés tituts ■ ™.i !
ceux qui font le plus fujers à l’èrre. Trois efpecK 5? i
vaux bégurs. Signe auquel on s’aflure que l’animal .A u
M i. b. Signes caraébériftiques de la vieüeift de
Ceiix qui ont été décrits par les auteurs : la plunart H.
témoignages four équivoques. Quels font ceux ou'on A ?
regarder comme déciffis. lbii. 448. a. Pourquoi 1? cavité !
la dent ne s efface tamais dans le cheval béeut P0„ rn “ : i
germe de feve fubfifte toujours dans celui qu’on appelle W
| § g l ? " rV 01 i " ombre jumens béguës eftfi confidÎ
rable. Maladies caufées par l’éruption des dents, & narric».
fièrement des crochets. Comment on facilite cette
Néceflité de l’extrailion d’une dent carié, H i C
de détruire les inégalités des dents molaires, qui Vienne«*
preftjue | tous les vieux chevaux. Maux qui réfultent de
ces inégalités. Moyen de raffermir les dents vacillantes Ibid
449. a.
F a u x -m a r q u é , en parlant du cerf, { Vénerie) VI aaq a.
F a u x -p l a n c h e r , {Archit.) V I .449.a. ’
F a u x - p o n t , ( Marine ) VI. 449. a.
F a u x - p r e c i p i t é . ( Cnymie ) Matière qui a l’apparence du
précipité, mais qui n’a pas été réellement féparée du diffol-
vant par un intermede & par. la précipitation. Suppl. 1U.
9. Tel eft le mercure précipité perfe, & le précipité rouge;
Efpece de précipités, qui ne font formés que par leur union
avec l’intermede qui caufe la précipitation. Ibid. b. .
F a u x -p r i n c i p a l . ( Jurifpr. ) En quoi le faux-principal
différé du faux-incident. VI. 440. a. En quelle forme fe font
les plaintes 8c accufations de faux-principal. L’accufation de
faux peut être admife, encore que les^fcieces euffent été vérifiées
même avec le plaignant. Procédures qui fe font en con-
féquence d’une requête ou plainte de la partie publique
ou civile. Les pièces arguées de faux doivent être remifes
au greffe. Voyez l’ordonnance de 1737 , fur cette madere.
Ibid.b.
F a u x -R à C A G E , {Marine) VI. 447. b.
F a u x -r a s , ( Tireur d'or ) VI. 447. b.
F à UX-REMBUCHEMENT , ( Vénerie ) VI. 449. b.
F a u x -s a v o i r , ( Philofoph. ) ce qu on entend par-là. Suppl.
I. 96. a.
F.AUX -SÀUNAGE , ( Comm. defaux fe l) peines rigoureufes
fous lefquelles il eft défendu. Le commerce du fel étranger
févérement puni en France. VI. 449. b.
Faux-faunage y fe l de y XIV. 928. b.
F a u x - s e l , ( Comm. ) VL 430. a. t
F a u x -s o l d a t , paffe-volant, {Artmilit.) Comments’ex-
eufent ceux qui paftent les faux-foldats aux montres. VL
430. a.
FAYDIT. {Pierre) Obfervations fur cet auteur & fur fes
ouvrages. XIV. 296. a.
FA i £ , ( Jean-Elie Leriget de la) XVII. 264. *.
FAYENCE, ( Art méch. ) elle eft originaire de Faenza en
Italie. Quelle eft la ville de France où la première fayence
de ce royaume a été fabriquée. VI. 434. Inftruâions¡fur
le travail de la fayence. Préparation de la terre. Ibid. m
Travail fur le tour. Ibid. 433. a. Préparation du cru fur«
planche pour faire fécher les pièces travaillées. Enfuite1 on
einnrcaaâftfri*e le cmrui ddaînnes rdlensr gmaAfeutt.e«s.. Qn.umannrdl llpeCs gOalifCetttCt«S lWOH"
remplies, on les porte au four. Maniéré d’enfourner, {¿ua
le four eft bouché, on met le blanc au four dans une to
faite de fable pour y être calciné ; & ceux qui fonj « ®
fayence, y mettent aufli leur couverte à cdtiner./W-J '
pofition pour la fayence ordinaire, telle que celle de ne •
En quoi confifte le calciné. On met le tout enfembie
fournette , &c. Cuiflbn de la fayence. Ce qu’ou *nteJ1e £P r
la fougafte ; inconvénient qu’il faut éviter. On 1 ^
au bout de trente ou trente-fix heures. Après avoir dé 0 »
on defeend dans la voûte d’en-bas, & l’on en enlevé le
que la grande chaleur du four en feu a calciné, & re^*.
un gâteau. Préparation du gâteau pour le moulin. P
F E C
lion du moulin. Ibid. 436. a. Phénomène à obferver dans cette
•opération. Préparation du blanc. Maniéré d’y tremper les
vaifleaux. Ibid. b. Toutes les pièces étant trempées & prêtes
à être enfournées, on a des gafettes de la même figure que
les premières, mais d’une grandeur proportionnée à celle-des
pièces. Maniéré de remplir les gafettes. On enfourne comme
ci-devant. Travail des gafettes oc des pernettes. Ibid. 437. a.
Compofitiorts des diverfes couleurs dont on fe fert pour
peindre la fayence. Ibid. b. & fuiv. Si l’on defire en lavoir da*
vantage , on peut confulter l’article Porcelaine. Ibid. 460. b.
Fayence y ce qui a rendu précieux plufieurs vafes de là ville
rie Faenza en Italie. VI. 371. a. Manufaéhire de' fayence
à Nevcrs. 5tt/?/>/. IV. 33. a. Poterie dé fayence. 318. a.
Fayence trezalée. XVI. 609. b. Les planches à confulter
fur la fabrication de la fayence, fe trouvent dans le vol.
IV. Ouvrage à confulter fur cet art. Suppl. IV. 33. a.
FAYENCIER, voye^ V e r r i e r .
F E
FÉ, F o , FoÉ, {Uift’ d'Afie) idole cdorèe fous diffé-
fens noms par. les Chinois idolâtrés , les Japonnois & Iss
Tartares. En quel tems cette idolâtrie eft née. Par qui elle
eft prêchée. Exercices de pénitence qui effraient la nàttire
humaine, pratiqués par certains'prêtres en l’honneur de
cette idole. Divers effets de leur fanatifme. Cette fefte fé-
duit quelquefois des Mandarins. VI. 460. b. Montagne qui
félon l’imagination de ces fanatiques, repréfente à leurs yeux
leur dieu Fo. Ibid. 461. a. Voye[ FOH I .
FÉAL, {Jurifp.) épithete que le roi donne à fes vaf-
iàux & à. quelques officiers. Etymologie de ce mot.
Les leudes qui fous les deux premières races, étoient les
grands du royaume, étoient auffi qualifiés de fideles. Ufage
& lignification du mot amé ordinairement joint à celui de
féal. V’1.46z. tf.
FÉBRIFUGE, Médicament, ( Médec. thérapeul. ) On peut
trouver la vertu fébrifuge dans tous les moyens qui peuvent
être employés contre la caufe des léfions des fonctions
, en quoi confifte la fievre. Cependant on ne cherche
communément les fébrifuges que dans la claffe des alté-
rans. On pourrait regarder l’aaion des foüdes, des fluides,
l’agitation fébrile, comme le premier fébrifuge. Il faut recourir
au mot Fievre , où fe trouve tout ce qui concerne les
curations de toutes les diverfes affrétions comprifes fous ce
mot. Voyei auffi toutes les généralités concernant les reme-
des évacuans, & les altérans. Tous les genres de remedes
peuvent former des fébrifuges différens. VI. 46 z. b. Médica-.
mens particuliers auxquels on attribue préférablemeat à tous
autres la qualité de fébrifuge. Ibid. 462. a.
Fébrifuge y apozême, I. 342. b. emplâtre. V . 39z. b.
FÉBRILE. Froid fébrile, voyeç F r o i d 6» F i e v r e . In-
fomnie fébrile. VIII. 79z.' b. 792. a , b. Maladies fébriles
fimples & compofées. IX. 934. b. 933. a. Tremblement fébrile.
XVI. 384. tf.
FÉBRUA ou Fébruesy {Hifl. anc.) purification : fête que
les Romains célébraient au mois de février, pour les mânes
des morts. Etymologie du mot février. But desfacrifices
qu’on y célébroir. Leur durée. Origine de l’ancien mot februa.
VI.462.tf. pg . * m
FEBVRE y {M. le) fa méthode pour l’étude de la langue
latine. VI. 88. tf.
FECALE, matière y {Phyfiol. Médec.) voyez F i e n t e ,
D é j e c t i o n , E x c r é m e n t & Suppl. II. 614. a. nature de
cette matière en état de fanté : enangemens qu’elle éprouve
dans les maladies. IV. 771. b. Prognoftics tires de ces chan-
gemens. 772. a , b. Opérations par lefquelles on a*prétendu
tirer de cette matière tin fel doué d’une très-grande vertu.
VL 228. b. Doétrine de Van-Helmont fur la caufe de fon
odeur. 323. a, b. Les animaux qui ne vivent que de végétaux
rendent leurs excrèmens prefque fans féteur. 398. b.
La bile contribue à la corruption des matières fécales. VII.
35. b.
FÉCIAL ou fécialien, ( Hift. rom. ) officier qui étoit employé
à déclarer la guerre ou à négocier la paix. Etymologie
que Feftus donne de ce mot. College des féciaux. Leurs
charges ou fondions félon Denys d’Halicarnaflo. Il y avoit
quelque rapport entre ces féciaux & les officiers que les Grecs
appelloient érénophylaques. Nos anciens hérauts d’armes ne
répondent point à la dignité des féciaux. Officier fécialien
envoyé par Ancus Marrius aux Latins pour leur déclarer la
guerre. Cérémonies qu’il obfervoit. VI. 462. b. Dans la formule
de la déclaration de guerre, le roi n’étoit point nommé,
& tout fe faifoit au nom & par l’autorité de la nation. On
ne s’accorde point fur l’inftitution des féciaux : il eft vrai-
femblable que l’idée de cet ètabliffement fut tirée des anciens
peuples du Latium ou d’Ardée, qui la tirèrent des
Pélafges. Ces fondions étoient abolies du tems de Varron.
Auteurs anciens à confulter. Ibid. 463.a.
F E L 6 9 3
m a l Obfervatiom fur f e féciaux. VÜ1. 143. h. Chef de
leur collège. XII. 169. a.
entre VI. 46j . a.
FECONDATION. Différence entre fécondation & fé*
tation. VI. 364. tf. En quoi confifte la fécondation. VIII.
373. b. Fécondation des plantes. XII. 714. b. 71e a A.
XVI. 962. tf , b. Suppl. III. 63. tf, b. 22i. a, b. s'uppL IL
446. SupvL IV. 788. tf.
t- FÉCONDITÉ , ( {Mythol. Médaill. Littéral. ) Junon ado*
rée fous ce^ nom. Cérémonie à laquelle fe foumettoient les
femmes qui alloient l ’invoquer. Quelquefois on confond la
fécondité avec la déeffe Tcllus : comment alors elle eft
reprélentée. Les Romains érigerent un temple à la fécondité
de Poppée. VI. 463. b.
Fécondité, fon fymbole. XV. 73 t. a. La fécondité des
femmes en honneur chez les Arabes. Suppl. I. 303. b.
F é c o n d i t é , j( Econ. anim.) définition. V l , 463. b. Voyer
I m p u i s s a n c e , S t é r i l i t é , G é n é r a t i o n .
F é c o n d i t é , ( Agric. Jardin.) voyez F e r t i l i t é . Moyens
de fécondité, voyez E x p o s i t i o n , L a b o u r , E n g r a i s ,
A r r o s e m e n t . La fécondité des plantes dépend en partie
de la liberté des racines à s’étendre. Suppl. III. 211. b.
FECULE, {Pharmac. ) poudre blanche qui fe fépare du
fuc de certaines racines , & fe précipite à la maniéré des
feces. VI. '463 • b. Racines dont on tire communément les
fécules. Zwelfér dépouille les fécules de toute vertu. Son
fentiment reçu généralement aujourd'hui. Fécules, feces
vertes qui fe féparent des fucs des plantes, lorfqu’on les
purifie. Ibid. 464. tf.
FÉDÉRATIVE, république. XIV. 130.b. »58.b. tço.tf.
FÉE MORGANE , ( JTift. nat. ) phénomène obfervé pat
les peuples qui habitent ^extrémité de la Çalabre. Caufe de
cette apparition. Suppl. III. o. b. Phénomène femblable qui peut
avoir donné lieu chez les Grecs à la prétendue apparition des
dieux fur l’Olympe. Explication qu*a donnée M. de Mairap
d’une empreinte de fardoine du cabinet du roi, qui repréfente
Neptune plongé dans l’océan jufqu’à la moitié du corps,
& tenant au-deflùs de fa tête un voile arqué, fur lequel
Jupiter eft aflis avec la foudre en main. Obfervations fur
ce que dans cette même antique & dans une autre pierre
gravée qui appartient au duc d’Orléans, on voit une licorne
repréfentée auprès du figne du zodiaque qu'on appelle /tf
vierge. Ibid.b.
FÉES, {Bell.leu. ) elles n’ont aucun rapport avec les divinités
du paganifme, fi ce n’eft peut-être avec les larves.
Il paraît que les Perfans 8c les Arabes en font les inventeurs.
Noms qu’ils leur donnent. Province d’Arabie habitée
par les fées. La reine des fées, poëme de Spencer. Origine
des contes des fées, félon Naudé. VL 464. a. Uiàge que nos
romanciers modernes font de la fiétion des fées. Ibid.b.
Fées. Origine de l’opinion des fées. IV. 73 t. a. Cercles
que le peuple fuppofe avoir été tracés par les fées dans
leurs danfes en campagne. H. 836. b. Efpcces de fées des romans
des Perfans. Xli. 333. b. Grotte des fées. Suppl. III.
I 7 ! é É R I E , ufage qu’on en a fait à l’opéra. Quinault fe fer*
vit d’abord de la magie, 8c n’introduifit la féerie qu’en fous-
ordre. La férié a paru de nos jours propre à produire une
illufion agréable, & des aétions aufli intéreffantes que mer-
veilleufes. Ufage qu’en a fait M. de Moncrif, dans fon ballet
de Cempire de t amour. Mufique de MM. Rebel 8c Francoeur
pour ce ballet. VI. 464. A Voye^ E n c h a n t e m e n t .
FEINDRE, boiter , {Manège. Maréch.) ces deux mots ne
font pas exactement fynonymes. Deux lignifications du mot
Feindre. On doit d’abord fonder le pied de tout animal qui feint
ou qui boîte. VL 463. a.
FEINT , être feint y (Métaphyf) VI. 73. b. '
FEINTE. {Mufiq.) Feinte coupée desépinettes 8c davef-
fins qui ne font pas à ravalement. VI. 463. a.
F e in t e . ( Efcrime ) ce qu’il faut obferver pour bien faire
une feinte. Double feinte. Feinte droite. Voye^ vol. IV des
planches, Efcrime, pl. 9.
Feinte, dans l’ufage de l’imprimerie. VL 46ç. a.
FEINTIERS , alofieres , vergues , vergueux , rets verguans ,
cahuyautiers , { Pêche) defcription de ce filet propre à
preridre les alofes. VI. 463. a. Comment on fait cette pèche.
Ibid. b.
FEL, ( Mu* ) chanteufe de l’opéra : fon éloge. IIL
14?-
FELDKIRCH, {Géogr.) ville d’Allemagne. Anecdotes
concernant le fameux Bernnardi qui naquit dans cette ville.
VI. 46k. b.
FÉLICITÉ, ( Gramm. & Morale ) état permanent d’une
ame contente. Différence entre bonheur 8c félicité ; entre
un bonheur 8c le bonheur ; entre le plaifir, le bonheur, la
profpérité. Signification du mot féliciter. VI. 463. b. ■
FÉLICITÉ, {Mythol, ) Eudomonie, chez les Grecs. Lucullus
voulut élever une ftatue à la félicité après fes victoires.
Céfar conçut auffi le projet d’ériger un temple à cette même